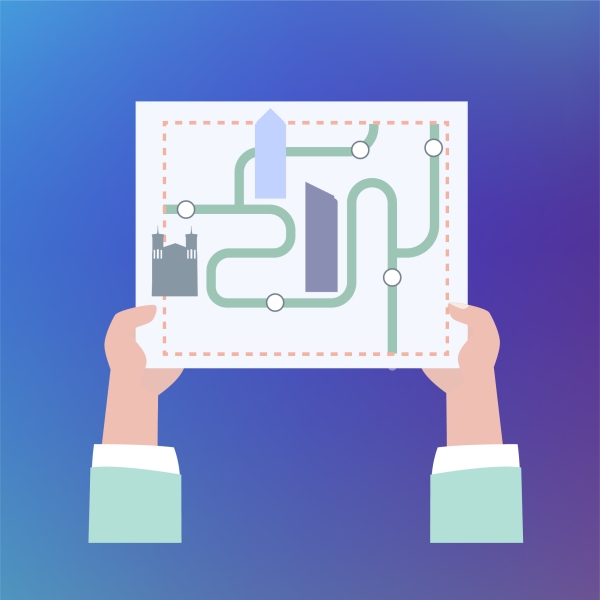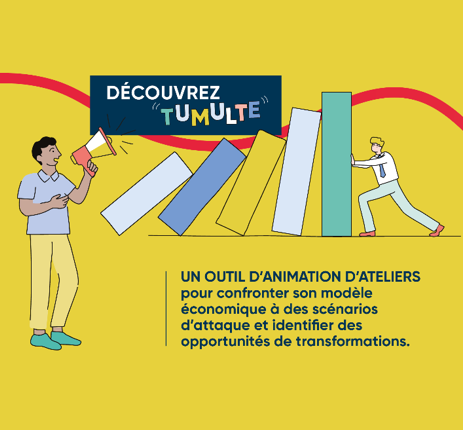Dans nos métiers, on distingue deux grandes fonctions. La première, c’est la prospection : aller chercher des entreprises pour qu’elles choisissent de s’implanter ici. La seconde, c’est l’accompagnement à l’implantation. C’est là que se joue une grande partie de notre valeur ajoutée.
Souvent, les projets que nous accompagnons sont conçus à l’échelle mondiale : une entreprise cherche un site, des débouchés, des ressources humaines ou foncières, parfois des financements. Mais ses objectifs ne sont pas nécessairement alignés avec les enjeux locaux. Notre rôle, c’est de faire en sorte que le projet s’adapte mieux au territoire — ce qui est aussi un avantage pour l’investisseur lui-même —, qu’il s’y ancre davantage et qu’il limite d’éventuels impacts négatifs.
Prenons le cas du foncier. Une entreprise arrive souvent avec un cahier des charges très précis : elle veut un terrain de tant de milliers de mètres carrés, parfois dans une localisation bien déterminée. Mais sur le territoire lyonnais, l’offre foncière est rare, morcelée, souvent contrainte par des enjeux écologiques ou sociaux. C’est un point de tension réel entre attractivité économique et sobriété foncière, et il faut savoir l’assumer.
Notre travail consiste alors à ouvrir d’autres possibilités : explorer des sites alternatifs, proposer des formes de réemploi de bâtiments industriels, ou des stratégies immobilières différentes, comme des baux évolutifs ou partagés. Parfois, on travaille aussi avec les entreprises pour revoir leur cahier des charges en fonction du foncier réellement disponible, plutôt que théorique.
Même logique sur l’emploi : on essaie de passer d’une logique de volume à une approche plus qualitative, en favorisant des recrutements plus inclusifs, qui s’appuient sur les ressources humaines réellement présentes sur le territoire. Dans ce genre de cas, on peut même mettre l’entreprise en relation avec la Maison métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMIE), afin de les aider à trouver des profils éloignés de l’emploi, mais correspondant réellement à leurs besoins.
Un exemple marquant, c’est celui d’une licorne française dans le domaine de la robotique qui cherchait des locaux, des clients, et surtout 150 développeurs à recruter en trois ans. Comme ces profils sont déjà très sollicités ici, nous leur avons proposé de diversifier leur stratégie de recrutement, en s’appuyant sur des viviers de talents issus des quartiers, ou formés dans des écoles de code comme Simplon. Ce n’est pas une solution miracle, mais cela permet d’élargir les perspectives, de réduire la pression locale, et de créer des opportunités pour des personnes éloignées de l’emploi.
Globalement, cet accompagnement que nous proposons dure entre six mois et un an, selon les projets. Ensuite, on passe le relais aux acteurs du territoire : la Métropole, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), les développeurs économiques, etc. On organise un rendez-vous d’ancrage pour assurer cette transition. C’est une logique de passage de témoin.
Nous restons dans notre périmètre : les implantations que l’on accompagne représentent 8 à 10 % de l’économie locale, selon une enquête Utopies menée il y a quelques années. Cela reste modeste, mais le déménagement est un moment stratégique, qui permet de faire évoluer des organisations, de réorienter leur trajectoire, parfois même de redéfinir leur raison d’être.