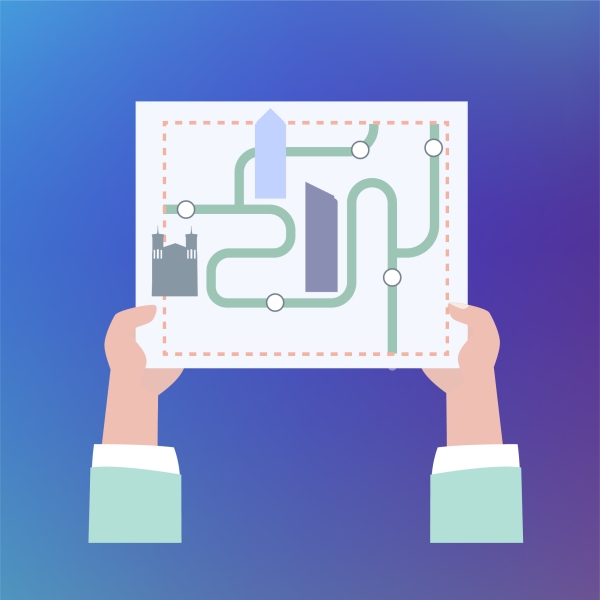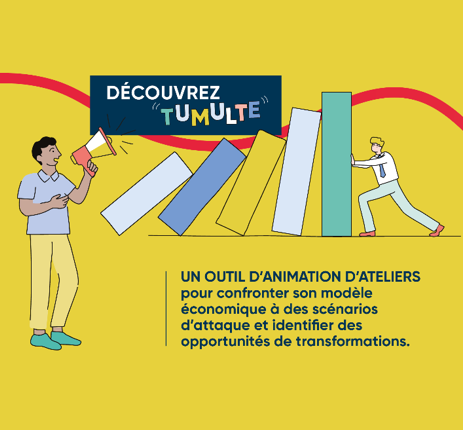En quelque sorte. Nous avons alimenté ce projet pendant plusieurs années par des interventions, des enquêtes informelles, etc. Nous avons même monté une formation en 2020 avec Emmanuel Bonnet, le master of science Stratégie & Design pour l’Anthropocène. Mais en France, on a beau « faire le travail », sans livre pour l’affirmer et l’afficher, il demeure difficile d’être pris au sérieux.
C’est d’ailleurs ainsi que j’ai été mis en relation avec mon éditeur, Divergences : suite à la lecture d’un de leurs ouvrages, j’ai contacté les auteurs, car, vu la proximité de certains thèmes abordés, je trouvais étonnant qu’ils ne cherchent pas à entamer un dialogue avec nous. Et ils m’ont très gentiment proposé de me mettre en relation avec Johan Badour, fondateur de cette maison d’édition.
L’objectif était de faire entendre un programme de recherche empirique dans l’espace intellectuel. De rendre audible ce qui, jusque-là, avait été traité sur un mode de quasi-performance alors que nous étions très sérieux et comprenions que les problématiques que nous évoquions allaient se généraliser. Le tout en évitant l’écueil d’une inflation rhétorique critique sans conséquences pratiques.
Il fallait également faire une place aux infrastructures, à la technique, et aux futurs obsolètes au moment où dominait une écologie du vivant qui ne ménageait guère de place à ces enjeux. Le projet est aussi né d’un sentiment d’inadéquation : on parlait de transition écologique comme d’un grand récit émancipateur, mais sur le terrain, on constatait des impasses, des fermetures de facto. Que faire quand un secteur, une infrastructure ou une activité n’est plus tenable écologiquement, mais se maintient par inertie ? Héritage et Fermeture répond à cette question en proposant une grammaire pour penser ces situations limites.
Il ne s’agissait pas d’ajouter une couche de diagnostic, mais de proposer un cadre opératoire, un ensemble de concepts et de protocoles — héritage, renoncement, attachement, protocoles de fermeture — qui permettent d’agir en connaissance de cause. Ce travail était lui-même en résonance avec les expérimentations concrètes menées dans des territoires, auprès des entreprises, etc., dans le cadre de la formation que nous avions créée.
Il a aussi ouvert un champ : celui de la redirection écologique, comme réponse aux limites planétaires non par le haut (la gouvernance globale), mais à partir des situations, de leurs prises, de leurs irréversibilités. Ce qui ne signifie pas qu’il faille abandonner les enjeux globaux ou géopolitiques par ailleurs !