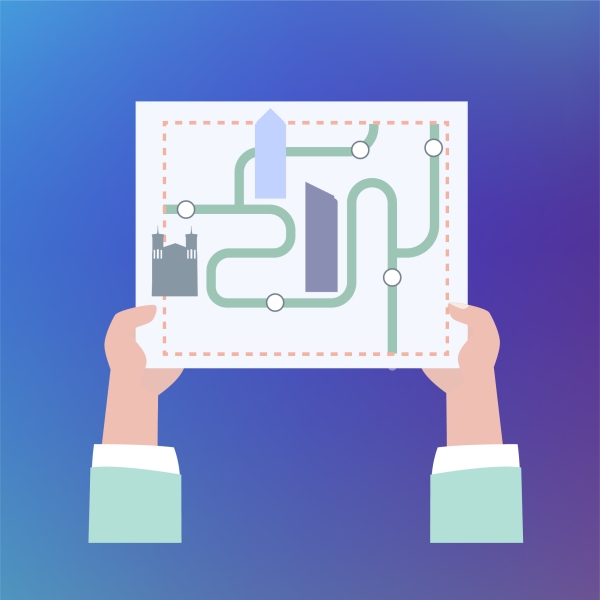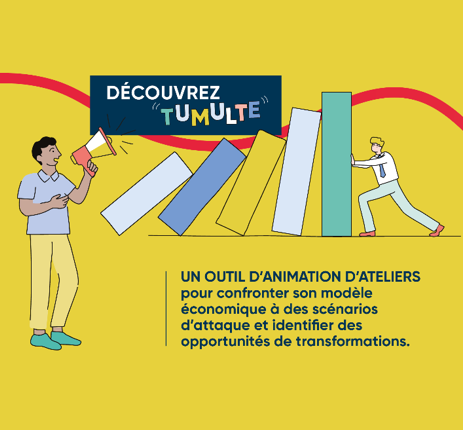La question du rôle des élus est, à mes yeux, absolument centrale. Nous vivons une période qui exige des choix, des arbitrages, des renoncements parfois. L’élu, en tant que dépositaire du mandat démocratique, porte cette responsabilité politique. Il ne s’agit pas simplement d’ajuster les politiques existantes : il faut redéfinir les finalités mêmes de l’action publique. Seul un engagement politique assumé peut porter cette transformation.
À l’ADGCF, nous sommes convaincus que les élus intercommunaux doivent trouver une position stratégique dans cette transition. Trop souvent, on a réduit leur rôle à celui de gestionnaires de services mutualisés, à la tête d’organisations techniques. Une intercommunalité, c’est un espace politique, un lieu où peut s’élaborer un projet de territoire à la hauteur des défis contemporains. Encore faut-il le revendiquer.
Ce projet ne peut plus se limiter à concilier un peu de développement économique, un peu de planification urbaine, et un peu de transition environnementale. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est un renversement de perspective : faire de la transformation écologique la matrice de toutes les politiques intercommunales. Comme le référentiel global plutôt que comme une surcouche. Cela suppose que les élus acceptent de revisiter les modèles qu’ils ont longtemps contribué à construire ou à défendre.
C’est une exigence lourde. Il y a beaucoup d’inertie, de résistances, y compris culturelles. Il y a aussi des attentes très fortes sur le terrain. Les habitants perçoivent les vulnérabilités qui s’accroissent. Ils attendent de leurs élus qu’ils prennent des décisions à la fois justes et durables. Cela passe par une forme de lucidité, de courage même, pour renoncer à certaines trajectoires et en ouvrir d’autres. Cette recherche d’équilibre me fait penser à l’une des maximes du temple de Delphes : « Rien de trop ». Elle nous rappelle qu’une politique territoriale soutenable suppose de poser des limites à nos propres ambitions. C’est exactement l’exercice auquel nous invite la transformation écologique.
La responsabilité des élus consiste à faire des choix dans l’intérêt général et à expliquer ces choix, à les assumer, à les inscrire dans le temps long. Cela suppose un nouveau rapport à la temporalité politique. On ne peut pas porter une transition de cette ampleur dans une logique de mandat à court terme. Il faut construire des récits partagés, capables de donner du sens à l’action collective, au-delà de la seule efficacité gestionnaire.
Il y a là un enjeu éthique très profond. Cette responsabilité est à la fois collective et singulière devant les générations futures, devant les habitants les plus exposés, devant les équilibres territoriaux fragiles. Elle ne peut pas être déléguée à des experts ni dissoute dans des logiques de gouvernance abstraite.
Concrètement, cela implique aussi de réinterroger les formes de gouvernance intercommunale. Les élus — tous les élus, pas seulement les maires — doivent pouvoir débattre, délibérer, arbitrer ensemble, sur des bases éclairées. Cela suppose du temps, de la confiance, des espaces de controverse. Il faut aussi veiller à une meilleure articulation entre les échelons : entre communes et intercommunalité, entre intercommunalités et régions, entre territoires et État. La transition ne pourra pas se faire en silos.
Enfin, je crois qu’il faut réenchanter la fonction d’élu local. Beaucoup s’épuisent, se découragent, parce qu’ils ont le sentiment de subir plus que d’agir. Restaurer leur capacité d’initiative, leur donner des marges de manœuvre réelles, les entourer de cadres compétents et motivés : c’est indispensable. La transformation ne se fera pas sans eux, elle ne se fera pas non plus à leurs dépens.
Ce que nous essayons de faire à l’ADGCF, avec d’autres partenaires comme France Villes et Territoires Durables, c’est justement d’accompagner cette prise de responsabilité. En proposant des outils, des méthodes, des espaces d’échange entre pairs. En aidant les élus à se poser les bonnes questions : que voulons-nous vraiment préserver ? Que sommes-nous prêts à changer ? Et comment rendre ces changements désirables, justes, soutenables ?
Cette voie suppose de faire confiance à l’intelligence des territoires, à leur capacité à inventer des chemins singuliers. Et de redonner toute sa portée à ce mot : responsabilité. Comme une opportunité de refonder le sens de l’action publique plutôt que comme une charge de plus.