Du dualisme entre nature et culture à une pensée du vivant

Article
Cet article appelle à s'extraire du dualisme nature/culture et donne à voir d'autres manières d'être au monde.
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Olivier Hamant
Olivier Hamant est biologiste, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), spécialiste des plantes.
Ses travaux le conduisent à des réflexions sur la manière dont les sociétés humaines peuvent faire face aux défis environnementaux et climatiques.
Il a publié en 2023 Antidote au culte de la performance, La robustesse du vivant (Galimard), où il constate que la performance est un objectif omniprésent dans l’action humaine, par contraste avec le vivant, qui mise avant tout sur la robustesse, construite contre la performance.
Sa thèse principale est que la recherche de la performance nous mène à une impasse, et qu’il nous faut viser la robustesse à tous les niveaux, une voie salutaire qui est aussi une manière de se réconcilier avec la nature.
Il vulgarise sa pensée par ses conférences, accessibles en ligne (La 3e voie du vivant, 2023).
Comment en êtes-vous venu à penser que des basculements sont indispensables pour préserver notre humanité ?
Un point de départ a été dans la prise de conscience que j’étais intoxiqué par la pensée de la performance, y compris dans l’interprétation des résultats de mes recherches. Dans mon laboratoire, une question s’est un jour posée : comment les plantes arrivent-elles à faire des fleurs qui ont la même forme ? J’étais parti de l’hypothèse que les plantes devaient contrôler la croissance des cellules pour faire des formes reproductibles, un peu comme quand vous montez des meubles Ikea.
Quand avec des collègues, nous avons commencé à analyser le phénomène, on s’est rendu compte que c’était le contraire : les cellules augmentaient l’hétérogénéité locale. On était déconcerté ! Comment est-il possible que cela débouche sur des formes reproductibles ? Le secret, c’est que quand on fait beaucoup d’hétérogénéité locale, ça génère beaucoup de conflits mécaniques, cela amplifie la quantité d’informations, ce qui permet aux formes d’être reproductibles. Tout a alors basculé dans ma tête, je me suis rendu compte que j’étais intoxiqué par l’idée de performance.
Si on regarde bien, autour de nous, tout est soumis à l’injonction de performance. La performance, et l’optimisation qui va avec, nous fragilisent. Je pourrais prendre d’innombrables exemples : les hôpitaux suroptimisés en tension permanente, l’épidémie de burn-out, etc. Et la performance a un coût, qui devient intenable. Ce coût, il est payé par les écosystèmes : effondrement de la biodiversité, pollution globale, réchauffement très rapide de la surface des océans, etc., c’est le produit de notre performance.
Et qu’imaginons-nous pour y remédier ? Encore plus de performance. En discutant de mes travaux avec certains spécialistes du développement durable, je me suis rendu compte qu’eux aussi étaient obnubilés par la performance. Ça ne marche pas, alors pourquoi continuer ? J’ai alors pris conscience que pour surmonter cette résistance, il fallait que je parle de la nécessité de faire cette bascule « performance vers robustesse » grâce au récit du vivant, qui est implacable.
Pourquoi la bascule performance/robustesse vous paraît-elle plus importante que d’autres ?
Quand on aborde la transition écologique, la plupart des solutions qu’on met en avant reposent sur la performance. L’agriculture de précision à base de drones pour réduire les pesticides, les éoliennes de plus en plus grandes, les panneaux solaires de plus en plus performants… Si on lit les rapports scientifiques (du GIEC, etc.), tous s’accordent sur la prédiction que le XXIᵉ siècle sera un siècle turbulent et fluctuant. À vrai dire, nous y sommes déjà : mégafeux, méga-inondations, remous sociaux, crises géopolitiques, pénuries de ressources…
La première question à se poser, c’est comment habiter dans un monde qui devient fluctuant. Les êtres vivants, cela fait des millions d’années qu’ils vivent dans un monde fluctuant. Qu’est-ce qui les rend capables de vivre dans un tel environnement ? La réponse, c’est d’abord la robustesse. Face à l’instabilité des ressources et des conditions, c’est la coopération et la robustesse qui dominent, et non la performance. Pour moi, c’est la première leçon à apprendre du vivant.
Un bon exemple est donné par la photosynthèse, dont le rendement énergétique est très peu élevé. Pourquoi existe-t-elle alors depuis des milliards d’années ? La réponse, c’est qu’elle permet aux organismes photosynthétiques, et donc aux plantes, de garder de grandes marges de manœuvre, pour gérer des fluctuations lumineuses et biologiques. Ce qu’on trouve chez les êtres vivants, c’est beaucoup de contre-performances : beaucoup de redondances, beaucoup d’incohérences, beaucoup de lenteur aussi. Ils ne misent pas sur la performance, ils font de la robustesse, pour maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ils sont robustes justement parce qu’ils ne sont pas performants.
Pouvez-vous définir les termes performance et robustesse, et ce qui différencie la performance de l’efficacité ?
La performance, c’est la somme de l’efficacité et de l’efficience. L’efficacité consiste à atteindre son objectif, et l’efficience à le faire avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. En gros, la performance revient à s’enfermer dans une voie étroite, c’est une forme de canalisation. Comme le dit l’adage zen, « celui qui a atteint son objectif a raté tous les autres ». La performance, c’est l’illusion de pouvoir tout contrôler. Par exemple, quand on se donne un objectif de performance sportive, on peut être amené à s’épuiser au-delà du raisonnable, à se blesser, voire à se doper.
La robustesse, c’est maintenir le système stable malgré les fluctuations, à court terme et à plus long terme. Cela implique d’avoir des plans B, de la redondance, une grande diversité d’options. C’est aussi l’expérimentation sans objectif (la recherche et l’innovation non dirigée). La robustesse est la seule réponse opérationnelle à un monde fluctuant. C’est l’adaptabilité pour pouvoir gérer des fluctuations, donc trouver des chemins de traverse, explorer, expérimenter, diversifier. C’est le contraire de la rigidité.
La robustesse, ce n’est pas non plus de l’agilité, qui revient à slalomer entre les risques. On est tellement intoxiqué par la performance qu’on a du mal à distinguer les choses. Parfois, on pensera choisir la solution performante (par exemple, choisir des panneaux solaires optimisés et performants), alors qu’on a fait de la robustesse (diversifier les sources d’énergie en ajoutant aux panneaux solaires, d’autres moyens si possible réparables par des collectifs locaux).
Pour le dire simplement, le monde de la robustesse est le contraire du monde de la performance. Dans le monde de la performance, on se focalise sur la réponse, alors que dans le monde de la robustesse, on questionne les questions. Dans le monde de la performance, on a besoin de personnes très spécialisées, avec la robustesse, on a besoin de généralistes, de polyvalence. On diversifie les activités, parce que se concentrer sur une seule activité, c’est beaucoup trop risqué. Le monde de la performance est le monde du zéro stock, le monde de la robustesse est un monde où l’on favorise les stocks.
La biodiversité est un indicateur de robustesse : dans une entreprise, s’il y a peu de biodiversité sur le site, cela veut dire que les effluents sont lâchés à l’extérieur. Si on a suffisamment de biodiversité, l’entreprise pourra gérer elle-même et éviter ses pollutions locales. La robustesse invite à mettre en place des solutions contre-intuitives.
Quand un client met la pression sur l’entreprise pour des délais de livraison encore plus courts, cela pose des problèmes. La solution, c’est allonger les délais, pour réduire les tensions et produire de la robustesse. C’est un peu la méthode japonaise, où il n’est pas poli de livrer en retard. Du coup, on annonce une livraison plus tard et avec assez de marges pour qu’elle soit totalement fiable.
La recherche de performance a quand même débouché sur des résultats incroyables (technologies, prospérité, etc.) sur une durée de quelques siècles. Pourquoi ce moteur est-il grippé ?
En fait, la performance marchait très bien tant que le monde était stable et abondant en ressources, tant qu’il y avait de nouvelles frontières à découvrir. Les êtres vivants recherchent la performance quand ils sont dans des niches écologiques où les ressources sont abondantes et le monde stable. Le parasite en est l’exemple typique : quand il rentre dans notre corps, il trouve des ressources abondantes et de la stabilité.
L’entrée dans l’Anthropocène marque l’entrée dans un monde très instable. On le voit aux événements climatiques extrêmes, les inondations à Dubaï récemment, les températures qui ont atteint 50 degrés dans l’Ouest canadien en 2021. On le voit aussi aux pénuries chroniques de ressources. Dans un monde instable sur tous les plans, social, géopolitique, climatique, faire de la performance revient à s’enfermer dans une voie étroite, c’est suicidaire.
Comment évaluer précisément si une solution est robuste ?
Avec les collègues de l’institut Michel Serres, on a proposé une méthode, qu’on appelle la santé commune. Il y a trois étapes. La première consiste à questionner les questions. En général, dans le monde de la performance, on répond vite à de mauvaises questions. La géo-ingénierie est l’exemple même d’une bonne réponse à une mauvaise question, puisqu’elle s’inscrit dans la recherche de méthodes pour réduire la quantité de CO₂ dans l’atmosphère — le symptôme et non la cause — alors que la question première est surtout celle du monde fluctuant.
Pour réinterroger la question, on peut la présenter à des gens qui n’ont rien à voir avec le sujet. Est-elle pertinente ? C’est un test de robustesse. Cela permet de déplacer la question jusqu’à arriver au cœur du sujet. Un processus lent, non performant, mais qui garantit que la question à traiter est la bonne. La deuxième étape, c’est de s’assurer que le projet alimente les trois santés : la santé des milieux naturels, la santé sociale, et la santé humaine. La santé des milieux naturels nourrit la santé sociale, la santé sociale nourrit la santé humaine. Et la dernière étape, la plus facile, est un stress test du projet.
Si par exemple, l’année prochaine, le pétrole est 50 % plus cher, ou si je perds les subventions publiques, si une catastrophe climatique advient, qu’est-ce que ça change à mon projet ? Si on passe le stress test, j’ai créé un modèle socio-économique robuste. Si ça ne passe pas, c’est qu’on a mal posé la question, il faut recommencer le cycle. De cette manière, on en arrive à construire des projets robustes.
Y a-t-il des penseurs de la robustesse ?
Oui, Elinor Ostrom a pensé le passage de la tragédie des communs énoncée par Garrett Hardin en 1968, à la gouvernance des biens communs, identifiant huit principes fondamentaux pour cela. C’est une pensée de la robustesse, même si elle n’utilise pas ce mot.
Robert Ulanowicz est un écologue et philosophe américain qui est aussi sur ce sujet. À partir de recherches sur la mesure de la biomasse dans les écosystèmes naturels, à un niveau macro, il a constaté que les systèmes totalement optimisés, comme les plantations de maïs, ne sont pas durables. La durabilité est maximale lorsque l’on trouve le bon équilibre entre l’efficience et la résilience, ce qu’il montre avec une courbe en cloche. Ses résultats peuvent être appliqués à de nombreux domaines. Plus tôt, dans les années 1960, la cybernétique et l’économie systémique ont été précurseurs.
Le couple performance-robustesse est-il le même, mais avec des mots différents, que le couple efficacité-résilience sur lequel on travaille habituellement, ou bien s’agit-il de choses différentes ?
Je ne parle pas de résilience, parce que ce mot est devenu polysémique et galvaudé. Pour les écologistes, c’est plus ou moins un synonyme de robustesse sur le temps long, avec l’idée de transformabilité qui peut être contenue dans la viabilité. Dans ce cadre, le couple performance — robustesse fait bien écho au couple efficacité — résilience. Pour les autres, la résilience ne signifie rien d’autre que la capacité à rebondir, et donc dans un monde néo-libéral drogué à la performance, c’est une injonction à tomber pour se renforcer.
Par exemple, la politique nationale de la résilience au Japon après Fukushima peut se résumer par cette phrase : « pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s’exposer ». La résilience, dans son acception psychologique généralisée au monde socio-économique, c’est une autre forme d’injonction à la performance mortifère. Face à ce constat, on pourrait donc dire que pour être résilient, et pour être sûr que ce n’est pas fatal, il faut d’abord être robuste. La robustesse acte le besoin de prendre des marges de manœuvre, et donc d’aller contre la performance, mais sans imposer de trajectoire de rebond comme le fait la résilience.
Cette bascule invite-t-elle à revoir notre relation à la nature ?
Pour moi, c’est une révolution culturelle. En schématisant, quand les humains ont inventé l’agriculture il y a 10 000 ans environ, ils ont cherché à contrôler la nature. Le dualisme nature-culture, qui revient à mettre la nature sous contrôle, apparaît à partir de là. C’est ce que dit Christophe Bonneuil, historien des sciences à l’EHESS.
On a toujours pensé que la nature était endormie et qu’il fallait la réveiller. Donc on l’a domestiquée, et on a « amélioré » les ressources végétales et animales que l’on peut en tirer. Le paradoxe, c’est qu’aujourd’hui, nos institutions sont endormies et que la nature se réveille vraiment, on le voit aux événements extrêmes. Nous sommes en train de quitter un fonctionnement basé sur la recherche combinée du contrôle et de la performance, qui s’est mis en place au Néolithique. Aujourd’hui, l’excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Donc il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Il est déjà trop tard pour espérer garder le contrôle sur la nature, le monde va fluctuer quoi qu’on fasse ; il tangue déjà beaucoup.
Qu’est-ce que cela implique pour les politiques publiques ?
C’est assez simple, demandons-nous si les solutions à mettre en œuvre sont robustes ou ne le sont pas, d’un point de vue socioécologique. À partir de là, on peut faire le tri. Je suis persuadé qu’on a accès à trop de solutions, et que trop de solutions contre-productives proviennent de l’ancien logiciel du culte de la performance. Par exemple, la géo-ingénierie et l’agroécologie. La première est coincée dans la performance étroite (qui ne voit que le CO₂ atmosphérique et ignore les causes sous-jacentes), alors que la seconde est systémique, considère les causes profondes, et est robuste.
Nous avons les réponses, nous savons quoi faire une fois le primat donné à la robustesse. Mais changer de paradigme est toujours un peu lent. Même les scientifiques ne font pas toujours ce tri. Il y a aussi de la confusion. Quand on mène des recherches pour avoir des plantes résistantes aux maladies, à la sécheresse, on pourrait penser que c’est une bonne idée, sauf qu’on soutient indirectement la monoculture, et qu’il faut au contraire diversifier.
Comment verriez-vous l’avenir d’ici 2100, si l’on continue sur la voie de la recherche de performance ?
On le voit, les performants deviennent ultra-performants et ultravisibles, c’est spectaculaire. C’est Elon Musk et son projet d’aller sur Mars, une planète morte, c’est Mark Zuckerberg qui fait construire un bunker à Hawaï, là aussi c’est aussi un projet de mort, un tombeau, c’est le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) qui projette une ville en plein milieu du désert en Arabie Saoudite, Neom. Les projets des ultra-performants sont mortifères.
Si on continue sur la performance, je le dis brutalement, c’est suicidaire. La performance donne des courbes en exponentielle, intenables dans la durée. Pour vous donner une bonne image, c’est comme le développement des cyanobactéries dans l’océan, ces microalgues qui peuvent se multiplier massivement quand les conditions environnementales leur sont favorables, quand elles trouvent des ressources (nitrates, phosphates, etc.) en abondance et qu’il fait chaud. Les bactéries entrent en mode performance/compétition, elles prolifèrent sur des surfaces énormes. Quand elles ont épuisé toutes les ressources disponibles, elles collapsent, d’un seul coup. Si on reste sur la voie de la performance, c’est très simple, ce sera un effondrement. À l’inverse, si on bascule dans la robustesse, on va beaucoup osciller, mais nous entrerons dans un monde viable.
Vous prenez pourtant vos distances par rapport aux théories de l’effondrement et à celle de la décroissance, évoquant d’autres options ?
Oui, je pense que les effondristes ou les collapsologues ont fait prendre conscience qu’on rentre dans quelque chose de dur. Mais l’effondrement ne crée pas de désir. La décroissance, c’est un peu le même problème. Le mot est mal choisi, parce que la décroissance est avant tout un programme politique (et non la récession), et c’est ensuite un mot négatif, qui ne va pas embarquer grand monde. Alors que le basculement de la performance à la robustesse, c’est une réalité observable. La robustesse répond par ailleurs à une pulsion humaine profonde, durer et transmettre.
À l’inverse, sauf pour les initiés, la décroissance et la sobriété renvoient à la nécessité de réduire, ce qui est loin d’être universel. Pour ne pas dépasser les limites planétaires, la sobriété est un bel objectif, mais une très mauvaise stratégie. Quand on commence par la sobriété, que se passe-t-il ? Les gens se braquent. Si vous êtes pauvre, accepterez-vous la nécessité de réduire ? J’espère que non ! Et pour les autres, réduire peut conduire à l’optimisation, à rechercher l’efficience énergétique par exemple, à construire des smart cities soi-disant frugales, mais qui génèrent de multiples effets rebond négatifs.
Par unité, une smart city consomme moins d’énergie, mais en les multipliant, on crée de nouveaux besoins et in fine, on consomme plus de ressources. Cette loi se vérifie pour tout, le charbon, le pétrole, les avions, les réfrigérateurs : quand vous pensez faire de la sobriété, souvent, vous allez consommer encore plus de ressources, indirectement.
Pour aller vers la sobriété, il faut donc passer par la robustesse. Si je veux rendre sobre l’ordinateur qui est en face de moi, je vais le rendre plus petit, avec des matériaux plus fins, plus légers, il sera sobre en matières, certes, mais bien plus fragile et donc jetable. Il consommera plus de ressources à la fin. Si je choisis la voie de la robustesse, mon ordinateur devra être intégralement réparable. Il utilisera bien plus de matière au départ, mais il pourra évoluer et s’adapter. Sa robustesse va générer de la sobriété à long terme.
Cette façon de penser la nécessité d’une bascule de la performance à la robustesse s’applique-t-elle à d’autres domaines, au travail par exemple ?
Bien sûr ! Dans les entreprises, la bascule de la performance à la robustesse se voit déjà. Un bon exemple, c’est le tout réparable. Pendant longtemps, on était plutôt dans la production de biens propriétaires, jetables finalement, à plus ou moins longue échéance. Les entreprises se posent maintenant la question du tout réparable. Les ateliers de réparation, c’est le marqueur d’une bascule de l’économie propriétaire vers l’économie de l’usage. Ce n’est pas du tout anti-technologique, c’est une autre façon de voir les choses, très pragmatique, cela dépasse même la question écologique.
Un autre exemple dans le monde du travail, c’est le salaire à vie ou revenu universel. En gros, dans le monde de la performance, c’est une méritocratie biaisée par la performance, la compétition, la soif de gagner toujours plus qui détermine le salaire. Avec la robustesse, on peut imaginer un monde où on a le même salaire au départ. L’hétérogénéité du salaire reflète d’abord le niveau de compétence et l’utilité sociale.
L’économiste et sociologue Bernard Friot a théorisé le salaire à vie, un revenu versé à chaque personne, irrévocable, qui augmente en fonction de la qualification personnelle. Comme ça libère du temps pour se poser la question du sens de son activité, de nombreuses tâches et activités pourraient disparaître. Un exemple parmi mille, on peut estimer qu’on a besoin de la mode, mais pas de la fast fashion.
Que reste-t-il de la compétition et de l’émulation ?
Nous avons besoin de systèmes robustes, qui n’interdisent pas le recours à la performance de manière exceptionnelle. Si je prends l’exemple du corps humain, la température est à 37 °C. S’il y a un pathogène, le corps monte en température, et à 40 °C, c’est contre-intuitif, notre système immunitaire est devenu très performant grâce à la fièvre, à condition que cela soit transitoire. Cela veut dire qu’à 37 °C, notre corps garde énormément de marge de manœuvre pour parer à une fluctuation imprévisible.
On peut appliquer cela à l’hôpital, auquel on a demandé d’être hyperperformant tout le temps, comme s’il était à 40 °C en permanence. Le personnel est en flux tendu, les soins sont mal faits et les professionnels quittent l’hôpital. Si l’on pense robustesse, l’hôpital a des marges de manœuvre, il y a suffisamment de lits, ce qui le rend davantage capable de répondre à une pandémie. Mais dans cet hôpital robuste, il y a des moments de performance, notamment quand des soignants interviennent pour les urgences. Cette bascule performance/robustesse invite donc à un rééquilibrage.
L’épidémie de Covid-19 l’a bien montré. Le SARS-CoV-2 est un virus respiratoire banal, ce qui ne l’était pas, c’était l’état des humains (obésité, diabète, stress, etc.) et les économies réalisées, notamment après la crise financière de 2008. L’hôpital était devenu moins robuste. Durant l’hiver 1969-1970, la grippe de Hong Kong a été la troisième plus grande pandémie grippale du XXe siècle, et on n’a pas confiné. Il y avait moins de déplacements en avion, les virus se diffusaient plus lentement, moins d’obésité, moins de diabète, moins de flux tendus à l’hôpital, etc.
Comment convaincre d’aller vers la robustesse ? Et comment passer d’un modèle économique à un autre ?
Les nuées d’étourneaux nous donnent une belle analogie du vivant pour rendre compte de la trajectoire du changement. On les voit tourner d’un seul coup à droite, et d’un seul coup à gauche. Qui décide de tourner ? Eh bien, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe. Les oiseaux au cœur de la nuée ne voient que leurs voisins oiseaux, ils sont aveugles au monde, alors que ceux qui sont à la périphérie sont sensibles aux fluctuations extérieures. Ils nous révèlent une règle toute simple : tout système bascule par ses marges, sa périphérie. Ce qui est vrai pour une nuée d’oiseaux l’est aussi pour les systèmes biologiques et pour les systèmes sociaux.
Dans l’histoire, de nombreux empires se sont effondrés parce que, à la marge, il s’est passé quelque chose. Si l’on veut capter les signaux faibles du monde qui vient, il faut regarder ce qui se passe à la périphérie. Et ce qu’on voit, c’est les petits paysans qui travaillent en agroécologie, c’est le tout réparable, c’est l’habitat participatif, des choses qui vont dans le sens de la robustesse, qui viennent de la périphérie et vont contaminer le centre, le faire basculer. On commence à voir cette contamination.
Dans l’agroécologie, l’illustration c’est KWS, un des grands semenciers jusque-là au cœur des logiques de monocultures, qui aujourd’hui vend des mélanges variétaux, premier degré de l’agroécologie. Ils ont été contaminés. Il est incroyable dans l’histoire humaine d’assister à ce genre de basculement. Il a lieu maintenant. Le basculement demande un nouveau rapport à la propriété, louer une voiture quand on en a besoin plutôt que l’acheter, utiliser la seconde main.
Quand on ne s’accroche pas à ces objets, on peut les faire circuler. C’est cela qui va changer le capitalisme. Cela demande aussi un travail de communication pour critiquer et ringardiser la performance, expliquer le monde turbulent, et expliquer que dans un monde fluctuant — c’est la première chose à retenir de tous les rapports scientifiques (GIEC et autres) —, les aléas climatiques vont augmenter, notre monde va tanguer très fort, et il est indispensable d’accroître nos marges de manœuvre.
J’étais à Verviers, en Belgique, une ville ravagée en 2021 par une énorme inondation. Ils sont partis du constat que ce genre d’événement allait se reproduire, ils ont travaillé en dialogue avec les citoyens et ils sont entrés dans la robustesse. Les entrepreneurs entendent très bien ce raisonnement également, parce qu’ils voient les fluctuations augmenter chaque année.
Faut-il brider la performance ?
Il faut avoir en tête que les systèmes robustes semblent bourrés d’incohérence. Le contrat social, ou le modèle de la démocratie libérale, c’est truffé d’incohérences. Mais en réalité, la contre-performance est au service de la robustesse.
La séparation des pouvoirs, c’est une contre-performance au service de la robustesse démocratique. Le secret des sources pour les journalistes, c’est contre-performant, mais sans cela le journalisme disparaît. Le secret médical, c’est une incohérence parce que pour soigner rapidement, il serait préférable de s’en affranchir, mais si on commence à employer les gens en fonction de leur profil médical, c’est très problématique. Les quotas de pêche, c’est de la robustesse, et ainsi de suite.
J’aurais tendance à penser que la dérive est venue après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 1950, on a débridé la performance comme jamais, sous l’influence de Friedrich Hayek, de Milton Friedman, de la pensée néo-libérale. Nous sommes allés trop loin dans l’excès de performance et on perçoit des aspirations à en sortir.
Le Tangping (littéralement, « rester allongé ») est un terme qui est apparu récemment chez de jeunes Chinois, en réaction aux excès de performance de leur modèle. On s’intéresse au Buen vivir, littéralement « bien vivre » en espagnol, un concept utilisé dans des régions d’Amérique du Sud, qui pose le principe d’une relation harmonieuse entre l’être humain et la nature. C’est de la robustesse.
Pensez-vous qu’en retrouvant de la robustesse, on puisse progresser en humanité, se réhumaniser en quelque sorte ?
J’aurais tendance à penser que se réhumaniser, cela revient d’abord à remettre l’accent sur les interactions. Dans la performance, on se canalise dans une voie étroite et on appauvrit les interactions, alors que dans un monde robuste, il y a abondance d’interactions. Je pense à l’essai de Stefano Boni, Homo confort (2022), qui explique comment le choix du confort nous a coûté nos relations au monde.
C’est peut-être pire que la déshumanisation, on s’est dé-sensualisé du monde, on ne supporte plus certaines odeurs, certains goûts, quelqu’un nous touche dans le métro, on va dire « Pardon ! ». Notre distance avec les interactions devient pathologique. Pour se réhumaniser, il faudrait multiplier les interactions avec les humains comme avec les non-humains. C’est le tissu social, c’est l’école du dehors, etc. C’est l’idée d’une symbiose des êtres vivants, cela résonne avec la robustesse.
Faut-il aller vers la robustesse en cherchant la justice sociale ?
Quand on bascule de la performance à la robustesse, on inverse tout, y compris le prix des objets, et c’est ainsi qu’on peut alimenter la justice sociale. Les aliments bio nous en donnent l’illustration. Il est anormal que dans les supermarchés, les aliments ultra-transformés soient moins chers que des aliments bio. Il faudrait que l’État légifère pour mettre en place un système de bonus-malus.
Les aliments bio produits par des paysans locaux devraient être très peu chers, parce qu’ils contribuent à la robustesse de tout le monde, des consommateurs, du système de santé, etc. Et les aliments ultra-transformés, qui coûtent extrêmement cher à la société, devraient être très taxés. Tout le monde aurait ainsi accès aux meilleurs aliments parce qu’ils seraient les plus accessibles. La même logique devrait s’appliquer aux objets réparables et aux objets les plus qualitatifs.
Que peut réaliser une métropole comme celle de Lyon pour aller vers la robustesse ?
Il est intéressant de regarder dans le passé et de voir comment le territoire a pu faire à la suite de grosses fluctuations. En 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, où se posaient des questions d’approvisionnement pour nourrir les gens, après un traumatisme, qu’a fait Édouard Herriot, le maire de Lyon ? Il fait acheter par la Ville des terres dans l’Ain pour sécuriser l’alimentation du territoire.
Aujourd’hui ces terres alimentent des crèches. Faire du stock, après un traumatisme, c’est de la robustesse. C’est pareil pour les Subsistances à Lyon, c’était un grenier à blé destiné à faire face aux épidémies. Pour les politiques locales, la robustesse peut passer par tout un ensemble de choses, par le lien au vivant, l’éducation, l’écologie, la santé commune, la formation de coopérateurs plutôt que des compétiteurs, le soutien au milieu associatif, qui est une formidable école de démocratie et de robustesse (dialogue, débat contradictoire, résolution des conflits, etc.), ou encore la mise en place de prix solidaires avec un système de bonus-malus.
La Métropole de Lyon est assez exemplaire, elle est bien placée pour faire cette bascule vers la robustesse. C’est comme l’image du nuage d’étourneaux : les lois nationales centralisées sont en retard sur le monde en basculement. Ce sont les territoires qui feront changer la loi nationale parce qu’ils sont au plus près des fluctuations. Dans le monde de la robustesse, le territoire n’est pas hors la loi, il est devant la loi.

Article
Cet article appelle à s'extraire du dualisme nature/culture et donne à voir d'autres manières d'être au monde.

Interview de Olivier Hamant
directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture (INRAE)
De la performance à la robustesse, les sociétés humaines peuvent-elles faire face aux défis environnementaux et climatiques ?

Article
Devenu omniprésent dans les débats politiques contemporains, l’universalisme serait à défendre, à abandonner ou à repenser.

Interview de Michel Desmurget
directeur de recherches en neurosciences à l'INSERM, à l'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod
Quand prendrons-nous au sérieux les effets massifs et systémiques des écrans sur la cognition, le langage, les interactions sociales et le fonctionnement démocratique ?

Interview de Nawel Bab-Hamed
Chargée d'études sociologiques, culture & modes de vie à l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise (UrbaLyon)
Comment pouvons-nous réactiver des mécanismes de ré-humanisation dans le cadre de nos politiques publiques ?

Article
Quel meilleur millésime pour soumettre les prophéties du passé à l’épreuve des faits ?

Interview de Thomas Perroud
Professeur de droit public
Le droit privé encadre désormais une large part de l’action publique, notamment par le biais des privatisations, d’externalisations et de nouvelles formes de contractualisation.

Article
Pour saisir ce que la présence du moustique révèle de nos manières de vivre et de gouverner le vivant, il est utile de se tourner vers les sciences sociales.
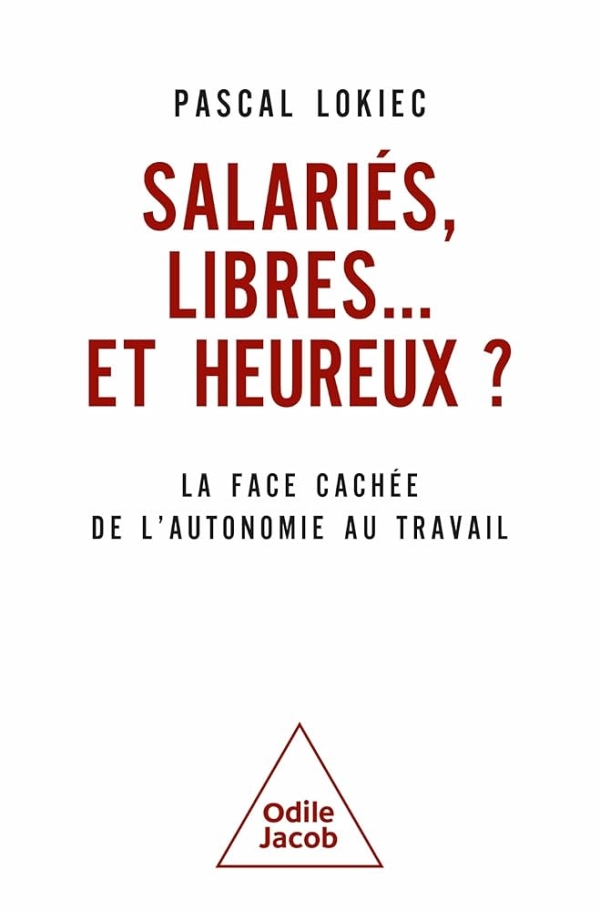
Article
Pascal Lokiec pose les termes d’un débat susceptible de concilier les intérêts de l’entreprise et le pouvoir d’agir des salariés.

Interview de Florian Fomperie
Directeur d’antenne de Radio Anthropocène
Une multitude de médias associatifs, locaux et citoyens pourrait-elle un jour constituer un rempart contre la désinformation et le manque d’indépendance des médias mainstream ?

Interview de Alain Eraly
Professeur de l’Université libre de Bruxelles (ULB), membre de l’Académie royale de Belgique
Partout, l’autorité est mise en cause.

Interview de Vincent Dubois
Professeur à l’Université de Strasbourg et membre du laboratoire SAGE
Retour sur le renforcement du contrôle et de la sanction des assistés sociaux depuis les années 1990, jusqu'à la mise en place d’une politique organisée du contrôle.

Article
À qui fait-on confiance ?

Interview de Olivier Aïm
Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, chercheur en théorie des médias et industries culturelles
Quelles sont les grandes évolutions en matière de surveillance ?