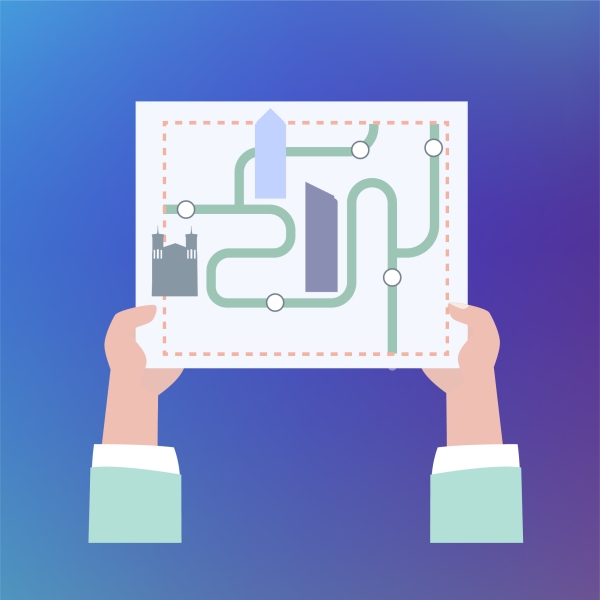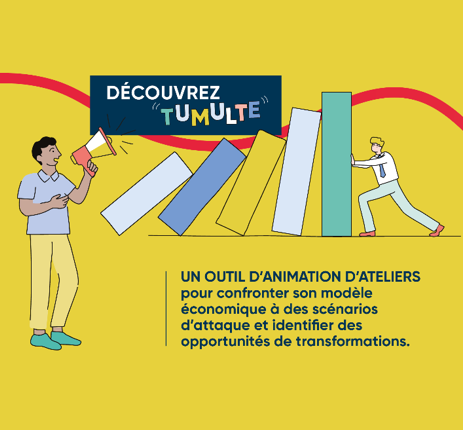Quand la transition économique devient réalité
À force d’être invoquée comme une nécessité écologique, la transformation de l’économie finit par devenir un horizon abstrait, coupé des réalités concrètes de celles et ceux qui produisent et emploient. Pourtant, au sein des territoires, des entreprises tentent déjà de bifurquer. Certaines relocalisent une partie de leur activité, d’autres réorientent leurs services vers des usages plus sobres, ou cherchent à réparer plutôt qu’innover.
Ces mouvements ne sont ni spectaculaires ni homogènes. Ils traduisent une volonté de faire autrement, en réponse à des tensions croissantes : pression écologique, vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement, attentes nouvelles des salariés et des clients.
Ces initiatives donnent à voir les dilemmes concrets de la transformation, au-delà des discours convenus sur l’exemplarité. En partant de quelques trajectoires d’entreprises engagées dans une forme de « redirection économique », cet article propose d’observer à hauteur d’acteurs ce que signifie changer de modèle productif dans un monde contraint. Il s’agit d’en tirer des enseignements pour penser, au niveau territorial, les conditions d’une transformation plus tangible et mieux située.
Cette redirection n’est pas réductible à la seule transition écologique, bien qu’elle intègre certaines de ses finalités. Elle engage aussi des enjeux sociaux, organisationnels et symboliques. Surtout, elle ouvre des controverses sur ce qui compte : ce qu’il est légitime de produire, de valoriser, de préserver ou d’abandonner.
Le territoire apparaît alors non seulement comme un cadre d’action, mais comme un espace d’expérimentation où s’opposent les critères de la valeur économique.
Des trajectoires d’entreprises qui sillonnent le territoire
Dans la métropole de Lyon, plusieurs entreprises ont entrepris ces dernières années de transformer leur modèle économique. Leurs motivations varient, mais une même intuition les traverse : les conditions dans lesquelles elles opèrent ne sont plus tenables à moyen terme.
Ce qui était traité comme une question de compétitivité ou de conformité réglementaire devient une inquiétude plus profonde : comment maintenir une activité viable sans aggraver les déséquilibres environnementaux, fragiliser davantage les ressources humaines, et s’enfermer dans une dépendance aux flux mondiaux ?
Par exemple, Tecofi, entreprise spécialisée dans la robinetterie industrielle, a décidé de relocaliser l’intégralité de sa production à Corbas alors qu’un certain nombre de composants sont encore fabriqués à l’étranger aujourd’hui. Ce choix, soutenu par la Métropole de Lyon, vise à renforcer sa souveraineté industrielle tout en créant des emplois et en améliorant la maîtrise environnementale de ses chaînes de fabrication.
Dans le secteur des cosmétiques, Karethic, basé à Lyon, adopte une démarche de production durable et zéro déchet. Elle propose des produits multifonctions sans emballage ou avec des contenants consignés, valorise l’ensemble de la plante de karité (jusqu’à la coque, utilisée comme gommage) et développe une filière équitable qui garantit un revenu complémentaire aux productrices.
Nexans, acteur majeur de la filière électrification, a engagé une transformation ambitieuse de son site lyonnais. L’entreprise a mis en place un centre de recyclage internalisé et un service innovant, CableLoop, qui permet de valoriser les déchets de câbles électriques en bons d’achat. Elle vise 30 % de cuivre recyclé dans sa production d’ici 2030, avec un investissement de 90 millions d’euros pour remanier son unité métallurgique.
Ces trajectoires diverses interrogent la viabilité économique d’entreprises qui prennent conscience de leur inscription dans un monde contraint. Pour rester viables sans renoncer à leurs engagements, elles doivent arbitrer entre des logiques souvent divergentes : rechercher la rentabilité, répondre à des exigences industrielles, préserver des relations de proximité ou contribuer à l’intérêt général.
Ces arbitrages ne sont pas uniquement techniques ou stratégiques. Ils mobilisent des conceptions différentes de ce qui compte et de ce qui mérite d’être défendu. Les dirigeants doivent ainsi composer avec ces registres de valeur hétérogènes, dans un équilibre instable qu’ils ajustent au fil du temps, au contact des parties prenantes et des ressources de leur territoire.
Dans le cadre de la sociologie des conventions, Luc Boltanski et Laurent Thévenot ont proposé de lire ces situations comme des « épreuves de justification » : des moments où les acteurs doivent rendre leurs choix acceptables aux yeux d’autrui en mobilisant des principes de légitimité. Dans le cas des entreprises engagées dans une forme de redirection économique, ces épreuves sont fréquentes. Il s’agit de faire tenir ensemble des conceptions parfois contradictoires de la réussite, de l’utilité ou de la valeur économique sans pouvoir toujours stabiliser un accord durable.
Comme le montrent Bousquet, Verstraete et Barbat, ces compromis entre registres de valeur ne relèvent pas seulement de réponses circonstancielles à des tensions locales. Ils participent à un processus plus large de construction d’un ancrage territorial, nourri par l’histoire des entreprises, la configuration des acteurs en présence et les ressources mobilisées dans la durée. Cet ancrage prend corps dans la manière dont les entreprises établissent des continuités, adaptent leurs pratiques et redéfinissent, progressivement, ce qu’elles considèrent comme viable, légitime ou désirable à l’échelle de leur territoire.
Exploiter les tensions plutôt que les craindre
À quelles conditions se transformer ? À quel rythme, avec quelles conséquences sur les emplois et les métiers ? Pour les entreprises, bifurquer vers des modèles plus sobres et plus territorialisés soulève des dilemmes concrets : réduire l’empreinte carbone sans fragiliser l’emploi, relocaliser sans désorganiser, écoconcevoir sans alourdir le coût du travail.
Dans le secteur public par exemple, l’abandon des pesticides a renforcé la pénibilité du travail des jardiniers, sans révision des moyens humains ou des outils mis à disposition. Plusieurs initiatives tentent d’ouvrir ces impensés. La démarche de « bifurcation RH » menée à la Ville de Grenoble propose d’écouter les agents pour en faire les acteurs d’une transformation progressive et ajustée.
Dans le même esprit, la CGT, via son partenariat avec l’association Pour un réveil écologique, a développé un « radar travail et environnement », afin de recueillir l’expertise des salariés sur leurs postes de travail et construire, à partir de cette connaissance empirique, des propositions de transformation écologique. Ce type d’initiative illustre une évolution syndicale qui conditionne la transition à une amélioration concrète des conditions de travail et du dialogue social.
Les tensions du travail peuvent ainsi devenir des points d’appui pour repenser l’activité, à condition d’en reconnaître la pluralité des engagements. Comme le montre Laurent Thévenot dans L’action au pluriel, les acteurs économiques n’agissent pas toujours à partir de justifications explicites ou de plans rationnels, mais naviguent entre différents régimes d’engagement : attachements familiers, logiques de projet, prises de position publiques.
Des entreprises s’engagent dans l’écoconception ou l’approvisionnement local, mais peinent à les généraliser, faute de filières, de débouchés ou de reconnaissance. D’autres affichent des ambitions fortes et rencontrent des incompatibilités entre leurs objectifs écologiques et les pressions économiques. Cette diversité des formes d’engagement, tantôt visibles, tantôt discrètes, mérite d’être rendue lisible à l’échelle des territoires et travaillée collectivement.
La Ruche industrielle, tiers-lieu installé au cœur de la Vallée de la chimie, met en commun des expériences et des ressources pour expérimenter autrement et développer des projets industriels à fort impact environnemental. Ce que la collectivité soutient ici relève d’une capacité à expliciter les arbitrages et à documenter les tâtonnements.
Dans cet esprit, certaines entreprises assument de renoncer à certains marchés pour se développer ailleurs, malgré des conflits d’intérêts internes ou des attachements forts à des pratiques historiques. Cette approche était présente dans les différentes promotions locales de la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC), qui vise à « rendre irrésistible la bascule de l’économie extractive vers l’économie régénérative » en créant des espaces de discussion où les dirigeants peuvent partager leurs questionnements.
Ce genre de posture, encore minoritaire, crée des effets d’entraînement, ouvrant la voie à une nouvelle manière de conduire le changement, mieux adaptée aux enjeux. Une stratégie de redirection se déploie ainsi avec cette capacité à composer avec les limites, à tenir compte des identités professionnelles et à naviguer dans l’incertitude sans s’y perdre.
L’économie territoriale comme espace de redéfinition de la valeur
La logique de redirection économique que nous venons d’esquisser dépasse l’adaptation technique ou réglementaire. Elle engage une redéfinition des critères de valeur, dans un contexte où les modèles dominants de croissance linéaire se muent en impasses.
Ainsi, l’économie circulaire, au-delà du recyclage, permet l’allongement de la durée d’usage des biens, la réutilisation de matériaux ou encore la vente de fonctions, déplaçant les critères de valeur, de la performance marchande vers la robustesse, la durabilité ou la proximité.
Les travaux de l’Institut national de l’Économie circulaire montrent que ces modèles permettent de réduire les externalités négatives (déchets, émissions, consommation de ressources), et de générer de nouvelles formes de compétitivité par l’innovation d’usage, la captation de valeur locale et la requalification des savoir-faire industriels.
À Villeurbanne, le site de Grand Plateau illustre bien cette recomposition. Ce tiers-lieu accueille des ateliers mutualisés où se croisent artisans, associations et entrepreneurs engagés dans la fabrication de vélos et autres véhicules de micro-mobilité.
En développant des microchaînes de production locale et en soutenant la mutualisation et l’échange, il propose une alternative à la filière industrielle classique. Il contribue à articuler économie et écologie autour de principes tels que la réversibilité, le réemploi, la contribution sociale ou encore la résilience face aux aléas. La « valeur » des véhicules produits devient fonction de leur adéquation à un usage, de leur capacité à être appropriés, transformés, entretenus puis remis en circulation.
Cette dynamique revient à construire des modèles économiques intégrant les contraintes écologiques dès leur conception. Elle demande un patient travail de coopération entre acteurs, une réévaluation des objectifs, par exemple entre performance économique et sobriété ou entre innovation technique et frugalité, jusqu’à mettre en débat les finalités de l’activité économique.
En reconnectant ces choix aux controverses locales, aux ressources disponibles et aux engagements que les acteurs sont prêts à assumer collectivement, la redéfinition de la valeur peut ainsi devenir un facteur de repolitisation des relations entre les entreprises et les autres composantes de la vie de la cité.
Politiser la redirection économique du territoire dans l’épaisseur des pratiques
La redirection économique d’un territoire prend forme là où se croisent contraintes de marché, dynamiques sociales, responsabilités écologiques et impératifs de viabilité. Les entreprises qui s’y engagent avancent à tâtons. Elles testent, ajustent, reviennent parfois en arrière. Cette démarche relève de l’expérimentation continue.
Cette capacité à transformer sans tout interrompre, à maintenir une activité tout en la réorientant, mobilise une forme d’imagination stratégique. Jérôme Tougne la décrit comme émergeant des tensions vécues, des attachements et des obstacles concrets. Elle rouvre des possibles en mobilisant des récits et des formes d’intelligence collective cultivées dans le territoire.
Observer ces bifurcations, c’est prendre la mesure de ce que signifie transformer une activité tout en maintenant sa pérennité. C’est aussi reconnaître que ces trajectoires accouchent d’autres façons de mesurer la valeur, la réussite ou l’utilité économique.
Pour certaines entreprises, « performer » signifie désormais maintenir des emplois qualifiés sur le territoire, malgré une baisse des volumes vendus. Pour d’autres, cela revient à structurer des filières locales à bas seuil de rentabilité, mais à haute valeur sociale ou environnementale. Dans les deux cas, la réussite se mesure moins à l’aune du chiffre d’affaires qu’à partir de l’agilité et la robustesse démontrée par une organisation connectée à son environnement immédiat.
Pour l’action publique, mieux comprendre ces situations permet d’accompagner des transitions souvent lentes et parfois fragiles, mais surtout de poser, en termes politiques et démocratiques, quelques questions souvent laissées de côté : que veut-on vraiment développer dans notre territoire ? Quels liens choisissons-nous de préserver ? Et de quelles dépendances devons-nous nous défaire ?
Le rôle des collectivités pourrait alors être de soutenir, mais également d’ouvrir des espaces de débat autour des critères de valeur et des tensions stratégiques, afin de relier les expériences là où les trajectoires semblent isolées. Autant de points d’entrée pour réinjecter du commun dans une redirection qui se joue encore dans les marges, en attendant de devenir la norme.