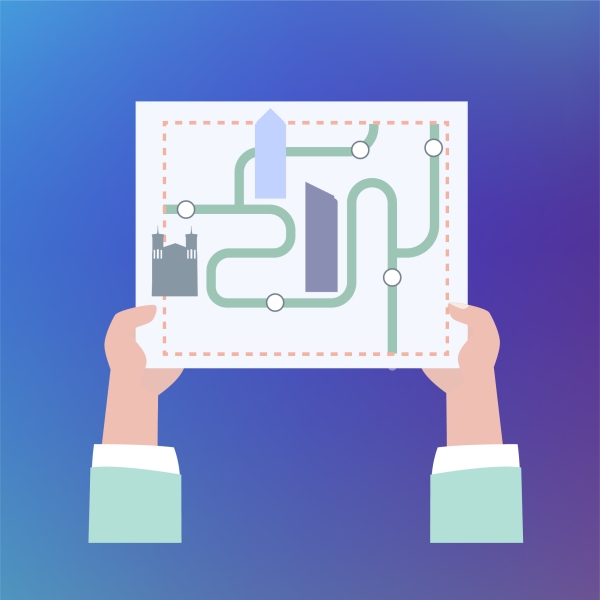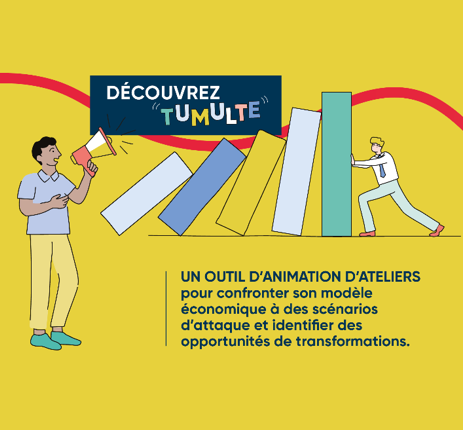Au-delà des bonnes intentions : partir du réel
Aucune stratégie économique ne part de rien. Elle s’inscrit dans un tissu déjà configuré, composé d’activités installées, de récits persistants et d’aménagements. Ces éléments façonnent les choix et les représentations de « ce qui compte ». À l’échelle d’un territoire, l’économie s’organise dans un cadre qui oriente ce qui est envisageable, soutenu ou simplement pensable. Ce cadre n’est pas qu’institutionnel, il est aussi spatial, relationnel, hérité.
Penser la transformation suppose donc un examen lucide de ce que produit le modèle en place : ses effets sur les usages du foncier, les formes d’emploi, ou la manière dont les ressources circulent et s’épuisent.
Plutôt que d’interroger ce que les entreprises doivent faire évoluer, cet article invite à regarder ce que le territoire leur fait. Comment l’environnement dans lequel elles opèrent les contraint, les oriente, parfois les enferme, et comment une stratégie de redirection pourrait consister non à ajouter de la nouveauté, mais à réorganiser les conditions d’apparition d’autres façons d’entreprendre.
Quand les héritages deviennent des verrous
Les politiques économiques locales s’inscrivent dans des récits et des aménagements consolidés au fil du temps. À l’échelle métropolitaine, ces héritages sont marqués par une certaine idée du développement : favoriser la compétitivité, attirer des entreprises, capter des flux. Cette orientation s’est traduite par des choix concrets d’infrastructures et de zonage, qui ont durablement structuré l’économie du territoire.
Ces choix ont permis de dynamiser certains secteurs et de consolider des bassins d’emploi, mais ils ont aussi généré des fragilités. La spécialisation de certaines zones, l’étalement des activités, la dépendance à des circuits logistiques étendus ont contribué à rigidifier l’organisation territoriale. Une partie de l’économie locale repose aujourd’hui sur des équilibres précaires, sensibles aux ruptures d’approvisionnement ou aux recompositions industrielles.
La Vallée de la chimie, au sud de la métropole lyonnaise, incarne cette ambivalence. Depuis des décennies, elle concentre une part importante de l’activité industrielle du territoire. Cette concentration continue de produire de la richesse monétaire, des emplois qualifiés et une puissance économique incontestable.
En parallèle, elle cultive aussi une forme de dépendance structurelle : les infrastructures y sont calibrées pour des flux industriels spécifiques, les usages du sol demeurent difficilement réversibles et les risques technologiques limitent fortement les évolutions. Ce n’est donc pas un simple « gisement d’opportunités » à réorienter, mais un agencement hérité, pesant, contraignant, mais vivant.
D’autres zones économiques connaissent des situations comparables, bien que moins visibles. Des zones d’activités périphériques pensées pour l’accessibilité poids lourds sont aujourd’hui enclavées. Le tissu économique local y est souvent fragmenté, les ressources peu mutualisées, les connexions urbaines faibles. Ces configurations sont le résultat d’un modèle où l’efficacité logistique prime sur l’ancrage territorial.
C’est dans cette tension que s’inscrit la stratégie de la Métropole pour la Vallée de la Chimie, qui cherche à articuler maintien de l’activité industrielle et transition progressive. À travers le dispositif Pacte pour l’Impact, elle mobilise les entreprises en faveur d’une transformation maîtrisée de la zone. Il ne s’agit plus d’attirer à tout prix, mais de composer avec les vulnérabilités, d’accompagner des adaptations parfois modestes, voire conflictuelles.
Réduction des émissions, sobriété foncière, relocalisation : ces objectifs peinent à transformer des structures pensées pour d’autres logiques. Cette inflexion rejoint les critiques récentes qui voient dans l’attractivité un mythe plus qu’un objectif débattu. Comme le note Jean-Michel Grossetti, cette notion s’est imposée dans les politiques publiques locales, alors qu’elle mériterait d’être interrogée pour ce qu’elle évacue : les coûts sociaux, l’empreinte écologique, les dépendances générées et les arbitrages implicites.
Ce décalage invite à relire la zone à la lumière des travaux d’Alexandre Monnin et en particulier de ses analyses sur les « communs négatifs ». Il propose de nommer « ruines » ces agencements hérités qui, bien que toujours actifs, pèsent sur notre capacité à changer le cours des choses.
Certaines ruines sont « ruineuses », toujours fonctionnelles, mais écologiquement ou socialement coûteuses. D’autres sont « ruinées », désaffectées, mais toujours présentes. Ces formes, actives ou latentes, continuent de structurer les usages et d’influencer les arbitrages. Elles ne sont ni des erreurs du passé ni des problèmes purement techniques : elles sont des objets collectifs, partagés malgré nous, qui imposent des formes d’entretien ou de démantèlement.
Une stratégie économique territoriale ne devrait pas être seulement pensée dans une logique de développement et d’attractivité mais aussi comme une gestion des héritages. Pour se transformer, un territoire doit apprendre à composer avec ce qui est, ici et maintenant. C’est dans cette ambivalence que se jouent, de manière concrète, les conditions d’une redirection économique pragmatique.
Comment les formes territoriales orientent les possibles
Les trajectoires possibles dépendent des structures dans lesquelles ces entreprises opèrent : localisation, régulation, circulation des ressources, organisation des filières. Le territoire, par sa configuration et ses institutions, agit comme un filtre. Il soutient certaines formes d’activité et en freine d’autres, parfois sans en avoir conscience.
Le secteur du bâtiment, largement mobilisé dans la perspective d’une massification de la rénovation énergétique, partage les objectifs des pouvoirs publics, alors que leurs conditions de mise en œuvre ne sont pas favorables : difficultés de recrutement, d’approvisionnement, et manquent d’espaces de stockage proches des chantiers.
Même lorsque des intentions de transformation émergent, elles se heurtent à une organisation fragmentée du secteur, pensée pour une logique de sous-traitance plutôt que pour des approches intégrées et coopératives.
Cette situation reflète une forme d’inadéquation entre les injonctions à la redirection et les milieux dans lesquels se trouvent les entreprises censées y répondre. L’outillage institutionnel reste largement tourné vers la création d’entreprise, le soutien à l’innovation technologique ou l’accompagnement de la demande (cf. service Écoréno’v de la Métropole de Lyon). Les entreprises qui ont besoin de faire évoluer leurs modèles économiques et organisationnels ne trouvent pas d’appui localement, de la part de collectivités ou d’autres structures.
L’enjeu devient de rendre visible un angle mort. Tant que le territoire reconduit des cadres conçus pour la performance immédiate, il limitera les expérimentations collectives de long terme. Tant qu’il valorise l’installation de nouveaux acteurs sans se soucier des conditions d’évolution de ceux déjà présents, il reproduira des formes de sélection implicites.
L’écart croissant entre les ambitions de transformation et les réalités territoriales alimente aujourd’hui des formes de rejet que les collectivités ne peuvent plus ignorer. Nicolas Rio et Manon Loisel décrivent ce phénomène à travers le concept de backlash écologique, ce retour de bâton que suscitent certaines politiques de transition lorsque leurs effets sont perçus comme injustes. Ces résistances sont portées par des habitants confrontés à des contraintes mal compensées (cf. Gilets jaunes), mais aussi par des entreprises locales fragilisées par des injonctions qui ne tiennent pas compte de leurs marges de manœuvre.
Le backlash social puise dans un sentiment d’injustice, une peur du déclassement et une défiance croissante envers les institutions. Le backlash économique se nourrit d’autres logiques : la pression concurrentielle, la financiarisation des entreprises, l’impératif de résultats immédiats qui rend difficile toute prise de risque ou investissement privilégiant la soutenabilité à la rentabilité.
Des groupes d’intérêt exploitent ces tensions en attisant les peurs, en déformant les mesures, et en accusant l’écologie d’être la cause des difficultés sociales. On passe ainsi d’un climatoscepticisme classique à une forme de green blaming, où la crise devient prétexte à disqualifier la transition.
Ces tensions révèlent, au fond, l’incapacité persistante à adapter les cadres territoriaux pour soutenir les transformations économiques attendues. Ce n’est donc peut-être pas la transition elle-même qui est rejetée, mais la manière dont elle est amenée.
Changer de posture : transformer les cadres plutôt que multiplier les incitations
Plusieurs propositions récentes invitent à sortir d’une logique d’accumulation d’incitations pour interroger plus radicalement les conditions d’existence des modèles économiques. C’est le cas du programme de recherche-action REBOND porté par la 27e Région, qui propose de déplacer l’attention vers les capacités locales d’agir, les formes d’entretien des ressources existantes, ou encore les attachements territoriaux souvent négligés.
Le programme Les Boucles, lancé par la Métropole de Lyon avec Ronalpia et Suez pour accompagner des entreprises circulaires et solidaires, éclaire cette transformation territorialisée. Ce programme vise à créer un environnement favorable à des modèles économiques plus sobres, en agissant sur les conditions d’existence même de ces entreprises : accès au foncier, mutualisation des ressources, animation de communautés d’acteurs.
Certaines structures comme Rebooteille ou Tizu ont pu bénéficier de lieux d’implantation temporaires, d’espaces partagés, ou encore de passerelles vers de nouveaux débouchés. Cette démarche révèle un déplacement stratégique : en assumant une fonction d’hospitalité, soutenir non pas des entreprises « exemplaires » en surplomb, mais des configurations collectives, révélatrices de nouvelles manières d’habiter l’économie.
Parfois, il faut aussi savoir organiser le retrait. Certaines activités, bien que légitimes en apparence, peuvent avoir des effets écologiques ou sociaux difficilement compatibles avec les limites du territoire. Au-delà des seules logiques du marché, leur disparition suppose un cadre de négociation et une capacité à élaborer des formes de sortie équitables.
Le rôle de la puissance publique retrouve ici toute sa portée : transformer les conditions, c’est déplacer le centre de gravité de l’action économique. Il ne s’agit plus seulement d’accompagner les acteurs les mieux dotés ou les plus structurés, mais de soutenir des initiatives dont les modèles restent marginaux, freinés par des obstacles institutionnels, logistiques ou économiques, qui peinent à trouver leur place dans les dispositifs de développement.
Faire stratégie : rediriger les équilibres territoriaux
Rediriger une économie demande de revoir les équilibres qui soutiennent certaines pratiques, et empêchent d’autres. Le territoire conditionne les ressources disponibles, les relations possibles, la place accordée à la durée ou à l’expérimentation.
La puissance publique peut agir sur ce que l’on fait tenir ensemble : les formes d’organisation, les récits de légitimité, les conditions de soutien ou de retrait. Ce travail devient possible à condition d’une lecture précise des trajectoires, associée à une capacité à ajuster les dispositifs, une attention portée aux transitions discrètes comme aux conflits ouverts.
Cette stratégie n’a de portée que si nous acceptons de questionner les fondements de notre propre action économique. Sommes-nous capables de voir ce que nos territoires produisent vraiment, non seulement en termes d’emplois ou de flux, mais aussi d’usure et d’inertie ? Sommes-nous prêts à revisiter ce que nous soutenons activement, ce que nous tolérons par habitude, ce que nous empêchons sans le dire ? Il ne s’agit pas de trouver des réponses définitives, mais d’ouvrir un débat sur ce que signifie rendre une économie soutenable.
Le territoire joue ici un rôle décisif. Il fait tenir ensemble des ressources, des infrastructures, des savoirs situés, mais aussi des inerties, des attachements, des blocages. Il produit des effets de seuil, de friction, parfois de cécité. C’est dans cette matérialité dense que s’inscrit toute tentative de transformation.