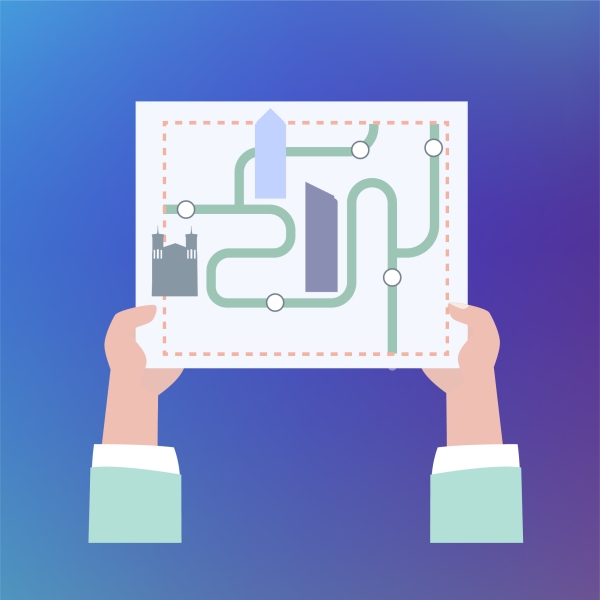Le financement de la transition écologique occupe désormais une place centrale dans les débats économiques et politiques. Mais derrière le mot fourre-tout « transition » se cache un impensé majeur : celui du renoncement.
Renoncer à certaines infrastructures, à des modèles économiques, à des fonctions ou à des usages devenus insoutenables ne relève pas simplement d’une transformation technique ou d’une amélioration de l’existant. Cela implique des gestes de retrait, des démantèlements, des reconversions — en un mot, des bifurcations rarement compatibles avec les logiques économiques dominantes.
À travers trois registres complémentaires — les propositions théoriques, les imaginaires de la science-fiction et les innovations des politiques publiques locales, nous proposons ici une exploration des conditions de possibilité du financement du renoncement. Loin d’un retrait passif ou d’une gestion de la pénurie, il s’agit d’un projet politique actif, fondé sur la soutenabilité, la justice et le soin.
Une redirection lucide, assumée, planifiée.
1. Une inversion critique de la valeur
« Il faut sauver le capitalisme de lui-même », entend-on fréquemment. Ce mot d’ordre, typique d’une approche réformatrice, cherche à infléchir les logiques existantes sans les remettre en cause. Mais une autre voix s’élève depuis plusieurs années : celle de la critique située des infrastructures mêmes de l’économie — de ses indicateurs, ses grilles comptables, ses conventions de valeur.
Dans ce cadre, la question du retrait et de la non-valorisation prend une place croissante. Si l’économie s’est construite historiquement sur l’extension des marchés et la croissance des flux, comment penser une économie du moins ? Faut-il en inventer une autre, ou détourner celle que nous avons déjà ? La perspective de la redirection écologique invite à explorer cette tension : que peut-on faire avec les instruments existants pour désarmer les activités non soutenables ?
Les travaux de think tanks comme l’Institut Rousseau ou d’économistes comme Daniela Gabor ont attiré l’attention sur la place systémique de la finance dans la perpétuation du « régime fossile ». Les actifs à risque (actifs fossiles, infrastructures carbonées) y sont désignés comme les « nouveaux subprimes » : dangereux non seulement par leur contenu, mais par la chaîne de garanties publiques (banques centrales, régulateurs), qui les maintient artificiellement à flot.
Dès 2021, des propositions visant à planifier leur dévalorisation, voire à organiser leur rachat public conditionné à leur fermeture, ont émergé — la députée européenne Marie Toussaint a d’ailleurs proposé une reprise en main des entreprises fossiles sur ce modèle durant la dernière campagne européenne. Il s’agit là d’une vision stratégique du déséquipement, assumant une forme de pilotage public du déclin dans les secteurs à fort impact.
D’autres propositions critiques viennent du champ de la monnaie et de la finance publique. Benjamin Lemoine, dans La démocratie disciplinée par la dette (2022), montre comment l’autonomie budgétaire de l’État a été progressivement soumise aux règles du marché, sous l’effet d’un récit performatif de la contrainte financière. Cette mise en marché de la dette publique rend quasi impensable une dépense sans contrepartie productive immédiate.
Pourtant, une lecture alternative, issue de la tradition chartaliste et de la théorie monétaire moderne (MMT, modern monetary theory), permettrait de concevoir l’émission monétaire comme un instrument de pilotage écologique : finançant, non la croissance, mais la soutenabilité. Lemoine invite ainsi à se réapproprier collectivement la puissance monétaire pour ouvrir un débat sur ses usages légitimes — parmi lesquels, justement, le retrait d’activités néfastes ou l’entretien de ce qui n’est plus rentable, mais reste vital.
Déstabiliser pour mieux reconstruire
Plus récemment, dans Comment bifurquer (2024), Cédric Durand et Razmig Keucheyan insistent sur la nécessité de réorienter le crédit et la politique monétaire au service de la transformation écologique portée par un « État socialisateur ». Cette logique rejoint celle défendue par Jézabel Couppey-Soubeyran, qui propose de sortir la politique monétaire de la « cage de fer » de la stabilité des prix pour la soumettre à des objectifs d’intérêt général : climat, justice, santé, soutenabilité.
Ces auteurs ne parlent pas explicitement de « renoncement », mais leurs propositions ouvrent la voie à des instruments de monnaie affectée, dédiés à des fonctions non marchandes : démantèlement, retrait, réparation, soin. Ces circuits, publics ou semi-publics, permettraient de financer les coûts du retrait en dehors des logiques de rentabilité, et d’assumer collectivement l’entretien des conditions d’habitabilité. Le financement du renoncement devient alors moins une anomalie qu’une modalité normale de l’action publique redirigée.
Enfin, les débats autour de la comptabilité ont connu un tournant décisif avec les travaux de Rambaud & Richard (modèle CARE ou Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) ou de Feger & Mermet (CEC ou comptabilité écosystème-centrée). Le modèle CARE, en particulier, propose d’auditer l’engagement à préserver ou à ne pas nuire, sans passer par la monétarisation. C’est une révolution silencieuse : en refusant de réduire la valeur à une équivalence marchande, on peut rendre visibles d’autres types de contributions — et donc envisager leur financement. Ces grilles permettent de reconnaître le travail du retrait : celui qui consiste à maintenir, à déséquiper, à désinvestir, à accompagner la sortie.
Or, reconnaître ce travail, c’est le rendre finançable. Encore faut-il pouvoir le comptabiliser. Si l’on veut financer la soustraction, il faut des outils capables de rendre visible le non-fait : ce qui a été évité, interrompu, désamorcé. Des modèles comme CARE ou CEC ouvrent la voie, mais bien d’autres indicateurs restent à inventer : une cartographie des renoncements, des bilans de non-développement, des indicateurs d’effacement maîtrisé. Il s’agit moins d’objectiver que de reconnaître, qualifier et « valuer » — pour que l’absence devienne elle aussi objet de politique publique.
L’enjeu est donc moins de « verdir » l’économie existante que de déstabiliser ses axiomes fondamentaux, en particulier ceux qui relient valeur, croissance et activité. Financer le renoncement, c’est commencer à construire une autre économie politique — non pas celle de la perte, mais celle de la redirection.
2. Imaginer autrement : la science–fiction comme laboratoire du renoncement
Toutes les propositions institutionnelles évoquées jusqu’ici — qu’elles viennent de think tanks, de collectivités pionnières ou d’expérimentations locales — posent une même question : comment rendre pensables, puis finançables, des trajectoires de retrait assumées ? C’est ici que la science-fiction, souvent reléguée à la marge des réflexions économiques ou politiques, peut jouer un rôle décisif. On songe moins ici à mobiliser des utopies éthérées. C’est plutôt sa capacité à mettre en scène les contraintes du réel qui nous intéresse, en testant, sous forme narrative, des hypothèses institutionnelles ou des bifurcations systémiques.
Le roman The Ministry for the Future de Kim Stanley Robinson en fournit un exemple paradigmatique. Loin d’une simple projection dystopique, ce texte constitue un véritable laboratoire fictionnel de redirection écologique. Son intrigue repose d’ailleurs en partie sur une idée empruntée à un article de sciences économiques, rédigé par Delton B. Chen, Joel Van der Beek et Jonathan Cloud, et présentant un mécanisme de Carbon Quantitative Easing (C–QE).
Ce mécanisme monétaire d’« assouplissement quantitatif » (l’injection de liquidités sur les marchés financiers pour soutenir l’économie), inspiré de politiques déjà connues des banques centrales (comme le QE post–crise de 2008), serait redirigé pour soutenir financièrement le retrait carbone. Le C–QE repose en effet sur la création d’une monnaie carbone supranationale, émise par une autorité indépendante, destinée à rémunérer les actions de réduction ou de séquestration du CO₂ : reforestation, conservation, maintien de la ressource pétrolière dans le sous-sol, etc..
Contrairement aux marchés du carbone existants, le C–QE propose une politique monétaire orientée vers la stabilisation climatique, injectant de la liquidité non par le crédit productif, mais en finançant directement les contributions à l’habitabilité. Ce système vise à instaurer un mécanisme de redistribution climatique non spéculatif, en soutien à une économie du retrait. Il ne s’agit pas ici de compenser des émissions futures, mais de créer une monnaie verte adossée à des actions concrètes de déséquipement, de renoncement, de conservation ou de restauration écologique, opérées par des États, des collectivités ou des communautés.
En intégrant cette proposition à un récit global mêlant crise climatique, gouvernance mondiale, géopolitique, mobilisations sociales et diplomatie climatique, Robinson déplace le regard : l’économie n’est plus un cadre à contourner ou à assainir, c’est un système à rediriger activement. Son roman ne propose donc pas un monde post-capitaliste idéal, mais plutôt une suite de compromis, de dispositifs, de négociations et de conflits, où le renoncement devient un objet explicite de politique publique. À ce titre, la fiction ne fuit pas le réel — elle le pousse dans ses retranchements.
Autre aspect essentiel de ce récit : l’introduction d’une garantie d’emploi écologique, ou Job Guarantee, conçue comme complément au C–QE. Là encore, l’idée est ancrée dans des travaux existants, notamment ceux de Pavlina Tcherneva dans le cadre de la MMT. Cette garantie d’emploi s’oppose frontalement à une fiction économique dominante : celle de la disparition inéluctable du travail humain du fait de l’automatisation.
Kim Stanley Robinson y répond vivement, soulignant que les tâches réellement nécessaires — restaurer les paysages, décarboner, prendre soin, cultiver, entretenir — sont justement les seules que les machines ne peuvent accomplir. En cela, la garantie d’emploi n’est pas un pis-aller, mais le socle d’une autre économie : une économie qui reconnaît le travail du vivant, celui qui ne peut être standardisé ni industrialisé. Cette perspective rejoint l’ambition portée par la Sécurité sociale de la redirection écologique : sécuriser les contributeurs et contributrices à l’habitabilité, en reconnaissant la nécessité de leur geste.
Du récit à la praxis
De fait, la science-fiction fonctionne ici comme un banc d’essai narratif pour des dispositifs institutionnels non encore stabilisés. Là où les modèles économiques peinent à intégrer des formes non ou alter-productives d’action, la fiction les met en scène, les habite, les incarne.
C’est une forme de praxis spéculative, articulant théorie économique, droit, géopolitique et conflits d’attachements. Et c’est précisément parce qu’elle accueille les tensions — entre rapidité du basculement et lenteur des transitions, entre technicité monétaire et désir d’habiter autrement — que la fiction permet de penser avec et au-delà des cadres existants.
Le rôle de la science-fiction, dans ce contexte, n’est donc pas de proposer une solution clé en main, mais de réactiver l’imagination stratégique. Elle aide — en prise avec des théories scientifiques en circulation — à formuler ce qui n’est pas encore dicible dans les arènes politiques ou budgétaires. Elle élargit le champ du pensable pour y inclure le retrait, la fermeture, le déséquipement — et ce faisant, elle outille l’action.
Cette mise en récit spéculative constitue un complément essentiel aux démarches d’ingénierie. Ce n’est ni un substitut à la technique ni une échappatoire. C’est un théâtre d’anticipation. Et dans une époque saturée d’urgences et de désillusions, ce théâtre est une ressource décisive pour oser concevoir des institutions du renoncement.
Reste que pour que ces récits fassent œuvre, il faut les inscrire dans une praxis. Raconter un renoncement pour mieux le faire exister dans l’espace public. En permettre l’appropriation, la discussion, la transmission. À ce titre, la narration est un outil d’ingénierie à part entière : elle prépare le terrain, rend possibles les arbitrages, légitime les gestes. Elle relie ce qui s’invente localement à ce qui s’esquisse globalement. Elle donne à voir, non pas une sortie sèche et brutale, mais un cheminement, une trajectoire — et c’est souvent ce récit qui manque pour enclencher le travail nécessaire à sa réalisation.
3. Expérimenter localement : les territoires à l’épreuve du retrait
S’il est un lieu où le renoncement cesse d’être une idée pour devenir une opération concrète, c’est bien le territoire. Là, les conflits d’usage, les arbitrages budgétaires, les attachements contrariés rendent toute abstraction impossible : on ne se retire pas d’une activité ou d’un équipement sans en mesurer immédiatement les conséquences sociales, économiques, patrimoniales ou symboliques. C’est pourquoi de nombreuses expérimentations locales, parfois marginales, parfois structurantes, permettent d’esquisser les contours d’un financement du retrait réellement opérationnel.
Parmi les rares domaines où le retrait fait déjà l’objet d’une ingénierie institutionnelle assumée, la gestion du recul du trait de côte offre un précédent structurant. Inscrite dans la loi Climat et Résilience, elle organise la relocalisation des biens menacés par l’érosion littorale à l’échelle de territoires pilotes. Elle mobilise des outils fonciers spécifiques (droit de préemption, bail réel d’adaptation climatique), des financements dédiés (fonds Barnier, fonds vert), et une planification intercommunale intégrant les risques d’habitabilité.
Si ces mécanismes restent limités à certaines zones littorales, ils attestent de la possibilité d’un retrait planifié, anticipé, indemnisé, adossé à une action publique structurée. Ce cadre peut ainsi servir de matrice à d’autres formes de redirection ou de fermeture volontaire d’activités menacées.
Dans un autre registre, les acteurs de l’assurance pourraient devenir des alliés stratégiques de l’économie du renoncement. Certaines pratiques de fermeture ou de déséquipement — arrêt d’un équipement exposé, abandon d’un projet d’urbanisation en zone inondable, fermeture préventive d’une route ou d’un captage — permettent d’éviter des coûts futurs majeurs. Ces coûts évités, bien connus des actuaires, pourraient faire l’objet d’une reconnaissance financière ex ante, soutenue par des mécanismes incitatifs ou des produits d’assurance inversés.
La prise en compte du risque systémique, déjà amorcée par la Caisse centrale de Réassurance (CCR) ou l’OCDE dans leurs travaux sur la prévention climatique, pourrait ainsi nourrir une comptabilité écologique du retrait. Il ne s’agit plus seulement de réparer ou compenser, mais d’encourager en amont des choix qui réduisent l’exposition et stabilisent les milieux. L’assureur devient alors co-financeur du non-faire.
Une économie du soin au service du renoncement
À Grenoble, le débat sur la fermeture de plusieurs piscines a mis en lumière la difficulté d’arbitrer dans un contexte d’augmentation des coûts (énergie, maintenance) et de fortes contraintes budgétaires. Mais ce débat a aussi révélé des manques : comment accompagner ces fermetures ? Comment faire participer les habitant·es à la redéfinition des usages ? Et surtout, comment chiffrer ce qui n’est plus — et ce qui, dans cette absence, pourrait ouvrir à d’autres formes de rapport au corps, au sport, à l’espace public ?
Dans ce contexte, la Métropole a engagé un travail de priorisation négative, consistant non pas seulement à planifier ce qui sera fait, mais à inventorier ce qui ne le sera plus — et à en tirer des conséquences budgétaires, comptables et politiques. Outre le cas grenoblois, ce sont, à ce jour, plusieurs dizaines d’expérimentations, menées souvent par la force des choses, dont il s’agit désormais de tirer les leçons.
Plusieurs programmes soutenus par l’État commencent à reconnaître l’importance de ces gestes. Les travaux des saisons 4 et 5 du programme Nouveaux Modèles Économiques Urbains (NMEU), portés par l’ADEME, la Banque des Territoires et le PUCA, ont documenté de manière approfondie les impasses des modèles actuels face aux exigences de sobriété. En s’appuyant sur des retours d’expérience territoriaux (Saint-Lô, Nantes, Besançon, entre autres), ces travaux montrent que la sobriété est déjà à l’œuvre — parfois même subie : baisse des consommations d’eau, de déchets, d’énergie.
Or, ces dynamiques, loin d’être neutres, engendrent un effet de ciseau préoccupant : les recettes issues des volumes baissent, tandis que les coûts fixes des infrastructures, eux, se maintiennent ou augmentent. Ce désajustement fragilise les équilibres économiques des services urbains, qu’ils soient publics (régies) ou délégués (DSP, délégation de service public), et révèle l’inadéquation des outils traditionnels de planification — conçus pour l’extension, non pour le retrait.
Les auteur·ices du programme appellent à une refonte des référentiels de gestion et de financement. Ils et elles plaident pour une révision des contrats, des indicateurs de performance et des grilles tarifaires, afin d’intégrer le « non-agir » ou les effets évités. Il ne s’agit plus seulement de mieux faire, mais de reconnaître la valeur des choix de renoncement. Cela implique aussi de créer des instruments de compensation et de réassurance pour sécuriser les opérateurs dans cette transition.
10 leviers sont proposés, parmi lesquels : la création de « fonds sobriété » pour financer des actions de réduction à partir des surplus de recettes ; la modification des contrats pour récompenser la performance de sobriété plutôt que les volumes traités ; la redéfinition de la continuité de service en termes de soutenabilité ; ou encore l’intégration de la sobriété dans les programmes pluriannuels d’investissement (PPI) et les documents de planification. Autant de pistes qui dessinent une nouvelle ingénierie urbaine du renoncement, où il ne s’agit plus d’ajouter, mais de maintenir, réduire, ou reconfigurer avec soin.
Le renoncement commence par ailleurs à intégrer la grammaire des réflexions en matière de budget d’investissement. Ainsi, l’Institut de l’Économie pour le Climat (I4CE) travaille actuellement sur un projet baptisé « ABC » (Arbitrages Budgétaires pour le Climat) : identifier et quantifier les dépenses brunes, définir des « mécanismes de redirection » (« mutualisation, substitution, renoncement ») et « évaluer les impacts financiers d’arbitrages liés aux projets bruns, incluant les coûts d’abandon, de transformation et les économies potentielles. »
Ces préconisations, très concrètes, rejoignent les enjeux plus larges d’une ingénierie du retrait : comment soutenir, budgétairement et politiquement, une trajectoire d’abstention ou de décroissance des services publics, tout en garantissant l’équité, la continuité et l’habitabilité ? C’est tout le sens d’une économie du soin appliquée aux infrastructures collectives.
La sobriété, un enjeu démocratique
Un autre apport majeur de ces travaux réside dans la réinscription des usagers, des élu·es et des agents publics au cœur de la décision. Les trajectoires de sobriété ne peuvent être imposées d’en haut sans produire d’effets contre-productifs ou de ruptures de confiance. À l’inverse, les retours d’expérience analysés montrent que le renoncement peut devenir une opportunité de recomposition démocratique, à condition d’en faire un objet explicite de débat.
Cela suppose de documenter les effets redistributifs des choix d’abstention (qui perd quoi ? Qui est protégé ?), de rendre lisibles les contraintes systémiques (budgétaires, climatiques, réglementaires), mais aussi d’inventer des espaces de délibération adaptés : forums locaux, diagnostics partagés, budgets participatifs négatifs. Ce souci d’associer les publics ne relève pas seulement de l’acceptabilité : il conditionne la légitimité et la viabilité des décisions. En ce sens, la sobriété n’est pas seulement une affaire d’ingénierie — elle est d’abord une affaire de démocratie.
Certaines agences techniques commencent à intégrer, de manière encore partielle, des logiques compatibles avec le retrait. Le programme Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique (ACTEE), piloté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), soutient la rénovation énergétique des bâtiments publics, tout en incitant certaines collectivités à repenser l’usage de leur parc immobilier. Cette dynamique peut parfois inclure la fermeture de sites peu fréquentés ou la mutualisation d’équipements, sans que cela ne constitue une orientation explicite du programme.
Du côté des agences de l’eau, les politiques de restauration de la continuité écologique ont donné lieu à des dispositifs de bonification financière pour les maîtres d’ouvrage optant pour l’arasement ou la suppression d’ouvrages hydrauliques devenus obsolètes. En valorisant ainsi le démantèlement plutôt que la simple mise aux normes, ces incitations témoignent d’un tournant discret, mais significatif dans les politiques de financement. Ces évolutions suggèrent l’émergence, à bas bruit, d’une ingénierie du retrait : désinvestir avec soin, déséquiper sans abandonner, soustraire sans désertifier.
Ainsi, Eau de Paris et l’Agence de l’eau Seine Normandie ont mis en place depuis 2020 un programme de soutien pour leur apporter une aide, afin de diminuer leurs usages des pesticides et accompagner le changement de pratiques — voire de modèles économiques, même si cela dépasse le périmètre strict du dispositif.
Plus globalement, se pose aussi une question de temporalité : le retrait n’est pas un geste ponctuel, mais un processus, souvent long, fait de négociations, de revirements, de médiations. Il faut donc pouvoir financer la durée, l’écoute, l’attente, le conflit — tout ce que la logique budgétaire classique peine à intégrer.
Ce que montrent ces expériences, c’est qu’une économie du renoncement n’est pas une économie de la fermeture brutale, mais bien une économie du soin. Soin des milieux, des personnes, des usages. Soin des traces, aussi, que laisse toute activité interrompue. Il ne suffit pas de fermer une usine ou une école : il faut accompagner, réaffecter, faire récit. Cela a un coût. Mais c’est ce coût, précisément, qui garantit que le renoncement ne sera pas un abandon, mais un geste politique à part entière.
Financer le renoncement : vers une économie de la redirection
Une politique de redirection écologique ne consiste pas à verdir les logiques en place, mais à en inverser les fondements. Passer de l’expansion des flux à leur contraction ciblée, de la production de valeur à la préservation de l’habitabilité, exige bien davantage qu’un ajustement : cela appelle un renversement de l’économie politique elle-même.
Ce basculement suppose des instruments inédits, car on ne finance pas un retrait comme on finance une extension. Il faut inventer — ou détourner — des outils capables de soutenir des trajectoires de sortie : monnaies affectées au déséquipement, obligations de démantèlement, fonds de transition soustractive, budgets participatifs du renoncement, sécurité sociale de la redirection… Autant de dispositifs à expérimenter, territorialiser, inscrire dans des logiques de soin, de justice et d’anticipation.
À rebours d’une vision austéritaire, cette économie du retrait ne se pense pas en termes de manque, mais de soin : soin des communs négatifs, soin des milieux, soin des trajectoires de sortie. Financer le renoncement, c’est refuser l’abandon et rendre possible une politique affirmée de la soutenabilité.