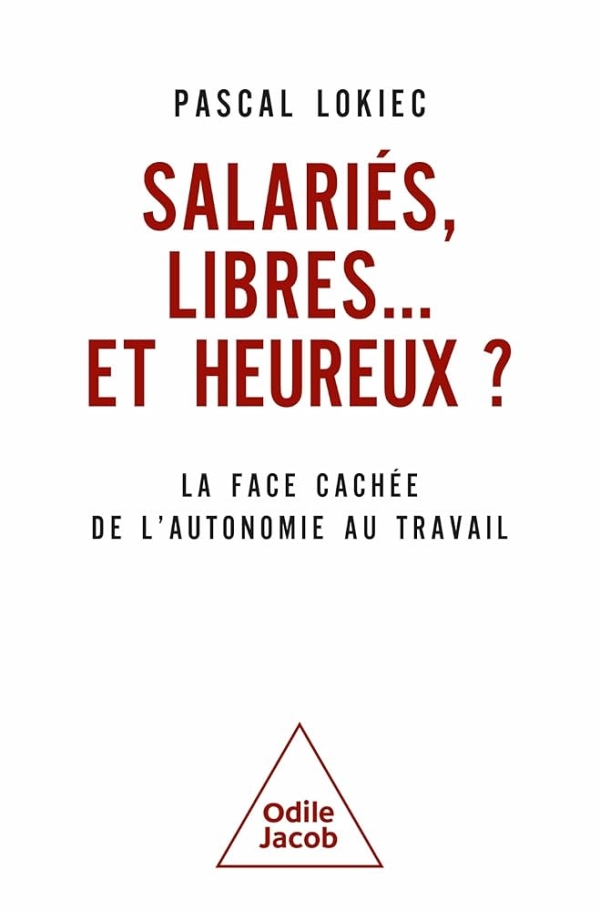Débats bioéthiques, néo-luddismes, ésotérismes, communautarismes et développement des spiritualismes new-age, complotismes, chamanismes, néo-traditionnalismes ou remise en cause croissante de la pax occidentalis, « la » modernité au singulier fait l’objet de remises en questions croissantes.
Nous « héritons » d’un monde comme infrastructure et comme épistémè (ou ingenium), et l’appel à de nouveaux imaginaires « écologiques », notamment pour élaborer une vision commune d’un monde redirigé vers la « sobriété », nous invite à réinterroger les fondements, les concepts centraux du monde moderne. Dès ses origines, un certain nombre de débats questionnaient la définition des contours de la Modernité. Et si « Nous n’avons jamais été modernes », comme l’affirmait Bruno Latour, notre époque s’en réclame, et l’activité intellectuelle autour d’une relecture de la Modernité sous-tend la critique d’un certain nombre des postulats qui la fondent.
Depuis une dizaine d’années, entre épuisement de la philosophie du sujet et crise de la modernité, le champ intellectuel n’en finit plus d’en appeler à des Lumières radicales chez Jonathan Israël, à des lumières sécularisée chez Margaret C. Jacob, à des altermodernités chez Yves Citton, qui parle aussi d’ailleurs d’un envers de la liberté. En bref, à un re-travail des fondements philosophiques qui dominent notre époque. Chez Blandine Kriegel, c’est une Autre voie qui est même tracée. Et à l’origine de tous ces appels, la pensée de Spinoza, comme critique radicale de l’édifice cartésien.
S’il ne s’agira évidemment pas de prétendre trouver chez lui des réponses prêtes à l’emploi près de 350 ans après la parution de son Éthique, « Spinoza mérite maintenant d’être lu, étudié et compris, c’est pour autant qu’il peut représenter une « autre voie », alternative à celle qui a dominé les siècles qui nous précèdent, une voie qui recèle peut-être plus d’actualité et d’avantages, pour surmonter ou résoudre les insuffisances et les catastrophes imputées à la modernité », écrit Blandine Kriegel.
Au-delà de la philosophie, ou du moins de ses frontières d’avec des sciences sociales historiquement construites en s’émancipant d’elle, un courant s’engage depuis quelques années à analyser l’influence de Spinoza dans les sciences sociales, et plus encore à créer une science sociale spinoziste. On retrouve cette ambition dans un nombre important de publications depuis maintenant une quinzaine d’année : Spinoza et les sciences sociales, de la puissance de la multitude à l’économie des affects, Spinoza et les passions du social, La société des affects, pour un structuralisme des passions mais encore Spinoza politique, le transindividuel, Spinoza et la politique de la multitude, le projet éditorial de la revue Multitudes, teinté d’une inspiration spinoziste, ou encore le projet de Frédéric Lordon et Sandra Lucbert de relire la psychanalyse à l’aune de cette pensée particulière.
Mais de quoi Spinoza est-il la critique ? Sans prétendre entrer dans le détail de ses débats avec Descartes - au sein d’une même aspiration à la rationalité - on peut retenir quelques grandes oppositions et en tirer le fil, pour tisser de nouveaux liens avec nos problématiques contemporaines.
La singularité humaine par rapport au reste du vivant
« Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », écrit Descartes dans son Discours de la méthode. La formule fait florès, et, déchirant le cosmos grec et l’inscription humaine dans des milieux, l’homme moderne naît comme singularité parmi les vivants du fait notamment de sa maîtrise croissante des sciences et des techniques. Cette position de surplomb et d’extériorité à une nature qui lui serait inféodée a été largement remise en question récemment par la nouvelle anthropologie, sous les plumes d’Eduardo Viveiros de Castro, Tim Ingold ou Philippe Descola.
Quelque quarante ans seulement après sa formulation, cette proclamation d’indépendance de l’Homme par rapport à son milieu est remise en cause. Au Discours de la Méthode, Spinoza oppose L'Éthique. « La plupart de ceux qui ont parlé des sentiments et des conduites humaines paraissent traiter, non de choses naturelles qui suivent les lois ordinaires de la Nature, mais de choses qui seraient hors nature. Mieux, on dirait qu’ils conçoivent l’homme dans la Nature comme un empire dans un empire. Car ils croient que l’homme trouble l’ordre de la Nature plutôt qu’il ne le suit » (Éthique, III, Préambule).
L’Humanité déchue de son trône par rapport à « la nature » est ainsi profondément reconnectée à un milieu qui la détermine. Dans cette conception, la liberté est redéfinie. D’une capacité d’intervention sur la nature, elle devient une capacité à comprendre ses lois et à agir en accord avec elles. La récente découverte des « limites planétaires » invite à deux réactions dont les coordonnées sont posées, dès le 17e siècle, lors de l’invention, non pas d’une modernité qui nierait la controverse, mais de modernités.
Ainsi, on peut schématiquement tracer une ligne entre Descartes et le technosolutionnisme qui, à partir d’une vision du progrès envisagée comme une fin en soi, espère d’avancées techniques (dont la discussion de l’utilité sociale est alors négligée) le dépassement de la crise écologique en cours. Toujours aussi grossièrement, la pensée spinoziste ouvre la voie à une techno-critique, soit l’impératif d’un questionnement social et politique du rôle de la technique dans nos sociétés, dans nos milieux. Ainsi, Spinoza propose une réinscription de l’humanité dans son environnement le plus large, et offre à la pensée écologique si ce n’est un modèle, au moins une précieuse source d’inspiration.
Le sujet contre le mode : l’hypothèse transindividuelle
« Je pense, donc je suis », écrit Descartes, ouvrant la voie à l’individualisme moderne. Spinoza, dénoncé comme panthéiste, définit l’homme comme une modalité particulière d’une substance unique, divine ou naturelle (« Dieu ou la Nature, agit avec la même nécessité qu’il existe » Éthique, IV, Préambule). Les êtres humains sont des variations d’une substance unique et infinie, et non des entités autonomes. Cette substance se manifeste dans une multitude de formes, reliant tous les individus dans un même tissu d’existence.
Alors que Descartes ancre la connaissance et l’existence dans la pensée individuelle, Spinoza en propose une vision intégrée et relationnelle. L’individualité, pour Spinoza, n’est pas isolée, mais profondément enracinée dans un réseau de relations transindividuelles. Ce rejet du cogito met en avant une conception de l’être où l’individuation émerge non pas de la séparation, mais de la relation et de la connexion. Ainsi, la pensée et l’existence ne sont pas attribués à des sujets isolés, mais le résultat d’une interdépendance complexe, d’un réseau où l’individu et le transindividuel s’imbriquent et se définissent mutuellement.
Il est à noter que certaines réflexions récentes issues des neurosciences supposent le même schéma de construction de l’intelligence, en excluant de fait toute forme « artificielle ». Pour Mathieu Corteel, philosophe et historien des sciences, « Les machines sont enfermées dans leur programme sans possibilité de s’en extraire par absence de référence au monde ». Et poursuivant sur le même axe : « L’attribut “penser”, qui émerge de l’activité des humains construisant et utilisant des ordinateurs s’immisce, par un glissement sémantique, dans la machine sous la forme de la qualité “pensante” qui structure la mécanique des opérations. Si bien que nous sommes enclins à attribuer la qualité de la pensée à des machines qui ne sont que des machines. »
Ce dépassement, et à la fois cette constitution de l’individu par le collectif, dans une vision dynamique et processuelle est théorisée plus tard comme individuation par Gilbert Simondon. À partir de ce concept, Étienne Balibar dégage de son côté un Spinoza politique, à travers la notion de « transindividuel ». Cette perspective souligne la nécessité de politiques qui prennent en compte non seulement l’individu, mais aussi les réseaux complexes au sein desquels il opère.
Une telle approche encourage des politiques intégratives, inclusives, axées sur la communauté, à l’image du communisme du soin développé par Josep Rafanell i Orra. Cet anti-humanisme théorique de Spinoza, formulé à l’os « Rien n’est plus utile à l’homme que l’homme » (Éthique, IV, 18, scolie), va à rebours de l’individualisme d’un moi souverain, pour réinscrire les corps dans leurs attachements communautaires (de la famille à l’engagement associatif ou politique, de l’expression culturelle au club de foot, de l’appartenance à une minorité à l’appartenance nationale, communale, etc.). Cette approche rend compte des questions d’individuation à tous les niveaux, de l’individu comme de la multitude, en matière de processus constituants. Or, « pour se faire une âme il faut sentir le dedans du dehors » .
Un déterminisme fondamental
« Le libre arbitre est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d’autant qu’il nous rend en quelque façon pareils à Dieu. », écrit Descartes. L’esprit, pour Descartes, est doté de la raison et a la capacité de faire des choix conscients, bien qu’il soit influencé par les passions et les sensations du corps. Il identifie le libre arbitre comme une caractéristique essentielle de l’esprit humain. À l’inverse, Spinoza écrit que « Les hommes se trompent quand ils se croient libres ; cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. » (Éthique, I, Appendice) et développe un déterminisme fondamental.
La liberté, dans cette optique, n’est pas l’expression du libre arbitre, mais plutôt la réalisation d’une connaissance profonde des lois naturelles et des causes qui nous gouvernent. Selon Lordon et Citton, il faut entendre « Nature » comme « l’ordre général de la production des effets ». Ainsi, là où Descartes voit la liberté dans la capacité de choix, Spinoza la perçoit dans la compréhension et l’acceptation du déterminisme intégral qui régit toute existence.
À l’inverse du libéralisme dominant qui pense le sujet individuel et ses droits comme alpha et oméga de la politique, une pensée spinoziste le plonge dans ses interrelations sociales, culturelles et biologiques. Membre d’un corps politique qui l’excède, l’individu est un processus qui se construit comme adossé à la multitude, et se sédimente à travers ses affections. Mais loin de consacrer l’impuissance de l’individu, la construction spinozienne tente de comprendre et accroître notre puissance d’agir. Ainsi le déterminisme n’abolit pas la possibilité de l’agir, mais il en réfute le caractère inconditionné, et tente de nous ouvrir à un devenir actif, enraciné dans notre environnement.
La dualité corps/esprit
Au Je pense donc je suis cartésien, qui institue une distinction fondamentale entre le corps (ou la matérialité des choses) et l’esprit qui le précèderait, Spinoza oppose encore un monisme, ou parallélisme, qui unit le corps (attribut de l’étendue) et l’esprit (attribut de la pensée). Plus un corps est apte à être affecté, plus son esprit est apte à percevoir les choses (Éthique, II, 13, scolie). Cet accent mis sur la matérialité physique du monde rompt avec l’idéalisme des Lumières autant qu’avec le mécanisme de l’animal-machine cartésien, et trace une voie qui reboucle avec le déterminisme spinozien : la liberté consiste en la connaissance de ses déterminations.
Rompant avec la supériorité déclarée de l’esprit, Spinoza rompt avec la démiurgie humaine théorisée par Descartes (dans laquelle même Dieu s’écarte). Ré-actualisée par le fameux « Nul ne sait ce que peut un corps » (Éthique, III, 2, scolie) porté par Deleuze, cet intérêt porté à la matérialité du monde ne peut que résonner avec les réflexions portant sur l’infrastructure qui nous forme, fonde l’ordre social : réseaux électriques, numériques, énergétiques, hydrauliques, routiers, etc.
La valorisation des études « intellectuelles supérieures » par rapport aux métiers corporels et manuels suffit à prouver l’hémiplégie d’un modèle social qui valorise l’idée de corps comme seul moyen de locomotion d’une tête pensante. Plus généralement encore, le corps collectif est aujourd’hui repoussoir : du kop d’un stade à une manifestation sauvage. Comment réapprendre alors à faire corps à l’ère de la distanciation sociale ?
Plus encore, le refus d’une interaction « causale » entre le corps et l’esprit permet de dépasser l’idée et objectif politique de la « prise de conscience » comme moteur de l’action. Elle valorise au contraire une politisation à travers le sensoriel, le sensible, le sensuel, l'expérientiel, et plus seulement via des contenus idéels puisqu’il n’y a pas « pas de force intrinsèque de l’idée vraie » comme le déplorait Bourdieu. La politique comme un « art d’affecter », l’art comme une affection politique ? C’est le pari de Milo Rau dans sa trilogie antique. Après Oreste à Mossoul, et le Nouvel Evangile, il présente cette saison Antigone in the Amazon, pour lequel il revendique cette posture de théâtre politique pourtant critiquée.
Réhabiliter le désir et nos affects
Si, « du désir on a fait un monstre : toujours porté vers ce qui manque », Spinoza positionne ce dernier en un affect primordial. Quand Descartes cherche à contrôler, par la raison et la volonté, les passions du corps, Spinoza fait des affects le moteur de nos déterminations, et donc de notre individuation. Il identifie trois affects primitifs : le « désir » ou conatus, entendu comme « volonté de persévérer dans son être », ou énergie vitale, la « joie », comme augmentation de notre puissance d’agir et la « tristesse » comme diminution de cette dernière.
Cette mise en avant des affects et désirs connaît une postérité transdisciplinaire, de la psychologie à la neurobiologie en passant par la philosophie politique. Elle ouvre la voie à une critique de la morale qui érige le Bien et le Mal comme opérateurs de jugement, pour un raisonnement qui nous confronte aux termes de bon et mauvais. À rebours de l’accusation en relativisme démontée dans sa correspondance avec Blyenbergh, cette posture est fondamentalement éthique, puisqu’elle préfère s’interroger sur les ressorts actionnables, qui dépendent de nous, plutôt que de pointer l’autre comme unique responsable.
« Ceci vaut pour l’insecte autant que pour l’étoile… »
Par sa critique de la modernité occidentale, Spinoza ouvre la voie à une réinvention des Lumières tenant compte des errements modernes. À l’heure où comprendre devient synonyme de justifier, et où l’anathème remplace la contextualisation et l’analyse, où la séparation des pouvoirs (pour laquelle il plaide dans le Traité théologico-politique) est menacée, où la démocratie (qu’il désigne dans le Traité politique comme meilleur système de gouvernement) semble prise dans un péril illibéral et que les dénonciations en fascisme pullulent, la pensée d’un philosophe du 17e siècle peut-elle être d’actualité ? C’est en tout cas le pari d’une génération de philosophes et de chercheurs.
À l’heure de l’Anthropocène et d’un appel à créer des imaginaires résilients, le réenchantement de la « nature » proposé par Spinoza, depuis sa position rationaliste, et la réinscription de l’homme dans ses milieux « naturel », apparaît comme un appel à s’engager sur le chemin d’une nouvelle modernité. On en retrouve la trace dans de nombreux textes contestataires, tels que l’Appel (republié en août dernier, après une vingtaine d'années de circulation plus ou moins clandestine et dont l’argumentation en Propositions, Démonstrations et Scolies est directement hérité de l'Éthique) ou dans la poésie de Monchoachi, de Bonnefoy ou de Jaccottet.
Si Démocrite avait prévu l’atome, la modernité a enfanté d’Oppenheimer, mais aussi d’Einstein, qui écrivait : « Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n’exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l’insecte autant que pour l’étoile. Les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique - nous dansons tous au son d’une musique mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible ». En établissant une éthique s’appuyant sur la joie de comprendre, en mesurant l’humanité à l’aune de sa puissance d’agir ainsi augmentée, plutôt qu’à celle d’une toute puissance aussi destructrice qu’illusoire, Spinoza n’offre-t-il pas un cadre ouvert à une sobriété heureuse ?