Economie collaborative et biens communs

Interview de Flore BERLINGEN
Directrice du Cniid (Centre national d’information indépendante sur les déchets). Co-fondatrice de OuiShare
Interview de Benjamin Lemoine et Edoardo Ferlazzo

Financiarisation de la dette publique, autonomie budgétaire des collectivités limitée par l’État, marges de manœuvre pour une relance responsable de l’économie…
D’où vient-on ? Où va-t-on ?
Ce sont ces problématiques essentielles pour l’avenir de l’action publique que ces deux chercheurs iconoclastes éclairent pour nous.
Benjamin Lemoine, dans votre ouvrage « L’ordre de la dette », vous proposez une perspective historicisée de la dette de l’État. Vous y analysez notamment ce que fut le circuit du trésor. Pouvez-vous nous présenter ce dispositif de financement administré, dont les mécanismes semblent aller à l'encontre des schémas de pensée actuels ?
Benjamin Lemoine : Le circuit du trésor était une pièce centrale de la reconstruction de l’économie après la Seconde Guerre mondiale. Ce dispositif s’articulait à une direction d’ensemble des mécanismes financiers et monétaires du pays : nationalisation de la Banque de France, nationalisation d’une grande partie du secteur bancaire français, rôle primordial de la planification et du conseil national du crédit… Le circuit du trésor, dont l’épicentre était au ministère des Finances, constituait en somme le point de passage obligé de ces différentes organisations qui contribuaient à encastrer politiquement les questions d’argent.
Dans ce dispositif, les fonds alloués à l’économie sont impulsés depuis l’administration des Finances, qui contrôle les émissions d’emprunts et la circulation du crédit de la quasi-totalité des secteurs, mais ils sont aussi drainés en retour vers les caisses publiques. Il s’agit d’un système d’autofinancement, qui lie entre elles les questions monétaires, financières et budgétaires. Ainsi, des systèmes comme les planchers de bons du trésor permettent à la fois de réguler la masse monétaire mise en circulation par le système bancaire, en contraignant les banques à souscrire, et le financement de la trésorerie d’État. Le marché joue un rôle secondaire, et c’est la puissance publique qui définit l’offre et la demande, décide des « bons » investissements, de leur taux de rémunération, des secteurs stratégiques, ainsi que de l’horizon à moyen long et termes.
Si la démocratie délibérative se ressaisit de cet outil de puissance technocratique, et le transpose à l’échelle européenne (sachant que les stratégies d’émission d’emprunt, et caractéristiques législatives, demeurent une prérogative souveraine dans le cadre des traités), on a là un dispositif opérationnel pour financer, sans emprunt auprès des marchés, les investissements écologiques et sanitaires nécessaires.
Aujourd’hui, ce sont bien les circonstances d’une crise qui semblent avoir fait bouger les lignes. Comment ce recours à l’endettement s’inscrit-il dans les orientations budgétaires précédemment suivies, quelle continuité peut-on établir ?
Benjamin Lemoine : La crise actuelle, inédite et incommensurable, appelle à un changement de paradigme dans les domaines monétaires et financiers. Il s’agit de se déprendre des réformes techniques et politiques qui, aux confins des années 1960, ont installé des structures de marchés pour le financement de l’État, au détriment de dispositifs administrés que je viens de décrire brièvement. Car malgré le basculement en cours, ces cadres de marché enserrent encore largement les idéologies légitimes et les façons de penser des solutions. Si la pandémie du COVID-19 a mis une grande partie de l’activité économique privée entièrement à l’arrêt, suite à un choix politique de santé publique, l’appréhension du problème de la dette reste indexée à ce changement technologico-politique de mise en marché.
En effet, l’État continue d’être considéré comme le débiteur de la finance privée et le « demandeur » de capitaux, qui doit se soumettre à la loi du marché. C’est précisément ce paradigme qui pourrait, et devrait me semble-t-il, craquer par tous les bouts vu les retournements matériels à l’œuvre. Étant donné l’argent public sans précédent injecté pour assurer la survie de l’économie privée et de nos sociétés, comment considérer que nous sommes encore en présence d’un État en dette et débiteur d’un univers privé créancier ? Il me semble que la rupture majeure, et qui fait l’analogie avec une situation d’après-guerre, est le fait que l’État – une réalité dont il faudrait démocratiquement se saisir à nouveau – n’est plus un simple emprunteur comme un autre, simplement plus massif et sécurisé que les autres, mais bien l’architecte et le grand investisseur du monde économique, social et écologique à construire.
La mise en marché du financement de l’État a été conduite au nom de la lutte, sacralisée, contre l’inflation, et du rêve des pouvoirs publics de voir les ménages « modestes » ou pauvres se transformer en classes moyennes, épargnantes, boursicoteuses et financièrement actives. Ces objectifs n’ont pas été atteints et ces priorités apparaissent aujourd’hui datées, obsolètes dans une situation où la demande s’effondre. Et des mécanismes administrés de financement, au contraire, redeviennent légitimes et pourraient fournir des solutions pérennes, permettant d’annihiler un retour à l’ordre de la dette, où le marché et les créanciers privés imposent la discipline aux dépenses sociales et publiques essentielles.
Edoardo Ferlazzo, au niveau des budgets des collectivités, la politique de réduction des dotations d’État et le rôle des autorités décentralisées dans la réduction de la dette nationale peuvent-ils être remis en cause ?
Edoardo Ferlazzo : Comme vous le précisez, il y a eu depuis la fin des années 1990 une remise en cause profonde de l’autonomie financière des collectivités locales, à contre-courant des réformes politiques et économiques décentralisatrices engagées depuis 1982 et l’Acte I de la décentralisation. Cette reprise en main des finances locales par l’État s’accélère peu après la signature du Pacte de Stabilité et de Croissance de 1997, qui prévoit des critères de tenue des comptes publics nationaux.
L’État est seul responsable devant les autorités européennes de son engagement à respecter ces critères, il y a donc une tentation grandissante pour lui de couper les robinets des finances locales et sociales, qui sont comptabilisées dans le calcul de la dette publique. Pour les budgets locaux, cette tentation s’est matérialisée dans un premier temps par une baisse du pouvoir fiscal local, symbolisée par la suppression progressive de la taxe professionnelle à partir de 1999, puis par un gel suivi d’une baisse des dotations d’État à compter de 2011 et, enfin, plus récemment par la signature du Pacte de Confiance et de Responsabilité en 2013, qui engage les collectivités à tenter de suivre des trajectoires de désendettement.
Ce resserrement des flux financiers centraux vers les autorités locales ne peut à mon sens tenir dans le contexte présent. Comment justifier que l’« argent facile » public massivement déployé pour sauver une économie privée asphyxiée ne puisse être aussi utilisé pour accompagner l’action publique locale, sur laquelle le gouvernement s’appuie pour organiser cette de sortie de crise ? Comment l’État pourrait-il légitimement le justifier, sans fournir des moyens financiers alignés ? En revanche, nul besoin de préciser que la permanence à plus long terme d’un renouveau décentralisateur d’un point de vue financier sera dépendant des changements plus ou moins radicaux sur les structures politiques et économiques qui adviendront dans le monde post-crise.
Le marché des produits financiers est-il adapté à une relance décentralisée, et les relations de crédit peuvent-elles être bouleversées au niveau local par les conséquences de la crise actuelle, avec par exemple une montée en puissance des emprunts groupés ?
Edoardo Ferlazzo : Je n’aborde ici que le cas français, même si le même constat est transposable pour de nombreux pays. L’hypothèse que vous mentionnez d’un recours accru aux marchés de capitaux comme solution à la crise économique actuelle, plutôt que par financement bancaire privé et surtout public, me semble être un non-sens absolu. Au-delà de présenter des limites pratiques déjà visibles dans la période pré-crise, ce choix serait contre-productif par rapport aux défaillances que la présente crise fait ressortir. En effet, les marchés de capitaux sont structurellement peu utilisés par les collectivités territoriales françaises et réservées aux plus grandes.
En dépit d’une volonté de l’État et des instances locales de développer ce type de financement, notamment saisissable par la création de la récente Agence France Locale, ce mode de financement de l’action publique locale reste de l’ordre de moins de 10% du marché du crédit des collectivités locales, les 90% restant représentant des financements de l’emprunt par recours aux banques publiques et privées. Cet état de fait reflète les profondes limites que présentent les marchés financiers pour la plupart des collectivités et qui résultent essentiellement du maillage politique et administratif français. La plupart des collectivités, en raison de leur taille, ont des besoins d’investissement trop faibles pour émettre des montants d’emprunt similaires à ceux que recherchent les investisseurs financiers. La solution des emprunts groupés pourrait en ce sens sembler être une voie naturelle pour associer des collectivités qui individuellement sont dans l’impossibilité d’émettre pour des montants critiques. Cela me semble être une route qui, si elle était poursuivie, marquerait une profonde incompréhension des événements présents. Les mêmes ressorts disciplinaires qui existent pour l’État face aux marchés financiers que décrit Benjamin Lemoine sont aussi à l’œuvre pour les émissions des collectivités locales, qu’elles soient groupées ou non. Recourir aux marchés financiers implique une dépendance face aux attendus et aux exigences des investisseurs, et contraint nécessairement les marges de manœuvre des emprunteurs, en légitimant certaines politiques publiques au détriment d’autres.
Dans les critères d’évaluation des investisseurs financiers, une variable comme les dépenses d’investissement est par exemple un marqueur d’un risque de défaut de paiement de la part d’une collectivité locale, parce que ces dépenses réduisent les ressources immédiatement mobilisables pour rembourser l’emprunt. Comment penser qu’après une crise ayant mis à nu la nécessité sociale et économique d’infrastructures de service public, de tels schèmes de pensée puissent perdurer ?
Enfin, une éventuelle généralisation du financement par les marchés de capitaux mettrait les collectivités locales encore davantage en compétition. Des effets de discrimination territoriale, issus des comportements grégaires des investisseurs, seraient à l’œuvre, comme on a déjà pu le voir dans le cas de villes américaines telles que Detroit. Les collectivités de petite taille ou en mauvaise santé financière aux yeux des investisseurs seraient encore plus pénalisées par rapport aux grandes collectivités urbaines, risquant d’aggraver des inégalités territoriales déjà très présentes.
Globalement, les collectivités territoriales portent à elles-seules plus des 2 tiers des dépenses d’investissement public. S’agit-il de la preuve de l’efficacité de la subsidiarité, qu’il faudra encourager pour soutenir la reprise d’activité du pays, ou au contraire, doit-on espérer selon vous le retour d’un État stratège, qui coordonne d’en haut la dépense publique et reprend les rênes de l’investissement ? Que nous dit l’Histoire des résultats de l’une ou l’autre de ces options ?
Edoardo Ferlazzo : Dans la période des Trente Glorieuses, les relations économiques et financières État/collectivités locales sont marquées par une forte régulation des finances locales par les pouvoirs centraux. L’État contrôle strictement l’investissement public local en jugeant de l’opportunité de certains projets, et en conditionnant l’accord de certains financements à l’alignement de ces investissements sur les exigences du Plan. Des subventions sont par exemple accordées aux collectivités locales si cet alignement est respecté. L’existence de subventions centrales aux investissements locaux ainsi choisis est un préalable indispensable pour obtenir des emprunts de la Caisse des Dépôts et des Consignations et de sa filiale, créée en 1966, la Caisse d’Aide à l’Équipement des Collectivités Locales (CAECL), les deux prêteurs très largement dominants de la période. Les effets de cette tutelle technico-financière, à laquelle s’ajoute une tutelle administrative exercée par le préfet, sont que l’État exerce un contrôle étroit sur les orientations sectorielles et territoriales des investissements publics locaux. Et cela avec un intérêt certain des décideurs publics, qui pourtant ne se concrétisera pas nécessairement, pour une certaine forme d’égalité territoriale. Cette mainmise de l’État va cependant être attaquée par les pouvoirs locaux jusqu’aux années 1980, car jugée trop contraignante.
La régulation administrée des finances locales craque au début des années 1980 sous l’effet de deux choix politiques. D’une part, la décentralisation consacre une liberté financière et d’administration étendues aux collectivités locales, celles-ci pouvant désormais, entre autres, engager des dépenses d’investissement sans jugement d’opportunité préalable de l’État, ou exercer un pouvoir fiscal plus important. D’autre part, le tournant libéral engagé se matérialise notamment, pour les finances locales, par une privatisation progressive de l’offre de crédit, reflet du désengagement quasi-complet de l’État dans l’offre de crédit local, qui se concrétise totalement à compter de la privatisation du Crédit Local de France (anciennement CAECL) à travers Dexia au milieu des années 1990.
Paradoxalement, alors que les discours des années 1980 promouvaient un système où s’organisait une entente entre collectivités locales, plus autonomes dans leurs choix financiers et économiques, et les acteurs financiers, libres de développer des produits d’emprunt inspirés des offres commerciales privées, cette réalité se heurte rapidement au retour d’un État interventionniste dans les finances locales. À la fin des années 1990, à la suite du Pacte de Stabilité et de Croissance qui engage les états européens à respecter les critères dits de « Maastricht », l’État français a diminué l’autonomie financière publique pour limiter le poids de la dette des collectivités locales dans la dette publique.
Cette réduction de l’autonomie financière locale s’est traduite dans un premier temps par un encadrement plus strict du pouvoir fiscal des collectivités locales, symbolisé par la suppression de la Taxe Professionnelle en 2010, puis par un gel et une baisse des dotations de fonctionnement dans les années qui suivent. Ces évolutions ont abouti à une situation plutôt éloignée des idéaux des années 1980, où les collectivités ont plus de compétences, mais sont privées des ressources pour les assumer.
Les collectivités sont donc désormais mises en concurrence dans l’accès à des ressources devenues plus rares et le souci d’une égalité entre territoires est relégué au second plan. Il en a résulté un accroissement important des disparités sociales et économiques territoriales. Certaines régions, essentiellement urbaines, réussissent à développer un tissu économique et social fertile, pendant que d’autres, de plus en plus importantes, sont enlisées dans des situations de détresse, par exemple issues des politiques de désindustrialisation. Il y a donc un bilan extrêmement contrasté à dresser de la décentralisation et de la libéralisation en ce qui concerne le développement local.
La tentation pourrait être de faire une analogie entre la situation actuelle et l’après-guerre, où la nécessité de reconstruire et de moderniser l’appareil productif avait justifié aux yeux des décideurs d’entreprendre une action étatique très interventionniste. La situation est différente pour au moins un aspect majeur. Les avancées décentralisatrices, notamment en ce qui concerne les compétences des collectivités locales, ont été suffisamment importantes pour ne pas être, du moins à court terme, aisément réversibles. L’État doit ainsi composer avec des pouvoirs locaux, dont l’influence politique et économique est allée grandissante depuis la décentralisation. En témoigne que, comme vous l’évoquez, 70% de l’investissement public est local. Plutôt que d’imposer une recentralisation des compétences des collectivités, une possibilité pourrait être au contraire de distribuer des ressources permettant de les assumer, quitte à ce que l’État conditionne l’obtention de ces fonds à la mise en œuvre de projets écologiques, sociaux ou économiques, ou encore à l’amélioration des services publics.
Cette distribution des fonds pourrait ainsi être dans le même temps pensée à l’aune de critères de réduction des inégalités territoriales, selon une optique proche des contrats de plan, mais dont la visée ne serait pas qu’économique et social, mais dont la visée serait économique, sociale, et écologique.
Benjamin Lemoine, lors des dernières élections présidentielles, vous avez défendu l’idée que la « façon dont l’État se finance » devait être « mise en débat », le recours à l’emprunt pouvant avoir des vertus stratégiques pour les États, leur permettant de grands investissements publics par exemple. L’exemple allemand ne confirme-t-il pas au contraire qu’une certaine rigueur en amont permet justement d’avoir des leviers puissants pour une relance massive et efficace, lorsque l’urgence l’exige ?
Benjamin Lemoine : J’ai publié en effet une tribune dans Libération avant le premier tour pour montrer que le recours au financement de marché, via la dette, était devenu un levier puissant de pouvoir politique pour les classes financières, dont les choix d’investir ou de désinvestir dans les obligations d’État s’imposent à nos choix démocratiques, quel que soit le parti. On parlait pour leurs décisions de placements, en décidant de se rendre ou non aux adjudications d’emprunt public, d’un vote « avec les pieds ». Par exemple, aux candidats qui cherchaient à transformer en profondeur le paysage économique et financier a été opposé le « risque politique ». Celui-ci n’était autre que la menace brandie par les investisseurs, domestiques ou étrangers, de se désinvestir du produit de dette français. Ce qui pour cette classe sociale financière était un risque, la perturbation de leur intérêt par un changement institutionnel, démocratique et social, était au contraire pour de nombreux citoyens la chance d’un retour de la vertu politique. Enfin, sur le plan technologique, l’Allemagne et la France ont recours aux mêmes dispositifs d’émission de dette : des agences publiques calées sur les exigences des investisseurs - l’Allemagne a même une société anonyme pour l’émission de la dette.
La modernisation de ce système d’emprunt, permettant une dette liquide, attractive, a longtemps été considérée par la France comme un moyen de compenser son « complexe » d’infériorité vis-à-vis du taux d’intérêt de la référence allemande. Certes, la dette publique allemande sera de l’ordre de 70% du PIB après 2020 quand la dette française sera aux alentours de 115%. Mais le choc sur la croissance allemande estimé par le FMI à près de de 7.5 points de PIB sera tout aussi violent et, forcément, rendra d’autant plus difficile la réduction de la dette à système financier et économique inchangé.
Au-delà de ces grandeurs et de ces masses d’argent public injectées, l’enjeu démocratique et politique majeur selon moi n’est pas ce différentiel entre d’un côté la fourmi allemande, qui aurait accumulé des réserves et marges de manœuvre à déployer en temps de crise, et de l’autre la cigale française, dispendieuse et budgétairement moins préparée. Réfléchir ainsi nous laisse entièrement enfermés dans la configuration marchande que j’ai envie de qualifier de monde « d’avant-pandémie ». Ce qui sera décisif, c’est bien plutôt la façon dont les élites technocratiques de ces différents pays vont s’ouvrir – ou vont être forcées à s’ouvrir – ou non à un nécessaire changement de paradigme sur les liens entre États et puissances privées dans les domaines monétaires et financiers. Ainsi, la question posée est : le corps social et politique va-t-il se décider à défaire la tutelle des marchés financiers privés, qui imposent à tous les secteurs d’activités leurs goûts, désirs, modes d’évaluations et « fondamentaux » sociaux et économiques ?
Au sortir de cette crise, l’extrême majorité des États seront endettés comme au lendemain d’une guerre qui n’aurait connu que des vaincus. Cela annonce-t-il selon vous, au vu des premières décisions, une mainmise prochaine des créanciers sur les politiques publiques, ou au contraire une mise au pas générale du secteur de la finance, contraint de se plier à l’autorité d’États re-légitimés par la gestion de crise ?
Benjamin Lemoine : Tout dépendra effectivement du rapport de forces social et politique qui se mettra en place dans les prochains mois. Ces deux devenirs sont également plausibles. Des signaux montrent que le néolibéralisme autoritaire, bien que déjà en place insidieusement depuis quelques années, pourrait sortir renforcé de ce régime de la peur à la fois économique, épidémiologique et budgétaire : pour cela, il suffit de penser au chantage envisagé par le gouvernement de la mise au travail forcée de certaines classes sociales, au détriment de leur protection sanitaire, menacées de perdre l’assistance du chômage partiel si leurs enfants ne se re-scolarisent pas. Autant de mesures destinées, selon cette logique, à remettre la France au travail pour « payer la facture de la dette ». Néanmoins, même si le régime néolibéral de disciplinarisation des États par le recours « nécessaire » au crédit privé venait à s’imposer, il serait à tout le moins affaibli pendant un certain temps.
On peut espérer que la re-hiérarchisation des valeurs sociales à laquelle a donné lieu la crise puisse se pérenniser : les secteurs et services publics, tous ces régimes spéciaux il y a peu dans le viseur des réformes libérales dogmatiques, ont au contraire révélé leur caractère nécessaire et indispensable, quand de nombreuses activités privées se sont montrées a minima inefficaces, au pire profiteuses ou spéculatrices. Enfin, les outils financiers et monétaires qui sont en cours de confection dans la coulisse pour faire face à un choc sans précédent pourraient déterrer des expériences passées, où le crédit public, sa crédibilité politique et financière, prenait le pas sur la crédibilité du privé.
Je vois trois options de gestion de cette situation budgétaire : une austérité brutale, un recours à l’inflation, ou une annulation pure et simple de tout ou partie des sommes dues. Quels sont les avantages et les inconvénients, dans le contexte actuel, de chacun de ces scenarii ? Peut-on innover dans ce domaine, et dessiner un nouveau chemin ?
Benjamin Lemoine : L’enjeu est bien d’assumer pour les questions financières une nouvelle philosophie de l’intérêt général : reconstituer les banques en services publics, orientées par des représentants politiques nationaux et européens soucieux de leur représentativité, canaliser l’épargne et la circulation monétaire dans des tuyaux compris comme soucieux du bien commun, environnemental, social et économique. Bref, assumer que nous sommes en présence d’une situation d’après-guerre, de reconstruction qui dépasse les clivages politiques, non pas pour les réunir en un consensus néolibéral renforcé, mais bien dans l’idée que le bien commun ne peut plus se permettre d’être soumis « aux aléas du marché » ou rendu aux forces de l’argent, et que dans le domaine de l’économie, pour citer le général de Gaulle en 1944, il s’agit « d’exploiter les grandes sources de la richesse commune pour l’avantage de tous », car « l’intérêt particulier (doit être) toujours contraint de céder à l’intérêt général ».
Au-delà des "annulations" de dette, qui sont une solution brutale, et loin d’être anodine en termes de « réputation de crédit », il faut plutôt "annihiler" la dette, c’est-à-dire rendre inopérante la contrainte de liquidité à court terme pour la puissance publique et constituer un régime de financement normalisé, qui fasse échapper l’État à la contrainte du crédit auprès des puissances d’argent privées.
Si aujourd’hui la BCE rachète massivement la dette sur les marchés secondaires aux acteurs privés, processus entamé largement avant la pandémie, il faut non seulement ouvrir le mandat de cette organisation experte, mais aussi évider cette bureaucratie de la culture marchande dont elle est imprégnée, et reconstruire un véritable circuit du trésor écologique européen, c’est-à-dire une puissance de trésorerie et d’action financière publique, qui soit réellement émancipée du régime de la dette, tout en étant nourrie et contrôlée par le politique. Il faut que les parlementaires puissent se saisir de ces outils de financement, et les mettre en débat.
En résumé, il s’agit de tendre vers un trésor européen responsable politiquement. Cela est bien différent de la proposition des coronabonds (ou feu des eurobonds), qui ne faisaient qu’acter la création d’une agence de la dette à l’échelle européenne, convertie aux canons de la marchandisation de la monnaie et de la finance, certes bénéficiant d’une super-crédibilité auprès des investisseurs privés mais, au nom de celle-ci, imposant en retour la discipline budgétaire et monétaire aux États considérés comme dispendieux par ces mêmes modes d’évaluations marchands. Si ce nouveau régime de puissance publique créancière, et investisseuse, devait se traduire par de l’inflation, celle-ci serait la résultante d’un choix démocratique, et non d’une décision technocratique, un choix qu’il serait possible d’adapter au gré des intérêts sociaux en jeu.
Edoardo Ferlazzo : Je rejoins complètement les analyses de Benjamin Lemoine. J’aimerais y ajouter deux remarques, pour élargir le spectre au-delà des seuls enjeux du remboursement des dettes publiques, auxquels les solutions que vous proposez répondent directement.
D’une part, la question de la fiscalité mérite aussi d’être posée, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. La mise en œuvre d’un impôt sur les entreprises commun au niveau européen, dont les recettes pourraient servir à abonder un budget européen aujourd’hui peu doté comparativement aux potentiels de contribution des économies européennes, nécessiterait par exemple d’être mis en débat, afin de saisir quel pourrait être son apport pour répondre notamment aux enjeux écologiques.
D’autre part, il me semble que cette problématique de la fiscalité européenne cristallise plus généralement la nécessité de mettre en discussion le dogme de la concurrence, qui prévaut au sein des instances européennes et qui empêche de porter de grands projets, de transition écologique par exemple. Remettre en cause cette doctrine marchande et concurrentielle nécessite de rouvrir la question des mandats de la BCE bien sûr, mais aussi d’interroger la totalité de l’architecture technocratique de l’UE et de son ouverture à des processus plus démocratiques.
Benjamin Lemoine :
Edoardo Ferlazzo :
Pour poursuivre vos lectures, retrouver ICI l’ensemble des articles #Covid-19

Interview de Flore BERLINGEN
Directrice du Cniid (Centre national d’information indépendante sur les déchets). Co-fondatrice de OuiShare

Étude
Étude qualitative de diagnostic : représentations et pratiques des habitant.e.s du Grand Lyon.

Interview de Caitlin McMullin
Associate Professor au Department of Social Sciences and Business de l’Université Roskilde
Comment les pratiques de coproduction de services publics implique les citoyens ?
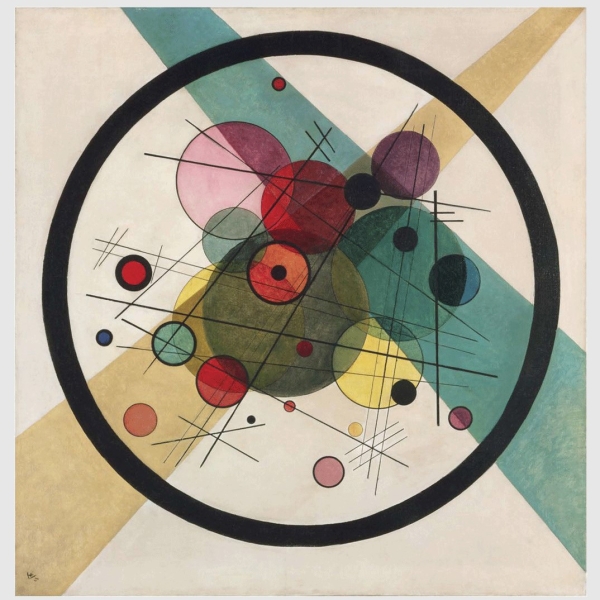
Article
Les entreprises et les collectivités doivent adopter une approche collective de transformation à la bonne échelle : celle de leurs « milieux ».

Étude
Comment évaluer son degré de déploiement ? Quels indicateurs privilégier avec quels objectifs ?
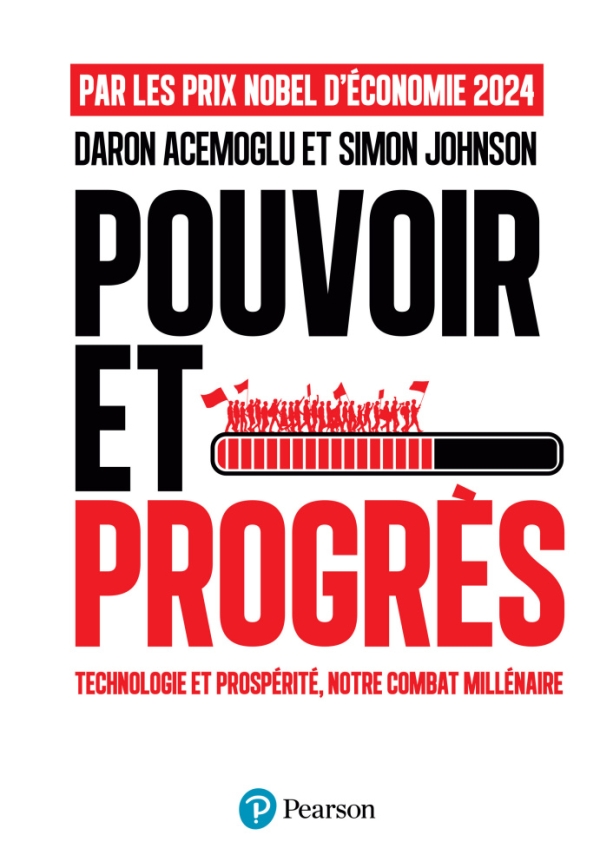
Article
Si l’IA peut automatiser des tâches répétitives et libérer du temps pour des activités plus créatives, elle menace également de nombreux emplois.

Article
Quels secteurs sont amenés à décroître, et quels autres vont au contraire devoir recruter ?

Interview de Bertrand Foucher
Directeur général d’ONLYLYON & CO
Comment mettre en œuvre une stratégie de robustesse ? Bertrand Foucher nous explique dans cet entretien les nouvelles modalités de son action.

Interview de Éléonore Gendry
Chercheuse à l’Université Lumière Lyon 2 dans le cadre d’un programme de recherche sur la ville durable et les bâtiments innovants
L’usine moteurs Renault Trucks d’aujourd’hui donne à voir une activité productive proche de la logistique.