L'enjeu du circuit économique local
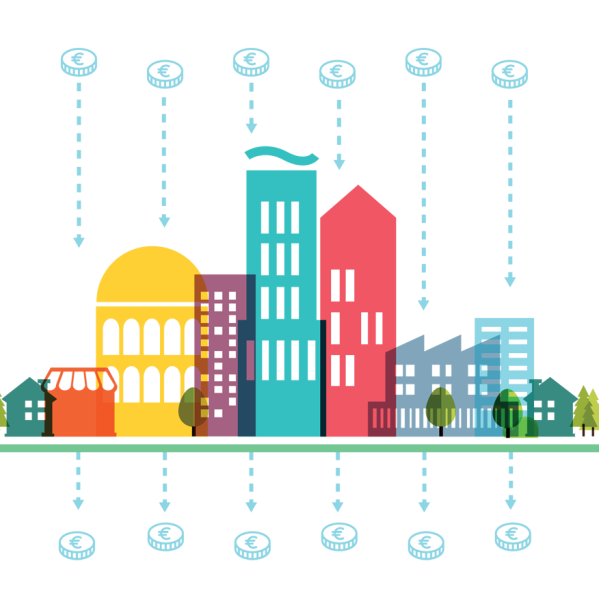
Étude
Cette étude présente quelques enseignements clés issus de l'étude exploratoire " développer l'économie de proximité" conduite par la Direction de la prospective et du dialogue public de la Métropole de Lyon.
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Magali TALANDIER
<< Les rares économistes s'intéressant au territoire tendent à décliner spatialement l'analyse des facteurs de croissance économique en se focalisant sur les clusters, pôles de compétitivité et autres systèmes productifs localisés >>.
Interview réalisée dans le cadre de la démarche Grand lyon Vision Solidaire
Les travaux de recherche de Magali Talandier, portent sur l’analyse des processus de développement territorial. Elle a notamment beaucoup travaillé sur la question du développement résidentiel et touristique, sur la mobilité ou encore sur l’impact des politiques intercommunales. Elle a également réalisé de nombreuses expertises en matière de développement économique local pour les DDE, DRE, collectivités territoriales, le ministère de l’écologie, la Datar, la Poste, l’Unesco.
Vous faites partie avec Laurent Davezies, de la poignée de chercheurs qui travaillent sur la circulation des revenus entre les territoires locaux. Comment expliquez-vous que cette approche soit encore peu répandue dans la communauté académique ?
Pendant longtemps, l’une des explications avancées a été le manque de données sur la circulation des revenus. Or, nos travaux montrent que les données existent. Aujourd’hui cette explication ne tient plus. Plus largement, je pense que cela tient au fait que les diagnostics et analyses territoriales sont encore trop souvent réalisées en travaillant sur les variations de stocks (de personnes, de revenus, d’emplois etc.) plutôt que sur les flux interterritoriaux. Par ailleurs, les rares économistes s’intéressant au territoire tendent à décliner spatialement l’analyse des facteurs de croissance économique en se focalisant sur les clusters, pôles de compétitivité et autres systèmes productifs localisés. Une dernière difficulté réside dans le fait que l’on se trouve à l’interface entre plusieurs disciplines, l’économie, la géographie, l’aménagement.
N’est-ce pas aussi le reflet du tropisme des services de développement économique local pour les questions de croissance et de compétitivité ?
Effectivement, dans la plupart des services de développement économique des collectivités, même dans les communautés de communes, quand on vous parle de développement économique, on va vous parler en priorité des zones d’activités, des actions ciblées pour attirer de nouvelles entreprises, de préférence des multinationales… Les discours et les schémas de pensée sont quasiment les mêmes dans les grands villes et dans les endroits reculés.
Nos travaux sur l’économie résidentielle leur restent encore étrangers. Pour ceux qui ont eu écho de nos analyses, il y a eu une époque de malentendus. On nous a taxés d’être des promoteurs de l’économie résidentielle contre l’économie productive. Pourtant, aucune de nos publications ne verse dans le discours normatif. Nous n’avons jamais dit que le tout résidentiel était la seule voie souhaitable. Au contraire, dès le départ, les travaux de Laurent Davezies ont souligné le fait que sans production de richesses, aucune redistribution n’est possible. En fait, la difficulté est d’arriver à faire comprendre qu’il y a deux leviers complémentaires de développement économique territorial : le productif et le résidentiel. De la même manière que l’on peut accompagner le développement des activités exportatrices pour enrichir le territoire, on peut également jouer sur les flux de revenus résidentiels – pensions de retraire, revenus dortoirs, dépenses touristiques – pour capter du revenu.
Peut-on revenir justement sur le fondement théorique de vos travaux, la théorie de la base, pour comprendre comment coexistent ces logiques productive et résidentielle ?
Les travaux sur l’économie résidentielle initiés par Laurent Davezies revisitent en effet la théorie de la base développée au début du 20ème siècle par le sociologue allemand Werner Sombart. Selon cette théorie, le développement des territoires dépend de deux mécanismes : de leur capacité à capter du revenu à l’extérieur et de leur capacité à redistribuer ces revenus dans leur économie locale sous la forme de dépenses de consommation. Cette approche distingue ainsi deux grands secteurs d’activités au sein d’un territoire. On a d’un côté les activités à vocation exportatrice, c’est le secteur « basique ». D’un autre côté, nous avons le secteur « domestique » qui est tourné vers la demande locale de biens et de services. Dans ce cadre, le secteur basique est considéré comme le moteur de l’économie local en ce qu’il permet de capter des revenus qui viennent stimuler l’essor du secteur domestique.
Ce qu’apporte de nouveau la notion d’économie résidentielle à ce schéma, c’est de montrer qu’il existe des bases non productives, c’est-à-dire des mécanismes de captation de revenus qui ne reposent pas sur la création préalable de richesses. Quatre bases différentes sont distinguées. Tout d’abord la base productive, dont on a vu qu’elle est au cœur de la théorie de la base. La base publique, ensuite, traduit le fait que certains emplois publics locaux ne sont pas financés localement mais par le biais de dotations en provenance d’une administration extérieure au territoire. La base sociale, quant à elle, renvoie aux divers transferts publics de revenu prévus par la protection sociale dont bénéficient les habitants. Enfin, la base résidentielle comprend les revenus dont bénéficient les actifs qui résident sur le territoire mais travaillent ailleurs, les pensions de retraites versées aux retraités résidants sur le territoire, les dépenses des touristes présents sur le territoire. La notion d’économie résidentielle a permis justement de souligner le poids de cette dernière base qui représente en moyenne la majeure partie des revenus captés par un territoire, que l’on raisonne à l’échelle des communes, des agglomérations, des zones d’emplois ou encore des régions. Plus précisément, la notion d’économie résidentielle est venue faire le lien entre ces flux de revenus et les choix résidentiels et récréatifs des individus. En ce sens, développer l’économie résidentielle consiste à développer les atouts résidentiels au sens large des territoires, c’est-à-dire tout ce qui participe à attirer des touristes et des ménages retraités et actifs.
Pourquoi avoir inclus les pensions de retraite à la base résidentielle ? Il peut paraitre plus naturel de les intégrer à la base sociale ?
Les stratégies résidentielles des retraités ne sont pas conditionnées par des préoccupations liées au marché de travail (base productive) et leur mobilité est souvent source de régénération économique pour de nombreux territoires. Les atouts territoriaux requis pour favoriser l’attractivité auprès de cette population sont de nature résidentielle, récréative et donc en lien direct avec l’économie résidentielle. La base sociale caractérise plutôt des revenus de prestations sociales et une population précaire.
Est-il juste de considérer que toutes les activités d’un territoire puissent être réparties entre sphère productive et sphère domestique ? La réalité économique est-elle aussi tranchée ?
Vous avez raison, la réalité est loin d’être binaire. Lorsque l’on prend la Nomenclature d’Activités Françaises (NAF) grâce à laquelle l’Insee découpe l’ensemble des activités du pays en 732 classes différentes, on peut assez facilement répartir une grande partie des activités entre la sphère productive et la sphère domestique. Certaines activités apparaissent clairement productives au sens où elles se produisent et exportent la majeure partie de leur production à l’extérieur du territoire. Ce sont l’agriculture, l’industrie, la R&D, etc. D’autres activités peuvent être considérées comme ayant pour principale vocation de satisfaire les besoins de la population présente sur le territoire. On pense ici au commerce, à la santé, à l’enseignement, à l’hôtellerie-restauration, aux services à la personne, etc.
Pour autant, il existe toute une partie des activités qui ne peuvent être affectées spontanément à l’une ou l’autre de ces catégories simplement en lisant l’intitulé de la NAF. Tout simplement parce que ces activités combinent les caractéristiques des deux autres sphères : elles ne sont pas tournées principalement vers la demande locale ou vers la demande extérieure, et ne s’adressent pas principalement aux ménages ou entreprises. Je pense à la construction, aux services aux entreprises, au commerce de gros, aux activités bancaires et d’assurance mais aussi à une partie des activités relevant du domaine public et qui rayonnent au-delà du bassin de vie locale comme les universités par exemple. Or, cette sphère mixte rassemble la plus grande partie de l’activité et des emplois, et c’est celle qui progresse le plus. Ce troisième ensemble présente donc un véritable intérêt. J’ajoute que cette sphère mixte ne doit pas être considérée comme un ensemble par défaut, simplement déduit des sphères productive et domestique.
Le fait que des activités combinent des caractéristiques exportatrices et domestiques constitue une réalité et, au-delà, peut constituer un atout, cette combinaison pouvant offrir plus d’agilité à ces activités pour faire face aux évolutions économiques. De ce point de vue, vous comprendrez que je suis plutôt sceptique par rapport à la grille d’analyse de l’Insee qui distingue seulement deux sphères, la sphère présentielle et la sphère non présentielle, laissant dans le flou cette sphère mixte. Des diagnostics territoriaux peuvent être complètement faussés si l’on s’en tient à cette logique binaire. D’autant plus que je me rends bien compte lors des études de terrain que je conduis que l’approche en trois sphères apparait naturelle aux yeux des personnes que je rencontre. D’une certaine manière, c’est du bon sens.
L’attention portée à la captation de revenus peut amener à penser qu’elle détermine l’ensemble des revenus d’un territoire. Or, l’économie domestique contribue également aux revenus qui sont disponibles localement. Quel est le poids de ces revenus domestiques dans l’économie locale ?
De la même manière que l’on peut mesurer les revenus captés par un territoire, on peut mesurer les revenus issus des activités domestiques. Il est difficile pour moi de généraliser dans la mesure où je n’ai pas travaillé de façon exhaustive sur ce sujet, mais on peut indiquer que, sur un territoire comme celui du Scot grenoblois, les revenus issus des activités domestiques représentent environ 1/3 des revenus captés, c’est-à-dire de l’ensemble des bases : productive, publique, sociale et résidentielle. Cela suggère que le poids des revenus captés dans l’ensemble des revenus disponibles sur un territoire est largement prédominant.
La théorie de la base suggère également qu’il ne suffit pas de capter des revenus pour assurer le développement d’un territoire, encore faut-il que ces revenus soient dépensés localement. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Capter des revenus extérieurs constitue en effet une étape essentielle du développement territorial, une condition nécessaire mais non suffisante. Il s’agit également de faire circuler les revenus au sein du territoire en maximisant la dépense locale. Rien ne sert de capter des montagnes de revenus si ces derniers s’évadent pour, in fine, être dépensés ailleurs. Et de la même façon qu’au jeu de la circulation des revenus, tous les territoires ne sont pas égaux entre eux, ce que l’on appelle la propension à consommer localement varie d’un espace à l’autre.
Par exemple, certains territoires disposant d’une base productive dynamique rencontrent dans le même temps des difficultés pour transformer les revenus ainsi captés en consommation locale. Le département de Seine-Saint-Denis en est un bon exemple. De même, d’autres territoires présentant une base résidentielle importante grâce à une forte attractivité touristique peuvent très bien ne pas profiter de la manne financière qu’ils captent, notamment lorsque l’activité touristique qu’ils accueillent est accaparée par quelques grands groupes hôteliers qui ont tôt fait de rapatrier ailleurs les gains qu’ils tirent de cette activité. Cette question de la circulation des revenus au sein même des territoires n’est pas accessoire : maximiser la propension à consommer localement permet de limiter les évasions de richesses et ainsi entretenir le marché local de l’emploi domestique dont on sait qu’il constitue une réponse tout à fait opportune au chômage des actifs peu ou pas qualifiés.
A cet égard, le rapport entre les revenus captés et le nombre d’emplois domestiques est-il le meilleur indicateur disponible pour rendre compte de la capacité d’un territoire à faire circuler les revenus en son sein ?
Le meilleur, je ne sais pas, mais c’est en soit une information très précieuse. D’autant que nous disposons de très peu de choses sur ces questions de géographie de la consommation.
Qu’est ce qui influe sur la propension à consommer localement ?
De la même manière que l’on observe un décalage entre lieu(x) de travail et lieu(x) de résidence, il peut exister un décalage entre lieu(x) de résidence et lieu(x) de consommation. C’est un domaine qui reste encore largement à défricher, et sur lequel je travaille actuellement. Ce que l’on peut dire à ce stade c’est que l’existence et la qualité de l’offre locale constitue évidemment une donnée déterminante. On ne peut pas évidemment consommer localement s’il n’y a pas de commerces ou de services disponibles. De ce point de vue, on remarque que l’évasion en termes de revenus que connaissent les agglomérations au profit du périurbain peut se trouver en partie compensée par un mouvement inverse en termes de dépenses de consommation, les habitant du périurbain venant consommer dans l’agglomération centre. A cet égard, les enquêtes de consommation conduites par les CCI offrent des éléments intéressants pour mesurer les phénomènes de polarisation et d’évasion commerciales et donc les aires de chalandises associées à chaque activité. On se rend compte que certaines consommations engendrent davantage de mobilité que d’autres.
D’ailleurs, dans un article qui va paraitre prochainement dans la revue Norois, j’étudie plus précisément les équipements qui structurent les mobilités quotidiennes des ménages. Par exemple, l’équipement le plus courant dans les territoires, c’est-à-dire celui que l’on trouve en parcourant le minimum de distance, c’est le restaurant.
De ce point de vue, l’essor du commerce électronique ne constitue-t-il pas une menace pour l’économie de proximité ?
On peut effectivement observer une évasion commerciale résultant d’achats effectués sur internet. Les enjeux ne sont pas minces en termes d’emplois. Et pourtant, ici aussi, les services de développement économique semblent peu réactifs. Ce sont peut-être les CCI qui paraissent les plus mobilisées sur le sujet. Même sur un plan académique, nous avons là une problématique qui reste sous-explorée. J’ajoute que l’enjeu ne concerne pas seulement les territoires urbains où se concentre l’offre de commerces et de services. Le commerce électronique concerne les territoires ruraux dans le sens où, d’un côté il concurrence les commerces existants, mais d’un autre côté il contribue à leur repeuplement en permettant à ceux qui y habitent d’accéder à distance à une grande partie de l’offre de biens et de services. Par exemple, il participe d’un mouvement de délocalisation des professions intellectuelles vers le rural, que l’on a du mal à appréhender par ailleurs.
Pour autant, il faut relativiser les effets du commerce électronique. On observe en effet que la partie la plus dynamique de la structure de consommation des ménages est celle des services : l’éducation, la santé, le sport, la culture, etc. Or, l’accès aux services se fait généralement dans la proximité. Deuxièmement, la fonction achat revêt de plus en plus une dimension de loisir. Le succès des boutiques ouvertes le dimanche le montre bien ! Enfin, les commerces de proximité ou bien encore la vente directe du producteur au consommateur se mettent à l’heure d’internet. Autrement dit, ce n’est jamais blanc ou noir, tout ou rien, ce n’est pas le productif ou le résidentiel, le présentiel ou le non présentiel, le commerce ou l’entreprise, le local ou le global, la proximité ou le e-commerce… On vit dans des systèmes temporels et territoriaux complexes, trop les simplifier n’en facilite pas, à mon avis, la compréhension.
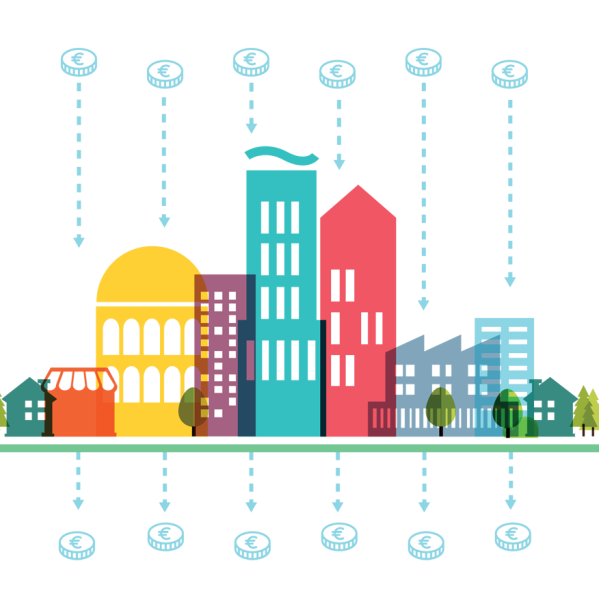
Étude
Cette étude présente quelques enseignements clés issus de l'étude exploratoire " développer l'économie de proximité" conduite par la Direction de la prospective et du dialogue public de la Métropole de Lyon.

Interview de Armand ROSENBERG
Directeur de Val Horizon

Étude
Ce premier volet consacré à l'emploi propose une approche quantitative de l’économie de proximité de façon à mettre en évidence son poids réel dans l’économie nationale.

Étude
Ce second cahier s’intéresse à la manière avec laquelle la prise en compte de l’économie de proximité réinterroge les politiques de développement économique déployées à l’échelle des métropoles.

Étude
Ce troisième cahier explore le ressort de la captation de revenus. Comment consolider l'attractivité résidentielle et touristique de la métropole ?

Étude
Ce quatrième cahier amorce la réflexion sur les leviers stratégiques permettant de favoriser la consommation locale dans la métropole lyonnaise.

Étude
Les leviers d'un territoire pour faire en sorte que la demande des acteurs économiques locaux soit davantage satisfaite par une production de proximité. Ce cinquième cahier aborde le ressort de la production locale.
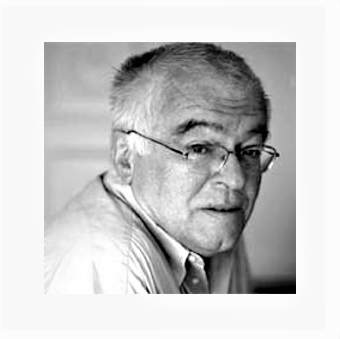
Interview de Laurent DAVEZIES
Professeur d'économie au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Interview de Arthur Bard
Cofondateur de France Barter, plateforme collaborative d’échange interentreprises.

Interview de Leïa Abitbol
Docteure en sciences de gestion et fondatrice d’Aldérane, facilitateur de synergies inter-entreprises et de démarches d’écologie industrielle.

Interview de Florian Julien-Saint-Amand
Florian Julien-Saint-Amand évoque l’inflexion de la démarche d’économie circulaire de la CCI en faveur d’une approche centrée sur les besoins et ressources actuels des entreprises.

Interview de Paul Boino
Maître de conférences à l'Institut d'Urbanisme de Lyon (Lyon2)
"Lorsque Lyon, Saint-Etienne et Bourgoin mettent en place le G3, elles font un acte politique. Elles affirment que l'avenir de la gouvernance de l'aire métropolitaine relève non pas de structures départementales …"

Interview de Cyril KRETZSCHMAR
"L'économie de proximité permet de retrouver le sens même de l'économie, qui est de répondre aux besoins humains".

Interview de Magali TALANDIER
Maître de conférences à l'Institut de Géographie Alpine (IGA) de l'Université Joseph Fourier de Grenoble

Interview de François GAILLARD
Directeur général de l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Lyon

Interview de Olivier CREVOISIER
Professeur au Groupe de recherche en économie territoriale (GRET) de l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel

Interview de Gabriel Colletis
Professeur d'économie à l'Université de Toulouse 1

Interview de Philippe MOATI
Philippe Moati revient sur les enjeux que soulèvent deux grandes mutations de la société de consommation.

Interview de Raphaël SOUCHIER
Consultant européen économies locales soutenables
"Promouvoir la relocalisation de l'économie n'est pas remettre en cause le principe d'ouverture économique. Il s'agit plutôt de repenser, en la rééquilibrant, notre conception de la mondialisation"

Interview de Jean-Christophe MENZ
PDG de Cook&Go

Interview de Marc DAVID
Responsable du service « animation réseaux commerce » de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon (CCI de Lyon).

Interview de Gerard Magnin
Délégué général de 1994 à 2014, Energy Cities est l'Association européenne des villes en transition énergétique.

Interview de Geneviève BECOULET
Geneviève Decoulet est manager de centre-ville et coordinatrice de l'économie locale à Sceaux.

Interview de Jean VIARD
Jean Viard est sociologue et directeur de recherche CNRS au CEVIPOF.

Interview de Niels MARTIN
Niels Martin est doctorant en géographie au laboratoire PACTE-Territoires de l'Université Joseph Fourier de Grenoble.

Interview de Hugues Béesau
Directeur de l'ingénierie de Rhône-Alpes Tourisme (MITRA)

Interview de Sophie MANDRILLON et Marie-Laure DESMET
Sophie Mandrillon et Marie-Laure Desmet évoquent les efforts engagés par les métropoles françaises, et notamment Lyon, pour se positionner sur le marché européen du tourisme urbain.

Interview de Flavie BAUDOT
Directrice d'European Cities Marketing (ECM)

Interview de Caitlin McMullin
Associate Professor au Department of Social Sciences and Business de l’Université Roskilde
Comment les pratiques de coproduction de services publics implique les citoyens ?
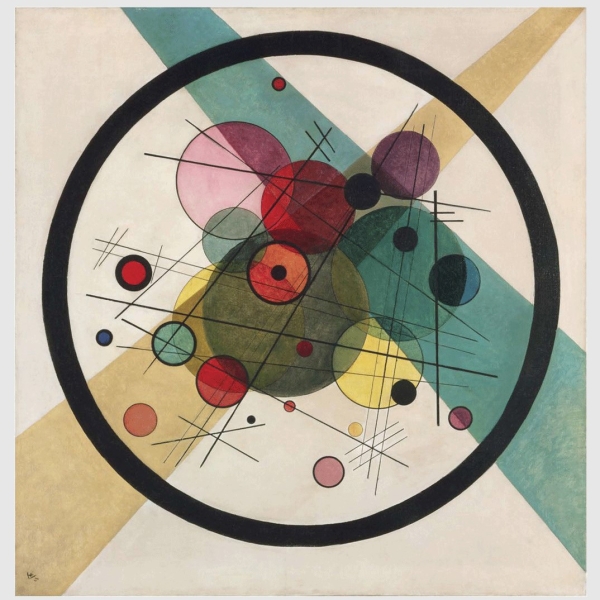
Article
Les entreprises et les collectivités doivent adopter une approche collective de transformation à la bonne échelle : celle de leurs « milieux ».

Étude
Comment évaluer son degré de déploiement ? Quels indicateurs privilégier avec quels objectifs ?
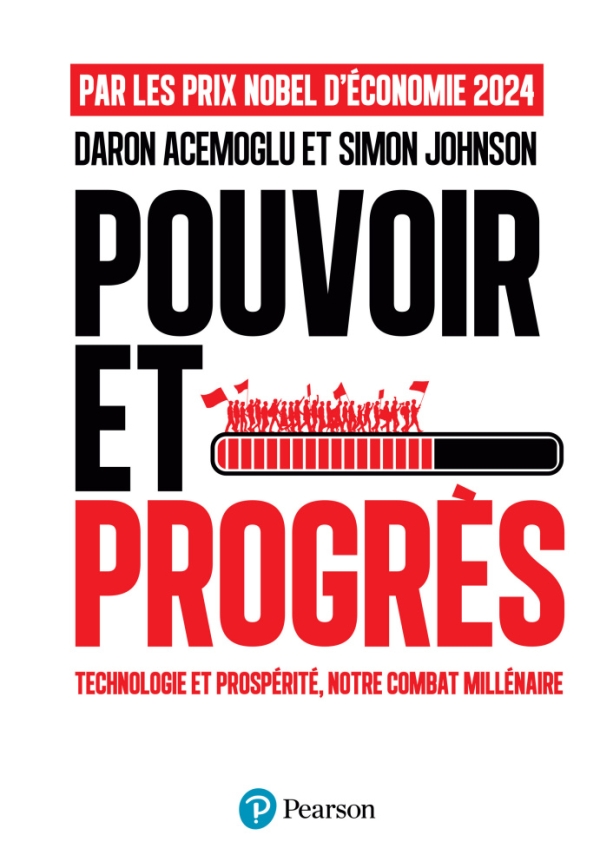
Article
Si l’IA peut automatiser des tâches répétitives et libérer du temps pour des activités plus créatives, elle menace également de nombreux emplois.

Article
Quels secteurs sont amenés à décroître, et quels autres vont au contraire devoir recruter ?

Interview de Bertrand Foucher
Directeur général d’ONLYLYON & CO
Comment mettre en œuvre une stratégie de robustesse ? Bertrand Foucher nous explique dans cet entretien les nouvelles modalités de son action.

Interview de Éléonore Gendry
Chercheuse à l’Université Lumière Lyon 2 dans le cadre d’un programme de recherche sur la ville durable et les bâtiments innovants
L’usine moteurs Renault Trucks d’aujourd’hui donne à voir une activité productive proche de la logistique.

Interview de Alexandre Monnin
Directeur du POPSU Transition Nice Côte d'Azur, Membre du comité scient. de CY École de design et France Villes et territoires Durables
Arrivés aux limites du système terre, et si nous nous intéressions maintenant à cet espace oublié : ce qui est à garder, ce qui reste ?

Article
Découvrez nos sept leviers à actionner pour consolider l’économie de votre territoire et améliorer sa soutenabilité !