Ce que le territoire fait à l’économie (et aux entreprises)
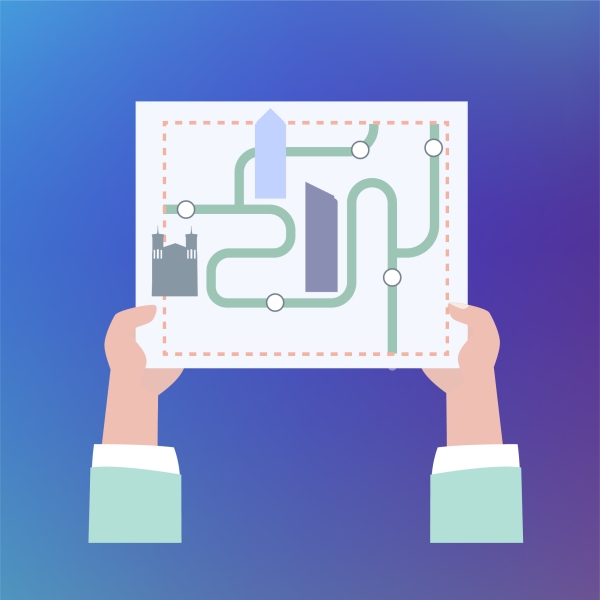
Article
Entre soutenabilité et exploitation des ressources, chaque décision ouvre la porte à un dilemme !
Interview de Alexandre Monnin

« On ferme » : pour une entreprise, la formule sonne souvent comme un aveu d‘échec, une lutte perdue, la fin d’une activité dans laquelle entrepreneurs, dirigeants et salariés se sont investis souvent avec passion.
Évidemment, les entreprises vivent, meurent ou se transforment. Heureusement, les activités se renouvellent. La vie économique s’intéresse surtout au remplacement de l'ancien par le nouveau.
Pour autant, beaucoup d’activités se maintiennent vaille que vaille retardant parfois l’inéluctable.
Nos territoires sont marqués par la sédimentation, parfois encombrante, de ces survivances et des ruines héritées.
Arrivés aux limites du système terre, et si nous nous intéressions maintenant à cet espace oublié : ce qui est à garder, ce qui reste ?
Le premier ouvrage qui vous a fait connaître est collectif. Avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, vous avez co-écrit Héritage et Fermeture. Pourquoi et comment ce travail est-il né, et quel en était l’objectif ?
J’avais déjà publié avant, mais des livres ou des revues cantonnés au monde académique. Ce qui était très bien.. Ce projet est né d’un constat : nous réfléchissions aux enjeux de la fermeture avec Diego Landivar depuis 2015. J’avais rencontré Diego en 2013 à Cerisy, à l’occasion d’un colloque réunissant Bruno Latour, Eduardo Viveiros de Castro, Philippe Descola, Isabelle Stengers, etc.
Deux ans plus tard, j’ai été invité par l’anthropologue Jean-Louis Tornatore à intervenir lors d’un colloque sur le patrimoine, à Dijon. Les historiens des sciences et des techniques Jean-Baptiste Fressoz et François Jarrige y intervenaient également. Et c’est là que le premier déclic a eu lieu : cette question du patrimoine, à laquelle je ne connaissais pas grand-chose, m’a amené à problématiser l’enjeu de la fermeture.
Déclosion, instauration, forclusion, destauration : de quoi s’agit-il ?
À travers cette variété de termes, il s’agit tout simplement de penser une dimension alternative à l’ouverture : l’ouverture de nouveaux mondes en particulier. L’ANT a beaucoup insisté sur l’importance du laboratoire et de l’innovation. Dans les deux cas, l’accent est mis sur l’introduction de nouveautés dans le monde. Il ne s’agit pas d’être contre en soi (une sorte de conservatisme ontologique), mais de penser comme je l’ai dit plus haut un envers à ces pratiques.
Moins la destruction ou le sabotage de l’existant, que des savoirs spécifiques pour apprendre à fermer, à ne pas faire advenir, à désintensifier nos attachements matériels et culturels. Diego Landivar a d’ailleurs développé l’idée d’une « Dark ANT » dans Héritage et Fermeture. J’avais moi-même, quelques années auparavant, réfléchi à un Dark Latour — sur le modèle du Dark Deleuze d’Andrew Culp.
Les premières briques étaient posées…
En quelque sorte. Nous avons alimenté ce projet pendant plusieurs années par des interventions, des enquêtes informelles, etc. Nous avons même monté une formation en 2020 avec Emmanuel Bonnet, le master of science Stratégie & Design pour l’Anthropocène. Mais en France, on a beau « faire le travail », sans livre pour l’affirmer et l’afficher, il demeure difficile d’être pris au sérieux.
C’est d’ailleurs ainsi que j’ai été mis en relation avec mon éditeur, Divergences : suite à la lecture d’un de leurs ouvrages, j’ai contacté les auteurs, car, vu la proximité de certains thèmes abordés, je trouvais étonnant qu’ils ne cherchent pas à entamer un dialogue avec nous. Et ils m’ont très gentiment proposé de me mettre en relation avec Johan Badour, fondateur de cette maison d’édition.
L’objectif était de faire entendre un programme de recherche empirique dans l’espace intellectuel. De rendre audible ce qui, jusque-là, avait été traité sur un mode de quasi-performance alors que nous étions très sérieux et comprenions que les problématiques que nous évoquions allaient se généraliser. Le tout en évitant l’écueil d’une inflation rhétorique critique sans conséquences pratiques.
Il fallait également faire une place aux infrastructures, à la technique, et aux futurs obsolètes au moment où dominait une écologie du vivant qui ne ménageait guère de place à ces enjeux. Le projet est aussi né d’un sentiment d’inadéquation : on parlait de transition écologique comme d’un grand récit émancipateur, mais sur le terrain, on constatait des impasses, des fermetures de facto. Que faire quand un secteur, une infrastructure ou une activité n’est plus tenable écologiquement, mais se maintient par inertie ? Héritage et Fermeture répond à cette question en proposant une grammaire pour penser ces situations limites.
Il ne s’agissait pas d’ajouter une couche de diagnostic, mais de proposer un cadre opératoire, un ensemble de concepts et de protocoles — héritage, renoncement, attachement, protocoles de fermeture — qui permettent d’agir en connaissance de cause. Ce travail était lui-même en résonance avec les expérimentations concrètes menées dans des territoires, auprès des entreprises, etc., dans le cadre de la formation que nous avions créée.
Il a aussi ouvert un champ : celui de la redirection écologique, comme réponse aux limites planétaires non par le haut (la gouvernance globale), mais à partir des situations, de leurs prises, de leurs irréversibilités. Ce qui ne signifie pas qu’il faille abandonner les enjeux globaux ou géopolitiques par ailleurs !
Et comment avez-vous été amené à vous intéresser à la finance, et à sa place politique aujourd’hui ?
Un peu par nécessité. En travaillant sur les conditions réelles de la redirection écologique, il devient vite évident que le nerf de la guerre, c’est l’investissement : qui décide, dans quelles conditions, selon quelles temporalités et pour quels actifs ? Le tournant a été la lecture des travaux de Daniela Gabor, en particulier sa critique du Wall Street Consensus, qui montre comment les politiques climatiques sont de plus en plus subordonnées à l’agenda de la dérégulation financière.
La finance verte, loin de transformer la logique d’accumulation, en raffine les instruments : elle sélectionne des projets « bancables » et évacue tout ce qui relève de la réappropriation collective. C’est une forme de capture insidieuse des politiques publiques, où l’État se mue en risk mitigator au service de la rentabilité privée. Il faut entrer dans ces mécanismes pour décrypter la nature de l’économie politique actuelle. Ce fut sans doute aussi le projet de Marx en son temps ! Cela oblige quelque peu à courir derrière son ombre, car c’est un monde qui mute plus rapidement que nos capacités à l’analyser.
Vous avez proposé de penser une « économie du soin aux communs négatifs ». Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
C’est une tentative pour déplacer le regard : de la transition comme promesse d’innovation vers la redirection comme prise en charge d’un héritage problématique. Les communs négatifs désignent ces passifs collectifs que nous ne pouvons ni valoriser ni ignorer : infrastructures obsolètes, déchets toxiques, pollutions irréversibles, héritages culturels et conventions mortifères, etc.
Il ne s’agit plus seulement de produire, mais de réparer, maintenir, démanteler. Cette économie du soin suppose des formes de travail patient, souvent invisibilisées, qui n’ont pas leur place dans les circuits de valorisation habituels.
Par exemple, le projet de Sécurité sociale de la Redirection écologique (SSRE), initiée par Paule Bichi (à qui je rends hommage) et Lionel Descamps au sein du Réseau Salariat, et portée avec l’Institut Rousseau, des syndicats, l’Agence pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), etc., vise à reconnaître et sécuriser ces engagements. Elle permet d’abord de quitter son emploi et de reprendre la main sur la production, en soutenant des formes d’engagement orientées vers le retrait — par exemple, le travail de terrain avec les travailleuses et les travailleurs pour recenser des futurs obsolètes, identifier des installations à démanteler, documenter des situations problématiques ou accompagner la transformation d’équipements devenus caducs.
C’est aussi la possibilité de réévaluer collectivement ce qui mérite d’être soutenu ou abandonné, à partir des situations elles-mêmes, en sortant des logiques d’optimisation ou de rentabilité. Cela suppose de reconnaître l’intelligence pratique de celles et ceux qui connaissent ces milieux de l’intérieur, et d’organiser avec elles et eux une prise en charge active : ce qui ne se voit pas, ce qui s’évite, ce qui s’assume à long terme.
Dans cette réflexion sur la redirection, quelle place donnez-vous à la comptabilité ?
Elle est centrale. Comme le montre Pierre Musseau-Milesi dans un article récent, la comptabilité peut être elle-même considérée comme un commun négatif : elle perpétue des logiques d’extraction et de profit sous couvert de neutralité technique. Hériter de la comptabilité, ce n’est pas tout conserver : c’est discerner ce qu’il faut renoncer à piloter, à quantifier de manière instrumentale. Les modèles comme la Comprehensive Accounting in Respect of Ecology (CARE), ou les recherches en comptabilité critique, explorent des voies alternatives, fondées sur la communalité et la gouvernance partagée.
Cela suppose de repenser la mesure non comme outil de contrôle, mais comme langage commun appuyé sur des indicateurs discutables et discutés, permettant de rendre visibles les arbitrages effectués, les responsabilités assumées et les soutiens mobilisés. C’est une aide à la décision collective, pas un substitut à la politique.
Comme le souligne Pierre Musseau-Milesi, la comptabilité actuelle fonctionne trop souvent comme une technologie de validation automatique des projets déjà inscrits dans des logiques d’extraction. Elle homogénéise des réalités hétérogènes, évacue les arbitrages qu’elle prétend objectiver, et alimente une gouvernance par les chiffres, délégitimant d’autres sources de concernement. En ce sens, elle participe à l’appauvrissement des capacités de jugement.
Dans tes travaux, vous insistez souvent sur la notion d’attachement. En quoi cela renouvelle-t-il la manière de penser les marchés ?
J’ai été marqué par les travaux de Michel Callon sur les marchés. Il montre qu’ils ne sont pas des lieux où des préférences préexistantes se rencontrent, mais des dispositifs d’attachement, qui formalisent, intensifient, et parfois arrachent des habitudes ou des émotions. Penser en termes d’attachements, comme nous y invite Callon, mais aussi Latour et Antoine Hennion, c’est ouvrir la possibilité de les réorienter, voire de les démarchandiser.
C’est ce qu’Émile Hooge appelle le démarketing — l’expression existait déjà, mais pas pour désigner la même chose. Cela nous oblige à prendre au sérieux les processus qui rendent certaines pratiques désirables — ou au contraire, les rendent inavouables ou impensables. Rediriger un marché, c’est donc moins interdire que recomposer des attachements, reconfigurer ce qui fait tenir ensemble une offre et une demande. C’est aussi un travail d’écoute et de transformation lente, pas de prescription brutale.
Cette attention aux attachements suppose une autre posture : moins surplombante, plus proche des pratiques. Elle permet aussi de mieux comprendre ce qui résiste — non par bêtise ou par conservatisme, mais parce que ce qui nous relie aux choses, aux techniques, aux usages, passe par des expériences vécues, elles-mêmes souvent marquées par des formes de dépossession, ou de désajustement.
Dès lors, rediriger, c’est aussi prendre soin de ces liens et accepter de les requalifier, parfois de les relâcher, sans violence symbolique ou morale. Ce n’est pas pour la beauté du geste : les attachements peuvent être mobilisés, détournés, instrumentalisés par des stratégies de captation — politique comme marketing.
En prendre soin est donc un travail politique crucial — car ce sont ces liens qui déterminent en grande partie nos marges de manœuvre collectives. Cela pourrait d’ailleurs constituer une manière détournée de retrouver des enjeux qui obsédait Bernard Stiegler : le soin contre la destruction de l’esprit, assurée par le marketing (sa vision à cet égard était plus négative que celle de Callon). Soit dit en passant, en faisant de la notion d’attachement une notion centrale pour aborder les enjeux écologiques, la redirection reste fidèle au courant de la sociologie pragmatiste, tout en accordant une centralité et une charge politique qu’elle n’avait pas nécessairement (ou pas de façon visible, disons) jusque-là.
Par ailleurs, elle n’est pas forcément si étudiée que cela en sociologie, la discipline d’où elle est issue. Serge Paugam a publié récemment un gros livre sur ce thème : il ne cite pas Antoine Hennion ! Charles Stépanoff a publié un gros livre récemment à ce sujet : il ne cite ni Paugam ni Hennion ! Ainsi va la recherche…
Alors, concrètement, une autre économie est-elle possible, ou faut-il apprendre à « sortir » de l’économie telle qu’on la connaît ?
Je ne crois pas qu’il faille « sortir de l’économie » au sens d’abandonner tout rapport à l’économie, mais plutôt remettre en cause la manière dont elle articule la valeur, les formes d’activité et les milieux.
Engels lisait les journaux économiques de son temps pour y comprendre le réel. Il savait que l’économie n’est pas seulement un champ disciplinaire, mais une manière d’ordonner le monde, d’identifier ce qui compte — et ce qui ne compte pas. C’est cela qu’il faut interroger : la fabrique de la valeur, ce qui est valorisé ou dévalorisé, ce qui est rendu visible ou invisibilisé dans les circuits d’évaluation dominants.
Je me retrouve partiellement dans les intuitions du courant critique de la valeur — cette idée que ce que nous appelons « économie » repose sur un impensé, une forme fétichisée de la valeur fondée sur la production marchande abstraite, qui persiste même dans les formes alternatives. Mais plutôt que de décréter une sortie théorique pure et dure de la valeur, je m’intéresse à ses recompositions concrètes.
Que vaut ce qui permet d’éviter, de renoncer, de démanteler, de maintenir ? Comment reconnaître ces formes d’engagement sans les réinscrire dans les logiques productivistes qu’elles cherchent à dépasser ? C’est là que se joue la possibilité d’une autre économie : non pas une économie nouvelle par son objet, mais par son architecture — une économie adossée aux milieux, à la pluralité des formes de vie, aux interdépendances concrètes.
Cette économie-là suppose d’autres institutions, d’autres outils d’évaluation, d’autres manières de compter. Elle ne se contente pas de redistribuer les richesses existantes, elle questionne ce qui mérite d’être produit, soutenu, abandonné. En ce sens, elle est moins alternative que réflexive : elle redonne prise à des collectifs sur les conditions matérielles et symboliques de leur propre soutenabilité.
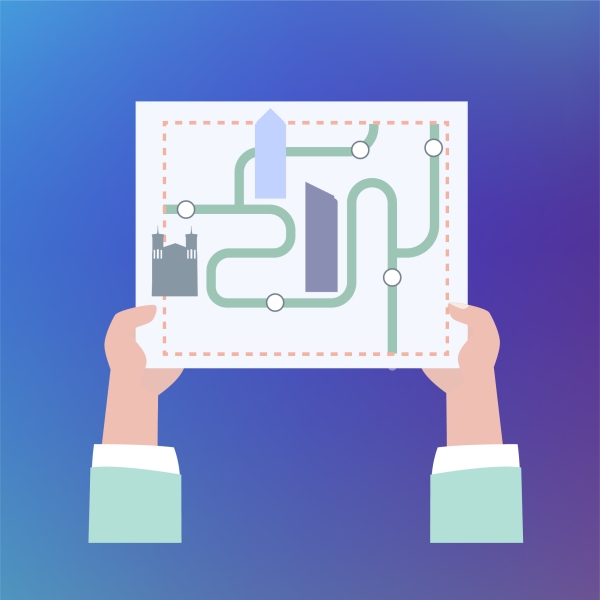
Article
Entre soutenabilité et exploitation des ressources, chaque décision ouvre la porte à un dilemme !

Article
Le défi de la transition économique est immense, complexe, car il implique des transformations des activités et des modèles.
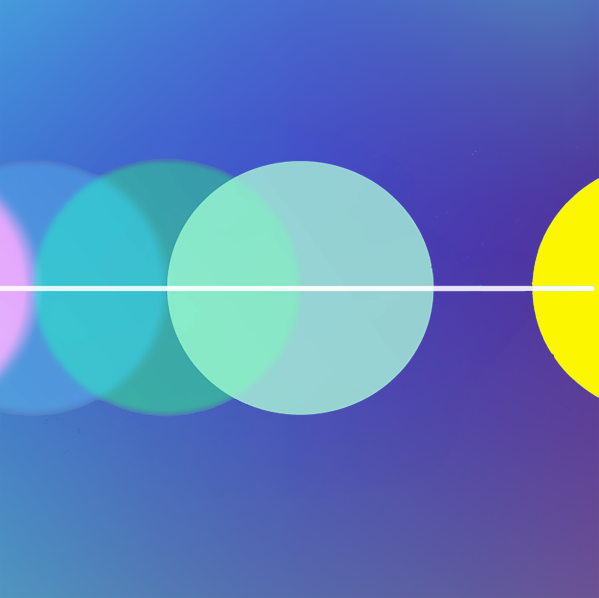
Dossier
Ce dossier donne de premières clefs pour interroger de manière lucide les leviers de transformation de nos entreprises et de leurs modèles.

Article
La pollution de l'eau pourrait coûter très cher à la société.

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?

Article
Pollueur-payeur : un outil efficace contre la pollution de l’eau et les micropolluants ?
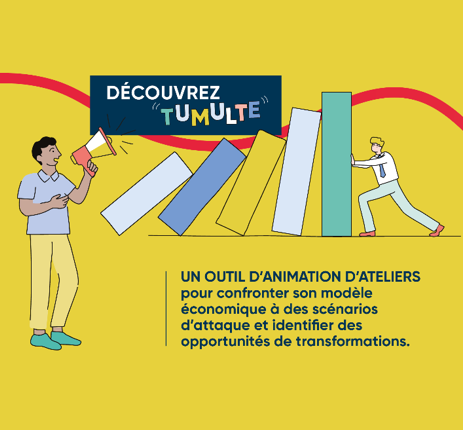
Article
Ce jeu destiné aux entreprises permet de confronter leur modèle économique à des scénarios d’attaque et identifier des opportunités de transformation.

Dossier
Ce dossier propose des grilles d’analyse et un jeu sérieux, « Tumulte », pour aider les entreprises à placer la recherche d’un impact positif au cœur de leur modèle économique.
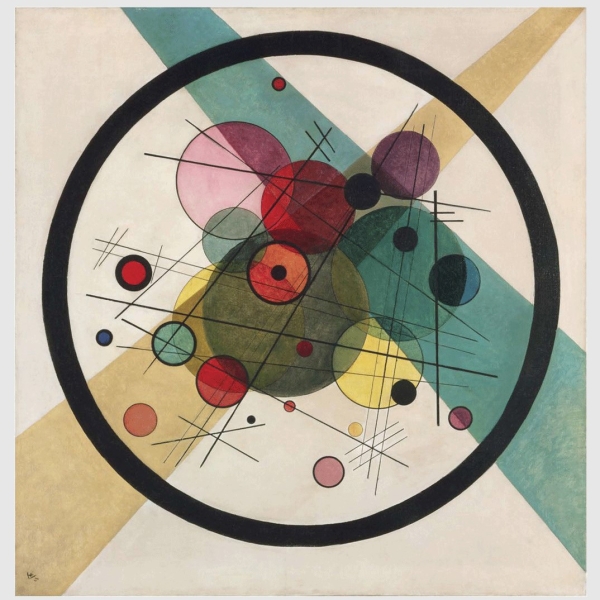
Article
Les entreprises et les collectivités doivent adopter une approche collective de transformation à la bonne échelle : celle de leurs « milieux ».