Des limites planétaires aux frontières du système Terre : quelles implications pour la Métropole de Lyon ? Synthèse

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?
< Retour au sommaire du dossier

Article
En 2009, un groupe d’une trentaine de scientifiques réunis autour du Stockholm Resilience Centre a proposé dans la revue Nature un cadre de référence pour mieux comprendre et identifier les perturbations humaines susceptibles de menacer les conditions de vie sur Terre. Au total, ils ont identifié neuf éléments sur lesquels l’humanité a des effets massifs. Ces pressions sont si fortes qu’elles pourraient perturber les équilibres du « système Terre », en tout cas tels qu’ils se sont stabilisés depuis les débuts de l’Holocène — cet âge climatique qui a débuté il y a environ 12 000 ans, et qui a permis l’invention de l’agriculture et l’émergence des civilisations.
Pour nous maintenir dans un « espace sûr pour l’humanité », les scientifiques préconisent de ne pas dépasser certains seuils, qu’ils nomment des « frontières ». Malheureusement, en 2023, six de ces frontières ont d’ores et déjà été franchies.
En 2023, les préoccupations humaines ont été prises en compte dans le cadre d’un nouveau référentiel. En intégrant les enjeux de justice sociale, ce travail propose de définir non seulement des « frontières sûres du système Terre », mais également des « frontières justes ». Partant du constat que les populations ne sont pas également exposées aux changements en cours, il s’agit alors de se poser la question suivante : quelle limite physique peut être considérée comme juste si l’on considère qu’aucune population humaine ne doit être exposée à des dommages significatifs ?
Huit déterminants du système Terre, parfois différents de ceux du précédent référentiel, ont été retenus. Pour chacun, les scientifiques ont défini une frontière « sûre », qui délimite les conditions permettant de stabiliser le système Terre ; mais aussi une frontière « juste », qui minimise les dommages aux personnes, tout en assurant l’accès à tous aux services et aux ressources essentiels permettant de mener une vie digne. En ajoutant cette dimension de justice sociale, les objectifs à atteindre sont parfois plus ambitieux encore.
Respecter la limite juste et sûre pour le climat (+1 °C) n’est plus possible ; en revanche, nous pouvons encore éviter de franchir la frontière « sûre », en limitant le réchauffement à +1,5 °C au niveau mondial. Ce seuil correspond par ailleurs à l’objectif fixé par l’Accord de Paris sur le climat. Pour y parvenir, il faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre à hauteur d’un certain « budget d’émissions » mondial maximal, qu’il est ensuite possible de répartir entre aujourd’hui et 2050 — date à laquelle nous devrons avoir atteint la neutralité carbone.
Pour savoir ce que cela signifie pour la métropole de Lyon, il faut faire un certain nombre de choix quant à la répartition de ce budget mondial. Cela pose des questions techniques, mais plus encore éthiques. Par exemple, doit-on prendre en compte les émissions du territoire de la métropole, ou doit-on intégrer les émissions importées dans les consommations des habitants ? Doit-on prendre en compte les émissions passées, ou pas ? Les résultats obtenus sont alors très différents…
La limite juste et sûre concernant l’intégrité de la biosphère est mesurée de deux manières.
La première concerne les écosystèmes naturels. Les scientifiques estiment qu’il faudrait que 50 à 60 % de la surface terrestre corresponde à des écosystèmes naturels majoritairement intacts. Seuls 45 à 50 % des écosystèmes peuvent aujourd’hui être considérés comme tels.
La seconde limite concerne les écosystèmes occupés par les humains et leur intégrité fonctionnelle, c’est-à-dire leur capacité à produire différentes fonctions écologiques — comme la pollinisation, la lutte contre les ravageurs ou les maladies, la régulation de la qualité de l’eau, la protection des sols, l’atténuation des risques naturels, etc. La littérature montre que chaque maille de 1 km² de zone anthropisée devrait comporter au moins 20 à 25 % d’habitats semi-naturels diversifiés pour permettre aux espèces indigènes d’assurer ces fonctions. 100 % des surfaces anthropisées devraient respecter cette proportion minimale ; or, à l’échelle mondiale, seul un tiers y parviennent aujourd’hui.
Cette intégrité fonctionnelle présente l’avantage de pouvoir être estimée à l’échelle locale. Par exemple, à l’échelle de la Métropole de Lyon.
La limite juste et sûre concernant l’eau aborde deux aspects : l’eau « verte », qui est utilisée par les végétaux ; et l’eau « bleue », qui alimente les cours d’eau et les aquifères, et dont dépendent les écosystèmes aquatiques. Pour cette dernière, deux ressources sont considérées.
La première concerne les eaux de surface, pour lesquelles une limite est relative à la variation de débit des cours d’eau par rapport aux débits naturels. Cette limite est proposée à +/— 20 % du débit naturel. Au niveau mondial, environ un tiers des écoulements d’eau ne respectent pas cette limite de variabilité pendant au moins un mois dans l’année.
La seconde limite concerne les eaux souterraines. Le principe général retenu est que les prélèvements d’eau dans les aquifères doivent être inférieurs à leur recharge. On estime que, à l’échelle mondiale, ce principe est aujourd’hui globalement respecté, mais avec de fortes disparités : 47 % des aquifères subiraient ainsi des prélèvements supérieurs à leurs capacités de recharge. D’où l’intérêt de territorialiser ces informations, par exemple à la Métropole de Lyon.
Dans le cadre de l’étude à l’échelle de la Métropole de Lyon, trois frontières « justes et sûres » n’ont pas été explorées pour l’instant : le cycle du phosphore, le cycle de l’azote et les aérosols.
Les cycles du phosphore et de l’azote ont été profondément perturbés depuis plus d’un siècle par les activités agricoles, du fait de l’usage trop important d’engrais. Ce déséquilibre entraîne notamment l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques, ou encore la pollution des nappes phréatiques. Les limites sûres et justes proposées pour ces enjeux sont fondées sur la quantité d’azote et de phosphore que les végétaux sont capables de recycler, afin que les surplus ne mettent pas en péril le fonctionnement des écosystèmes. Ces deux frontières sont largement dépassées au niveau mondial, et dans de très nombreuses régions du monde — dont la région lyonnaise.
De son côté, l’émission de particules aérosols a des effets sur le fonctionnement de l’atmosphère et le cycle de l’eau, pouvant perturber la répartition saisonnière et géographique des intempéries comme les moussons. La présence de particules fines a aussi un effet largement documenté sur la santé humaine. Et c’est précisément sur cette dimension sanitaire qu’est fondée la limite sûre et juste concernant les aérosols. Pour les particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (dites PM 2,5), le seuil proposé équivaut à une concentration de 15 µg/m3 d’air. Sur l’agglomération lyonnaise, le seuil réglementaire actuel de 25 µg/m3 est respecté, mais ce n’est pas toujours le cas de la frontière « sûre et juste » de 15 µg/m3.
L’exercice réalisé à la Métropole de Lyon a permis de confronter les travaux universitaires très récents sur les limites du système Terre à la réalité du quotidien d’une collectivité locale. Ce passage des travaux scientifiques internationaux aux préoccupations politiques locales est parfois complexe.
Le référentiel scientifique renvoie en effet à des enjeux qui, pour la plupart, sont encore peu connus du grand public et nécessitent un travail de vulgarisation qui reste largement à déployer. Par ailleurs, la manière la plus pertinente de territorialiser ces frontières planétaires reste une question ouverte, qui fait intervenir des questions techniques (comme la disponibilité des données locales), mais aussi des enjeux éthiques (comme la manière d’imputer un impact global à l’échelle d’un territoire).
Enfin, le cadre des limites du système Terre est pour l’instant moins connu que celui des limites planétaires ou que le « donut » inventé par l’économiste Kate Raworth. Il est encore difficile de savoir si le cadre des limites du système Terre parviendra à s’imposer dans les années à venir. Mais ce n’est pas impossible.
Car le référentiel présente de nombreux atouts. À l’instar de celui des limites planétaires, il permet de décentrer le regard au-delà du seul enjeu climatique, auquel la transition écologique est encore trop souvent réduite. En introduisant un enjeu de justice dans le référentiel des limites planétaires, il présente également l’avantage d’élargir la focale sur une problématique — la solidarité écologique — dont la prise en compte est absolument centrale pour réussir la transition.
Enfin, comparativement à celui des limites planétaires, ce nouveau référentiel est plus facilement déclinable et appropriable à l’échelle locale. En croisant les regards et les attentes des chercheurs et des praticiens, le travail réalisé à la Métropole a d’ailleurs permis une telle appropriation. Cette hybridation des savoirs et des compétences s’est avérée parfois féconde, par exemple en renouvelant l’appréhension de sujets comme l’intégrité de la biosphère, et en révélant la nécessité de mieux considérer la biodiversité dans les espaces très anthropisés de l’Est lyonnais — en milieu urbain, mais aussi en milieu agricole.
Un premier pas, espérons-le, vers une meilleure prise en compte locale des limites du système Terre par les acteurs publics.

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?

Interview de Duli Rashid
Élève ingénieur à l’École des Mines de Saint-Étienne
Les limites planétaires : quelles questions sur le plan scientifique et politique ?

Article
Cet article revient sur quelques-unes des évolutions récentes : les préoccupations relevant de la justice et de la solidarité.

Article
Peut-on mesurer la responsabilité d’un territoire dans ce dépassement ? Et quelles leçons en tirer ?

Article
Appliquée à l’échelle locale, les indicateurs des « frontières du système Terre » participent à renouveler notre regard sur la biodiversité.

Article
Quel état du cycle de l’eau pour les territoires ?

Article
Quelles perspectives pour la Métropole de Lyon ?

Étude
L’Anthropocène ou l’ère géologique dans laquelle l’activité humaine est devenue principale cause des déséquilibres terrestres.
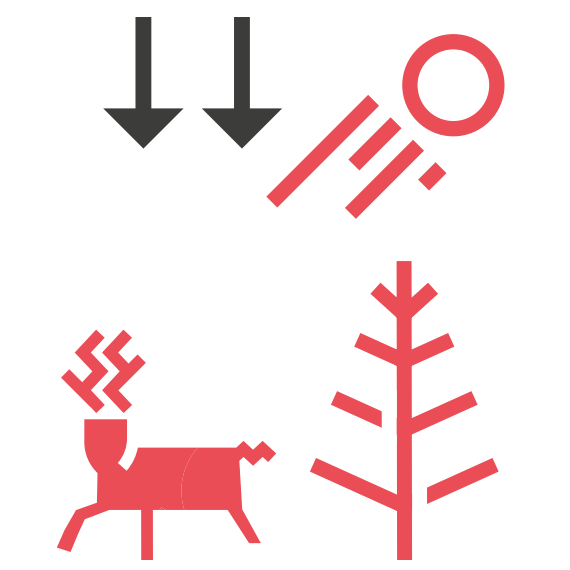
Étude
L’imprudence de l’industrie chimique a failli détruire la barrière de protection naturelle que représente la couche d’ozone.

Dossier
Que sait-on des limites planétaires ? Quelles en sont les causes, les conséquences et quels sont les leviers d’action ?
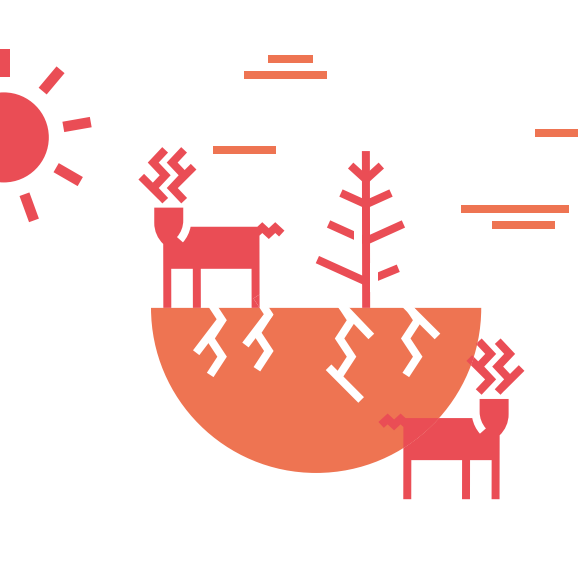
Étude
Ces infographies permettent de comprendre les processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.
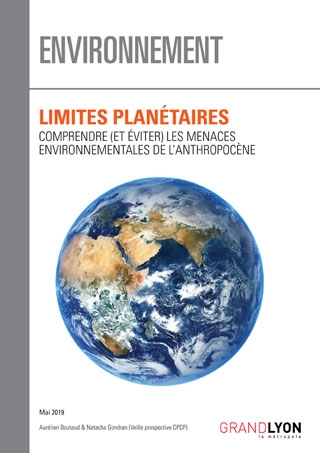
Étude
Décryptage de l'état des lieux scientifique des processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.

Étude
Qu’en est-il des impacts environnementaux sur la biodiversité et les ressources naturelles ?

Article
La pollution de l'eau pourrait coûter très cher à la société.
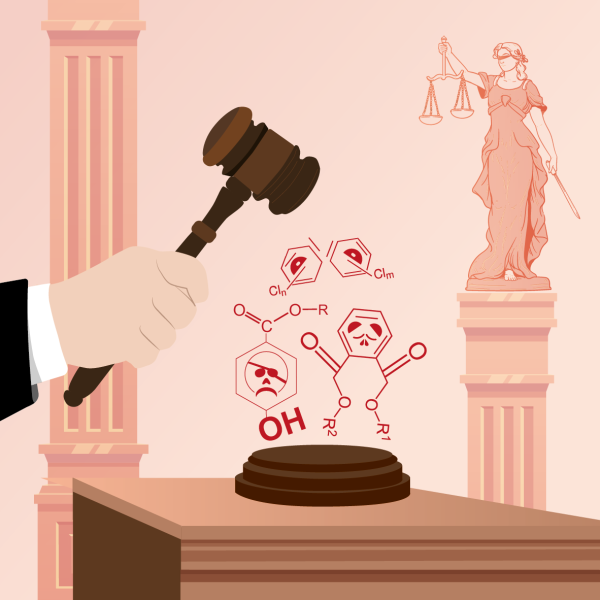
Article
Entre intérêt général et intérêts particuliers, le droit de l’environnement trace lentement sa route.

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?