Des limites planétaires aux frontières du système Terre : quelles implications pour la Métropole de Lyon ? Synthèse

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?
< Retour au sommaire du dossier

Article
Les cycles des nutriments de l’azote (N) et du phosphore (P) ont été profondément perturbés par les activités humaines depuis plus d’un siècle — en particulier depuis la généralisation de l’usage d’engrais minéraux dans l’agriculture. Ils sont étroitement liés au cycle de l’eau qui, par ruissellement et lessivage des nutriments en surplus sur les sols agricoles, provoque alors l’eutrophisation des milieux aquatiques.
Plus précisément, le surplus de nutriments conduit à la prolifération de cyanobactéries (dans les lacs et les cours d’eau) ou d’algues (au niveau des zones côtières) qui privent peu à peu les milieux de leur oxygène. Ce phénomène génère d’importants dommages aux écosystèmes, pouvant entraîner l’effondrement des populations de poissons, mais aussi libérer des composés toxiques dont certains peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine.
En France, ce phénomène d’eutrophisation est bien connu tout au long de la Loire, par exemple, où de nombreux plans d’eau sont régulièrement interdits à la baignade en été ; mais le phénomène est également très présent sur les plages bretonnes, où la prolifération d’algues vertes est souvent relayée par les médias.
Plus globalement, de nombreuses zones océaniques sont aujourd’hui touchées par la prolifération d’algues, telles que les sargasses. Lorsque celles-ci meurent, leur dégradation consomme l’oxygène de l’eau, pouvant aller jusqu’à transformer ces écosystèmes en « zones mortes ». On parle alors d’évènement « anoxique ».
En miroir de cette surabondance dans certaines régions, le faible accès aux engrais azotés et phosphorés menace la sécurité alimentaire de certaines communautés à faibles revenus. L’utilisation d’azote et de phosphore est donc actuellement en forte augmentation dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil.
Enfin, l’extraction minière de phosphate, dont les ressources sont limitées et localisées, expose les communautés voisines des exploitations, souvent pauvres et marginalisées, aux déchets miniers, aux terres détruites et à des violations des droits de l’homme. Ce thème fait donc l’objet d’enjeux forts en termes de justice sociale.
Le cadre des limites « sûres et justes » du système Terre s’intéresse aux perturbations maximales acceptables de ces cycles de nutriments par les activités humaines. Ce surplus (total des apports d’azote moins ce qui est consommé par les plantes) d’apport maximal acceptable est estimé au niveau mondial à 57 millions de tonnes par an pour l’azote et à 4,5 à 9 millions de tonnes par an pour le phosphore. Ces deux frontières sont aujourd’hui largement dépassées.
Azote — En complément de l’indicateur global sur l’azote, trois principaux sujets d’attention sont proposés par les scientifiques à l’échelle locale avec, pour chacun, un seuil critique à ne pas dépasser :
Phosphore — Comme pour l’azote, la frontière proposée au niveau global pour le phosphore se base sur des seuils critiques de concentration à ne pas dépasser (< 4,5 à 9 MtP/an). Les scientifiques s’appuient en outre sur une concentration critique au niveau des eaux de surface, pour éviter une pollution significative par le ruissellement de phosphore. Ce seuil est compris entre 50 et 100 mgP/m3. Toutefois, l’approche disponible et retenue par les scientifiques pour l’évaluation du phosphore est ici moins pertinente à une échelle territoriale. Elle est basée sur des calculs en bilan global qui ne tiennent pas compte par exemple de l’hétérogénéité spatiale des types de sols, des taux d’érosion ou de l’effet du changement climatique sur le ruissellement du phosphore et les débits d’eau.
Les surplus de phosphore sont pourtant particulièrement impactant sur les écosystèmes locaux, car le phosphore est un élément limitant du développement de la photosynthèse des milieux d’eau douce. C’est donc son excès qui est à l’origine des phénomènes d’eutrophisation évoqués plus haut. Des travaux sont en cours pour améliorer ces estimations en adoptant une approche similaire à celle utilisée pour l’azote.
Les aérosols sont des particules de matière en suspension dans l’atmosphère qui font partie de la catégorie des « particules fines » : elles mesurent souvent moins de 10 micromètres (µm). Les émissions d’aérosols peuvent être d’origine naturelle (éruptions volcaniques, tempêtes désertiques…), mais aussi d’origine anthropique, par exemple suite à la combustion de biomasse ou d’hydrocarbures, ou consécutivement à certains procédés industriels.
Paradoxalement, le sixième rapport du GIEC a montré que certains aérosols (le dioxyde de soufre en particulier) ont contribué à limiter le réchauffement global. C’est la raison pour laquelle l’émission volontaire d’aérosols stratosphériques est aujourd’hui envisagée dans une perspective de géo-ingénierie solaire. Toutefois, ce « refroidissement », qui reste localisé sur des zones de stagnation, peut provoquer des perturbations importantes du cycle de l’eau. Dans certaines régions d’Asie, par exemple, l’augmentation de la concentration d’aérosols perturbe d’ores et déjà de manière inquiétante le régime des moussons, avec des effets collatéraux importants pour les activités humaines.
Enfin — même si cet aspect n’est pas au cœur des enjeux liés au fonctionnement du système Terre — les aérosols sont surtout connus pour leurs effets nocifs sur la santé humaine. La pollution aux particules fines provoque ou aggrave certaines pathologies pulmonaires ou cardiovasculaires. Elle est chaque année responsable de plusieurs millions de décès prématurés à travers le monde — la plupart ayant lieu dans les pays à revenus faibles ou modérés.
Pour mesurer à une vaste échelle les écarts de concentration de particules dans l’atmosphère, l’indicateur choisi est la « profondeur (ou épaisseur) optique des aérosols ». Cet indicateur mesure la quantité de lumière absorbée ou diffusée au travers d’une couche d’atmosphère, témoignant ainsi de son opacité.
Johann Rockström et ses collègues (2023) montrent qu’il existe une différence croissante de pollution aux aérosols entre les hémisphères Nord et Sud (les émissions de particules tendant à se réduire dans l’hémisphère nord, alors qu’elles augmentent dans l’hémisphère sud). Ce phénomène peut impacter les conditions hydrologiques régionales, et venir modifier des régimes tels que celui de la mousson, comme évoqué précédemment. Johann Rockström et ses collègues proposent donc d’utiliser comme frontière la différence de profondeur atmosphérique optique des aérosols entre les deux hémisphères.
Pour l’instant, cette frontière « sûre » est respectée, mais une frontière « juste » plus stricte est proposée pour prendre en compte les importants dommages causés à la santé humaine par les aérosols. De nombreuses populations, souvent urbaines et pauvres, sont aujourd’hui exposées à des concentrations de particules fines (dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm) supérieures à la frontière « juste » estimée à 15 µg/m3 d’air.
À l’échelle d’un territoire, la perturbation des cycles biogéochimiques peut être abordée en mobilisant différentes approches complémentaires.
Certaines études ont déjà été réalisées à l’échelle de métropoles pour estimer l’empreinte azote ou l’empreinte phosphore des habitants — par exemple à Paris. Cette piste pourrait être intéressante à explorer dans le cas de la Métropole de Lyon.
Pour le reste, les données utilisées par les scientifiques pour dresser leur état des lieux des frontières du système Terre s’inscrivent principalement dans la première approche : il s’agit d’évaluer les pressions subies par les écosystèmes locaux.
Concernant l’évaluation des flux d’azote, les scientifiques se sont fondés sur des modélisations numériques permettant une résolution d’environ 50 km. Elles permettent donc d’obtenir des informations relativement locales mais sur une zone qui dépasse le périmètre de la métropole de Lyon et englobant par exemple une partie à l’Ouest de la métropole (comprenant des espaces plutôt agricoles).
À l’échelle de cette zone élargie de la métropole de Lyon, ces données indiquent un excès d’azote d’environ +25 kgN/(ha.an) par rapport au seuil critique local de surplus « acceptable », évalué à environ 3,6 kgN/(ha.an) (Figure 1).
En faisant l’hypothèse d’un taux de fixation moyen de l’azote par les plantes, cela correspond à un seuil critique d’intrants azotés (fertilisants et fumier) évalué à 17,4 kgN/(ha.an). Dans le détail, ces données indiquent que les seuils critiques sont dépassés pour les eaux de surface et pour les écosystèmes terrestres, mais pas pour la qualité des eaux souterraines.
En revanche, en ce qui concerne les flux de phosphore, les données scientifiques relatives aux frontières du système Terre ne nous permettent pas aujourd’hui d’apporter d’éléments précis sur l’état ou la contribution d’un territoire donné.
Les rejets d’azote et de phosphore combinés à l’augmentation de la température associée au changement climatique favorisent les risques d’eutrophisation des plans et cours d’eau. Les stations d’épuration de la Métropole de Lyon permettent de limiter ces risques. Si les frontières à ne pas dépasser évaluées par les scientifiques se focalisent sur les surplus ou apports agricoles, il n’en reste pas moins qu’au niveau mondial, une grande partie des flux excédentaires provient aussi d’autres sources de pollution comme les eaux usées rejetées dans les écosystèmes, en particulier en milieu urbain. Les stations d’épuration jouent ici un rôle prépondérant pour leur traitement. Au niveau de la métropole de Lyon, 12 stations d’épuration réparties sur le territoire permettent notamment de réduire considérablement les rejets azotés dans les milieux naturels puisque 99 % des eaux usées sont raccordées au réseau d’assainissement. Les déjections humaines sont une part importante du phosphore rejeté dans les milieux aquatiques. Si une portion est collectée et traitée en partie par les stations d’épuration, des techniques permettent aujourd’hui d’améliorer la récupération du phosphore. |
À l’échelle locale, la concentration des aérosols dans l’atmosphère (en μg/m3) est suivie de près. Des modèles estiment la provenance de ces émissions, par type d’activités : industries, agriculture, transport, résidentiel ou autre (en % du total des émissions). Ces données sont aujourd’hui produites par les organismes chargés de l’observation de la qualité de l’air, comme Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
Les mesures opérées ces dernières années sur le territoire de l’agglomération lyonnaise montrent que les valeurs limites légales pour la concentration de particules fines (40 μg/m3pour les PM10 et 25 μg/m3pour les PM2,5) sont respectées sur l’ensemble du territoire. Ces concentrations ont connu une tendance nettement baissière au cours des dernières décennies, témoignant d’une véritable prise de conscience de la part des acteurs publics, et ce à toutes les échelles de gouvernance.
Sur la métropole, cette tendance s’est toutefois ralentie, avec une relative stagnation des concentrations depuis quelques années. Or, les seuils proposés par le référentiel des frontières du système Terre (15 μg/m3pour les PM2,5) sont plus ambitieux que les actuels seuils réglementaires et ne sont pas encore respectés partout sur le territoire lyonnais, loin s’en faut. Qui plus est, les seuils préconisés par l’OMS (respectivement 15 et 5 μg/m3pour les PM10 et les PM2,5) s’avèrent encore plus restrictifs.
Même si les sources de particules fines sont variées, leur concentration est majoritairement due au chauffage du secteur résidentiel, qui compte pour environ 60 à 70 % des émissions de particules fines – avec en première ligne les équipements de chauffage au bois peu efficients. Dans une moindre mesure, le secteur des transports est également en cause, avec environ 15 % des particules fines émises sur le territoire.
Ce diagnostic a servi de base à la réalisation des différents plans d’action relatifs à la qualité de l’air, dont l’actuel Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise. L’une des principales mesures liées aux particules fines concerne le chauffage au bois, qui est aujourd’hui mieux encadré.
Des aides pour le remplacement des équipements les plus vétustes, peu nombreux sur le territoire mais particulièrement émetteurs, ont par exemple été mises en œuvre. La Zone à Faibles Émissions (ZFE), qui vise à interdire l’accès au centre des véhicules les plus émetteurs durant les pics de pollution, pourrait également participer à améliorer la situation – et ce même si les polluants prioritairement visés par cette mesure ne sont pas les particules fines, mais plutôt les oxydes d’azote.
En 2024, le partenariat entre l’École des Mines de Saint-Étienne et la Métropole de Lyon n’a donc pas permis de territorialiser toutes les limites « sûres et justes » proposées par le référentiel des frontières du système Terre. Le rapide état des lieux réalisé dans cet article permet néanmoins de constater que les thématiques non abordées peuvent, au moins pour partie, être traitées à l’échelle de la métropole lyonnaise.
Ces enjeux sont d’ailleurs d’ores et déjà pris en compte dans les politiques publiques, notamment parce qu’ils ont des impacts locaux largement documentés sur les milieux (pour le cycle de l’azote) et sur la population (pour ce qui concerne les particules fines).
Ces actions n’empêchent toutefois pas le territoire d’être encore concerné par un dépassement de ces limites « sûres et justes » : trop d’engrais azotés sont encore utilisés autour de la Métropole et, malgré une nette amélioration, trop de particules fines sont encore émises dans l’atmosphère. De quoi encourager les acteurs du territoire à poursuivre leurs efforts vers le respect des limites sûres et justes du système Terre.

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?

Interview de Duli Rashid
Élève ingénieur à l’École des Mines de Saint-Étienne
Les limites planétaires : quelles questions sur le plan scientifique et politique ?

Article
Cet article revient sur quelques-unes des évolutions récentes : les préoccupations relevant de la justice et de la solidarité.

Article
Peut-on mesurer la responsabilité d’un territoire dans ce dépassement ? Et quelles leçons en tirer ?

Article
Appliquée à l’échelle locale, les indicateurs des « frontières du système Terre » participent à renouveler notre regard sur la biodiversité.

Article
Quel état du cycle de l’eau pour les territoires ?

Article
Quelles perspectives pour la Métropole de Lyon ?

Interview de José Halloy
Chercheur au sein du Laboratoire interdisciplinaire des Énergies de demain (CNRS)
Pénuries, crises sanitaires, dépendances accrues… Les signaux d’alerte se multiplient.

Étude
L’Anthropocène ou l’ère géologique dans laquelle l’activité humaine est devenue principale cause des déséquilibres terrestres.
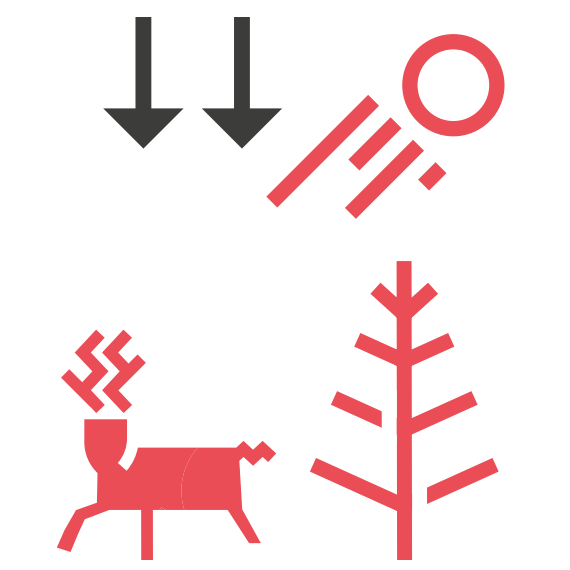
Étude
L’imprudence de l’industrie chimique a failli détruire la barrière de protection naturelle que représente la couche d’ozone.

Dossier
Que sait-on des limites planétaires ? Quelles en sont les causes, les conséquences et quels sont les leviers d’action ?
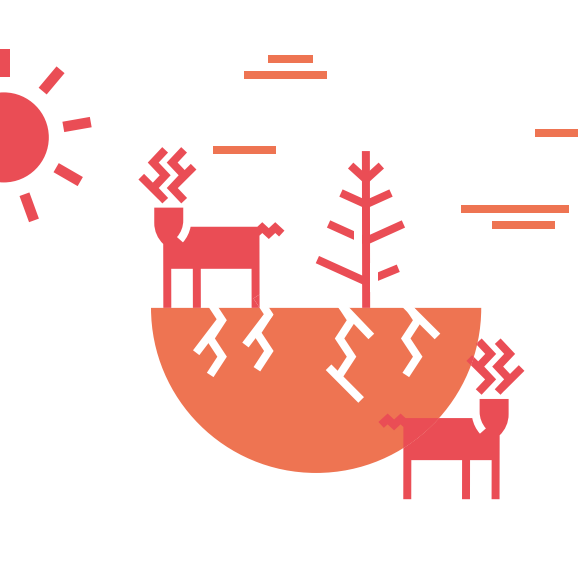
Étude
Ces infographies permettent de comprendre les processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.
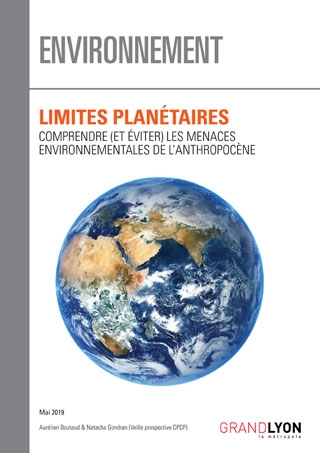
Étude
Décryptage de l'état des lieux scientifique des processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.
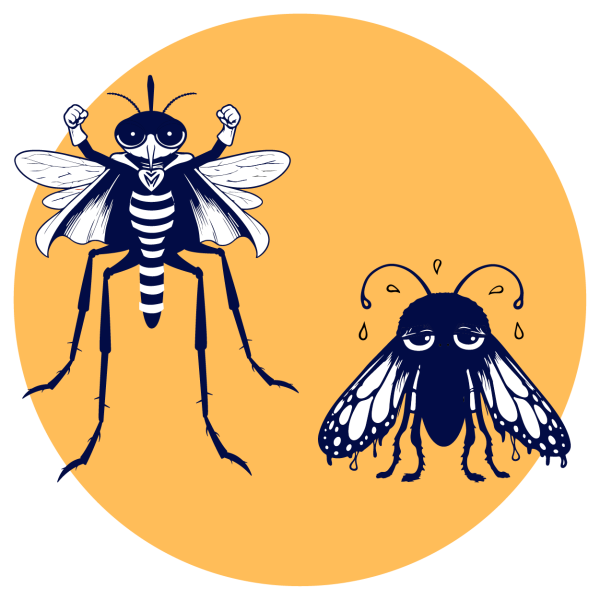
Article
Comment l’Anthropocène favorise certains êtres vivants, tout en précipitant la disparition d’autres ?
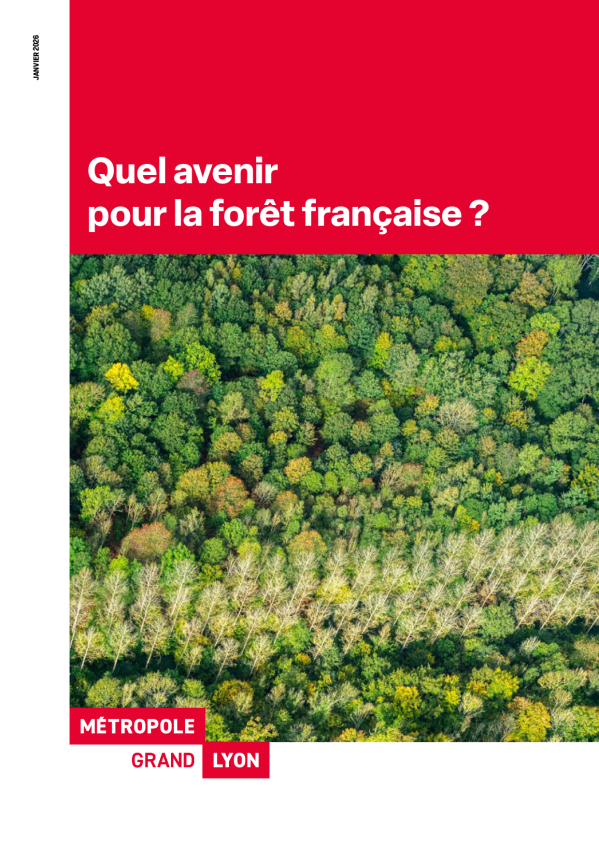
Étude
La forêt, une réalité contrastée entre les attentes d’une société une source d’énergie et de matériaux biosourcés, mais également un levier pour lutter contre le changement climatique.

Interview de Jonathan Lenoir
Chercheur au CNRS, écologue au sein du laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés (EDYSAN), Université de Picardie
Dépérissement des arbres, incendies dévastateurs, perte de biodiversité… Ces véritables poumons verts de notre territoire subissent de plein fouet le réchauffement climatique.