Des limites planétaires aux frontières du système Terre : quelles implications pour la Métropole de Lyon ? Synthèse

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?
< Retour au sommaire du dossier

Article
Parmi les différentes perturbations anthropiques du système Terre, le changement climatique est probablement le plus connu et le plus médiatisé.
Depuis le 19e siècle, l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre d’origine humaine (comme le dioxyde de carbone, le méthane ou encore le protoxyde d’azote) a provoqué une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère terrestre — qui dépasse aujourd’hui les 1,2 °C par rapport à l’ère préindustrielle.
Proposé par des scientifiques à la fin des années 2000, le cadre des limites planétaires essaie de déterminer à partir de quel niveau de perturbation ces changements pourraient être irréversibles et faire sortir le climat de la Terre du régime dans lequel il est entré depuis les débuts de l’Holocène, il y a environ 12 000 ans. Autrement dit, il s’agit de chercher à définir à quel moment le climat de la Terre franchirait un point de bascule.
Un point de bascule correspond à l’état d’un système donné où le changement d’un paramètre, même modeste, peut entraîner des bouleversements rapides et radicaux. Il s’agit en quelque sorte d’un seuil qui, une fois franchi, provoque des changements qui s’autoentretiennent, faisant passer le système d’un état d’équilibre à un autre, sans possibilité de retour en arrière.
Un exemple emblématique de point de bascule climatique est lié à l’évolution de la calotte glaciaire Antarctique Ouest. Sous l’effet de l’augmentation de la température de l’océan, de l’eau salée s’infiltre sous cette calotte glaciaire, accélérant ainsi sa fonte. Différentes modélisations montrent qu’à partir d’un certain réchauffement de l’océan, il existe un point de bascule au-delà duquel des pans de cette calotte sont condamnés à fondre, ce qui aurait un impact majeur sur les courants marins et la dynamique climatique associée. Le franchissement d’un tel point de bascule provoquerait également une montée du niveau des océans pouvant atteindre trois mètres.
Les scientifiques ont aujourd’hui identifié au moins 16 points de bascule majeurs liés au changement climatique, dont la probabilité d’advenir est représentée dans la figure 1, en fonction du niveau d’augmentation de la température moyenne mondiale.
Pour garantir que ces points de bascule ne sont pas transgressés, les spécialistes des limites planétaires proposent deux « frontières » à ne pas dépasser :
Plus récemment, les spécialistes des limites justes et sûres du système Terre ont proposé une troisième manière de positionner cette frontière, qui correspond à une augmentation de la température moyenne mondiale de + 1,5 °C. Ce seuil équivaut à un risque modéré de franchir 5 points de bascule (figure 1) et coïncide avec l’objectif que se sont fixé les États dans le cadre de l’Accord de Paris. C’est cette frontière que nous utiliserons par la suite pour déterminer la responsabilité de la Métropole.
Toutefois, il convient de noter que, pour mieux prendre en compte les enjeux de justice sociale, des chercheurs proposent de fixer la frontière « juste et sûre » à 1,0 °C d’augmentation de température, afin d’éviter d’exposer des populations à des dommages significatifs.
Au-delà de cette limite, des dizaines de millions de personnes subissent des conditions de température et d’humidité, dites « de bulbe humide » [1], qui ne permettent plus au corps humain de réguler sa température. Une exposition trop longue à ces conditions peut entraîner la mort. Or cette limite « juste » est aujourd’hui déjà dépassée, avec une augmentation de température moyenne estimée à 1,2 °C pour la période 2014-2023.
Pour essayer de prévenir le dépassement de ces points de bascule, il est nécessaire de limiter les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES). Pour connaître la responsabilité d’un territoire en matière de dérèglement climatique, la première étape consiste donc à mesurer les émissions dont il est responsable. Celles-ci sont généralement mesurées en termes de CO2 équivalent (CO2eq).
Il existe principalement deux manières d’estimer les émissions d’un territoire donné :
Dans un second temps, il s’agit de comparer cette contribution à une cible d’émission qui correspond à la valeur maximale permise pour respecter les limites définies dans le paragraphe précédent. Pour ce faire, là encore, deux méthodes peuvent être choisies : la définition d’un « budget » maximal d’émissions annuel, ou la définition d’une trajectoire de réduction d’émissions à partir du niveau actuel (méthodes illustrées dans la figure 2).
Cette dernière option dépend de nombreux choix politiques, difficilement arbitrables pour réaliser cette étude. Nous avons donc privilégié la méthode de détermination d’un budget maximal d’émissions annuelles permettant de donner un aperçu de l’ambition requise pour ne pas dépasser les limites.
Cette cible est estimée à partir d’un budget d’émissions qu’il convient de ne pas dépasser pour respecter la frontière planétaire. Ce budget est généralement défini par des articles scientifiques, pour une période donnée (50 à 100 ans, par exemple) et sur la base de modélisations climatiques. Il correspond aux émissions pouvant encore être émises pour respecter la frontière planétaire.
Comme cela a été dit plus haut, les frontières « justes et sûres » basées sur le cadre des limites planétaires sont aujourd’hui déjà dépassées. Il n’y a donc a priori plus de « budget d’émissions » possible pour les respecter. Nous avons donc privilégié ici la valeur de la frontière « sûre » (et non « juste et sûre ») pour estimer ce budget, qui équivaut à une augmentation de +1,5 °C de la température moyenne mondiale.
Comme évoqué plus haut, ce choix correspond également à l’un des objectifs politiques définis lors de la COP 21, à Paris. L’analyse produite pourra ainsi fournir des informations opérationnelles à la Métropole de Lyon en confrontant ses émissions actuelles aux réductions nécessaires pour respecter les engagements de la France transcrits dans la Stratégie nationale bas-carbone.
Enfin, pour passer de ces « budgets d’émissions », définis au niveau mondial, à des cibles d’émissions territoriales, plusieurs principes de répartition peuvent être mobilisés [2]. Les principes qui ont été envisagés pour cette étude sont les suivants :
Il va sans dire que ces choix sont éminemment politiques, puisqu’ils renvoient à des principes éthiques et philosophiques très différents. Il est ainsi important de comparer les résultats de plusieurs répartitions pour mettre en perspective l’importance de ces différents choix [3].
Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas retenu les principes des droits acquis et de la contribution économique, car ils ne sont pas en accord avec le droit international. Et nous n’avons pas pu appliquer les principes de droit au développement et de capacité à payer, par manque de données. Deux principes de répartition ont donc été utilisés : l’égalité et la responsabilité historique.
Pour estimer la part que chaque habitant de la métropole de Lyon « peut » émettre pour respecter cette frontière sûre, il faut d’abord identifier, dans la littérature, le « budget d’émissions » qui peut encore être émis dans l’atmosphère avant d’atteindre un réchauffement climatique de +1,5 °C. Dans son dernier rapport publié en 2021, le GIEC estime que l’humanité pouvait encore, en 2020, émettre 500 GtCO2 afin d’avoir 50 % de chances de maintenir l’augmentation de température moyenne mondiale en dessous de +1,5 °C en 2100.
On peut ainsi estimer la part de ce « budget » qui pourrait être affecté à la métropole de Lyon. Nous avons fait l’hypothèse que ce budget serait consommé, de façon équitable, entre l’année actuelle (2024) et 2050 (figure 2) — la Métropole s’engageant à contribuer fortement à l’atteinte de la neutralité en termes d’émissions directes de GES en France à cet horizon. Pour définir les cibles annuelles d’émissions, deux méthodes de calcul ont été testées, correspondant aux deux principes de répartition retenus :
Le résultat du calcul de cibles pour la métropole de Lyon est donné figure 4. Ces résultats mettent en évidence des conclusions très différentes en matière d’empreinte ou d’émissions directes.
Si l’on considère la responsabilité historique, les émissions directes cumulées des habitants de la métropole de Lyon sont aujourd’hui encore inférieures au budget total d’émissions permettant d’éviter une augmentation de température mondiale de plus de 1,5 °C. Mais si ce budget n’a pas encore été totalement consommé, les émissions actuelles de 3,5 tCO2 eq par an et par personne sont toutefois plus de deux fois supérieures à la cible de 1,7 tCO2 eq par an et par personne.
Par contre, l’empreinte moyenne des habitants de la métropole de Lyon est largement supérieure à la moyenne mondiale sur la période 1990 – 2024 (et les résultats seraient du même ordre de grandeur si l’analyse était faite au niveau de la France). Cela signifie que la métropole a déjà consommé davantage que son budget disponible depuis 1990. Ses empreintes passées sont en moyenne supérieures au budget d’émissions qui serait nécessaire pour éviter une augmentation de température mondiale de plus de 1,5 °C.
Il faudrait donc, en théorie, « stocker » 3,6 tCO2eq par habitant chaque année entre 2024 et 2050 pour « rembourser » la dette contractée — un chiffre à comparer à l’empreinte carbone actuelle de 8,1 tCO2 eq par an et par personne, et qui montre au contraire que cette « dette carbone » continue de lourdement s’aggraver.
Par ailleurs, il faut préciser qu’un tel stockage de carbone est aujourd’hui impossible à l’échelle de la métropole de Lyon. Par souci de solidarité, ces résultats pourraient en revanche être pris en compte dans la perspective des mécanismes de reversement vers les pays des Suds discutés dans le cadre des négociations internationales (COP) [4].
Ces résultats montrent par ailleurs la forte ambition nécessaire pour atteindre l’objectif politique de respecter l’Accord de Paris grâce à l’atteinte d’une neutralité carbone en 2050. En effet, même en prenant l’hypothèse la plus favorable, les émissions directes de la métropole (3,5 tCO2eq/an.hab en 2023) sont 3 fois plus élevées que sa cible, calculée avec le principe d’égalité (1,2 tCO2eq/an.hab).
Le respect de ce budget ne pourra donc se faire qu’en passant au plus vite sous cette barre des 1,2 tCO2eq/hab. Cette nécessité de diviser au plus vite par 3 les émissions directes représente un effort considérable, en particulier lorsqu’elle est mise en perspective avec la division par moins de 2 des émissions directes de la métropole obtenue entre 1990 (6,8 tCO2eq/an.hab) et 2023 (3,5 tCO2eq/an.hab).
En premier lieu, la littérature académique montre que, pour ce qui concerne les concentrations de CO2 et les modifications du bilan radiatif de l’atmosphère, il est d’ores et déjà trop tard pour rester sous les seuils de réchauffement suggérés par le référentiel des frontières « justes et sûres » du système Terre. Ce dépassement générera des impacts conséquents sur les sociétés humaines, y compris la métropole de Lyon (voir encadré 1). Cependant, il existe encore une petite chance de limiter le réchauffement à +1,5 °C, qui correspond à la fois à la frontière « sûre » du référentiel des frontières du système Terre, mais aussi à l’objectif de l’Accord de Paris.
À ce propos, l’exercice réalisé montre que les efforts à produire pour amener les émissions de gaz à effet de serre à respecter cet engagement sont considérables. Ils devraient idéalement s’accompagner d’une participation des pays du Nord à des mécanismes de soutien pour pertes et dommages subis par les Pays des Suds.
Dans tous les cas, cela signifie que les progrès encourageants réalisés au cours des dernières années par la Métropole de Lyon ne sont pas encore suffisants pour que la Métropole prenne sa juste part à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris : il va falloir accélérer la transition et, dans le même temps, accroître les efforts d’adaptation du territoire (encadré 1).
C’est ce que prévoit de faire la Métropole en élaborant actuellement son nouveau plan climat, qui acte cette nécessité d’accélérer à la fois la baisse des émissions et l’adaptation au réchauffement climatique. En espérant que le dépassement des frontières planétaires ne se traduira pas par le franchissement de plusieurs points de bascule, qui pourraient alors rendre l’adaptation beaucoup plus difficile et aléatoire pour le territoire lyonnais… et probablement impossible pour d’autres territoires, davantage exposés à ces changements.
La métropole se situe dans un climat semi-continental et elle est fortement urbanisée. L’augmentation moyenne des températures s’y fait donc ressentir de façon particulièrement forte. Ainsi, entre la période 1950-1980 et la période 2003-2023, la température moyenne sur le territoire de la métropole a déjà augmenté de 2 °C.
Ce réchauffement est encore plus important pendant les périodes estivales, soumettant alors la métropole et ses habitants à des épisodes de fortes chaleurs (canicules, vagues de chaleur) bien plus fortes que par le passé, phénomène qui va encore s’amplifier dans les années à venir.
La métropole pourrait ainsi connaître 34 nuits tropicales pendant lesquelles la température ne descend pas en dessous de 20 °C (valeur médiane des projections de la TRACC) par été en 2050, soit 3 fois plus qu’aujourd’hui. Les valeurs maximales des projections relatives à cet indicateur dépassent 90 nuits à cet horizon.
Une hausse de la fréquence des épisodes de sécheresse et de fortes pluies est également à anticiper, renforçant le risque d’inondation, avec toutes les conséquences matérielles et humaines que de tels événements peuvent entraîner (dégradation d’infrastructures, risques de coupure des réseaux de transports, risques industriels associés aux inondations, mise en danger de personnes isolées, etc.). Les inondations de Givors de 2024 en sont une claire illustration.
Enfin, d’un point de vue social, les zones les plus denses et urbanisées, ainsi que les zones inondables, correspondent souvent aux endroits où résident les ménages les plus fragiles économiquement. Les événements extrêmes cités ci-dessus (canicules et inondations) frappent ainsi plus souvent ces populations. Ces enjeux d’adaptation appellent donc la mise en place de politiques publiques abordant simultanément les enjeux sociaux et climatiques.

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?

Interview de Duli Rashid
Élève ingénieur à l’École des Mines de Saint-Étienne
Les limites planétaires : quelles questions sur le plan scientifique et politique ?

Article
Cet article revient sur quelques-unes des évolutions récentes : les préoccupations relevant de la justice et de la solidarité.

Article
Peut-on mesurer la responsabilité d’un territoire dans ce dépassement ? Et quelles leçons en tirer ?

Article
Appliquée à l’échelle locale, les indicateurs des « frontières du système Terre » participent à renouveler notre regard sur la biodiversité.

Article
Quel état du cycle de l’eau pour les territoires ?

Article
Quelles perspectives pour la Métropole de Lyon ?

Étude
L’Anthropocène ou l’ère géologique dans laquelle l’activité humaine est devenue principale cause des déséquilibres terrestres.
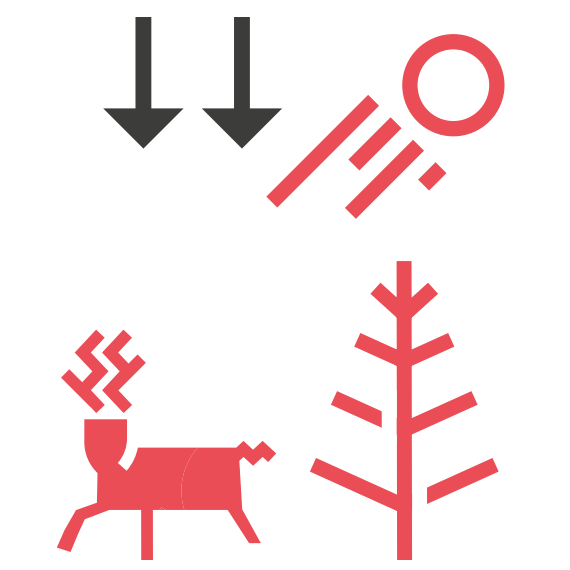
Étude
L’imprudence de l’industrie chimique a failli détruire la barrière de protection naturelle que représente la couche d’ozone.

Dossier
Que sait-on des limites planétaires ? Quelles en sont les causes, les conséquences et quels sont les leviers d’action ?
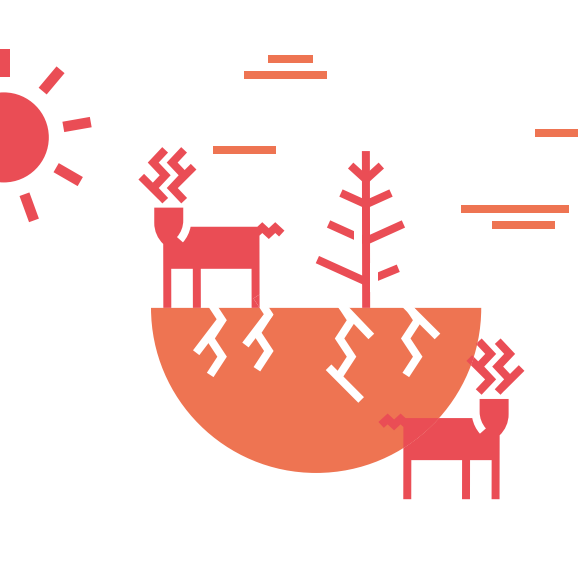
Étude
Ces infographies permettent de comprendre les processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.
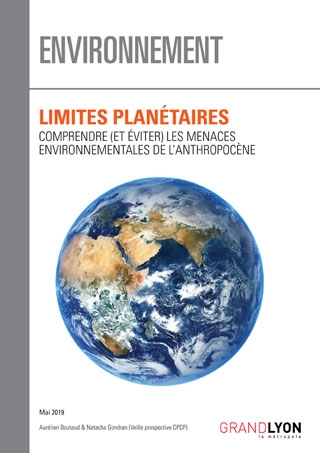
Étude
Décryptage de l'état des lieux scientifique des processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.

Étude
Qu’en est-il des impacts environnementaux sur la biodiversité et les ressources naturelles ?

Article
La pollution de l'eau pourrait coûter très cher à la société.
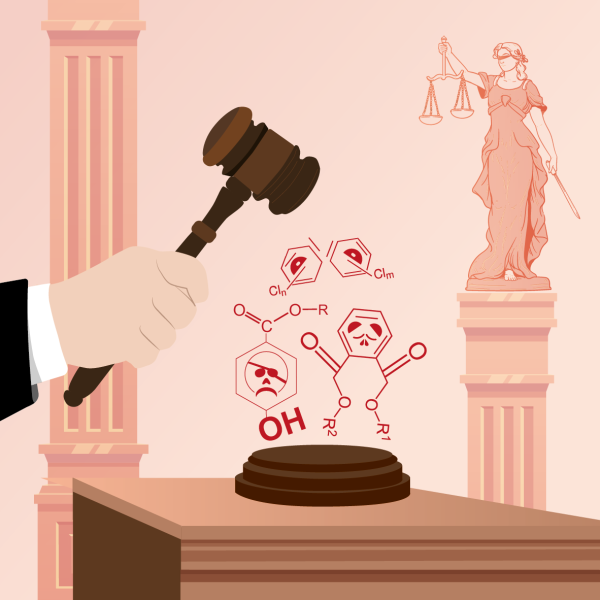
Article
Entre intérêt général et intérêts particuliers, le droit de l’environnement trace lentement sa route.

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?