Des limites planétaires aux frontières du système Terre : quelles implications pour la Métropole de Lyon ? Synthèse

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?
< Retour au sommaire du dossier

Article
Les analyses associées aux limites planétaires présentent deux principaux cycles d’eau, interreliés et nourris par les précipitations (figure 1). D’un côté, l’eau dite « verte » est contenue dans la zone insaturée des plantes et des sols puis restituée à l’atmosphère à travers l’évapotranspiration des plantes et l’évaporation des sols. De l’autre côté, l’eau dite « bleue » équivaut à l’eau présente dans les zones saturées : il s’agit des eaux de surface (plans d’eau, rivières) et aquifères, qui ruissellent jusqu’aux mers et océans. Elle peut être soit réinjectée dans le cycle de l’eau verte en étant captée par des plantes ou être reconnectée aux précipitations par l’évaporation des plans d’eau.
L’eau verte a un rôle régulateur sur les régimes des pluies et l’humidité des sols, qui eux-mêmes influent sur la stabilité des écosystèmes terrestres. Des variations trop importantes du cycle de l’eau verte peuvent ainsi modifier ces écosystèmes et, par la suite, entraîner une instabilité climatique (notamment en impactant les forêts boréales et tropicales, ainsi que les tourbières).
L’eau bleue maintient quant à elle les écosystèmes aquatiques et ripariens (bordant les plans d’eau) en bonne santé. Cette portion de la biodiversité est aujourd’hui victime d’une dégradation très rapide, alors qu’elle apporte des contributions fondamentales au vivant dans son ensemble (régulation des flux d’eau, filtration de l’eau, provision de nourriture…).
Dans leur mise à jour récente des cadres des limites planétaires et des frontières justes et sûres du système Terre, les scientifiques ont utilisé des variables de contrôle permettant de suivre l’état de chacun des deux compartiments.
Pour l’eau verte, l’indicateur choisi est la proportion des terres émergées, sans glace, pour lesquelles l’humidité du sol au niveau des racines des plantes présente une anomalie, c’est-à-dire que le sol est trop humide ou trop sec. Pour définir une frontière, les scientifiques se sont appuyés sur les données de variabilité maximale estimée sur l’ère préindustrielle (1600-1850). Considérée comme référence de stabilité, cette valeur est estimée à 11,1 % des terres émergées sans glace pouvant présenter une telle anomalie. À l’aide de modélisations réalisées à partir de données satellites, les chercheurs constatent que 15,8 % des terres émergées sans glace sont aujourd’hui anormalement sèches ou humides. La frontière est donc dépassée, posant le risque de modifications majeures d’écosystèmes, et renforçant l’instabilité climatique.
Pour l’eau bleue, c’est la proportion des terres émergées sans glace où les débits des cours d’eau sont anormalement élevés ou bas qui est considérée. Ici, la variabilité maximale de l’ère préindustrielle était de 10,2 % des terres émergées sans glace. Une modélisation de la situation actuelle montre que cette frontière est largement dépassée avec 18,2 % des terres présentant une telle anomalie, mettant à risque les écosystèmes aquatiques et ripariens.
Réactualisant le cadre des limites planétaires, celui des frontières du système Terre propose, pour le cycle de l’eau bleue, une démarche plus territorialisée, fondée sur deux indicateurs.
Tout d’abord, à partir d’études bibliographiques sur le lien entre la biodiversité aquatique et riparienne et les variations des débits d’origine anthropique, il propose de fixer comme frontière une variation de ±20 % par rapport aux débits naturels. Cette frontière est fixée pour chaque mois de l’année (voir figure 2).
La mesure de l’état global des cours d’eau est réalisée à partir d’une modélisation numérique de l’écoulement de l’eau de surface. Elle compare deux situations : avec les installations humaines perturbant les débits sur la période 2000-2020, et sans ces équipements. Le résultat est que, en l’état des installations humaines, 1/3 des écoulements d'eau n'ont pas respecté la frontière d’une variabilité inférieure à ±20 % sur au moins un mois de l’année, mettant à risque les écosystèmes qui en dépendent.
Un indicateur complémentaire mesure la perturbation de la ressource en eau souterraine. Ici, la fixation d’une frontière s’appuie sur des considérations de maintien d’un débit de base (aussi appelé soutien à l’étiage) des cours d’eau, permettant le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et ripariens.
Le principe général est que les prélèvements dans les aquifères doivent être inférieurs à leur recharge. L’état des aquifères est estimé à partir de modèles prenant en compte de nombreux paramètres (humidité des sols et plantes, eau de surface et glaciers, etc.). Il montre une inégale répartition des prélèvements à l’échelle mondiale : si les prélèvements dans les aquifères en volume à l’échelle globale sont en dessous de leur recharge, 47 % des terres émergées se situent au-dessus d’aquifères dans lesquels les prélèvements semblent dépasser la recharge locale, réduisant les débits d’étiages et mettant en péril la biodiversité qui en dépend.
La traduction de ces analyses à l’échelle d’un territoire est complexe à mobiliser pour le cas de l’eau verte, car la variable de contrôle (l’anomalie d’humidité des sols) a été définie en considérant des interactions entre la végétation et le climat à l’échelle des continents. Un travail supplémentaire, qui n’a pas encore été réalisé, serait donc nécessaire pour traduire ces interactions à l’échelle des territoires.
Pour l’eau bleue, les analyses proposées par le cadre des frontières du système Terre sont en revanche applicables localement, en mobilisant des données sur les débits des cours d’eau et les prélèvements dans les nappes.
Pour l’étude de la variation du débit des cours d’eau, la publication d’origine des frontières du système Terre utilise une modélisation des écoulements d’eau naturels et perturbés par l’humain sur chaque mois de la période 2000-2020. Cette modélisation est réalisée à l’échelle de carreaux d’environ 7,5*7,5 km.
Si cette mesure est déjà territorialisée, sa mobilisation directe à l’échelle d’un territoire est limitée pour différentes raisons, comme l’explique Quentin Dassibat :
Pour contourner ces limitations, une territorialisation de la quantification des débits perturbés est proposée, en utilisant les données mesurées au niveau des stations hydrométriques installées sur les territoires et en faisant appel aux logiciels développés par Quentin Dassibat. La quantification des débits naturels peut alors être envisagée : soit en réalisant une simulation des débits naturels directement calibrée sur le bassin versant d’étude, soit en utilisant les données de prélèvement et de relâche d’eau des activités humaines. Pour ce dernier cas, cela peut consister à soustraire ces données aux débits observés permettant d’obtenir des débits « désinfluencés » des perturbations humaines pouvant approximer les débits naturels.
À l’instar de la variation du débit des cours d’eau, la modélisation utilisée dans les frontières du système Terre pour analyser l’état des aquifères est trop imprécise à l’échelle locale, car elle ne mobilise pas une mesure directe de l’état et des prélèvements dans les nappes.
Des données relatives à la pluviométrie et aux prélèvements peuvent ainsi être mobilisées pour estimer la recharge et les prélèvements réalisés dans les nappes d’un territoire donné (voir par exemple les travaux du BRGM).
On notera enfin que la consommation d’eau d’un territoire ne provient pas uniquement ou systématiquement des cours d’eau et des nappes locales. De nombreux biens importés ont été produits en consommant de l’eau dans d’autres territoires : on parle alors d’empreinte eau. La mesure de l’empreinte eau est un champ de recherche en expansion avec des enjeux concernant la répartition des différentes consommations de par le monde.
Une publication a par exemple montré que si les importations d’eau liées à la consommation de l’Union européenne sont globalement soutenables en volume, 90 % proviennent de bassins versants aux débits perturbés de façon préoccupante. De même, l’évaluation globale des frontières du système Terre calcule une consommation en eau souterraine globalement soutenable en volume, mais insoutenable localement sur la moitié des aquifères (voir figure 1).
Des méthodes ont été développées pour mesurer l’empreinte eau des pays et la relier à la perturbation des bassins versants d’où elles proviennent. Il est en revanche encore impossible de les appliquer à l’échelle de territoires subnationaux.
La métropole de Lyon est traversée par cinq cours d’eau principaux : la Saône, l’Yzeron, le Gier et le Garon, qui confluent avec le Rhône au sein de la métropole.
Les modélisations des frontières du système Terre (voir figure 3) montrent que sur la période 2000-2020, plusieurs espaces, correspondant principalement à l’écoulement du Rhône, dépassent, sur plusieurs mois, une variabilité sur les débits supérieurs à 20 %.
Pour mettre en perspective ce résultat avec des données d’observation du territoire, deux sources de données sont mobilisables :
Des données d’observations peuvent être mobilisées pour représenter la perturbation des débits.
C’est ce qu’a réalisé, au niveau de la station hydrométrique de Ternay, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à l’aide du modèle J2000, calibré sur le bassin du Rhône et appliqué sur la période 1986-2015. Cette station se situe au niveau de l’aval du Rhône, en sortie de métropole (voir figure 3). Le résultat de l’analyse de l’Agence de l’eau (figure 4) montre que, pour 3 mois de l’année (juillet, août et novembre), les débits observés sont proches de dépasser la frontière de -20 % de variation par rapport aux débits naturels modélisés par J2000. Cela montre qu’il existe bien une perturbation significative des débits du Rhône au niveau de la métropole, comme représenté sur la figure 3.
L’analyse proposée précédemment reste cependant limitée, car réalisée en un seul point de la métropole. Par ailleurs, elle ne permet pas d’identifier directement les causes de perturbations des débits.
Pour les identifier, les données de prélèvements sont mobilisables. La moyenne des données de prélèvements disponibles sur la métropole sur la période 2012-2021 selon leur usage est représentée en figure 5. On peut différencier 2 types de prélèvements :
Ces données ne sont pas suffisantes pour estimer des « débits désinfluencés » (voir 2.1), car les informations sur les apports des activités humaines aux cours d’eau (notamment les restitutions des barrages et les apports d’eaux usées) ne sont pas disponibles. Elles peuvent cependant être comparées aux débits observés au niveau des stations directement à l’aval des perturbations pour déterminer les prélèvements les plus impactant.
À l’exception du cas particulier du barrage de Couzon sur la Saône, dont le prélèvement est au fil de l’eau (immédiatement restitué), les perturbations associées à la métropole sont principalement situées sur le Rhône et peuvent impacter les débits mesurés au niveau de deux stations hydrométriques : celles de Lyon-Perrache et de Ternay (voir figure 5). À ces stations, le débit moyen observé sur 2012-2021 est respectivement de 18 800 Mm3/an et 114 000 Mm³/an.
Les prélèvements non directement restitués au Rhône semblent donc représenter une fraction suffisamment faible des débits pour ne pas introduire trop de perturbation. Seuls les prélèvements par les barrages de Cusset et Pierre-Bénite impactent significativement les débits : ils représentent respectivement 65 % et 21 % des débits aval observés.
Cette analyse permet de conclure que les problématiques de variations trop importantes de débits du Rhône relevées par les modèles des frontières du système Terre (figure 3) et de l’agence de l’eau (figure 4) seraient le plus significativement associées à la présence des barrages de Cusset et Pierre-Bénite et des dérivations qu’ils réalisent sur le fleuve.
La perturbation de la biodiversité induite par ces 2 barrages est toutefois à nuancer. D’une part, il serait nécessaire d’étudier plus précisément leur effet sur les débits en aval en fonction des choix de gestion qui y sont réalisés. D’autre part, si l’installation des barrages a causé au niveau des canaux de dérivation un fort ralentissement des débits en scindant le Rhône en deux bras avec un impact sur la biodiversité caractérisé, cette installation est ancienne (mise en service en 1899 pour Cusset et 1967 pour Pierre-Bénite). Elle a engendré la mise en place d’un nouveau fonctionnement de la biodiversité locale avec notamment la création d’une zone humide au nord du barrage de Cusset. L’incidence sur la biodiversité de la présence de ces barrages est donc plus complexe aujourd’hui que ce que peut mesurer une modélisation avec et sans ces derniers comme réalisé en 3.1.1 et 3.1.2.
De leur côté, les nappes souterraines de la métropole comprennent trois familles d’aquifères par ordre de profondeur :
Ces trois types d’aquifères sont en interconnexion avec des échanges dont les volumes ne sont pas précisément connus. Les prélèvements en eau peuvent se faire dans chacune avec des enjeux différents de pollutions, la molasse étant la nappe la plus pure et privilégiée pour les prélèvements en eau potable.
La détermination directe de la recharge de ces nappes n’a été réalisée que partiellement pour la molasse (4 200 Mm3 en 2007) et les couloirs fluvio-glaciaires (60 Mm3/an en 2010), mais pas pour les nappes alluviales. Une autre méthode de détermination de cette recharge consiste à estimer la pluie s’infiltrant jusqu’aux nappes (nommée pluie efficace). Un calcul semble possible à l’échelle de la métropole de Lyon, appuyé sur des travaux du BRGM de 2021, mais trop de paramètres interviennent pour qu’il ait pu être réalisé dans le cadre de ce travail.
Pour les prélèvements, des données BNPE sont disponibles sur 2012-2021. Comme pour l’eau de surface, les prélèvements peuvent soit être directement restitués (refroidissement industriel), soit consommés. Les prélèvements de la métropole sont représentés figure 6. Sur 2012-2021, 195 Mm3/an ont été prélevés en moyenne dans la métropole dans les nappes, dont 189 Mm3/an ne sont pas restitués. Les principaux contributeurs sont les prélèvements d’eau potable (97 Mm3/an) et ceux pour l’industrie (88 Mm3/an). [1]
Ces prélèvements semblent donc a priori inférieurs à la recharge estimée des aquifères fluvio-glaciaires et de la molasse. Pour conclure sur le lien entre recharge et prélèvements, une étude plus poussée serait cependant nécessaire pour :
La territorialisation du cadre des frontières du système Terre à l’échelle de la métropole de Lyon pour le cycle de l’eau bleue permet d’identifier les activités ayant un impact significatif :
Cette étude montre que, dans le territoire de la métropole, l’impact de ces activités sur les débits et la ressource en eau bleue est significatif. D’un côté, les débits des cours d’eau peuvent en effet être perturbés au-delà des frontières soutenables par les barrages hydroélectriques, notamment au sein de la métropole par ceux de Pierre-Bénite et de Cusset.
D’un autre côté, les prélèvements sur la ressource en eau souterraine semblent encore soutenables et restent en dessous de la recharge. Pour représenter une mesure locale des frontières du système Terre, ces résultats nécessiteraient cependant d’être approfondis en intégrant de nouvelles données non disponibles aujourd’hui, en particulier sur la gestion des barrages et la recharge des nappes.
Cette possible position de la métropole de Lyon dans la « zone sûre » des frontières du système Terre est un point positif pour la soutenabilité du territoire. Maintenir cette soutenabilité sera cependant un défi face aux dérèglements du cycle de l’eau bleue que va générer le changement climatique. De récentes études sur le bassin du Rhône ont en effet montré des risques de baisse à venir de la quantité d’eau bleue sur le territoire, à la fois pour l’eau de surface (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 2023) et pour les eaux souterraines (BRGM, 2021).
Enfin, pour préciser encore ce diagnostic, il serait intéressant de mieux identifier les responsabilités de la métropole quant au dépassement des frontières planétaires à travers les importations et exportations d’eau contenues dans les produits qu’elle consomme (partie 2.3).

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?

Interview de Duli Rashid
Élève ingénieur à l’École des Mines de Saint-Étienne
Les limites planétaires : quelles questions sur le plan scientifique et politique ?

Article
Cet article revient sur quelques-unes des évolutions récentes : les préoccupations relevant de la justice et de la solidarité.

Article
Peut-on mesurer la responsabilité d’un territoire dans ce dépassement ? Et quelles leçons en tirer ?

Article
Appliquée à l’échelle locale, les indicateurs des « frontières du système Terre » participent à renouveler notre regard sur la biodiversité.

Article
Quel état du cycle de l’eau pour les territoires ?

Article
Quelles perspectives pour la Métropole de Lyon ?

Interview de José Halloy
Chercheur au sein du Laboratoire interdisciplinaire des Énergies de demain (CNRS)
Pénuries, crises sanitaires, dépendances accrues… Les signaux d’alerte se multiplient.

Étude
L’Anthropocène ou l’ère géologique dans laquelle l’activité humaine est devenue principale cause des déséquilibres terrestres.
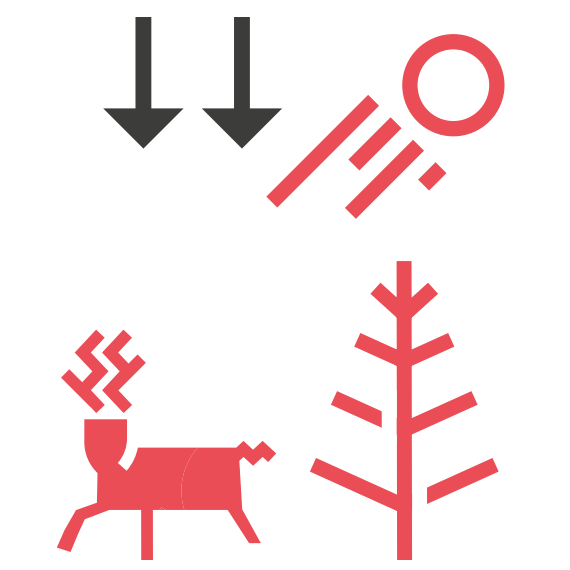
Étude
L’imprudence de l’industrie chimique a failli détruire la barrière de protection naturelle que représente la couche d’ozone.

Dossier
Que sait-on des limites planétaires ? Quelles en sont les causes, les conséquences et quels sont les leviers d’action ?
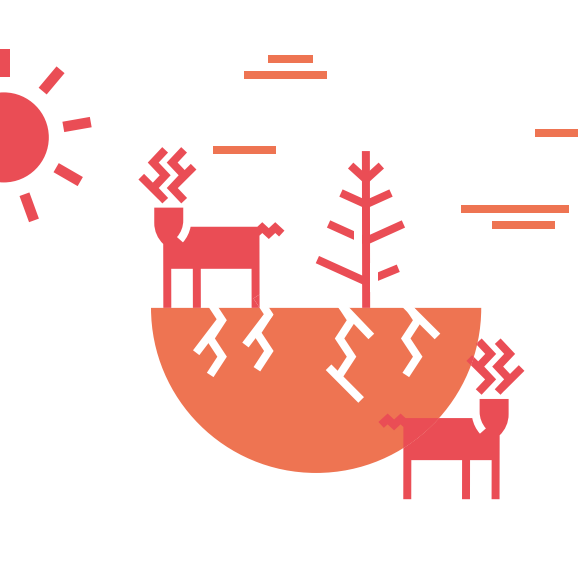
Étude
Ces infographies permettent de comprendre les processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.
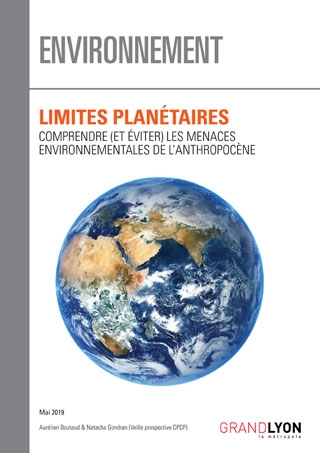
Étude
Décryptage de l'état des lieux scientifique des processus environnementaux qui pourraient mener à un effondrement planétaire.
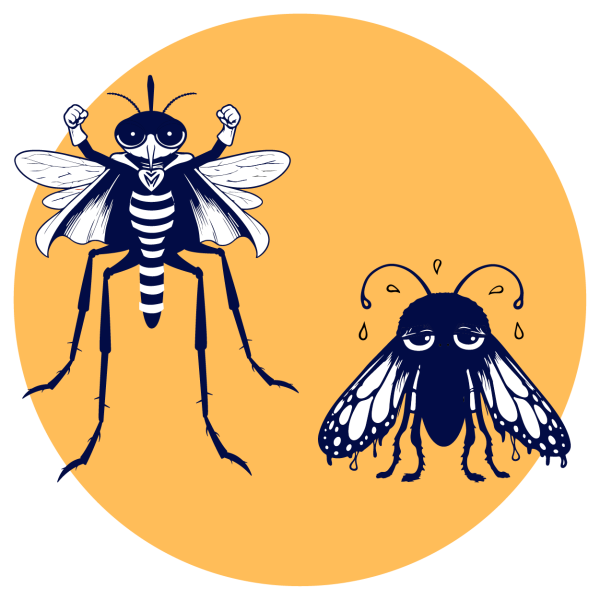
Article
Comment l’Anthropocène favorise certains êtres vivants, tout en précipitant la disparition d’autres ?
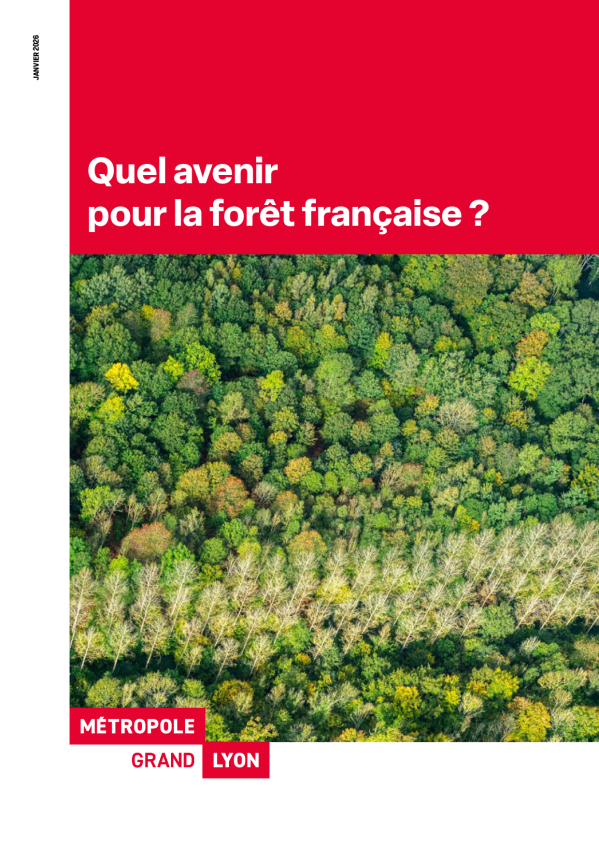
Étude
La forêt, une réalité contrastée entre les attentes d’une société une source d’énergie et de matériaux biosourcés, mais également un levier pour lutter contre le changement climatique.

Interview de Jonathan Lenoir
Chercheur au CNRS, écologue au sein du laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés (EDYSAN), Université de Picardie
Dépérissement des arbres, incendies dévastateurs, perte de biodiversité… Ces véritables poumons verts de notre territoire subissent de plein fouet le réchauffement climatique.