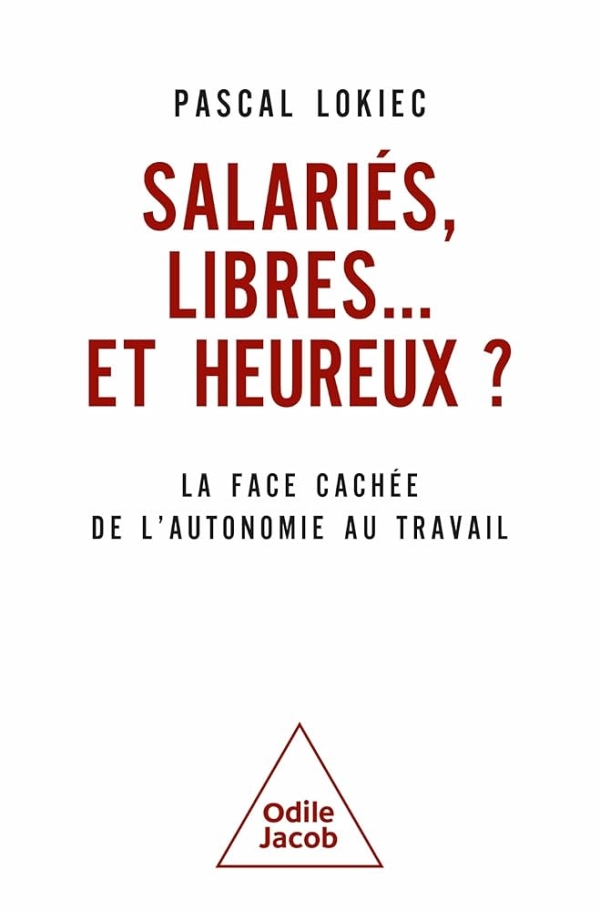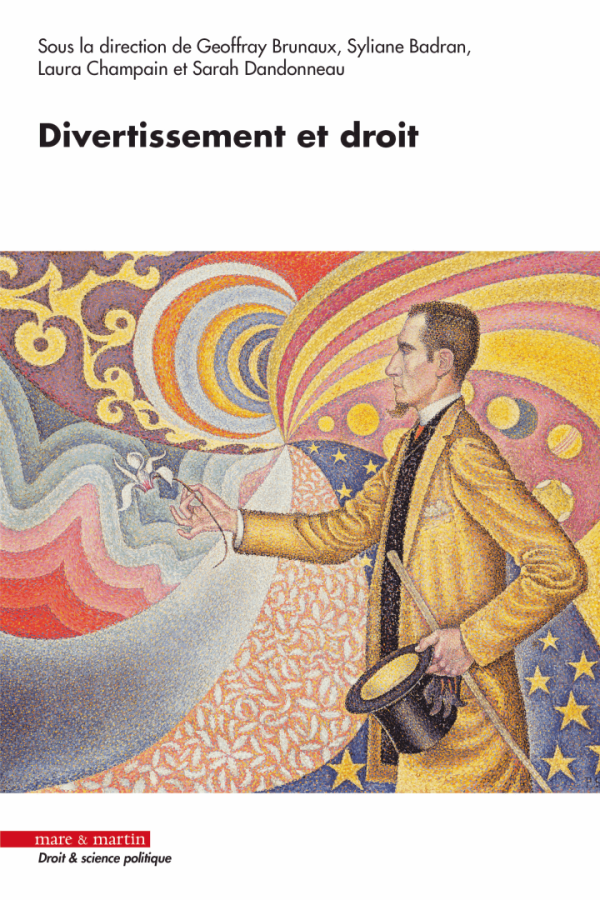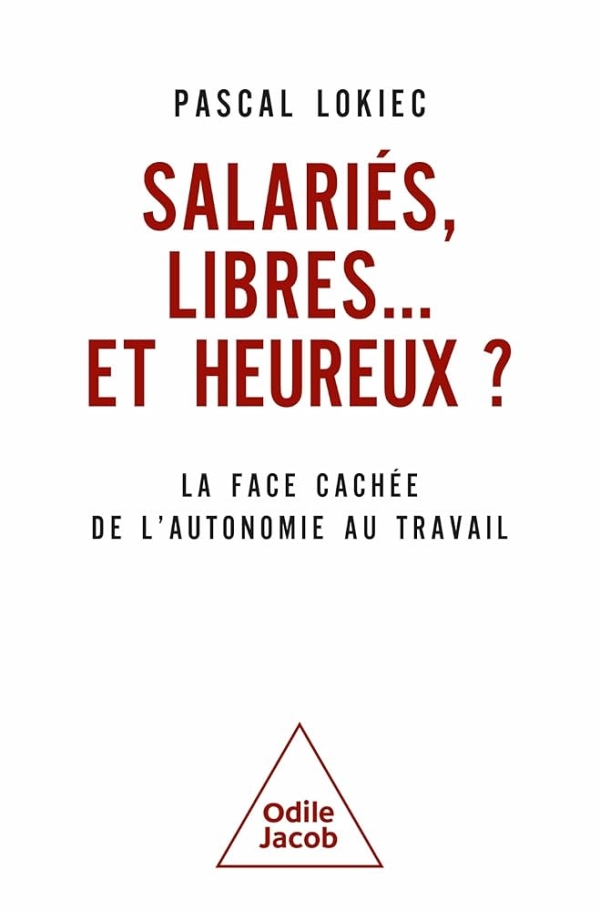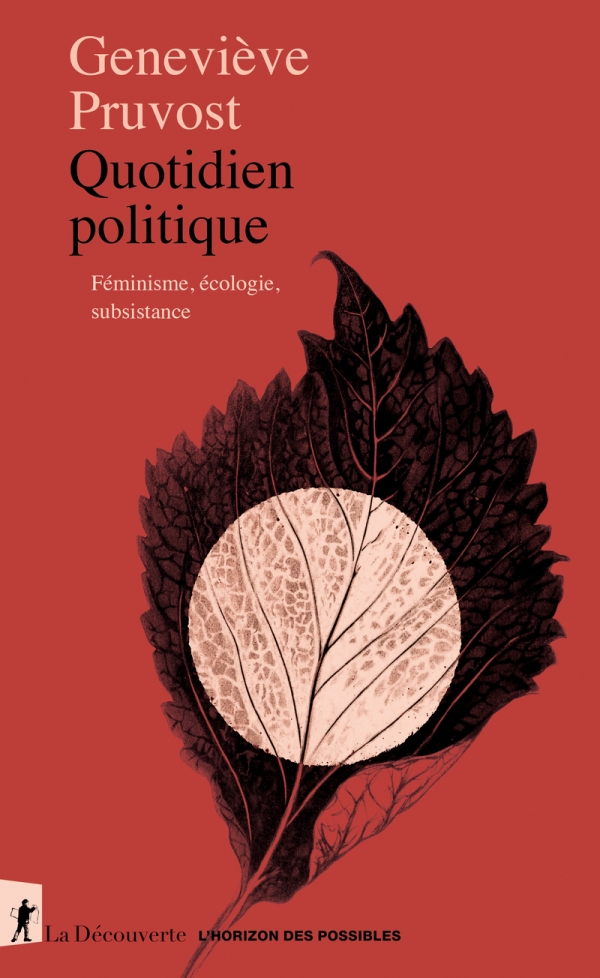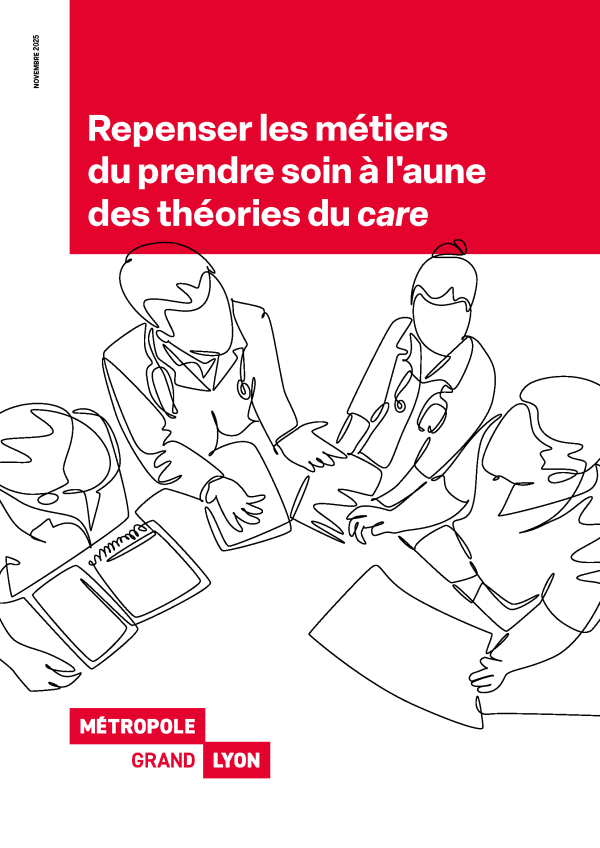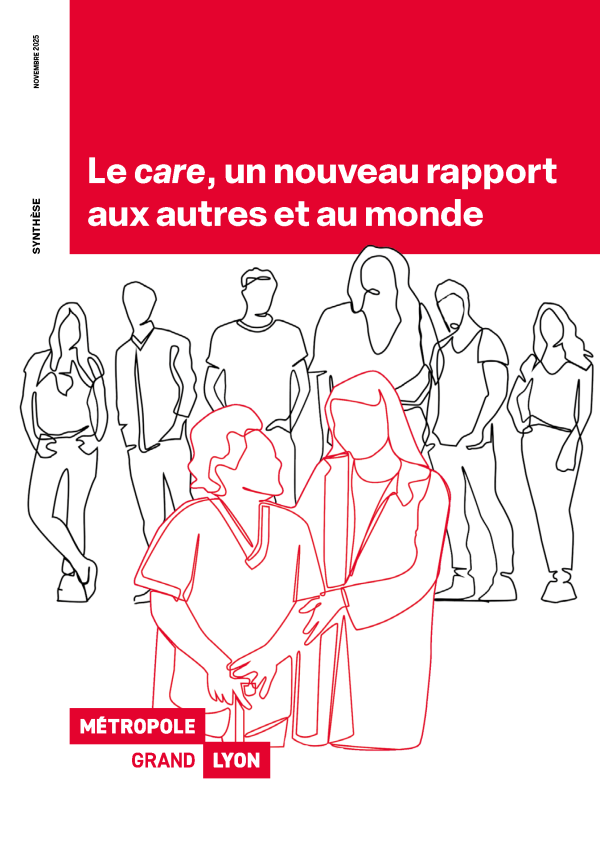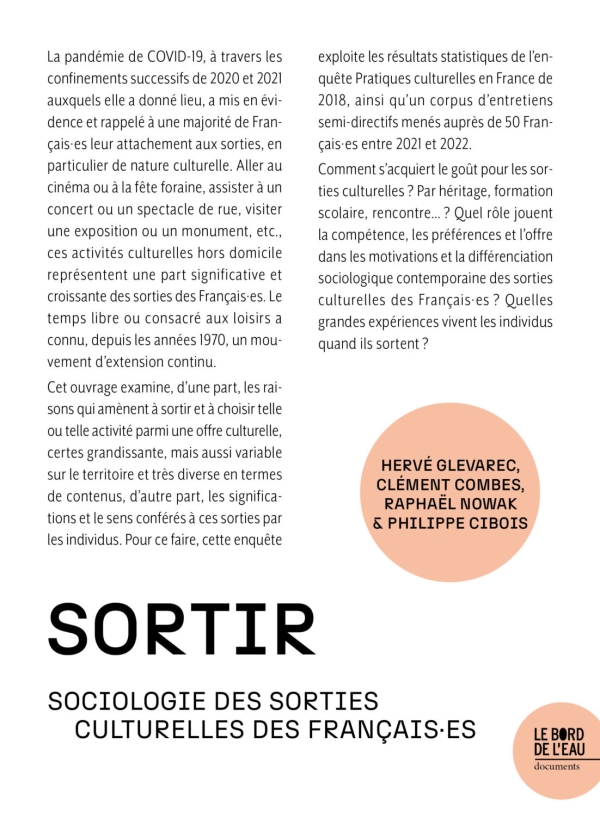« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie », aurait dit Confucius. Déjà au 5e siècle avant notre ère, le travail n’a pas bonne presse. Pour être heureux, il faudrait s’éloigner de la situation de travail.
Les représentations sociales contemporaines du travail n’invitent pas à se détacher de cette perception négative, comme en témoigne le succès de la proposition du linguiste Alain Rey de faire du mot « travail » l’héritier du mot latin « tripalium », un instrument de torture à trois pieux. Cette origine est contestée dans la communauté scientifique, notamment par la linguiste Marie-France Delport : travailler se rattacherait plus certainement à l’idée d’un voyage avec des obstacles.
Mais, pour elle, l’important est de ne pas oublier « le caractère indissolublement anthropologique et social du travail » : « Le travail est la manière propre dont s’organise notre espèce, dans la nature, pour y survivre, vivre et bien vivre. Il n’est donc pas un problème en soi, mais une solution. Ce qui est un problème, c’est la manière dont il est concrètement conçu, par qui et à quelle fin. […] Le problème, ce n’est donc pas le travail en soi qui n’existe pas, ce sont les conditions dans lesquelles chacun d’entre nous est amené à exercer le sien. C’est cela qu’il faudrait changer. […] Sa réalité, individuelle et collective, est une construction sociale, et peut donc faire l’objet d’une profonde rénovation, voire d’une autre construction ».
De la tâche au temps
Questionnant l’articulation entre travail et divertissement, le doctorant en droit privé Louis Noé rappelle qu’après la Révolution française, le travail était rémunéré à la pièce. Ce contrat de « louage d’ouvrage » permet effectivement de corréler assez directement temps passé à travailler et gain, quel que soit le ratio entre ces deux critères. Mais l’industrialisation des 19e et 20e siècles transforme radicalement ce modèle en faisant du temps le nouvel étalon.
Faire fonctionner les machines nécessite d’avoir une main-d’œuvre disponible sur une même unité de temps et de lieu. C’est donc la mise à disposition temporelle du corps et de l’esprit qui fait l’objet du contrat entre employeurs et employés, ce dont témoigne le Code du travail pour qui le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art L 3121-1). Toute la législation sociale qui se développe depuis vise à encadrer et réguler ce « louage de service », que ce soit pour en définir l’amplitude journalière, les durées annuelles, les dérogations ou autre.
Cette centralité du temps légitime le droit des employeurs à organiser et contrôler le bon usage de cette mise à disposition effective de la force de travail. Cette logique sous-tend ainsi le déploiement de nouvelles formes de surveillance en situation de télétravail, dont l’intrusivité ouvre un nouveau champ de luttes sociales.
Écorné au nom de l’autonomie (travail au forfait) ou de la compétitivité (dérégulation des heures supplémentaires), ce modèle au temps séparant travail et temps libre, temps loué et temps privé, est mis à mal par un double phénomène : d’un côté, le retour d’un travail à la tâche s’exonérant des protections légales, et invisibilisé sous les auspices du divertissement, et de l’autre la gamification.
Les fouleurs : la marchandisation du temps en mode fun ?
Den nos jours, trier des données, reconnaître des objets sur des images, vérifier la traduction d’un mot, la pertinence des réponses des chatbots, modérer les publications, reconnaître une langue, etc. sont autant de tâches nécessaires pour entraîner les algorithmes soutenant l’intelligence artificielle. Ce « prolétariat 2.0 » ainsi dénommé par le sociologue des cultures numériques Antonio A. Casilli, auteur de l’ouvrage En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic (2019), s’élèverait entre 45 et 90 millions de personnes réparties sur tous les continents. Cette « foule » recrutée par des plateformes dédiées à ce microtravail numérique réalise ainsi des tâches ultra-fragmentées de l’ordre de la seconde, rarement des minutes, et majoritairement rémunérées en centimes, rarement en euros.
Ce nouveau modèle de travail conjugue une rémunération par tâche à une disponibilité plus ou moins forte pour repérer les tâches quand elles arrivent, voire contrainte sur certaines plages horaires. Les sociologues Pauline Barraud de Lagerie et Luc Sigalo Santos, auteurs d’une enquête sur le crowdsourcing de micro-tâches et la marchandisation du temps, distinguent trois facettes de ce modèle de marchandisation du temps : vendre le temps « perdu », notamment au travail entre pause-café et trajet, vendre le temps libre et enfin la disponibilité, permettant une pratique intensive. Si les plateformes vantent la valorisation du temps perdu, en réalité, ce microtravail consiste en une activité prégnante pour beaucoup de fouleurs.
Tant l’ouvrage que les deux sociologues s’inquiètent du brouillage volontaire des frontières entre travail et divertissement promu par ce nouveau modèle vantant simplicité et variété. Un quart des utilisateurs de la plateforme française de microtravail Yappers Club (anciennement Foule Factory) considèrent d’ailleurs cette activité comme un travail ludique et 15 % comme seulement ludique.
Des revendications émergent sur le fait d’assimiler ces activités volontaires à du salariat, mais les postures sont clivées : si la plateforme américaine Crowdflower a vu sa relation aux fouleurs requalifiée en contrat de travail, ce n’est pas la position adoptée en 2022 par la Cour de cassation dans l’arrêt Clic and Walk, désavouant ainsi l’analyse des juges des instances précédentes, ainsi que l’Office central de lutte contre le travail illégal, à l’origine de la plainte.
Le jeu, au centre d’un nouveau modèle de travail ?
« Et partout le temps du jeu mord sur celui d’un sérieux érodé par l’ennui. […] Mais, puisque nous appartenons désormais à la “société ludique”, le jeu et les autres formes de divertissement tendent à occuper un espace de plus en plus important dans notre quotidien et notamment au travail », constatait déjà le sociologue Alain Cotta en… 1980 !
45 ans plus tard, le phénomène a définitivement fait sa place dans le monde professionnel au fur et à mesure que les recherches en neurosciences, psychologie et éthologie montrent l’importance du jeu sur le développement humain et ses impacts bénéfiques sur la santé mentale, l’apprentissage, la motivation et le lien social. La ludification, ou l’introduction de l’univers du jeu dans les espaces de travail, et la gamification, soit l’adoption des ressorts du jeu dans le travail même, sont ainsi mobilisées, plus ou moins intensivement, au service de l’engagement, de la productivité individuelle et de la performance de l’entreprise. Être dans un « état de jeu » transforme la perception du temps : il le suspend. Introduire le jeu au travail, revient donc à minorer la référence au temps dans la conception du travail.
L’anthropologue Emmanuelle Savignac développe une approche critique de cette dynamique entre bienfaits et limites. Ainsi, à l’instar du carnaval, les jeux proposant de renverser les hiérarchies pour un jour peuvent aussi servir, in fine, à les asseoir. Esteban Giner, docteur en Sciences de l’information et de la communication, creuse la piste d’un détournement de la gamification par la Gen Z, qui mobiliserait les codes du jeu vidéo, notamment stratégique, pour transcender un cadre de travail sur lequel elle n’a pas de prise. Plutôt que de se définir par rapport au travail et en chercher le sens, les Gen Z s’appuieraient sur la « meta », soit la connaissance des règles formelles et informelles structurant le milieu, pour jouer avec ses limites, s’épanouir et lutter contre l’exploitation salariale, par exemple en respectant à la lettre les horaires de travail.
Travailler pour divertir, est-ce encore travailler ?
Ces différentes problématiques furent mises en débat lors du colloque « Divertissement et droit », organisé en 2023 par la Faculté de Droit et Science politique de Reims. Un des constats récurrents qui y fut dressé par les chercheuses et chercheurs est la nécessité de mieux définir ce qu’est une prestation de travail au regard des multiples formes prises par l’hybridation du jeu et du travail, que ce soit la gamification ou la professionnalisation d’activités de passe-temps, telles que la création de contenus en ligne ou encore l’e-sport, investigué par le doctorant Célian Godefroid. Faut-il rémunérer le temps passé à jouer, puisque la personne en retire déjà des bienfaits ? Jouer, est-ce un « vrai » travail ?
Sarah Dandonneau, doctorante en droit public, souligne en premier lieu la difficulté à définir clairement les temps travaillés. En effet, de nombreux temps dits « de repos » sont en réalité contraints par le travail : temps d’habillage et de déshabillage, temps d’astreinte, temps de trajet, etc. Pour les « fouleurs », si les plateformes promettent une rémunération équitable au temps passé par tâche, le temps est en réalité déterminé à l’avance par les clients et laisse de côté le temps passé à se connecter et attendre des tâches, à s’entraider en l’absence de référent, à vérifier les rémunérations, etc.
La problématique est aussi celle des artistes relevant du régime de l’intermittence. Si ce dernier permet de « prendre du temps » pour créer, il ne considère pas comme temps effectif de travail, et donc permettant de constituer le socle d’heures minimales pour y être éligible, tout le travail de recherche et de montage de projet, de gestion administrative, de diffusion, activités reléguées aux périodes « chômées ».
La maîtresse de conférences Stéphanie Le Cam invite ainsi les pouvoirs publics à dépasser une conception « propriétariste » de l’œuvre intellectuelle, rémunérée au succès de son exploitation, pour reconnaître la nature économique des activités de divertissement et rémunérer le temps passé à créer, invisibilisé actuellement. Il faudrait ainsi dépasser les représentations romantiques et naïves d’une activité vocationnelle, l’image de l’artiste « bohème ou rentier qui se délasse dans ce passe-temps culturel », alors que nombre de créateurs travaillent à la commande et dépendent des industries culturelles.
C’est bien l’argument de l’amusement qu’ont évoqué les sociétés de production de jeu télévisé (Île de la tentation, Koh Lanta, Pékin Express, etc.) pour refuser aux participants le statut de travailleurs salariés. Un argumentaire réfuté par la Cour de cassation depuis 2009 en raison des directives imposées à ces derniers et de la production de valeur économique pour autrui. Cette posture constitue, en matière de doctrine, « une avancée juridique » dans la protection des droits des créateurs, mais une avancée encore insuffisante au regard des problématiques : bricolage juridique dans l’e-sport, faiblesse des droits sociaux, insuffisance de la représentation collective laissée à l’engagement bénévole, rapport de force inégal dans les négociations collectives, etc.
La résolution adoptée par les députés européens en novembre 2023 pour la mise en place d’un statut professionnel pour les artistes-auteurs laisse espérer des avancées indispensables à la préservation de la création culturelle. Comme le souligne l’ouvrage, qu’adviendra-t-il de la création et du divertissement s’ils sont l’apanage d’une élite à succès ou n’ayant nul besoin d’une activité rémunératrice ?