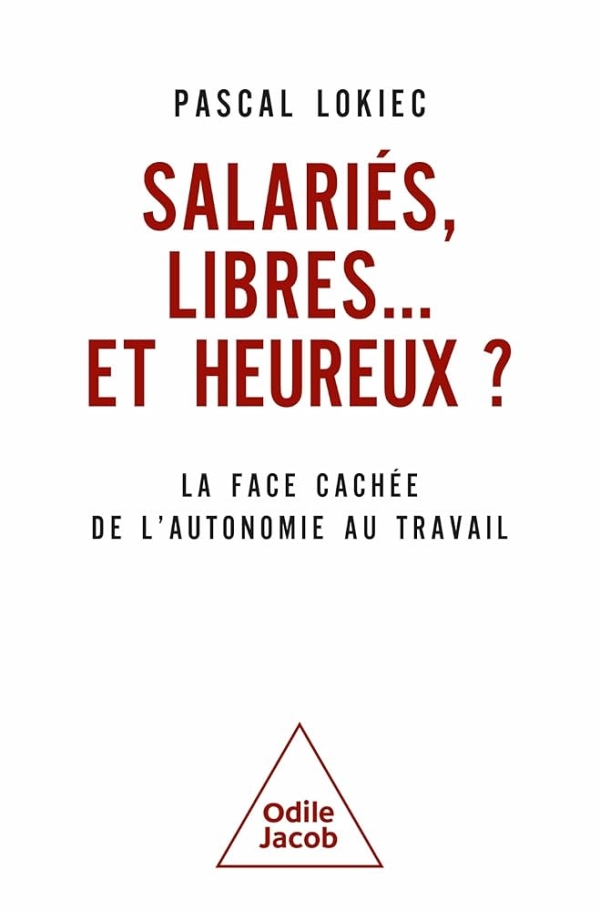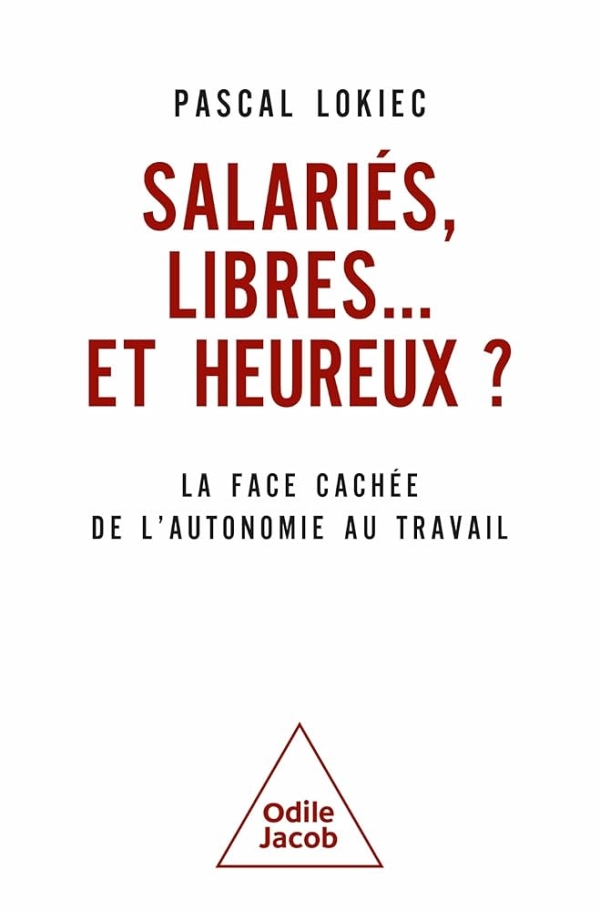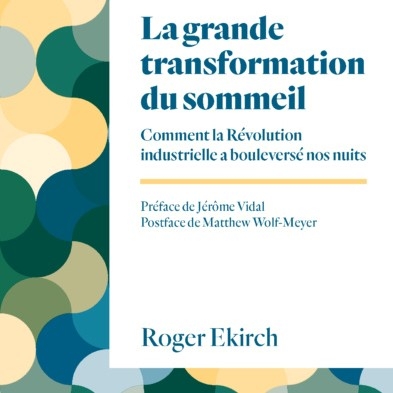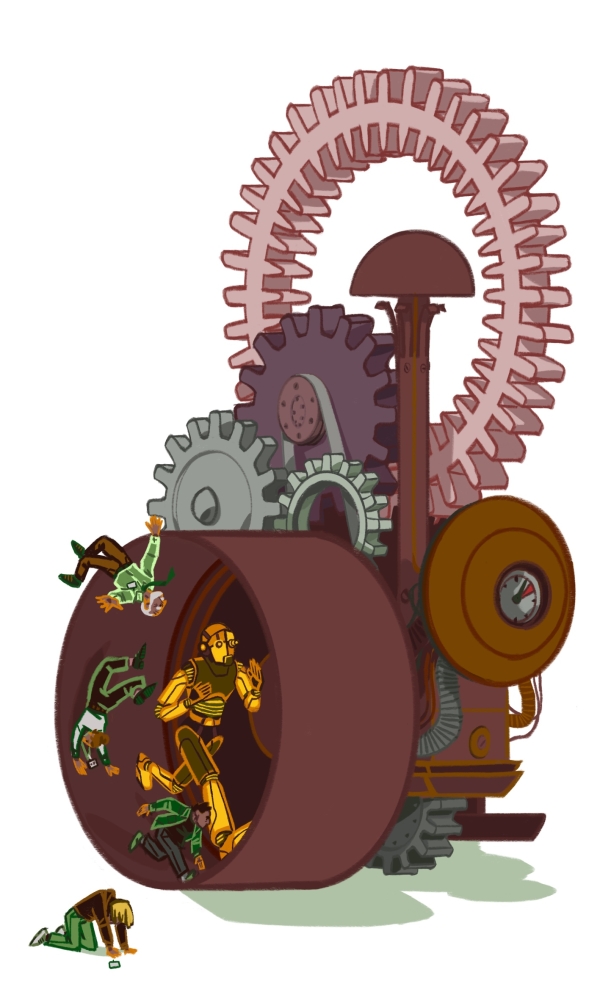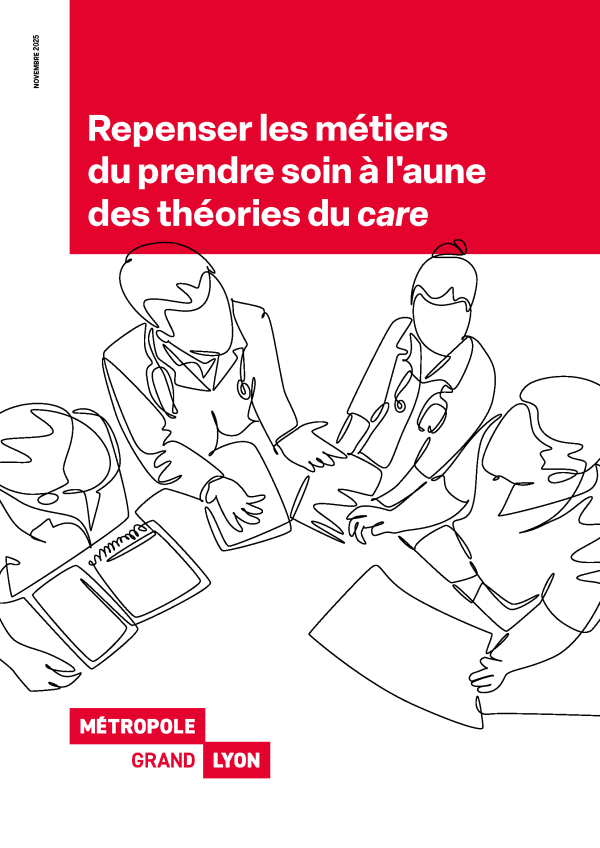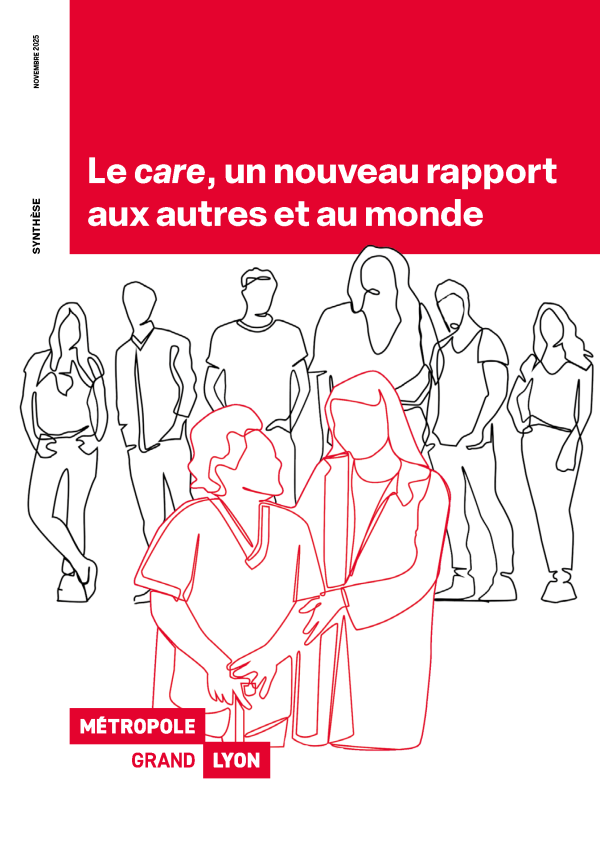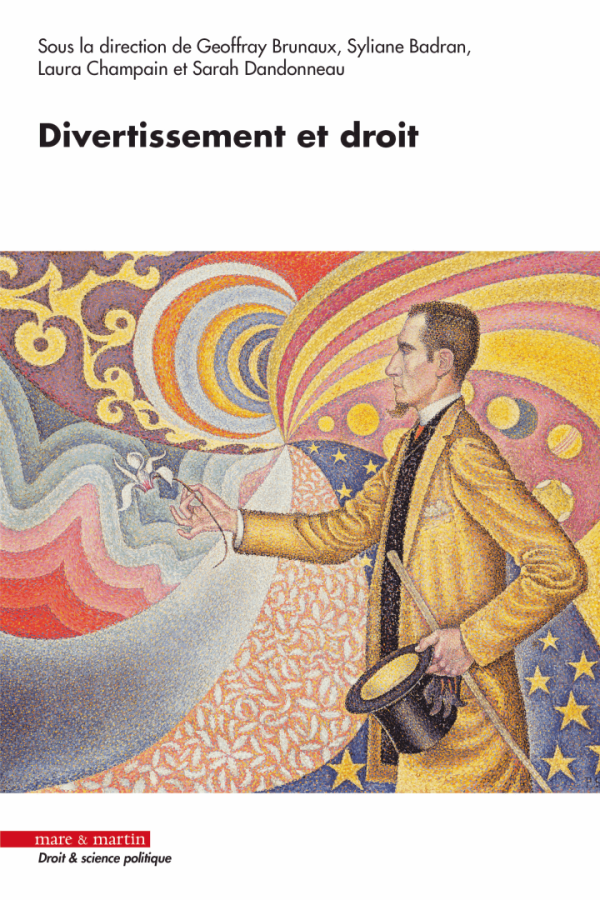Le temps libre revient en force dans les imaginaires contemporains. À mesure que les technologies, et notamment l’intelligence artificielle générative, promettent de remplacer des pans entiers du travail humain, certains se prennent à rêver d’un nouveau communisme du luxe, libéré des contraintes productives.
Cette projection, quelques semaines après le sommet de l’IA, à Paris, ressuscite les utopies du passé. Elle repose pourtant sur un malentendu : ce n’est pas tant la production qui manque à notre époque que la capacité à prendre soin — des milieux, des corps, des infrastructures vieillissantes, des communs abîmés.
Pourquoi la médiatisation du IA Submit, qui se déroulait à Paris 6 au 11 février 2025, questionne-t-elle la question du renouveau des temps libres ? Parce que cette vitrine promotionnelle du développement des performances et des champs d’action de cet ensemble de technologies a exclu de sa feuille de route la réflexion sur le poids de son empreinte écologique, pourtant chaque jour plus grand. Or, le temps libéré par cette automatisation vorace en énergie, en matériaux et en eau peut être envisagé comme une ressource précieuse pour préserver, voire restaurer, ce qui pourrait l’être, et démanteler ce qui devra l’être.
En parallèle, deux autres évènements viennent donner un écho particulier à ce contexte. D’une part, la Commission européenne a publié le 26 février un projet de législation « omnibus » visant à simplifier les obligations européennes de reporting en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), afin d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, tout en harmonisant les réglementations CSRD, CS3D (devoir de vigilance) et la taxonomie verte européenne.
D’autre part, le 27 mars dernier, le régulateur américain des marchés financiers (SEC) a annoncé l’abandon du projet d’obligation pour les sociétés cotées à Wall Street de communiquer des données sur leurs émissions de gaz à effet de serre et sur leur exposition aux risques climatiques.
En clair, nous misons beaucoup sur les apports d’une IA qui devrait impacter l’ensemble des secteurs de l’économie mondiale. Nous ne posons pas en profondeur la question de son impact écologique, et il n’est actuellement pas envisagé de mettre les ressources en temps ainsi libérées au service de la redirection écologique. Par ailleurs, alors que la température augmente de façon imprévisible, nous décidons, en quelque sorte, de briser le thermomètre.
C’est pourquoi cet article se propose de déplacer la question du temps libre non pas du côté de la promesse technologique, mais du côté de la redirection écologique. Il ne s’agit pas ici de rêver d’une vie sans travail, mais d’interroger les formes d’activité nécessaires, quoique peu désirées, que la situation impose désormais.
Les communs négatifs et l’écologie du démantèlement
Dans le sillage de la redirection écologique, les communs n’ont plus seulement le visage désirable des ressources partagées ou des services (plus ou moins) ouverts. Il faut aussi apprendre à composer avec leurs revers : des communs désormais négatifs, produits d’une histoire longue d’accumulation, d’artificialisation et d’oubli.
Centrales nucléaires comme à charbon, incinérateurs, infrastructures surdimensionnées, pollutions persistantes, ou encore modèles urbains fondés sur la croissance à tout prix : autant d’héritages empoisonnés qui appellent à une prise en charge spécifique. Le démantèlement devient alors une pratique à part entière. Il implique, pour que celle-ci se démocratise, un travail, une économie et des institutions.
Parmi les propositions qui émergent pour penser cette bascule, l’écologie du démantèlement met l’accent sur les formes de travail et d’organisation requises pour gérer les infrastructures devenues indésirables, sans qu’il soit aisé d’y échapper. Certaines réalisations du passé — centrales, réseaux, territoires artificialisés — ne peuvent être simplement effacées ou mises à l’arrêt. Elles laissent derrière elles des traces persistantes, des risques à surveiller, des effets durables.
Yves Citton parle à ce propos d’effets de féralité : des manifestations imprévues, durables, parfois incontrôlables, produites par des dispositifs techniques échappant partiellement à notre maîtrise. Ces effets contraignent à envisager un travail spécifique, fait de surveillance, d’entretien, de reconfiguration — un travail peu visible, souvent ingrat, mais essentiel.
Temps libre, travail et contribution
Le soin que cela suppose ne relève pas du care dans son acception morale ou relationnelle. Il ne s’adresse ici ni à des personnes vulnérables ni à des individus en demande d’attention. Il s’agit plutôt d’un soin sans sujet, d’une attention soutenue portée à des héritages matériels actifs, dont la négligence ou l’abandon ne feraient qu’aggraver les effets. Ce type de soin engage une temporalité longue, discontinue, qui déborde les formats habituels du travail et de l’action publique. Il appelle à repenser collectivement ce que nous acceptons de prendre en charge.
Penser une économie du soin des communs négatifs suppose alors une redéfinition du travail et du temps. Jim Gabaret et Céline Marty proposent de concevoir le travail comme une activité non spontanée, réalisée pour autrui, et appelant reconnaissance et rétribution. Les tâches de la redirection — maintenir, surveiller, renoncer, démonter — relèvent pleinement de cette définition. Elles ne s’imposent ni par l’envie ni par la vocation. Elles s’imposent néanmoins.
À l’inverse, le temps libre est aujourd’hui souvent valorisé comme espace d’épanouissement, de détente ou de développement personnel. Or, dans un monde abîmé, il ne peut pourtant être complètement dissocié des tâches collectives nécessaires à la préservation des conditions d’habitabilité. Autrement dit, d’une forme de travail. Ce sont donc les frontières entre ces deux termes (et les réalités qu’ils désignent), qui se brouillent, face à un nouvel impératif.
Il ne s’agit pas de demander à chacun de devenir technicien du démantèlement, mais de reconnaître que le temps disponible peut devenir un temps habité, structuré autour d’engagements non spontanés, mais reconnus, soutenus, socialement organisés. Il devient alors nécessaire de penser ensemble travail, temps libre et contribution, au-delà des catégories héritées.
De nouvelles formes d’organisation et de rémunération
Trois dispositifs offrent des réponses contrastées à cette exigence : le revenu universel, le salaire à vie (dans la lignée de Bernard Friot, qui voit dans la retraite précoce une voie de réappropriation du travail), et le revenu de transition écologique. Le revenu universel dissocie revenu et emploi, permettant à chacun de choisir ses engagements. Le salaire à vie rattache toute contribution à une qualification reconnue, universalisée. Le revenu de transition, plus pragmatique, oriente les ressources vers des chantiers concrets de redirection, en ciblant les territoires.
Ces approches divergent quant à la manière de libérer le temps. Le revenu universel est d’ailleurs souvent convoqué pour panser les plaies de la montée en puissance promise par l’automatisation de tâches toujours plus nombreuses et qualitatives. Il l’ouvre sur un temps libre disponible, sans orientation précise. Le salaire à vie le transforme en temps de contribution reconnue. Le revenu de transition l’affecte à des activités précises. Dans cette dernière perspective, les tâches liées aux communs négatifs trouvent un ancrage clair : il ne s’agit plus de parier sur la bonne volonté d’individus isolés, mais de créer les conditions collectives, économiques et temporelles, pour que ces tâches soient prises en charge dans la durée.
Une autre piste passe par les formes organisationnelles. Le modèle de la « mission à entreprise », développé dans le projet L’Entreprise qui vient (Plurality University), renverse la logique classique de l’entreprise pérenne. Il s’agit de s’assembler autour d’une mission temporaire, puis de se dissoudre une fois celle-ci accomplie. L’archétype de la Corp B incarne cette mutation : gouvernance collégiale, objectif de transformation, acceptation de la finitude.
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) offre un exemple bien réel de ce principe : une institution dont le capital est affecté à une mission spécifique, non échangeable, au service du soin apporté à un commun négatif. Le philosophe Pierre Caye rappelle que c’est précisément cette logique d’affectation qui distingue une institution d’une entreprise/organisation.
Vers une comptabilité du soin et de la soustraction
Transformer les règles du jeu économique reste néanmoins indispensable. Les travaux menés dans le cadre des « Nouveaux Modèles économiques urbains » (NMEU, saisons 4 et 5) par Partie prenante, Ibicity et Espelia apportent des pistes concrètes. La sobriété — baisse structurelle des consommations (eau, énergie, déchets, mobilité, foncier…) — agit désormais comme un aléa économique majeur. Elle fragilise les modèles reposant sur la croissance des volumes, déstabilise les financements liés aux recettes d’usage et confronte les collectivités à la sous-utilisation coûteuse d’infrastructures prévues pour l’abondance. Elle met en lumière la dépendance structurelle de notre économie à la massification des flux.
La sobriété crée un effet ciseaux : moins de consommation égale moins de recettes, alors que les coûts fixes, eux, restent élevés. Le cas de l’eau potable l’illustre : la baisse des usages ne réduit pas les obligations d’entretien. Le modèle « l’eau paie l’eau » devient dès lors insoutenable. Les rapports NMEU proposent plusieurs leviers :
- Décorréler la rémunération des opérateurs des volumes consommés ;
- Créer des fonds sobriété incitatifs ;
- Réviser les outils de planification pour intégrer la contraction et la fermeture ;
- Intégrer les effets de seuil dans les modélisations ;
- Repenser les indicateurs : mesurer non seulement ce qui est produit, mais ce qui est évité, retiré, désinvesti.
Ces propositions dessinent les contours d’une économie du soin orientée vers la soustraction, la mise en veille, la reconfiguration. Elles engagent à repenser non seulement les modèles économiques de la transition, mais bien la transition des modèles économiques. Une transformation qui touche aussi bien la gouvernance que les instruments comptables.
La comptabilité n’est pas un simple outil de mesure : elle constitue un mode d’organisation du monde. Dès Max Weber, on voit se dessiner une intuition forte : la comptabilité en partie double, en tant que technologie de calcul des flux, a accompagné l’émergence du capitalisme moderne, en en formalisant les logiques et les attentes. Elle a contribué à façonner la manière dont les agents économiques perçoivent les activités, les finalités, la performance. Elle installe une forme de rationalité instrumentale centrée sur la rentabilité et l’optimisation.
Ainsi, repenser les modèles économiques de la redirection suppose aussi de déconstruire et reconstruire les schèmes cognitifs et matériels véhiculés par la comptabilité conventionnelle, pour rouvrir sur d’autres conceptions de la valeur, du lien, du temps et du coût.
À rebours d’une simple mise à jour des indicateurs, plusieurs approches comptables alternatives proposent aujourd’hui de refonder les cadres de gestion à partir des limites planétaires et des engagements éthiques. Le cadre CARE (Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Environnement, aujourd’hui Comprehensive Accounting in Respect of Ecology), porté par Jacques Richard, Alexandre Rambaud et Hervé Gbego, vise à reconnaître explicitement dans le passif des organisations les obligations contractées envers les milieux et les personnes.
La CEC (Comptabilité Écosystème-Centrée) cherche à ancrer cette logique dans les territoires, en mettant en regard l’activité des entités et la préservation effective des écosystèmes concernés. De son côté, l’analyse de matérialité, telle qu’elle est mobilisée dans le cadre du Green Deal européen, permet d’identifier les enjeux économiques et environnementaux majeurs pour chaque organisation. Ensemble, ces approches forment le socle d’une comptabilité apte à accompagner les politiques de renoncement, plutôt qu’à les empêcher. Il ne s’agit pas seulement de mieux compter, mais de compter autrement — en cohérence avec les fins de la redirection.
C’est à ce niveau que se situe le travail de Pierre Musseau, membre de la Coop des Communs, au sein de Metapolis et du Centre européen de Sociologie et de Science politique (CESSP) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En articulant la comptabilité CARE (on pourrait lire : « Comptabilité adaptée au Renoncement écologique » !), les communs négatifs et les approches féministes du soin, il souligne que les outils comptables eux-mêmes peuvent constituer des communs négatifs.
Sous leur apparente objectivité, ils véhiculent des conventions qui invisibilisent les dettes sociales et écologiques. CARE propose de faire figurer dans le passif d’une organisation non seulement ses obligations financières, mais aussi ses engagements envers les milieux et les personnes.
En croisant C.A.R.E avec l’analyse de matérialité du Green Deal et la comptabilité de gestion écosystème-centrée (C.E.C), Musseau nourrit l’approche de la « Sécurité sociale de la redirection écologique » par la reconnaissance du travail de soin, les mutuelles alimentaires vertueuses, ou encore des mécanismes de compensation inspirés du principe des avaries communes, récemment remise au goût du jour par Blanche Segrestin et Armand Hatchuel. Autant d’éléments qui participent à la construction d’un langage comptable commun, permettant de renoncer sans être sanctionné (ou le moins possible).
Redéfinir le travail pour responsabiliser le temps libre ?
Au fond, la redirection écologique engage un triple mouvement : redéfinir le travail, transformer les organisations, recomposer les modèles économiques. Replacée sous l’angle du temps libre, cette dynamique prend une tout autre ampleur, car la prise en charge des communs négatifs révèle une vérité souvent tue : le temps dit « libre » ne l’est jamais tout à fait.
Dans un monde façonné par les séquelles du productivisme, par des dispositifs techniques en fin de cycle, ce temps ne saurait être réduit à un espace de retrait, de consommation ou de délassement octroyé par les gains de productivité (un otium consumériste, ce qui constitue presque une contradiction). Il devient le support d’une nouvelle politisation du soin — moins comme une obligation morale qu’une disponibilité collective (et non seulement bénévole ou découlant d’un engagement individuel) pour des tâches nécessaires, souvent non choisies, situées et toujours vitales.
Redéfinir le travail, ici, revient à reconnaître que certaines tâches essentielles échappent aux formes classiques de l’emploi. Transformer les organisations vise à rendre possibles des assemblages temporaires, adaptés à la finitude des missions comme à celle des structures. Recomposer les modèles économiques implique de soutenir une économie de la retenue, de la maintenance et du retrait actif — non pas en marge de la valeur, mais comme sa condition.
Dans cette perspective, le temps libre ne figure plus comme un bénéfice accessoire de la modernité ou un droit individuel abstrait — pas plus qu’une dimension dévolue à une forme d’autonomie retrouvée axée sur la subsistance, dans un monde qui aurait évacué la supposée « parenthèse moderne ». Il devient une ressource politique, à relier aux responsabilités partagées, aux formes instituantes du soin, aux engagements situés. Ce que la redirection esquisse, ce sont moins de nouvelles promesses que de nouvelles manières d’habiter les restes : ce qui persiste, ce qui encombre, ce qui oblige — et à quoi il faut bien répondre, collectivement et politiquement.