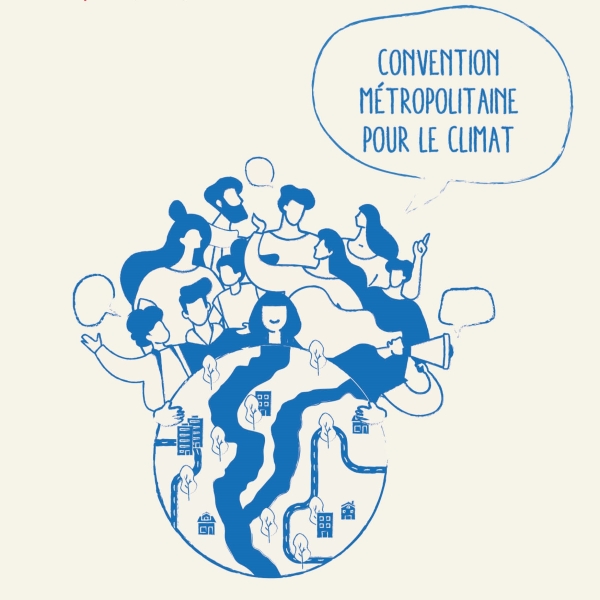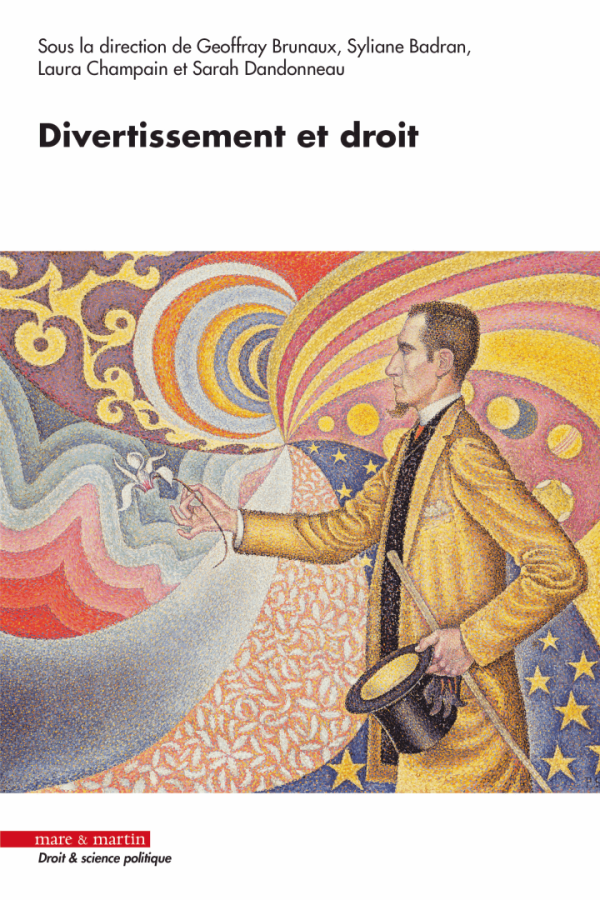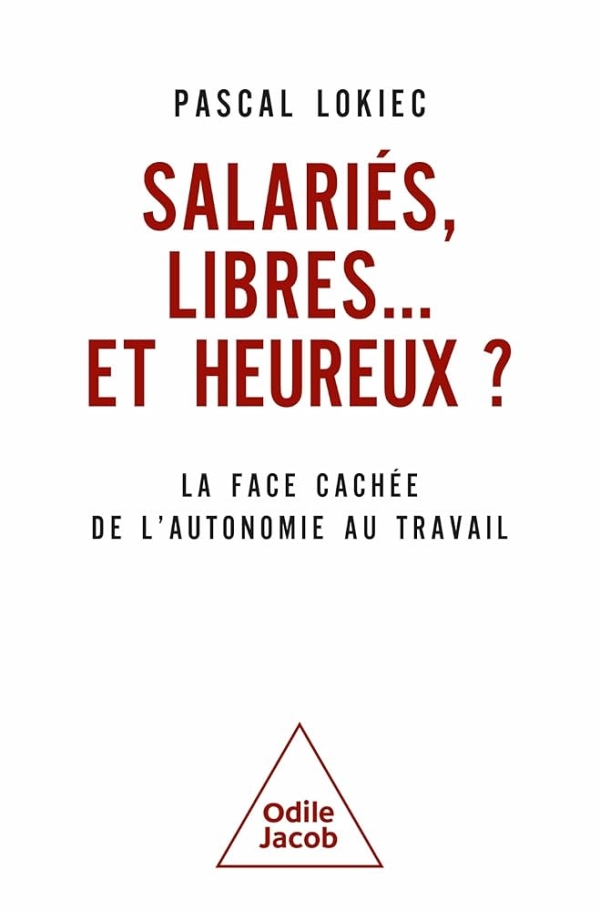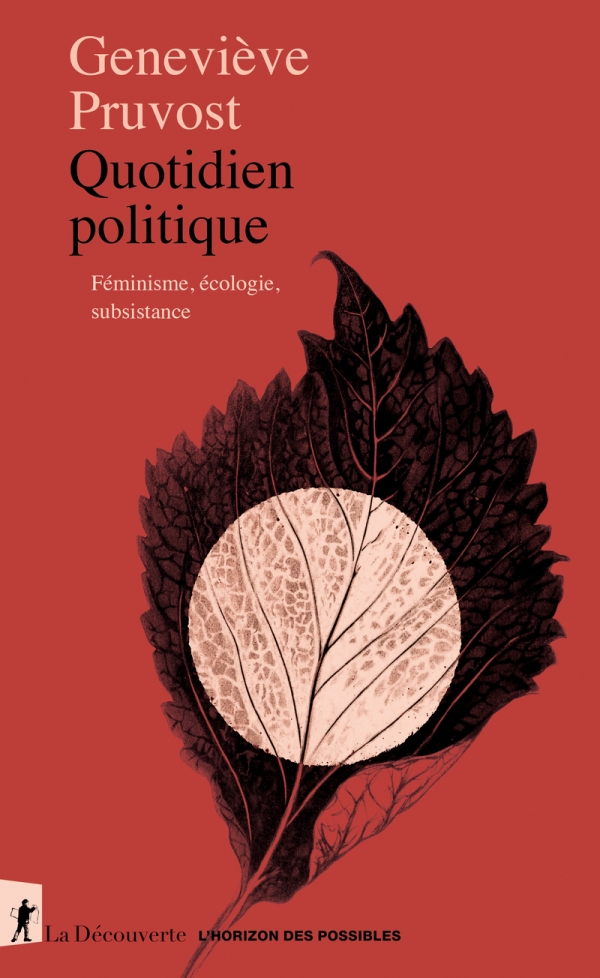La crise écologique est désormais indissociable des transformations sociales qu’elle exige. Si le modèle productiviste a permis un développement sans précédent, il a aussi conduit à un épuisement des ressources naturelles, à une destruction massive de la biodiversité et à une remise en cause des conditions mêmes d’habitabilité sur Terre. Dans ce contexte, le travail, moteur de l’activité humaine, est à la croisée des chemins.
Alors que la transition écologique est souvent envisagée sous l’angle technocratique ou purement économique, la redirection écologique propose une approche radicalement différente. Elle refuse l’idée que tout doit être maintenu — infrastructures, emplois, habitudes de consommation — et appelle à un « juste renoncement », porté par une démocratie réelle impliquant directement les travailleuses et travailleurs dans la transformation de leurs activités.
Cet article explore les dynamiques émergentes qui redéfinissent le travail à travers les luttes syndicales, la formation professionnelle et la dissociation entre emploi et revenu. Ces approches, encore expérimentales, tracent cependant les contours d’un avenir où justices sociale et climatique convergent.
Le travail, moteur ou frein de la transition ?
La transition écologique est souvent présentée comme une opportunité de création massive d’emplois « verts ». Pourtant, cette vision optimiste, reposant sur une « destruction créatrice », peine à convaincre. Les chiffres, quand ils sont disponibles, oscillent entre projections séduisantes et réalités bien plus contrastées. On parlait de 4 millions d’emplois en 2019, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.
L’idée que les emplois verts ou « écolo-compatibles » pourraient compenser mécaniquement les destructions d’emplois élude les délais nécessaires à la reconversion, les résistances au changement, et surtout, l’absence d’un cadre structurant pour accompagner cette transformation, sans parler de conditions de travail appelées à se durcir à l’avenir, comme nous en rendions compte dans un précédent billet.
Reste l’angle du marché, qui passe par la formation et de nouveaux socles de compétences. Le rapport du Shift Project sur la formation des actifs met en lumière un paradoxe : alors que les besoins en compétences pour accompagner la redirection écologique sont immenses, les dispositifs actuels restent largement inadaptés.
La formation professionnelle (dont la Cour des comptes vient tout juste d’évaluer le Plan d’investissement dans les compétences le 28 janvier dernier), pensée pour répondre aux exigences d’un marché du travail stable, peine à intégrer la flexibilité et l’innovation nécessaires à une transition rapide. Pour y remédier, le Shift Project propose des formations territorialisées, en concertation avec les acteurs locaux, y compris les travailleurs eux-mêmes. Cette approche, loin des solutions génériques, permettrait d’anticiper les besoins spécifiques de chaque région, tout en réduisant les résistances au changement.
Ajoutons que les précédents historiques de la fermeture des mines et centrales à charbon ne fournissent pas un exemple probant au regard des enjeux actuels. Un rapport de l’institut Veblen paru en 2022 rappelait à cet égard que si l’État a su mettre sur la table des sommes importantes en proposant des compensations essentiellement financières, les réponses aux enjeux actuels nécessitent d’aller plus loin, ce sont désormais tous les secteurs qui sont touchés de même que l’ensemble des territoires. Comment, dès lors, aborder une problématique aussi massive ?
Allier justices climatique et sociale
L’écologie est souvent perçue comme « punitive », en particulier par les catégories populaires et les travailleurs de secteurs polluants. Cette perception est alimentée par des politiques publiques qui privilégient des interdictions unilatérales ou des contraintes financières (taxes ou réglementations), sans toujours prendre en compte les impacts sociaux de ces mesures. Les Gilets jaunes ont illustré cette fracture entre écologie institutionnelle et justice sociale.
Toutefois, comme l’a montré le travail de Nils Hammerli (primé par l’Institut Veblen) sur la raffinerie de Grandpuits, les travailleuses et travailleurs ne s’opposent pas systématiquement aux logiques écologiques, mais demandent des garanties claires. Ces garanties concernent la sécurisation de leurs revenus, l’accompagnement dans la transition, mais aussi une reconnaissance pleine et entière de leur rôle dans la transformation productive. À Grandpuits, la convergence entre syndicats et écologistes a permis de poser les bases d’une transition juste. Mais cet exemple reste l’exception, non la règle.
Une récente étude de Parlons Climat montre que cette la défiance vis-à-vis de l’écologie est renforcée par un déficit d’information et une défiance croissante envers les institutions. Bien que le climatoscepticisme ne représente qu’une minorité, il trouve écho chez ceux qui ressentent l’écologie comme une menace pour leur mode de vie ou leurs conditions de travail. Ce phénomène met en lumière la nécessité de recontextualiser les transitions écologiques pour qu’elles soient perçues comme justes et inclusives.
La redirection écologique propose justement une approche basée sur la l’enquête et la justice. Elle reconnaît que le renoncement à certaines activités écocides est nécessaire, mais insiste sur l’importance de laisser les premiers concernés — travailleuses et travailleurs — décider des modalités de cette transition.
Il s’agit donc de renouveler les ressorts du dialogue social, afin de ne pas considérer les salarié·es comme des actifs échoués, à l’instar de la question posée par le nouveau podcast C’est Chaud., lancé par la journaliste Layla Hallak, et qui se demandait récemment comme recycler les travailleurs polluants : une manière de prendre de la distance, sur un mode ironique, avec les visions très top-down qui dominent habituellement les politiques publiques en matière d’emploi — et de transition.
À Gardanne, par exemple, les salarié·es de la centrale biomasse ont obtenu des garanties salariales prolongées grâce à leur mobilisation collective, montrant qu’il est possible de négocier des compromis équitables tout en s’alignant sur les objectifs climatiques. Pour autant, leur sort est loin d’être réglé à ce jour, illustrant les difficultés de mettre en œuvre ces reconversions.
Les luttes autour de la raffinerie de Grandpuits offrent un exemple concret de convergence entre justices climatique et sociale. Raffineurs et militants écologistes ont uni leurs forces pour contester un modèle extractiviste, tout en exigeant une reconversion juste pour les salarié·es concernés. Cette expérience montre que les travailleurs et les travailleuses peuvent être les allié·es d’une transition écologique ambitieuse, à condition qu’ils et elles soient pleinement associé·es aux décisions et non réduits à des variables d’ajustement.
Dans le privé ou le public, des salarié·es mobilisé·es
Associer les travailleurs et les travailleuses constituent bel et bien, aujourd’hui, un impératif qui anime plusieurs initiatives. À commencer par le « RADAR » lancé par l’Ugict-CGT (Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens) et le collectif Pour un réveil écologique, avec un soutien de l’Agence nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Anact) et du cabinet de conseil RH Secafi. Sur le site de cette initiative, on peut notamment lire deux constats :
- « En tant que salariées et salariés, nous sommes doublement aux prises avec ces menaces : d’un côté, nos conditions de travail se dégradent, de l’autre certaines activités vont devoir s’arrêter. »
- « Par nos responsabilités professionnelles, nous sommes les mieux placé·es pour identifier ce qu’il faudrait faire autrement. Pourtant, nous ne sommes ni consulté·es ni écouté·es. Nous nous organisons pour faire entendre notre voix. »
Ce dispositif vise à permettre aux représentant·es du personnel d’établir un état des lieux de leur entreprise (ou de leur collectivité) face aux enjeux écologiques, selon sept domaines ou critères : le réchauffement climatique, la biodiversité, les pollutions, la consommation de ressource, la stratégie économique, l’implication des salarié·es et les parties prenantes. À partir de cet état des lieux, les salarié·es mobilisent leur expertise pour formuler des propositions, les porter auprès de leur direction et suivre leurs revendications.
Pour une Sécurité sociale de la redirection écologique (SSRE)
Initiée au sein du réseau salariat, avec le soutien des Shifters d’Aix-Marseille, de l’institut Rousseau, du Réseau Action Climat, du Printemps écologique ou encore de l’Anact, la Sécurité sociale de la Redirection écologique représente une tentative audacieuse de redéfinir les relations entre emploi, revenu et transition écologique.
Inspirée du Régime général de Sécurité sociale instauré en 1945, la SSRE propose de dissocier le droit au salaire de l’emploi occupé, permettant ainsi aux travailleuses et travailleurs de quitter des activités écocidaires sans craindre pour leur subsistance. De nombreux travailleurs ressentent en effet une dissonance cognitive entre leurs valeurs écologiques et l’impact de leur activité professionnelle. Cette tension, souvent atténuée par des justifications économiques (« Je fais ça pour nourrir ma famille »), devient de plus en plus difficile à ignorer face à l’aggravation des crises climatiques.
L’étude participative menée dans le cadre du projet SSRE montre que cette dissonance peut être réduite par des dispositifs garantissant un revenu sans condition d’emploi. En dissociant revenu et travail, la SSRE permettrait aux travailleurs de s’engager en accord avec leurs convictions, tout en limitant les phénomènes de rationalisation qui freinent la transition écologique.
Ce dispositif vise également à renforcer leur pouvoir d’agir en leur conférant une capacité décisionnelle sur les orientations productives. En pratique, la SSRE s’appuie sur des débats entre salarié·es, syndicats et experts. Ces débats permettent d’identifier les besoins spécifiques des travailleurs tout en explorant des modèles alternatifs de gouvernance démocratique dans l’entreprise. L’objectif est clair : transformer les travailleurs en acteurs de la transition/redirection, capables de décider ce qui doit être produit, pour quoi et comment, et selon quelles conditions.
Bifurcation RH : associer besoins humains et limites planétaires
Le projet Bifurcation RH porté par la Ville de Grenoble, l’association Auxilia et financé par l’Anact, a permis de poser des jalons essentiels pour la redirection écologique des RH dans les collectivités territoriales. Plusieurs métiers (jardiniers, thermiciens, mécaniciens, auxiliaires de puériculture, etc.) ont été analysés dans leurs spécificités, leurs défis et leurs trajectoires.
Le projet a montré comment ces professions, souvent invisibilisées, peuvent devenir des vecteurs de transformation écologique, en valorisant leurs savoir-faire et en réinterrogeant leurs pratiques. Ces métiers ont été replacés au centre de l’action publique, non comme de simples exécutants, mais comme les acteurs clés de la transition.
En partant du quotidien des agents, le projet a éclairé les interactions complexes entre contraintes climatiques, organisationnelles et sociales. Cette approche a permis de dépasser une vision abstraite de la transition pour mettre en lumière les tensions vécues et les inventions locales. L’attention portée aux pratiques concrètes, aux routines professionnelles et aux ajustements improvisés a permis de dégager des enseignements applicables à d’autres contextes.
En intégrant les agents, les managers, les syndicats et les décideurs dans une réflexion commune, le projet a ouvert la voie à une démarche contributive. Les ateliers de restitution et les entretiens qualitatifs ont contribué à construire un langage partagé autour des enjeux de résilience et de sobriété. Ce dialogue a révélé la richesse des points de vue et des expériences, tout en identifiant des leviers de coopération encore sous-exploités.
Les projections élaborées dans le cadre du projet ont esquissé des voies concrètes pour l’avenir des métiers et des pratiques RH. En imaginant des trajectoires de transformation de ces métiers par et pour celles et ceux qui les exercent, ces scénarios offrent des repères pour guider les collectivités dans leurs bifurcations. L’idée d’une planification bottom-up, intégrant les limites planétaires et les besoins (et attachements) humains, répond ainsi aux recommandations du rapport de l’institut Veblen cité plus haut
Vers une écologie de la co-décision
La redirection écologique invite à un changement de paradigme : passer d’une écologie imposée à une écologie où la co-enquête occupe une place centrale et les travailleurs jouent un rôle clé dans la définition des orientations productives. En réconciliant justices climatique et sociale, en repensant les droits sociaux et en renforçant la formation, elle ouvre la voie à des modèles à la fois plus soutenables et plus démocratiques.
Les expériences menées à Grandpuits, Gardanne ou encore dans le cadre de la SSRE montrent que cette transition est possible, mais nécessite une volonté politique et une mobilisation collective sans précédent. Face à l’urgence climatique, il ne s’agit pas seulement de préserver des emplois, mais de redonner aux travailleur·euses les moyens d’agir sur leur avenir et celui de la planète.