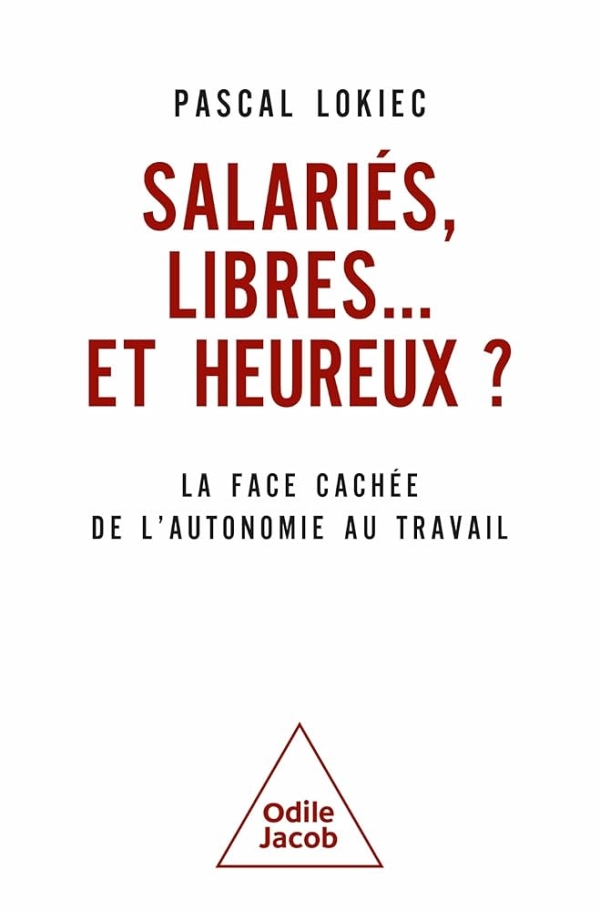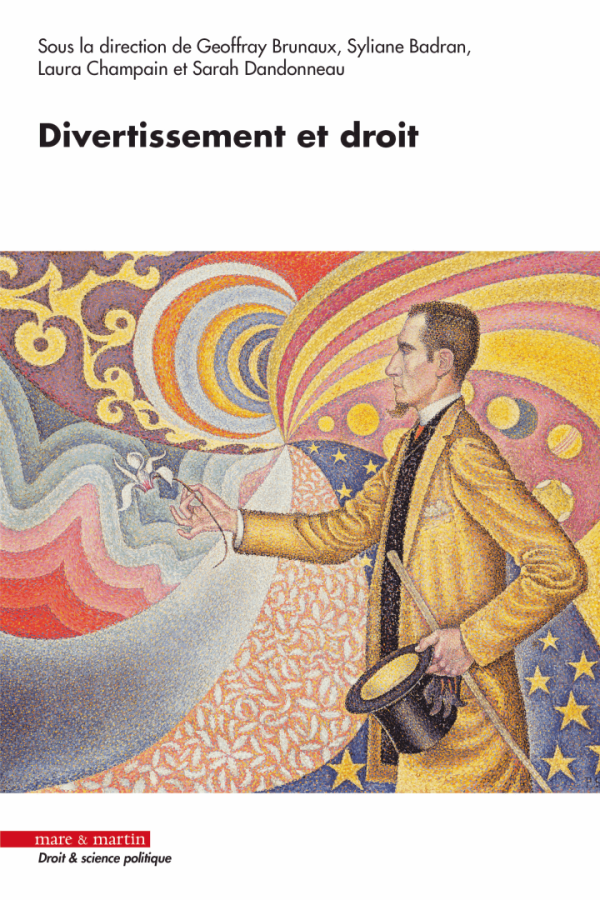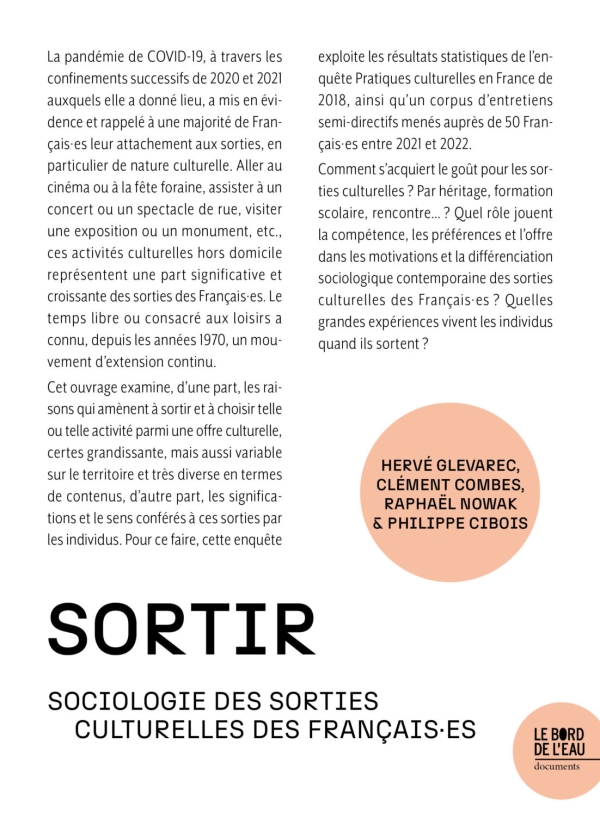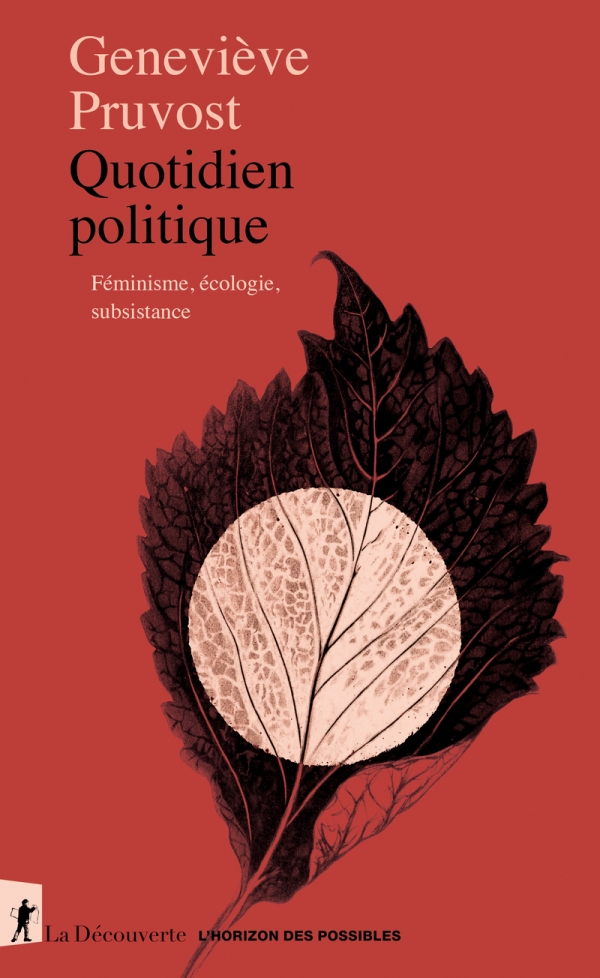Alors que le management s’affirme comme un savoir-faire spécifique, les travailleurs semblent douter de plus en plus de sa capacité à « optimiser » l’exercice de leurs compétences. Pourtant, selon le juriste Pascal Lokiec, « Répondre à cette demande d’autonomie est fondamental pour l’avenir de nos sociétés ».
Force est de constater que tous les salariés n’en disposent pas également. Les salariés occupant des emplois manuels, de services ou de de soins bénéficient d’ailleurs statutairement de moins d’autonomie que les cadres et les travailleurs intellectuels, malgré les marges de manœuvres informelles que les contextes leur accordent.
L’autonomie prend aussi des chemins parfois biaisés. En rompant avec une organisation et un management rigides, les entreprises dites « libérées » s’efforcent de renforcer l’autonomie et l’intelligence collective. Elles en tirent des bénéfices significatifs : augmentation de la satisfaction des salariés, réduction des difficultés de recrutement, du turnover et de l’absentéisme. Néanmoins, ces pratiques peuvent induire des risques de surengagement, d’épuisement professionnel, de concurrence entre salariés, etc. Or, responsabiliser ses collaborateurs ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de santé, de sécurité et de ses obligations en matière de durée du travail.
Quant au travail indépendant, il ne tient pas toujours ses promesses. Pour son étude Freelancing in Europe, la place de marché en ligne Malt a interrogé plus de 5 000 freelances dans six pays d’Europe, ainsi que des entreprises ayant recours à ses services. Selon cette enquête, « Devenir son propre patron » se révèle souvent synonyme de temps de travail moyen supérieur à celui des salariés (Insee) et d’insécurité économique et sociale, le travailleur indépendant renonçant à la protection sociale des régimes généraux.
Enfin, en télétravail ou en présentiel, les salariés peuvent aussi bénéficier d’une autonomie très relative, en raison du renforcement d’une tendance inquiétante sous couvert d’autonomie : l’essor de la surveillance.
Vers une surveillance sans limites ?
Comme le souligne le sociologue du travail Jean-Yves Ottmann, en matière de subordination, le contrôle vise à « garantir la qualité du travail et la sécurité des travailleurs […]. Il peut être bienveillant, transparent, honnête, mais cela reste du contrôle ». Certaines entreprises poussent le curseur plus loin, en imposant des pratiques excessives de reporting ou en franchissant le pas de la surveillance numérique.
Accès aux mails et SMS, activation de webcam, enregistrement des frappes du clavier grâce au keylogging, traceur GPS permettant de suivre les déplacements : ces pratiques se développent, parfois à l’insu du salarié. Selon une étude réalisée par Vanson Bourne en 2021 en France, 63 % des entreprises françaises de plus de 500 salariés ont déjà mis en place de tels dispositifs.
Le travail sur site est également concerné. Par exemple, les puces de géolocalisation, destinées à renseigner la disponibilité des espaces partagés, peuvent aussi permettre de connaître la fréquence et la durée des pauses. De même, l’implantation de puces sous-cutanées, acceptée déjà par des salariés suédois, américains et belges, permet d’accéder aux locaux, de lancer des photocopies, de payer son déjeuner, mais ouvre aussi la voie à une géolocalisation permanente, au suivi des temps « productifs » et « non productifs », etc.
Ces pratiques sont pour le moins incompatibles avec l’idée de management par la confiance. La CNIL prend le sujet très au sérieux et veille aux pratiques de surveillance excessive, aux manquements à l’obligation d’information des salariés ou encore à la protection des données.
La régulation est d’autant plus cruciale que les données de la surveillance servent de plus en plus à fonder une sanction disciplinaire, et ce, même si « suivant une jurisprudence très discutable, une preuve illicite ou déloyale, par exemple, un enregistrement clandestin, peut être produite devant un juge lorsqu’elle est le seul moyen pour l’employeur de prouver la faute du salarié et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie personnelle », souligne Pascal Lokiec.
C’est à partir de ce type de preuve qu’une salariée de la MAIF a été licenciée pour avoir raccroché au nez de clients lors d’une période chargée, souhaitant privilégier ses dossiers. Parce qu’elle n’avait pas été informée du recours au logiciel de surveillance, elle a par la suite obtenu la condamnation de l’assureur au conseil des prud’hommes, pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse ».
Une fois le bureau ou l’atelier quitté, la surveillance de l’employeur ne se dissipe pas. Sur les réseaux sociaux, l’utilisateur n’en pas moins « l’ambassadeur » de son employeur. Dans le secteur public (devoir de réserve, aux contours flous) comme dans le privé (abus de liberté d’expression en cas de dénigrement), les sanctions se multiplient.
En toile de fond, l’attention se porte sur les potentialités d’IA capables de traiter des stocks colossaux de données, de contrôler le sourire des employés des supermarchés, ou d’apprécier la qualité de la conduite de livreurs. Notons que le suivi des émotions des salariés, dénoncé par la CNIL dans son Guide du recrutement, est interdit depuis mai 2025 au sein de l’Union européenne par le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act).
Temps de travail + diffus = pression accrue
La quête d’autonomie au travail se heurte aussi à la réduction et la flexibilisation du temps de travail, qui devient de plus en plus délicat à mesurer. Cela était déjà le cas dans les métiers du care (ex. intervalle entre deux interventions de l’aide à domicile), des services (ex. heures d’attente du serveur entre deux services), des métiers itinérants (ex. trajet). Cela touche désormais d’autres activités. Lire ses mails en mangeant, est-ce travailler ? Le télétravailleur échangeant avec ses collègues matinaux et ceux étant « du soir » travaille-t-il réellement de 8 h à 21 h ?
Le droit européen exige la mise en place d’un système « objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps journalier effectué par chaque travailleur ». Les accords collectifs, ayant reçu l’aval des syndicats, cadrent ces dispositifs de contrôle du temps, mais ne suppriment pas totalement les risques de détournement.
En lien avec les difficultés à décompter les temps de travail, les entreprises accordant plus d’autonomie amplifient en général leurs attentes en matière d’objectifs. Cette pratique garantit un niveau élevé d’engagement, dans des conditions rarement discutées avec les salariés. De fait, ceux-ci doivent se montrer productifs, performants, y compris lorsque les efforts pour y parvenir menacent leur santé physique et mentale.
Pour apprécier la performance des salariés, des directives algorithmiques prennent déjà le pas sur les décisions humaines dans certains secteurs. Des logiciels peuvent vérifier et ajuster les objectifs, identifier les meilleurs éléments, décider des promotions et des ruptures de contrat. L’algorithme Uber dicte un trajet déterminé aux chauffeurs ; le robot Amazon dirige les préparateurs de commandes ; Hilton et Unilever utilisent un programme calculant un score d’employabilité, en décryptant les vidéos des candidats lors de leurs entretiens d’embauche, etc.
Soulignons que les agents publics ne sont pas épargnés par le culte de la performance. Soumis à des contraintes budgétaires, au nouveau management public et au recours croissant à des prestataires extérieurs, les agents témoignent de leurs difficultés à servir leurs missions d’intérêt général et de la perte de sens de leurs métiers. Avec près de 6 millions de salariés concernés (pour 27 millions de salariés en France), sans compter les prestataires impactés par les modes de fonctionnement, l’enjeu est de taille.
Quelles garanties pour les droits humains au travail ?
Pour Pascal Lokiec, il est urgent d’inverser la tendance, en considérant la personne derrière le salarié et en protégeant les droits humains au travail. Au début des années 1980, les lois Auroux ont posé des bases : « Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans leur entreprise ». Mais le manque d’actualisation de la notion de subordination et sa difficile conciliation avec la notion d’autonomie expliquent les difficultés à rendre effectifs les droits à des conditions de travail décentes, à la protection de la santé, à un environnement sain, au respect de la vie privée, à la liberté d’expression, etc.
Pourtant, les droits humains sont présents dans les traités et chartes européens et internationaux, ainsi que dans notre Constitution : « Les droits fondamentaux sont opposables au pouvoir, privé comme public, y compris au législateur ».
Mais assurer l’effectivité des droits fondamentaux dans le travail implique de disposer du cadre juridique approprié et d’une justice capable de sanctionner les manquements. Or, comment consacrer un droit au télétravail, en tant que prolongement du droit au respect de la vie personnelle, si l’on n’en garantit pas l’exercice en améliorant la politique du logement et l’accès à Internet, par exemple ?
Pour Pascal Lokiec, « Nous ne sommes pas condamnés à l’impuissance face aux technologies innovantes et à leur promotion par le marché », mais il demeure impératif de leur poser des limites pour maintenir l’humain dans les processus décisionnels. Une fois le principe posé, les solutions restent à inventer. Comment consacrer un droit à la déconnexion si l’on ne peut protéger les salariés de la surabondance d’informations ? Comment garantir le respect des droits humains sans encadrer des décisions confiées de plus en plus aux IA (recrutements, changements d’affectation, promotions, licenciements) ?
Concilier autonomie des salariés et intérêts de l’employeur, c’est possible ?
Permettre aux « collaborateurs » de peser sur leurs « missions » s’avérera une autre condition sine qua none pour redonner au salariat son attractivité. Même si tous n’auront pas la même latitude pour agir, selon leurs métiers, aucun ne devrait être oublié. Trois niveaux d’action permettraient de revaloriser leur capacité de décision : l’environnement de travail, les tâches confiées et la politique de l’entreprise.
Pour tendre vers une « autonomie contrôlée », deux voies sont tracées par Pascal Lokiec. La première est la définition collective des modalités de travail par l’intermédiaire des syndicats (démocratie sociale). La seconde reviendrait à légiférer (démocratie représentative) en faveur d’un dispositif accordant aux salariés le droit de définir leurs conditions de travail. Pour s’y opposer, l’employeur devra démontrer un motif légitime : impossibilité de répondre aux demandes des clients, changement générant un coût excessif, etc. Le Royaume-Uni reconnaît ce droit dès leur embauche, le Canada au bout de six mois d’ancienneté.
L’autonomie peut aussi s’instaurer dans la définition du travail lui-même. Dans cette logique, employeur et salarié codéfinissent la charge de travail, les objectifs et les méthodes de travail. Cette proposition va beaucoup plus que loin que les entretiens annuels prescrits par la loi, même si certains employeurs utilisent d’ores et déjà ce cadre pour échanger de façon constructive avec les salariés.
Plus ambitieux encore, la participation aux choix économiques et à la politique de l’entreprise. L’actionnariat salarié reste ultra minoritaire en France, mais le modèle de codétermination, attribuant des voix délibératives aux salariés dans les instances de direction, pourrait davantage changer la donne. Jusqu’à présent, la loi française ne rend possible la désignation d’administrateurs salariés que dans des cas précis, loin des modèles allemand et suédois de cogestion/codétermination. Soulignons que ce modèle se révèle a priori bénéfique pour l’entreprise : engagement des salariés, innovation stimulée, hausse de la productivité, fluidification du dialogue social, etc.
Des entreprises attractives et porteuses de valeurs
Travailler dans de bonnes conditions, respectueuses du droit, jouir d’une autonomie aménagée, ou « émancipatrice » pour reprendre les termes de Pascal Lokiec, ne suffiront peut-être pas pour attirer et retenir les salariés. De plus en plus, les salariés attendant des engagements sur les questions sociales et environnementales, la redirection écologique ou encore l’égalité des chances (Baromètre national 2024 RSE & Égalité des chances).
Des obligations existent déjà, comme déclarer l’impact social et environnemental depuis 2017, et le devoir de vigilance pour les grandes entreprises, adopté en 2017 en France, consacré par l’Europe en 2024. Conformément à la loi Pacte, certaines entreprises se dotent dans leurs statuts d’une « raison d’être », une ligne de conduite à suivre allant plus loin que la considération des enjeux sociaux et environnementaux.
Encore facultative, on peut imaginer qu’elle devienne plus contraignante à l’avenir sous la pression des salariés ou du législateur. Carrefour devra alors prouver qu’il propose à ses clients « des services, des produits et une alimentation de qualité, et accessibles à tous » et EDF qu’il « construit un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement ».
Le statut de sociétés à mission, lui, est vérifié par un organisme indépendant. La certification à grande échelle des entreprises vertueuses sera sans doute un nouveau tournant pour les acteurs économiques et leurs salariés, si l’on parvient à fournir des indicateurs pertinents aux PME comme aux grands groupes, tout en conciliant des objectifs sociaux et environnementaux.
Autonomie épanouissante, contrôles encadrés, engagements vertueux évalués… Saurons-nous relever ces défis pour redonner au salariat sa juste place dans le monde du travail ?