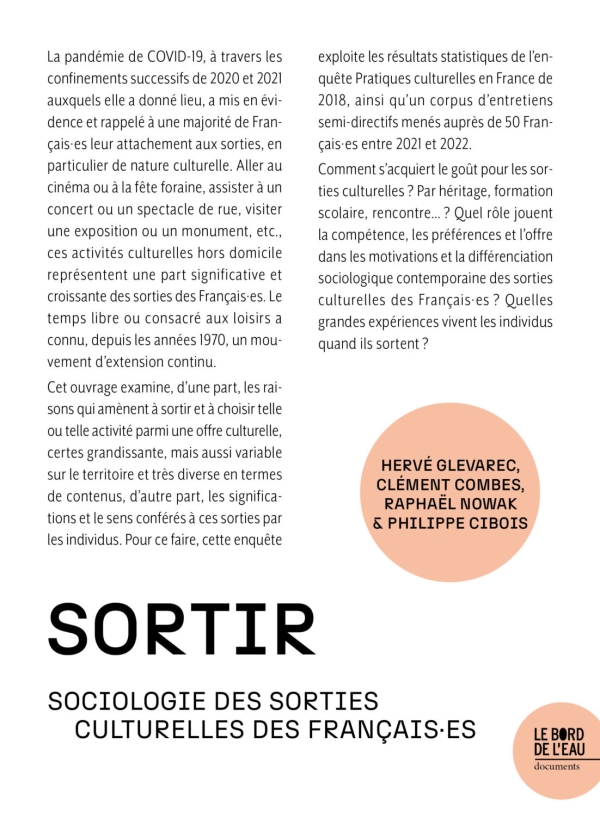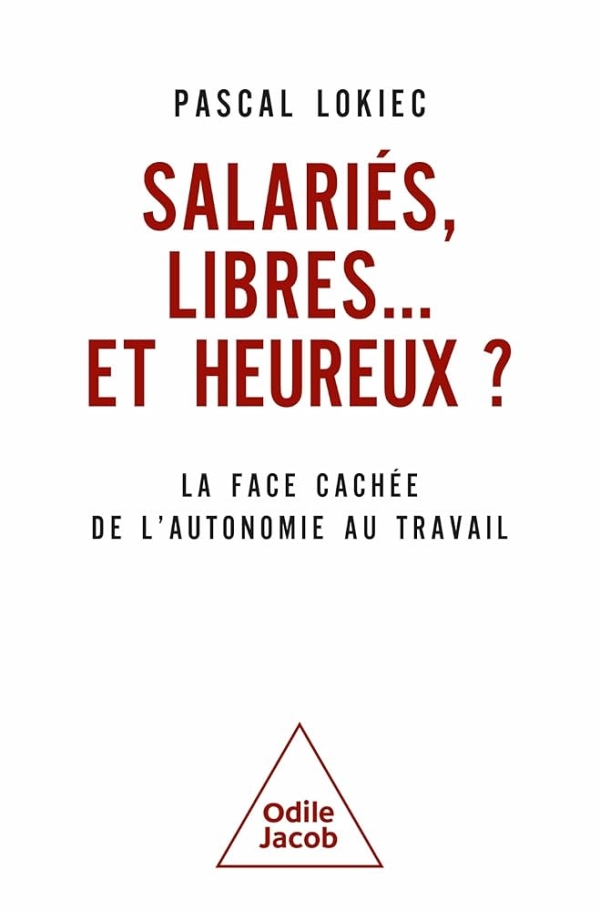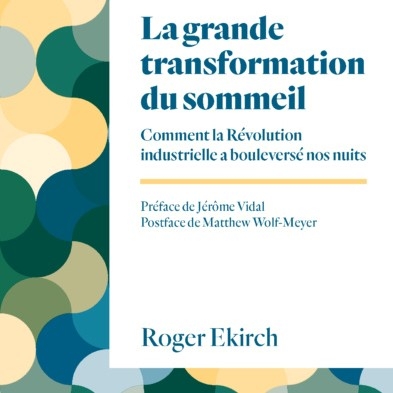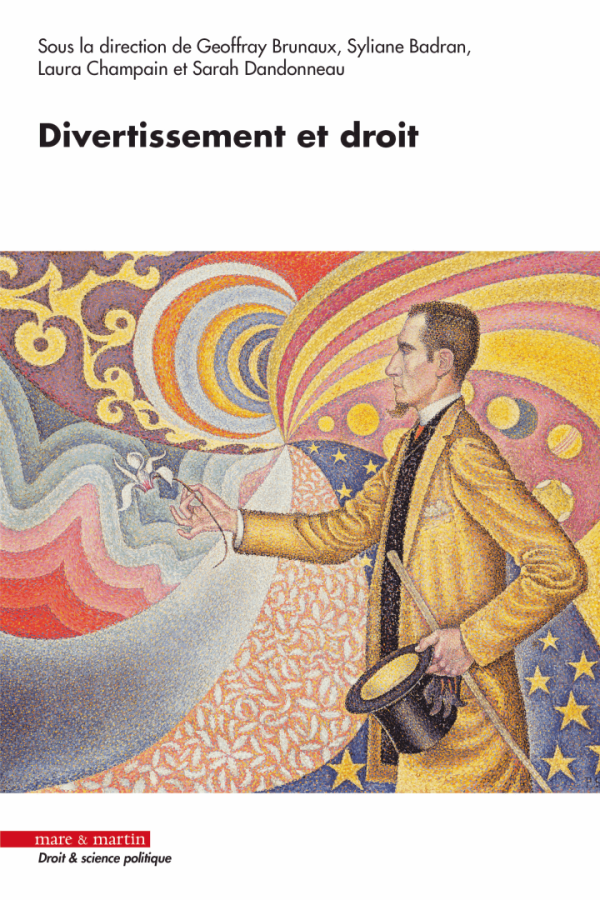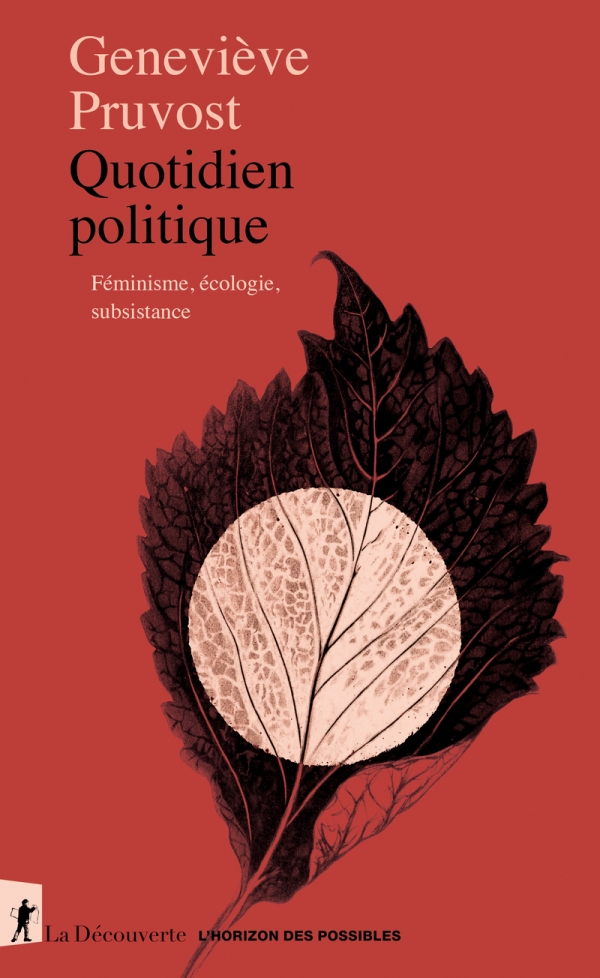De quatre par jour en 2020, le temps libre des Français serait dorénavant de cinq heures ! Cinq heures dégagées des contraintes professionnelles, biologiques, familiales et sociales, disponibles pour faire ce que bon nous semble : se reposer, se divertir, s’évader, se réaliser, s’engager bénévolement…
Comme toute moyenne, ce chiffre vaut pour tous et pour personne, variant en fonction du genre, du métier, de la situation professionnelle (étudiant, actif, retraité) et familiale, du lieu de résidence, de l’état de santé, etc. Mais le constat est indéniable : les avancées sociales, telles que la réduction du temps de travail, les droits aux congés payés, au repos et aux loisirs ou encore le droit à la déconnexion ont permis de donner à tous du temps libre, même si chacun peine à en prendre conscience tellement le sentiment d’être « en retard, toujours en retard » domine. Que faisons-nous donc de tout ce temps ?
Est-il gaspillé, voire pillé, comme s’alarment de plus en plus de voix ? Gaspillé, car cette ressource en expansion serait happée par un entertainment abêtissant. Pillé, car phagocyté par des pratiques numériques, qui ruineraient nos capacités d’attention, menaçant de nous transformer en zombies digitaux au profit de nouveaux prédateurs dénués de tout sens de l’intérêt général.
Le « loisir fécond », ce grand oublié
L’alerte est forte. Penser un usage bénéfique du temps libre, qui permet à l’individu de s’émanciper, de s’instruire et de se réaliser, appelle à des réflexions d’autant plus ardues à mener que les capacités pour réfléchir s’étiolent, comme le pointe l’historien Jean-Miguel Pire dans son ouvrage L’otium du peuple : « Toujours plus complexe, la réalité réclame davantage d’intelligence, de profondeur, d’empathie. Pourtant, les conditions nécessaires à la lucidité ne cessent de se dégrader. Dans l’accélération générale du rythme de nos vies, le temps de la pensée est ainsi le premier sacrifié ».
Née chez les Grecs, au 5e siècle avant notre ère, la skholè est un temps consacré à « déployer le libre arbitre et acquérir les instruments de l’autonomie individuelle » par la connaissance de soi, le développement d’une pensée rationnelle mise au service de la compréhension du monde. Après son passage chez les Romains, ce temps de la pensée, devenu otium, semble un luxe inutile sacrifié sur l’autel du travail productif, réduit à un temps qui récompense et compense l’effort.
Or ce temps dégagé de toutes obligations est indispensable à la construction d’une pensée complexe, qui permet de « réfuter les arguments d’autorité, qu’ils soient puisés dans la tradition, la religion ou toute autre transcendance ». Comme le rappelle l’historien, c’est bien ce « loisir fécond » qui a engendré la philosophie et la démocratie, car permettant à chacune et chacun de contribuer à la délibération collective.
L’évolution des loisirs des Français annonce-t-elle une inéluctable crise intellectuelle, politique et sociale, ou illustre-t-elle un renouvellement de leurs dimensions culturelle, réflexive et collective ?
Analysant les loisirs de sortie et leurs motivations, l’ouvrage Sortir, sociologie des sorties culturelles des Français.es des sociologues de la culture et des médias, de Hervé Glevarec, Clément Combes, Raphaël Nowak et Philippe Cibois, ouvre des pistes de réflexion et d’action optimistes.
Le temps libre, c’est d’abord pour les loisirs
Les loisirs occupent l’essentiel du temps libre, même si un peu de cette liberté est consacrée au bénévolat ou encore à la pratique confessionnelle (enquête Emploi du temps, Insee, 2010). Le temps du repos et du loisir pour tous est protégé par la Constitution française depuis 1946 et la loi relative à la lutte contre les exclusions (1998) a réaffirmé le principe d’un « égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs ».
L’Observatoire du rapport des Français aux loisirs pointait ainsi leur attachement à ces activités, qu’elles soient culturelles, sportives, pratiques ou sociales, comme les catégorise le sociologue Roger Sue : « Au-delà du temps qui leur est consacré, c’est l’importance que [les Français] accordent [aux loisirs] qui est particulièrement frappante. Manifestement, pour beaucoup, les loisirs constituent une composante importante, voire essentielle, de leur vie ». Comme le résume la juriste Sarah Dandonneau, « Le loisir, c’est trouver le temps de vivre ».
L’enquête Pratiques culturelles en France (2018), sur laquelle s’appuient les auteurs, donne à voir la participation de la population aux loisirs et à la vie culturelle depuis 1973. Certaines pratiques rencontrent un public toujours plus nombreux, comme l’écoute de la musique, les jeux vidéo, la visite de monuments historiques. D’autres se maintiennent, comme la télévision ou le cinéma, et d’autres encore déclinent, telles que la lecture, les pratiques artistiques amateurs, l’écoute de la radio ou la visite de musées et d’expositions.
Les pratiques évoluent selon les territoires, les catégories socioprofessionnelles, les générations : ainsi, si les pratiques artistiques amateurs ou les spectacles vivants sont délaissés par les 15-24 ans, elles sont dorénavant investies par les plus de 60 ans.
En 2020, 98 % des Français de 18 à 75 ans déclaraient avoir pratiqué, au moins occasionnellement, un ou plusieurs loisirs dans l’année qui précède, qu’ils soient à dimension culturelle ou autres. Ils plébiscitaient ainsi l’écoute de la musique, le shopping, les contenus vidéo, la lecture, la cuisine, le jardinage, le bricolage. Le temps des vacances permet aussi de privilégier certaines activités, comme les sports d’hiver, les séjours collectifs, la randonnée, la visite de musées, d’expositions ou du patrimoine, de parcs animaliers ou encore la lecture.
Après le passage obligé au domicile, un appétit renouvelé pour l’extérieur
Comme le rappelle l’ouvrage, la pandémie de Covid 19, la fermeture des lieux culturels, les confinements, l’essor du télétravail ont contribué « à redéfinir le rapport de beaucoup d’individus […] à l’extérieur sur le long terme » en conjuguant « une domiciliation et une individualisation des pratiques ».
Les loisirs numériques sont les grands gagnants de cette évolution, portée à la fois par l’essor de l’offre (podcasts et tutos en tous genres, jeux en ligne, etc.) et par la démocratisation des outils numériques, dont le smartphone : plus de 90 % des 12-69 ans en possèdent un pour 98 % des 18-39 ans !
Le domicile utilisé comme espace de loisir centré sur l’entre-soi a paradoxalement revalorisé certaines qualités des loisirs extérieurs, perçus « comme des activités cognitives, engagées (corporellement) et partagées ». Ce sont d’ailleurs les activités culturelles et sportives que les Français souhaiteraient pratiquer davantage, d’après un sondage récent pour la plateforme de valorisation de l’artisanat Wecandoo (2024).
La pratique d’une activité physique et sportive a bénéficié à la fois des politiques publiques de santé promouvant ses bienfaits sur la santé physique et mentale et des Jeux olympiques, valorisant le sport perçu comme activité fédératrice. Le baromètre Sport Santé 2025 d’Ipsos confirme le goût des Français pour l’activité physique, passée de 54 % en 2021 à 71 % en 2024, avec une préférence pour les activités d’extérieur.
Sortir pour rencontrer, engager le corps, partager, apprendre et s’évader
Les auteurs identifient quatre types de sorties, chacune dominée par une attente spécifique. La recherche de convivialité mêlée à une expérience corporelle et émotionnelle est le principal moteur des sorties « sympa » et « partage ». Ces dernières mettent en jeu d’une part la sociabilité et, d’autre part, la « socialité », ou l’envie d’être en coprésence dans l’espace public, qui peut aussi permettre d’échanger spontanément sur l’expérience vécue. Près de la moitié des 18-30 ans déclarent ainsi aimer passer du temps avec leurs proches.
Cette double attente ne semble pas le propre des sorties culturelles. Elle est aussi un marqueur de l’essor des espaces de loisirs indoor et des nouvelles pratiques sportives, que ce soit celles mixant performance individuelle dans un contexte convivial, voire événementiel à l’instar du MMA, du Chase Tag, ou encore de l’Hyrox, ou celles misant sur l’inclusivité, le « pratiquer ensemble » quel que soit le niveau comme le padel, le pickleball, la marche active ou même dans une certaine mesure le parkour, s’ouvrant aux seniors. Autonomie, convivialité et plaisir sont aussi ce que recherchent les jeunes dans leurs pratiques sportives, comme le décrit Guillaume Dietsch dans son ouvrage Les jeunes et le sport. Penser la société de demain.
Sortir, c’est aussi s’évader du quotidien pour expérimenter autre chose. La sortie « évasion » est ainsi une « alternative émotionnelle à la vie quotidienne, un changement par rapport à ses préoccupations ordinaires et une proposition d’une vie vécue autrement (plus joyeuse et positive) ».
S’évader, c’est voyager, mais aussi se passionner pour l’heroic fantasy, les escape games, les expériences immersives (réalité virtuelle, e-gaming) ou « exclusives », par leur prix, leur personnalisation, leur intensité ou leur rareté au quotidien (restaurant gastronomique, hôtel de luxe, rencontre personnalisée avec un artiste, un sportif, concert VIP, etc.). L’engouement pour ces loisirs haut de gamme est tel que le phénomène a reçu le nom de « funflation », contraction de fun et d’inflation, car la demande pour ces offres premium contribue à l’augmentation générale du prix de ces activités (Credoc).
Enfin, sortir, c’est aussi apprendre, transmettre, découvrir d’autres univers culturels et sociaux. La sortie « intéressante » s’apparente ainsi au loisir fécond, de même que l’appétence pour le faire-soi-même, qui ne se dément pas depuis un quart de siècle, porté par une offre pléthorique d’apprentissages en ligne, ou encore les activités d’autoproduction, tendance de fond pratiquée dorénavant par 70 % des Français.
Sortir, c’est d’abord se faire plaisir
La quête du plaisir, au sens de « faire ce qui plaît », est la motivation première des pratiquants. Mais les loisirs ont aussi d’autres fonctions, comme la distraction ou encore la distinction, bien étudiée par le sociologue Pierre Bourdieu en lien avec la culture dite « légitime ». Les auteurs identifient trois autres dimensions qui conditionnent le choix des sorties culturelles :
- La compétence, en tant que savoir minimal permettant de comprendre, de se sentir à l’aise voir autorisé, légitime à pratiquer une activité. Cette dimension est essentielle pour accéder à la « culture classique », entendue non pas comme des pratiques savantes, mais bien comme celles demandant, pour y prendre plaisir et y revenir, d’avoir acquis un certain savoir, que ce soit par l’éducation, la pratique familiale, etc. Pour les auteurs, ce n’est pas seulement un enjeu de distinction, mais bien de connaissance. À l’inverse, la « culture actuelle » recouvre les pratiques qui permettent aux individus de pratiquer et prendre du plaisir sans nécessiter une compétence issue d’une transmission liée à son histoire ou sa condition sociale ;
- Le concernement, ou « la manifestation de l’acquisition du savoir », qui permet de se sentir intéressé, touché par l’objet de la pratique. Cette dimension vient pondérer l’impact des savoirs transmis par le milieu culturel. Pour continuer une pratique, il faut en retirer du plaisir ;
- L’attachement lié à l’identité et aux valeurs du pratiquant.
Pour les auteurs, « Les sorties culturelles apparaissent en définitive comme des pratiques qui mobilisent une combinaison, chaque fois singulière, de compétences et d’identités. Elles sont l’expression de centres d’intérêt déterminés par la connaissance culturelle et par le positionnement socio-biographique ».
Ces dimensions conditionnent plus ou moins les choix des sorties, jouant comme moteurs ou comme freins. Ainsi, avec l’âge, la recherche de confort et de tranquillité peut plaider en faveur d’un film chez soi plutôt qu’en plein air, d’un concert en streaming plutôt qu’en live.
Loin d’être figées par le contexte social, familial, éducatif, ces dimensions sont susceptibles d’évoluer au fil de la vie et de la découverte de nouveaux milieux amicaux, professionnels, artistiques, etc. De même, la rencontre avec une œuvre ou une pensée intellectuelle peut avoir un impact bien plus déterminant sur la vie et la vision du monde d’un individu que sa condition sociohistorique.
Une étude du ministère de la Culture publiée en 2024 confirme ce que pointe l’ouvrage : celles et ceux qui n’ont pas de pratiques culturelles rencontrent des freins bien réels au-delà du simple désintérêt : inaccessibilité financière et géographique, isolement, état de santé. Ainsi, les inégalités en matière de loisirs rejouent les inégalités socio-économiques et territoriales, par exemple en matière d’équipements, de quantité et de diversité d’offre culturelle, d’accessibilité (éloignement, faible offre de mobilité). S’y reproduisent également les inégalités temporelles, ou de genre.
Dans les foyers modestes, les loisirs font l’objet d’arbitrages familiaux, le plus souvent en faveur de l’enfant au détriment du parent. Comme le souligne le Défenseur des droits dans son rapport sur Le Droit des enfants aux loisirs, au sport et à la culture, de nombreux obstacles privent les enfants d’accès aux activités de leur choix.
Les loisirs, au cœur des politiques éducatives territoriales ?
Les politiques publiques et les collectivités locales sont des acteurs de premier plan pour assurer ce droit aux loisirs. Le droit à la ville inclut ainsi un droit aux loisirs garantissant aux citoyens une offre accessible, avec le souci de lutter ou compenser les inégalités territoriales. Les auteurs soulignent ainsi que la ville contribue à démocratiser des pratiques qui étaient l’apanage de la jeunesse ou de milieux urbains éduqués.
L’essor de la budgétisation sensible au genre a permis une prise de conscience des biais liés aux pratiques de loisirs et des avancées en matière de diversification de l’offre. La prise en compte de besoins spécifiques liés à l’âge ou au handicap avance aussi, en offrant des espaces et pratiques aux temporalités et ambiances diversifiées.
L’évolution des mentalités reste encore à soutenir face à la montée de demandes d’espaces de loisirs excluant enfants et adolescents. Comme le note la designeuse urbaine Sarah Tahebi « On se plaint des “ados d’intérieur” coincés devant les jeux vidéo et les réseaux sociaux, mais on ne supporte pas les “ados d’extérieur” » !
L’essayiste Olivier Babeau souligne la nécessité de déployer une offre, notamment culturelle, pour lutter contre la tyrannie du divertissement, et in fine contre les inégalités de capitaux social et culturel, dont « Le poids est sans doute déterminant dans les trajectoires de vie ». Comment « démocratiser le loisir fécond ? » s’interroge-t-il ?
Sur ce point, l’école, les temps périscolaires et les structures d’éducation populaire ont un rôle fondamental à jouer, que ce soit en encourageant la curiosité et le goût de l’apprentissage de long terme, par l’ouverture et l’initiation à des pratiques culturelles permettant de s’affranchir des milieux sociaux et familiaux et de donner un sentiment de légitimité, à l’instar du dispositif Orchestre à l’école.
Sociologues et juristes invitent aussi à qualifier « l’usage gratuit, désintéressé, non mercantile du temps » (J.-M. Pire), afin de le faire exister en le nommant et le protégeant juridiquement. Une invitation qui rejoint l’envie des Français exprimée au long des enquêtes, avoir plus de temps pour ce qui donne le sens de l’existence : la famille, la culture, la solidarité.