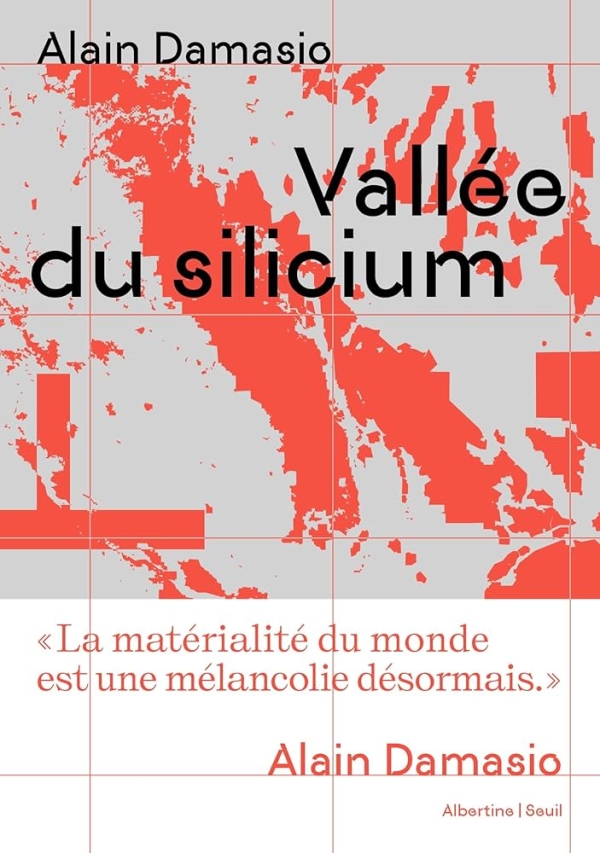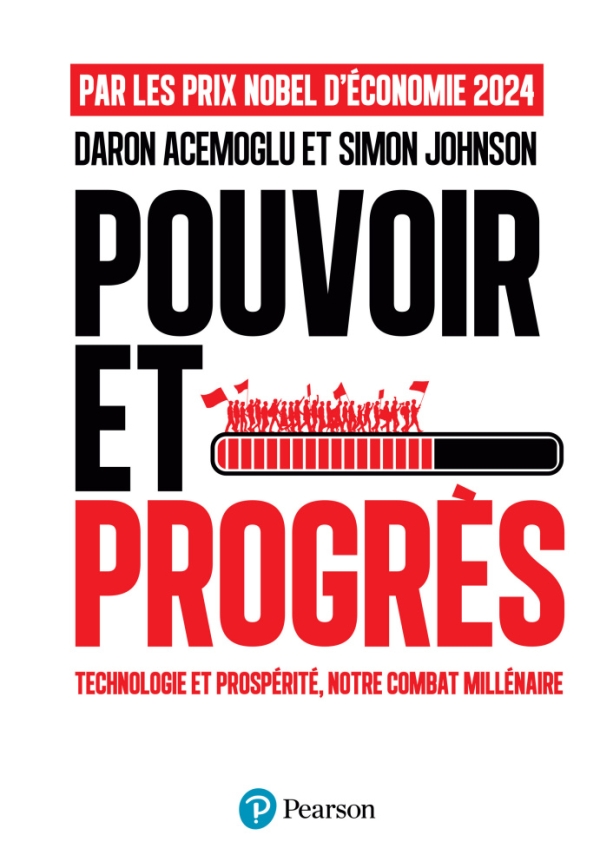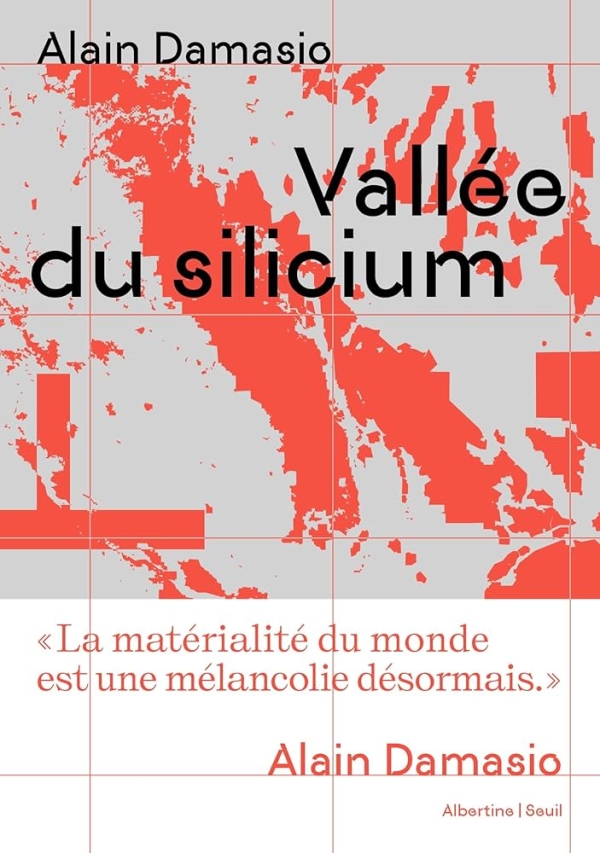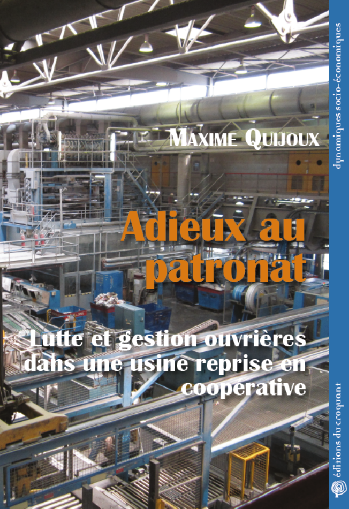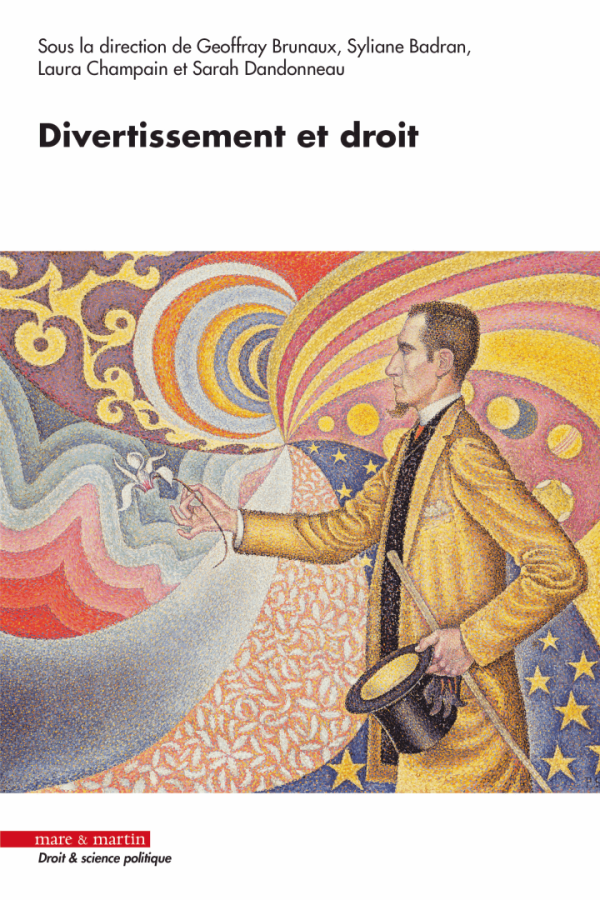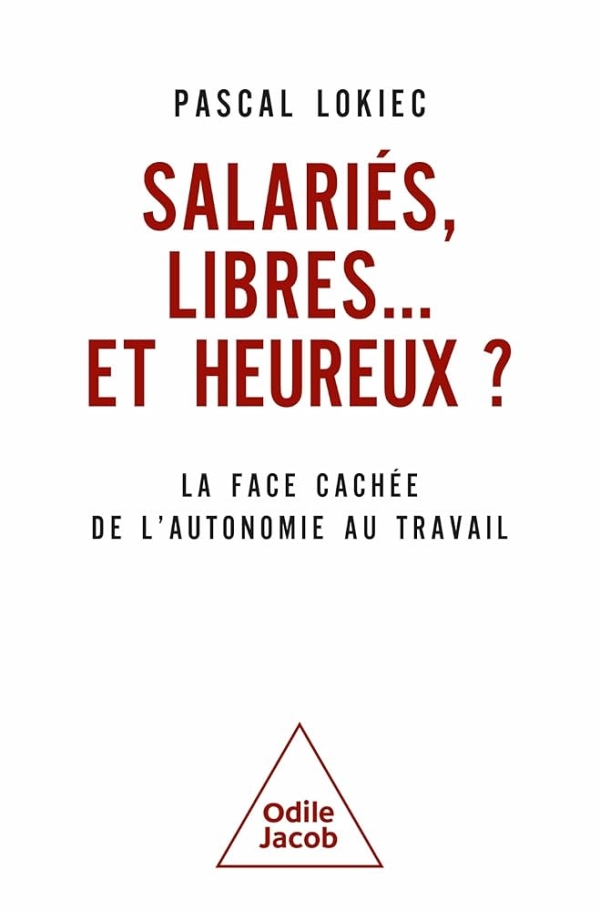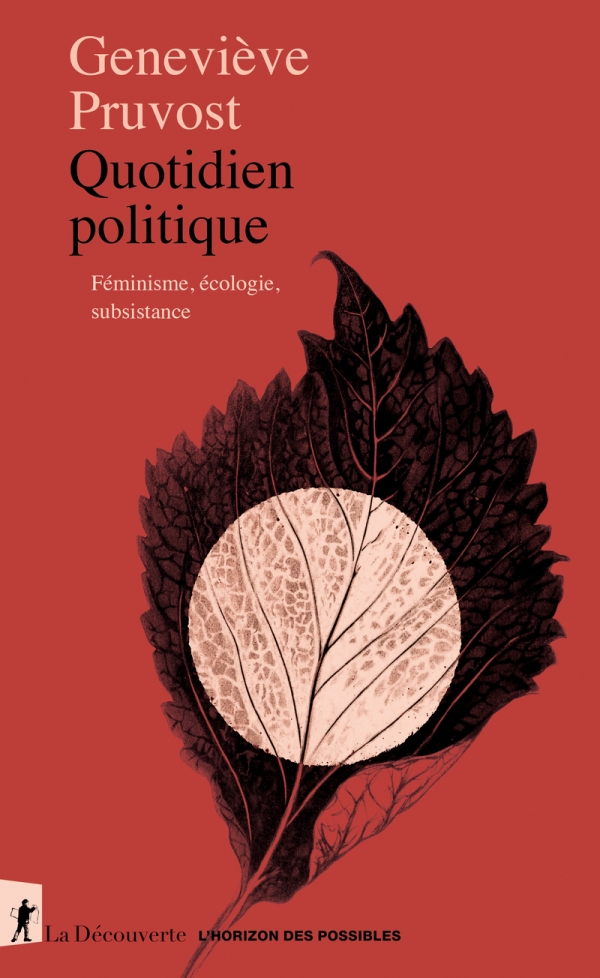Une question aussi vieille que les machines
« La violence des bouleversements sociaux a divisé le corps social en deux classes et a creusé entre elles un immense abîme. D’une part, une faction toute-puissante par sa richesse. Maîtresse absolue de l’industrie et du commerce, elle détourne le cours des richesses et en fait affluer vers elle toutes les sources. Elle tient d’ailleurs en sa main plus d’un ressort de l’administration publique. De l’autre, une multitude indigente et faible, l’âme ulcérée, toujours prête au désordre ».
Ce constat indigné n’est pas le fait d’un parti politique contemporain d’inspiration révolutionnaire, mais l’observation du pape Léon XIII dans une encyclique datée du 15 mai 1891. Intitulée Rerum Novarum – c’est-à-dire « des innovations » selon la traduction du Vatican — cette lettre est considérée comme le premier texte fondateur de la doctrine sociale de l’Église catholique.
Elle fut publiée en pleine révolution industrielle, alors que la majeure partie de la classe ouvrière, en pleine expansion, vivait misérablement à l’écart des richesses accumulées grâce aux machines. Le souverain pontife y préconisait de « venir en aide aux hommes des classes inférieures », tout en réprouvant fermement « le mythe tant caressé de l’égalité [qui] ne serait pas autre chose, en fait, qu’un nivellement absolu de tous les hommes dans une commune misère et dans une commune médiocrité ».
C’est cette encyclique qui explique, 134 ans plus tard, le choix du nom de pape de Robert Francis Prevost, Léon XIV, qui entend placer au cœur de son pontificat la question sociale liée à « une autre révolution industrielle et aux développements de l’intelligence artificielle, qui posent de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail ».
Le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA) ravive ainsi toutes les questions historiques liées à l’automatisation du travail. Porteuse d’une promesse d’efficacité décuplée et de gains de productivité pour les uns, elle alimente chez les autres la crainte d’une dévalorisation du travail intellectuel et d’une concentration extrême des richesses. À quel camp le futur donnera-t-il raison ? Très possiblement aux deux, car, en dépit des apparences, ces visions n’ont rien de contradictoire.
Dans leur ouvrage Pouvoir et Progrès (Power and Progress), les économistes Daron Acemoğlu et Simon Johnson (ci-après A&J) déconstruisent l’idée reçue selon laquelle l’innovation technologique mènerait inéluctablement à une prospérité largement partagée. Leur thèse, qui s’inscrit dans une longue tradition de critique constructive de la technique, dénie à la technologie toute prétention de neutralité. Pour objectiver ses impacts, il importe d’analyser les intérêts et les rapports de force des organisations qui façonnent, déploient et adoptent l’innovation : entreprises, travailleurs, gouvernements et, aujourd’hui, les géants technologiques.
Aux antipodes de tout déterminisme, l’histoire millénaire de la relation entre la technologie et la prospérité est celle d’un combat toujours renouvelé, dont l’issue dépend de notre capacité collective à mettre les bénéfices de l’automatisation au service de la majorité.
Apprendre des leçons du passé
La thèse d’A&J s’appuie d’abord sur l’examen méticuleux des conséquences historiques des révolutions techniques. Souvent accompagnées de promesses de félicité universelle, celles-ci donnent généralement lieu, dans les faits, à une aggravation significative des maux qu’elles prétendaient combattre, en dégradant les conditions de travail et parfois même le niveau de vie des ouvriers.
La première révolution industrielle, en Grande-Bretagne, à partir de la fin du 18e siècle, constitue un exemple saillant à l’appui de cette thèse. Conformément aux promesses de leurs inventeurs, l’introduction des métiers à filer et à tisser mécaniques a occasionné une augmentation spectaculaire de la productivité dans l’industrie du textile. Pourtant, pendant près d’un siècle, les salaires réels de la majorité des ouvriers ont stagné, voire diminué.
Les conditions de travail dans les usines étaient effroyables et l’autonomie des artisans, auparavant maîtres de leurs ateliers et de l’organisation de leurs journées, fut anéantie. Les gains économiques, considérables, ont afflué entre les mains d’un petit nombre de propriétaires d’usines et d’inventeurs issus d’une classe moyenne émergente, peu soucieuse du sort des travailleurs. Comme le soulignent A&J, les Luddites, ces ouvriers révoltés, crédités de l’invention du concept de « sabotage » (action de détruire une machine avec un sabot), « avaient raison de s’inquiéter » : les machines « détruisaient leurs moyens de subsistance ».
Comme l’observait un tisserand lettré de Glasgow, « Les théoriciens de l’économie politique accordent plus d’importance à l’accumulation globale de richesse et de pouvoir qu’à la façon dont celle-ci se diffuse ou à ses effets sur la société elle-même. L’industriel qui possède des capitaux et l’inventeur d’une nouvelle machine ne cherchent qu’à les exploiter à leur propre profit et avantage. » Le nom des Luddites s’est pourtant perpétué jusqu’à nos jours pour moquer tout type d’opposition au progrès technologique.
L’invention de l’égreneuse à coton d’Eli Whitney (1793) aux États-Unis est un autre cas d’école. Cette innovation a décuplé la productivité de la culture du coton, contribuant à transformer le Sud américain en puissance économique. Mais loin de bénéficier aux travailleurs, cette invention a « intensifié la sauvagerie de l’esclavage ». En augmentant la rentabilité du secteur, elle a directement contribué à motiver la déportation forcée de centaines de milliers d’esclaves vers les nouvelles plantations.
Même les révolutions agraires du Moyen Âge — moulins à eau et à vent, rotation des cultures, traction équine — n’ont que très peu amélioré le sort des paysans, qui constituaient plus de 90 % de la population. Les gains de productivité ont été largement absorbés par une élite cléricale et nobiliaire qui a financé la construction de cathédrales monumentales plutôt que l’amélioration du niveau de vie général.
Ces exemples archétypaux, comme de nombreux autres moins connus, dessinent un schéma historique récurrent : lorsque les capacités de négociation des travailleurs sont faibles — comme c’est généralement le cas — et que les élites économiques et politiques privilégient l’augmentation brute de productivité au détriment du progrès sociétal, la technologie tend à accroître les inégalités et à concentrer le pouvoir. La prospérité partagée n’apparaît que lorsque des contre-pouvoirs — syndicats, réformes politiques, — parviennent à infléchir la trajectoire des révolutions techniques et à imposer un partage plus équitable des profits.
Les facteurs déterminants de l’impact technologique
Pour A&J, l’impact d’une nouvelle technologie sur la société et le marché du travail dépend de plusieurs facteurs :
— Les gains de productivité et leur répartition. Une technologie n’améliore la condition collective que si elle engendre des gains de productivité suffisants et que les bénéfices afférents sont répartis entre le capital et le travail. L’effet d’entraînement de la productivité sur les salaires est loin d’être automatique : il dépend au premier ordre du pouvoir de négociation des travailleurs et des politiques sociales (salaire minimum, protection sociale, etc.).
– La nature de l’automatisation. Certaines machines se substituent purement et simplement aux travailleurs humains, tandis que d’autres complètent ou augmentent leurs capacités de travail.
- La création de nouvelles tâches. Historiquement, les effets négatifs de l’automatisation sur l’emploi ont été compensés par la création de nouvelles tâches productives pour les humains (conception, maintenance, logistique, services associés, etc.). Si une vague technologique automatise rapidement le travail sans créer suffisamment de nouvelles tâches, l’impact sur l’emploi et les salaires peut être durablement négatif. De même, une technologie très productive peut stimuler l’ensemble de l’économie, par la baisse des prix et l’augmentation de la demande, et ainsi créer indirectement des emplois, même si elle en détruit d’autres. Certaines automatisations « médiocres » (so-so automation), qui déplacent des travailleurs sans gains de productivité substantiels, n’ont pas cet effet bénéfique.
- La concentration du pouvoir. Qui décide de la direction de la recherche et développement (R&D) ? Une concentration excessive du pouvoir économique et technologique tend à favoriser des innovations qui accentuent les mécaniques de concentration des richesses (surveillance, automatisation pour affaiblir le travail) plutôt que celles qui bénéficieraient au plus grand nombre.
Défis pour l’ère de l’intelligence artificielle
L’IA, par sa capacité à automatiser des tâches cognitives jusqu’ici considérées comme exclusivement humaines, soulève des questions urgentes au regard du cadre d’analyse d’A&J. Après avoir été d’abord présentée, à l’instar d’autres technologies numériques, comme un moyen d’automatiser des tâches routinières et rébarbatives, l’IA s’attaque désormais de façon évidente à des tâches à haute valeur ajoutée, traditionnellement réservées aux cols blancs et aux cadres.
Les enquêtes disponibles témoignent d’une adoption très rapide de l’IA dans des secteurs comme la finance, le droit et la programmation informatique. Le FMI estimait début 2024 que près de 40 % des emplois mondiaux étaient exposés à l’IA, avec une proportion plus élevée dans les économies avancées (environ 60 %), notamment pour les emplois qualifiés.
La première question soulevée par A&J est donc de savoir si l’IA générera suffisamment de nouvelles tâches pour compenser celles qu’elle automatise. La nature généraliste de cette technologie ainsi que l’expansion très rapide de ses capacités pourraient largement compromettre les possibilités de reconversion des travailleurs.
Par ailleurs, le progrès de l’IA repose largement sur d’énormes capacités de calcul, ce qui tend à renforcer l’oligopole technologique (GAFAM, BATX) des rares entreprises capables d’investir dans ces ressources. Cette concentration du pouvoir économique contribue à définir la direction future de l’IA au profit des gains de productivité économique plutôt qu’au service de l’humain et de la société. Comme le souligne le Stanford AI Index, l’investissement mondial en IA est d’ailleurs dominé par un très petit nombre d’acteurs privés.
L’IA n’est donc pas une simple continuation des vagues technologiques précédentes. Son potentiel d’automatisation cognitive et sa dépendance aux données posent des défis inédits pour la prospérité partagée et la structure même de nos sociétés.
Orienter le progrès : une affaire collective
Les auteurs refusent tout fatalisme. Si le scénario « par défaut » semble bien être celui de l’automatisation à tout crin et de l’hyperconcentration des richesses, cette trajectoire n’a rien d’inéluctable.
Il s’agit d’abord, selon A&J, d’abandonner notre fascination collective pour la machine autonome, qui cherche avant tout à remplacer l’humain, au profit de la machine utile, qui vise à l’outiller. Peut-être pourrait-on renouer avec l’idéalisme des débuts de l’informatique : Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, avait pour ambition originale de faire de l’ordinateur « une bicyclette pour l’esprit », avant de construire l’une des multinationales les plus rentables de la planète.
Orienter l’innovation passe par des incitations (réformes fiscales, commande publique, financement de la recherche) pour favoriser le développement de technologies utiles ou complémentaires au travail humain : celles qui accroissent les compétences, créent de nouveaux emplois (notamment dans l’éducation, la santé, la transition écologique), améliorent la prise de décision humaine et encouragent la collaboration — plutôt que celles visant uniquement l’automatisation et la surveillance. De telles stratégies ont fait leurs preuves, par exemple pour stimuler la recherche sur les antibiotiques ou les vaccins.
Ensuite, A&J plaident pour renforcer les contre-pouvoirs, en revitalisant les syndicats et en expérimentant de nouvelles formes de représentation des travailleurs adaptées à l’économie numérique : négociations sectorielles, « syndicats de données », défendus par Jaron Lanier pour la gestion collective des données personnelles, etc.
Le rôle de la société civile est également fondamental pour changer le narratif autour de la technologie, exercer une pression sur les entreprises et les gouvernements, et promouvoir des régulations pour protéger la vie privée, encadrer le déploiement des algorithmes et réguler la publicité ciblée — principale source des revenus colossaux des géants numériques. Le démantèlement des monopoles technologiques est aussi un outil à envisager.
A&J se montrent en revanche critiques vis-à-vis du revenu universel comme réponse aux défis de l’IA. S’ils sont favorables au renforcement des protections sociales, ils considèrent le revenu universel comme une solution « défaitiste », qui admet la trajectoire actuelle d’automatisation massive et de dévalorisation du travail pour se contenter de compenser ses effets a posteriori. Pire, cette politique entérinerait selon eux la vision d’une élite technologique « bienfaitrice », qui financerait le reste d’une population rendue passive, renforçant ainsi les hiérarchies de domination. Pour A&J, l’enjeu principal est de rediriger la technologie pour créer des emplois de qualité et une prospérité partagée, et non simplement de « gérer la misère » créée par une technologie abandonnée à elle-même.
Un déterminisme politique plutôt que technique
Le principal message de Pouvoir et Progrès est que l’avenir de notre relation avec la technologie n’est pas une fatalité dictée par les algorithmes ou l’ambition de quelques milliardaires. Il est le résultat de choix passés, présents et futurs. L’histoire nous enseigne que le progrès technologique ne se traduit en progrès humain que lorsqu’il est activement orienté et encadré par des institutions et des normes sociales favorisant le partage des profits et limitant la concentration des pouvoirs.
Certains objecteront qu’il s’agit de vœux pieux au regard des gigantesques pressions de marché poussant à l’automatisation et à la course à la puissance brute. Ces dynamiques se trouvent d’ailleurs renforcées par des volontés politiques s’opposant à la régulation, comme l’illustre la situation aux États-Unis, première puissance technologique mondiale, où une proposition législative cherche à empêcher toute régulation de l’IA par les États pour les dix prochaines années à venir.
Mais même difficile à mettre en œuvre, un conseil ancré dans le réel vaut mieux que le déni et la résignation. La vigilance démocratique et un débat public lucide, nourris par des analyses rigoureuses comme celle d’A&J, sont plus que jamais nécessaires pour que le « progrès technologique » ne soit pas synonyme de régression sociale pour le plus grand nombre.