Repenser les métiers du prendre soin à l’aune des théories du care

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?
Interview de Jean-Pierre Rosenczveig

<< Le législateur sait ne pas aller sur certains points. Il laisse les praticiens trouver une solution et vient ensuite cautionner leur pratique. >>.
Jean-Pierre Rosenczveig a été président du tribunal pour enfants de Bobigny jusqu’en 2014 et a dirigé de 1984 à 1992, l’Institut de l’enfance et de la famille. Il a participé à de très nombreuses instances de réflexion relatives à la famille, au travail social, à l’intégration, à l’évolution du droit des enfants… Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, dont « Les enfants et la Justice », ed. Dalloz 2013. Pour Millenaire3, il revient sur son expérience professionnelle, sur la pratique de la loi, son interprétation et ses évolutions.
Pourriez-vous, à titre introductif, faire un bref retour sur votre parcours professionnel ?
Je me suis orienté dès le début de ma carrière sur les juridictions dédiées aux enfants, pour diverses raisons personnelles, mais surtout parce que la justice des mineurs était une justice sociale, familiale. Par-delà l’enfant délinquant ou en danger, se joue la place des familles en difficulté dans la société. Quitte à forcer un peu le trait, la justice des mineurs, c’est celle des pauvres et des précaires ! C’est aussi une justice moderne qui n’intervient pas en se fondant uniquement sur les codes, mais aussi à travers le travail social pour prendre en charge, accompagner, soutenir, enfants et parents.
Vous voulez dire que la justice des mineurs été l’un des domaines les plus en avance, un de ceux qui a su accompagner les évolutions sociétales ?
La justice des mineurs a largement inspiré la justice des majeurs. Encore récemment avec la probation qui permet un contrôle et un suivi des personnes placées sous main de justice, en milieu ouvert ou fermé, équivalent de la liberté surveillée pour les jeunes délinquants. Par ses expérimentations et son influence sur la justice des majeurs, la justice des mineurs a été au XX° siècle une sorte de guerre d’Espagne. On a appris à gérer le temps pour transformer la personne de l’enfant, on a fait appel au travail social pour prendre en compte l’enfant et les parents.
Dans un procès classique, le juge juge des faits et il s’attache au passé du jeune alors que dans la justice des mineurs, sans nier l’histoire personnelle et familiale, il doit se tourner vers l’avenir : il envisage l’évolution de la personne. Au-delà du fait lui-même, il s’efforce de décrocher le jeune de son engagement délictueux. Il s’appuie pour cela sur les travailleurs sociaux et les institutions sociales publiques ou associatives. Aujourd’hui la justice des majeurs continue à s’inspirer de cette posture.
Et concernant le droit des mineurs lui-même, pensez-vous qu’il a suivi ces évolutions sociétales, et qu’il accorde une place nouvelle aux enfants ?
Comme le montre mon rapport sur les droits des enfants en France (janvier 2014) nous disposons encore d’une marge de progression dans ce domaine. Avec le code Napoléon, il y a deux « grands incapables » : la femme mariée et les enfants. Tout au long du XIXe et du XXe siècle, les choses vont se rééquilibrer. Le parcours vers la non-discrimination n’est pas encore achevé pour les femmes. De même dans la foulée de Françoise Dolto, on a peu à peu admis l’idée que l’enfant est une personne. La convention internationale sur les droits de l’enfant consacre l’idée que l’enfant dispose de tous les droits de l’homme en plus de ses droits d’enfant. Mais il a fallu attendre 2007 pour que l’enfant se voit reconnu le droit d’être entendu en justice ! Jusque-là, on pensait l’enfant comme un être fragile, qui ne pouvait pas être présent sans l’entremise d’un adulte. Il a fallu se battre pour mettre à niveau le droit de l’enfant.
Aujourd’hui encore, il y a beaucoup d’exemples qui montrent qu’on ne considère pas les enfants comme des personnes à part entière. Ainsi, on va parler de repas « alternatifs » pour les enfants qui ne mangent pas de porc, mais dans une entreprise, un adulte peut choisir entre plusieurs entrées, plusieurs plats, etc..
Le droit a avancé sur certains points pour rattraper le retard, mais on reste sur cette idée que les enfants sont des enfants, qu’ils ont besoin d’un adulte pour les assister et les représenter, qu’ils ne sont pas achevés… Certes les plus jeunes ont besoin d’être protégés, ne fut-ce que pour subvenir à leurs besoins vitaux, mais très vite l’enfant peut décider sur des choses importantes pour lui. Il va être capable de se prendre largement en charge, de co-construire une décision. A l’inverse, des adultes de 35 ans peuvent ne pas être autonomes, sont « inachevés » et ont besoin d’une protection. L’âge a finalement peu à voir avec l’affaire. En tout cas, on ne peut plus dire qu’avant 18 ans un enfant ne pense pas et ne peut décider en rien sur ce qui le concerne.
Et comment le droit prend-il en considération les droits des enfants aujourd’hui ?
La loi s’alimente par les mœurs. Depuis le droit romain en passant par le code Napoléon, on a mis en place un dispositif de protection, mais comme je l’ai dit, la question est la même que celle à propos des femmes : est-ce qu’il faut les protéger contre elles-mêmes et contre autrui ? Cela a pris un certain temps avant qu’on envisage l’égalité parentale… Il a fallu attendre de Gaulle pour que les femmes aient un carnet de chèque !
On a fait un parcours similaire pour les enfants par rapport aux adultes. On dit que les enfants ont une pensée propre, des opinions, voire des convictions religieuses. Mon père m’emmenait à la synagogue. A 5 ans j’ai fait une fugue d’une synagogue. Quand il s’est agi de faire ma Bar Mitsva j’ai fini par lui dire, « Désolé, mais je ne crois en rien ». En autres termes, l’enfant est un être humain qui peut avoir des opinions, des points de vue sur ce qui le concerne et qui doit pouvoir être acteur de ses droits. La question est de savoir jusqu’où il peut être acteur de ses droits sans être victime d’un tiers.
Dans le rapport remis à Dominique Bertinotti, Ministre de la famille, nous proposons de reconnaître de nouveaux droits aux enfants mais surtout de leur reconnaitre une plus grande capacité à les exercer, à la hauteur de leur capacité à engager leur responsabilité. Un enfant peut aller en prison à partir de l’âge de 13 ans et comme le montre l’affaire du Chambon sur Lignon : un enfant de 17 ans et demi qui viole et tue peut être condamné comme un adulte si l’on considère qu’il avait la maturité d’un adulte le jour des faits. Mais paradoxalement il n’a pas le droit d’aller de demander son émancipation… Il a donc un statut pénal plus répressif que son statut civil. Il faut mettre à même niveau les deux
Plus précisément, comment ce processus d’ajustement se développe-t-il ?
Il y a de multiples canaux, qui ne sont pas contradictoires. Regardez la condamnation des châtiments corporels dans la loi Citoyenneté et égalité. Il y a encore 6 mois, la ministre – Laurence Rossignol – était contre la loi, elle voulait un débat quand nous appelions à prendre des mesures dans l’esprit des recommandations du Conseil de l’Europe de 2007… Il faut du temps pour faire bouger les esprits ! En l’espèce, il faut convaincre qu’il est possible d’avoir de l’autorité autrement qu’avec des châtiments corporels… On peut faire autorité sans violence, par son autorité personnelle… Simplement parce qu’on fait comprendre aux enfants la nécessité de respecter une règle, faute de quoi, il va se mettre en danger.
C’est un processus long, qui repose en fait sur le dialogue social. Il faut que les intellectuels théorisent, que le législateur entérine, il faut parfois une pression internationale, des associations qui militent, etc. Ce sont toutes ces occurrences qui vont faire que le droit évolue. Parfois il faut une décision de justice. Regardez ce qui s’est passé avec l’IVG. On savait qu’il y avait des femmes qui partaient en Angleterre pour se faire avorter. Le Manifeste de 343 « salopes » se dénonçant d’avoir avorté, a été un acte majeur. Mais il a fallu la décision du tribunal pour enfants à Bobigny pour faire basculer la loi. Une jeune fille était poursuivie pour crime, et le juge Casanova et ses assesseurs l’ont relaxée alors même qu’avec son avocate Gisèle Halimi, elle revendiquait son acte criminel. Ainsi, à un instant T, la loi apparaît comme dépassée, caduque et le juge renonce à l’appliquer. Il y a ainsi des pratiques sociales qui sont relayées par la justice, au moyen de la jurisprudence.
Mais l’évolution d’une norme juridique peut se faire autrement, par un passage en force. D’une manière révolutionnaire, quand on « viole » l’opinion. Cela a été le cas pour la peine de mort. Et dans une certaine mesure, c’est ce qui s’est passé pour le « Mariage pour tous ».
Il se peut aussi qu’une loi ait été suffisamment bien rédigée pour pouvoir être interprétée au fil du temps. C’est ce qu’on constate à propos des accidents du travail ou de la circulation. Des juges, sur la base d’un texte napoléonien qui n’avait pas prévu les accidents que l’on connaît aujourd’hui, peuvent néanmoins s’y référer. Ils font entrer la vie dans la loi, qui va évoluer par la jurisprudence.
N’avez-vous pas l’impression que dans les années 70 ou 80, il y a pu y avoir des évolutions amenées par la loi qui ont été acceptées parce que venues de la loi, alors qu’aujourd’hui, la loi n’a plus la même « autorité », voire la même légitimité ? Ne vous semble-t-il pas plus compliqué de faire admettre que la loi peut être en avance ? Par exemple la loi sur le « Mariage pour tous » a-t-elle vraiment provoqué un retournement d’opinion ?
Oui, la loi peut avoir du mal à passer l’opinion, mais dans ce cas, le plus souvent, c’est qu’elle aborde mal le problème. Dans le cas du mariage homosexuel, c’est évident. Il y a eu des réserves pour toutes sortes de raisons. La première voulait qu’à utiliser le mot mariage, on induisait la possibilité d’adopter alors même qu’il n’y pas d’enfant à adopter. Pour réaliser un projet d’enfant, il faut aller vers la PMA et la GPA. La PMA apparaît aussi comme une fabrication d’enfants pour convenance personnelle, et là, on perd une partie des troupes. Qui plus est si l’on revendique le droit à un enfant… Se pose alors un nouveau problème au nom de l’égalité : si on reconnaît aux lesbiennes le droit d’avoir un enfant par la PMA, il faut faire de même pour les gays au risque de tenir la femme pour un utérus qu’on loue et l’enfant un être qu’on fabrique. Et cela bloque encore plus !
Ces dispositions sur le mariage homosexuel n’ont pas été réfléchies en anticipant ses conséquences. Il eut été plus opportun de proposer une union civique, qui laissait de côté le débat sur la filiation pour ensuite avancer sur ces questions de filiation, d’homoparentalité, etc. On a voulu aller trop vite et on a tout bloqué.
L’histoire de l’humanité fait que la loi est toujours un peu en retard, sauf en période révolutionnaire, où une minorité impose une dictature de la loi. Mais dans une démocratie classique la loi a toujours un temps de retard sur l’évolution des pratiques sociales et va devoir s’adapter. Le droit du travail est un exemple, les questions de mœurs aussi… Est-ce qu’aujourd’hui la difficulté est accentuée ? Peut-être car on est dans une période où on a atteint un certain niveau d’organisation sociale, où les conditions de production changent, où la condition ouvrière n’est plus ce qu’elle était, où la famille évolue…
Je dirai aussi qu’il y a peu de théorisations, d’analyses, il n’y a plus de gauche et de droite marquées. Nous sommes peut-être dans une période historique intermédiaire où il n’y a plus de corps de pensée globaux qui donneraient du sens.
Mais les grandes notions qui permettent de vivre ensemble, l’idée que la loi doit être respectée, qu’elle s’appuie sur des valeurs communes, etc sont-elles encore véritablement intégrées ? N’y-t-il pas aussi une forme de déshérence qui laisse la formation politique s’étioler. Les valeurs qui fondent la République ont-elles un sens pour tous ?
On est attaqués sur nos valeurs et il faut les réaffirmer. Il va falloir redonner du sens et de la portée aux grands mots comme Liberté, Egalite, Fraternité, Laïcité. Pour beaucoup de gens, de jeunes de banlieue, ces mots sonnent creux ! Il faut admettre que ce sont des utopies qui permettent quand même de faire progresser les droits des personnes. Ainsi il va falloir montrer aux femmes de France et aux jeunes filles maghrébines, que c’est bien la laïcité qui leur permet d’aller travailler avec les hommes, et que ce ne sont pas les prêcheurs musulmans qui vont reconnaître l’égalité de la femme et de l’homme.
Pour tous les autres mots au fronton de la République, il va falloir montrer, comme pour le droit du travail, que la loi est le fruit d’un rapport de forces et que l’application de la loi est un autre rapport de forces. Il y a un fossé entre les droits affichés au fronton, les droits qui sont formels et les droits réels. Par exemple tout enfant a droit à être scolarisé, mais tout enfant handicapé, malgré la loi de 2005, a de grandes difficultés à avoir une scolarisation aussi normale que possible au regard de son handicap.
Cela ne veut pas dire que notre droit du handicap est mauvais ou que nous rejetons les handicapés. Mais que malgré les textes votés, on a du mal à faire la même place aux enfants handicapés qu’aux autres. Regardez la place des enfants autistes dans une classe. Le regard n’est pas forcément bienveillant. De plus, les dispositifs administratifs ne sont pas toujours opérationnels quant au financement, car la prise en compte du handicap, cela a un coût… Les cheminements pour les personnes aveugles, les rampes pour les personnes en fauteuil roulant, cela coûte de l’argent !
Il faut expliquer à tout le monde le fossé entre droit formel et droit réel. Ça ne veut pas dire que tout est pourri, mais que la vie est un combat, qu’elle est injuste… Et ça n’est pas parce qu’on n’est pas riche, beau et en pleine forme qu’on n’a pas le droit de vivre…
Comment expliquez vous que les valeurs qui fondent la République apparaissent ainsi comme des coquilles vides et qu’il ait fallu autant de temps pour qu’on en prenne conscience avant d’essayer de lutter contre ce phénomène ?
e crois que l’on s’est endormi… De temps en temps, on perd individuellement ou collectivement, le sens des réalités. Et on prend pour acquis les combats passés, on néglige de se rappeler que l’état du front a été une avancée, que l’on vient parfois de loin. L’égalité hommes-femmes n’est pas tombée du ciel ! Elle apparait comme aller de soi aujourd’hui, mais elle est le fruit d’un combat Il faut aussi rappeler que les avancées du XXe siècle sont récentes !
Il en va de même pour le combat des laïcs de 1905. La bataille a été rude, mais une fois qu’elle a été gagnée, les laïcs n’ont pas vu passer la redistribution des cartes, notamment lorsque les catholiques ont relevé la tête, alors même que les protestants et les juifs restaient discrets. Et surtout, on n’a pas su voir arriver les musulmans de France. Comme toutes les religions, ils ont leurs extrémistes, même si évidemment, la plupart des musulmans pratiquent leur religion sans excès.
S’il y a problème aujourd’hui, c’est que les laïcs ont cru que leur combat était gagné, qu’il n’était plus nécessaire d’entretenir la flamme. Ils n’ont pas vu remonter le poids du religieux, dans une période où les idéologies politiques se sont effondrées. La vie est ainsi faite que les gens ont besoin de se raccrocher à des choses. De plus, nous sommes dans une période de crise économique. Dans ce contexte, il faut trouver de l’espoir et quand l’espoir n’est plus politique, on se tourne souvent vers la religion. Marx disait la religion, c’est l’opium du peuple, même si l’opium peut faire du bien, ça reste de l’opium…
Vous semblez prôner une conception du droit très pragmatique, alors qu’en France on a souvent l’impression que le discours dominant dit « il y a la loi » et que cela va suffire à ce qu’elle soit s’appliquée ?
Les gens qui tiennent ce discours sont dans l’erreur, c’est sûr. Le droit français est un droit avec des concepts cadres. Quand on parle de discernement, d’intérêt supérieur de l’enfant, d’hygiène, de sécurité, ce sont des concepts cadres, qui identifient des objectifs, mais qui appellent au moment de la mise en œuvre à des interprétations par rapport à une situation, à une période.
Par exemple quand j’étais jeune magistrat, le fait qu’une femme se prostitue supposait pour les travailleurs sociaux de lui retirer son enfant. Aujourd’hui, on s’inquiètera par-delà l’activité de cette femme, des conditions de vie faites à l’enfant. Pourtant la loi n’a pas changé. Les juges vivent dans la société comme tout le monde, sont pères de famille, citoyens, consommateurs et sont aussi la résultante des pratiques sociales. Ils vont alors essayer de faire monter dans la loi des contenus qui ne sont pas explicitement prévus au départ.
Le concubinage par exemple, a obtenu une reconnaissance. Ainsi, dans le cas ou une concubine est tuée dans un accident de voiture, on va admettre maintenant que le concubin soit indemnisé, même si le concubinage n’est pas légal. On a accepté l’idée qu’il n’est pas nécessaire d’être marié pour subir un préjudice… Personne aujourd’hui ne conteste ce type d’indemnisation. Les magistrats se sont faits l’écho des transformations sociales : on peut aimer quelqu’un sans être marié…
Ceux qui prétendent que la loi est intangible devraient se plonger dans le journal officiel, ils verraient qu’on n’arrête pas de faire des lois, ce qui prouve bien qu’elles changent tout le temps, ne serait-ce que parce qu’on en fait constamment de nouvelles. La loi est aussi à contenu variable, et sans changer les termes formels de la loi, on peut traiter des situations nouvelles. On rejoint alors le droit anglais, qui est très pragmatique et qui fixe de grands principes, et est appliqué selon une casuistique. Une situation en rappelle une autre, qui en rappelle encore une autre et ainsi que suite. Cela permet de déduire le droit. Les Allemands ont une législation plus carrée qui cherche à tout prévoir, mais la vie est souvent imprévisible.
Comment arriver à se repérer dans la multiplicité des lois, des règlements avec tous ces niveaux administratifs qui produisent des normes ?
Dans mon livre Le dispositif français de protection de l’enfance, je montre que les travailleurs sociaux sont soumis à plusieurs types de lois : la loi pénale, la loi civile, la loi du travail, les règlements intérieurs, leur déontologie, le contexte « moral » (le bien, le mal, le permis, l’interdit) et enfin chacun doit respecter son éthique personnelle… Cela fait donc sept régimes normatifs. Généralement, on ne viole pas la loi pénale, on ne fait de mal à personne, on respecte le droit du travail, on respecte la hiérarchie et les pairs, et enfin je ne choque pas ma conscience.
Et de temps en temps il y a un acte qui peut être conforme à mon éthique mais peut me faire violer la loi. Or quand on n’est pas d’accord, comme dit Chevènement, on démissionne. De fait, pour moi, les professionnels doivent respecter les différents régimes normatifs. Il faut être conscient de ces régimes et du fait qu’il existe une hiérarchie des normes : toutes les normes ne se valent pas.
Il y a des cas dans lesquels vous devez vous taire, ou parler, d’autres où vous avez l’obligation de parler, et d’autres où moi, en tant que juge, je dis vous avez la possibilité de vous taire, mais je vous demande de parler, même si vous violez le secret professionnel, parce que je vous donne mon accord… La loi elle-même vient reconnaître la liberté des professionnels de parler ou de ne pas parler.
Quelle est la place de la religion dans ce système normatif ?
Moi je maintiens, comme Michel Onfray, que la religion peut vouloir contribuer, influencer, mais que c’est le Parlement de la République qui fait la loi : la loi républicaine l’emporte sur la loi de la religion. De même que la loi de la République l’emporte sur la déontologie, sur les règles du service, etc. Autrement dit, un travailleur social a le droit d’avoir son point de vue, ses convictions, mais il doit respecter la loi.
Cela revient à rappeler que la loi est supérieure aux autres régimes normatifs. Mais la loi dans un pays comme le nôtre, permet aux autres régimes normatifs de trouver leur place. Il y a une place pour la religion, pour l’éthique, la déontologie. Mais ça n’est pas non plus la religion qui gouverne, pas le « moi je ».
Je le disais un jour à un psychiatre qui travaillait dans mon service. Il me disait « Moi je ne dis que ce que j’ai envie de dire ». Je lui ai répondu « Je suis ton patron, si tu ne dis que ce que tu veux, tu repars en profession libérale. Si tu acceptes ton salaire, tu acceptes les règles de ce service, dans le cadre de la loi, et ça n’est donc pas toi qui décides de tout ».
Les institutions, les corps de métiers ont de plus en plus tendance à constituer des instances spécialisées, avec des comités d’experts, voire des comités d’éthique. Que pensez-vous de ce phénomène ?
Tout le monde a des règles personnelles de fonctionnement et donc tout le monde a une éthique… J’ai une éthique, tous les professionnels ont une éthique. Chacun a des codes de référence. La question est de savoir quelle est la place de cette éthique par rapport à d’autres règles du jeu. Par rapport au travail, à la loi pénale ou civique.
Il est normal qu’une institution quelle qu’elle soit, médicale, scolaire, etc, par-delà les points de vues individuels, cherche à définir une règle du jeu, sachant que la loi ne définit pas tout au millimètre et qu’elle reconnaît souvent plus de liberté qu’on ne le croit. Mais elle ne peut pas tout prévoir, elle ne peut pas prévoir des pratiques qui émergent par exemple du fait de l’avancée de la science. Il faut alors retrouver dans la loi ses valeurs. Il faut donc prendre un peu de recul pour retrouver des fondamentaux pour trouver des solutions à la question nouvelle qui est posée.
Dans un rapport sur la déontologie en travail social pour Claude Evin, ministre des affaires sociales, je préconisais d’instituer dans chaque région un comité d’éthique sur le travail social. Pour que par-delà la pensée de chacun, par-delà les règles prévues par la profession, on puisse voir comment une équipe pourrait réagir dans telle ou telle situation.
Il est intéressant de pouvoir travailler entre pairs pour définir une éthique au niveau professionnel. Par exemple, pour le personnel médical, chacun donne son point de vue dans le cadre des règles générales de l’hôpital. Car la loi ne dit pas tout. On le voit bien pour le cas de Vincent Lambert qui est dans le coma depuis des années : faut-il arrêter ou non de l’alimenter ? Des valeurs se heurtent. Et la loi ne dit pas que lorsque que quelqu’un est dans le coma depuis 40 jours, il doit être débranché, s’il y avait un texte aussi précis que cela, tout serait plus simple.
Le législateur sait ne pas aller sur certains points. Il laisse les praticiens trouver une solution et vient ensuite cautionner leur pratique. On l’a vu sur l’IVG, on le verra dans d’autres domaines, comme sur l’insémination artificielle : le législateur estime la question trop délicate, l’opinion est trop tranchée, laissons les pratiques professionnelles émerger. Même chose pour l’homoparentalité, quand le législateur veut passer en force, cela ne fonctionne pas…
Donc les comités d’éthique sont une bonne chose, tout le monde y a intérêt, cela permet de trouver des réponses à des situations précises, et de faire émerger une nouvelle vision collective, qui va sortir de l’hôpital pour aller vers l’opinion, et cela deviendra un jour la loi. Mais entre temps d’autres problèmes auront émergé, et cela justifiera qu’à nouveau un comité d’éthique se réunisse. C’est sempiternel, il n’y a pas de fin !

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?

Étude
Comment le care peut renouveler notre rapport à l’autre, à la société, à la nature et aux objets ?

Article
Les juristes nous interpellent sur le floutage des frontières entre travail et divertissement.

Article
Découvrez les témoignages de figures marquantes de l’histoire du Défilé pour remonter à ses origines.

Interview de Ariella Rothberg
Psychologue clinicienne et anthropologue
Est-ce que de l’information, de la sensibilisation aux différentes cultures est suffisante ?

Interview de Hélène Monier
Enseignante chercheuse à BSB école de commerce de Dijon
Comment gérer les incidents du facteur émotionnel face à des incidents sur le lieu de travail dans des métiers à risque ?

Interview de Pierre Vidal-Naquet
Sociologue et chercheur au CERPE, associé au Centre Max Weber
Dans cet entretien, Pierre Vidal-Naquet montre que le travail social confronte à une incertitude éthique qui appelle des espaces de régulation.

Interview de Nicolas FIEULAINE
Maître de conférences en psychologie sociale, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS), ’Université Lyon 2
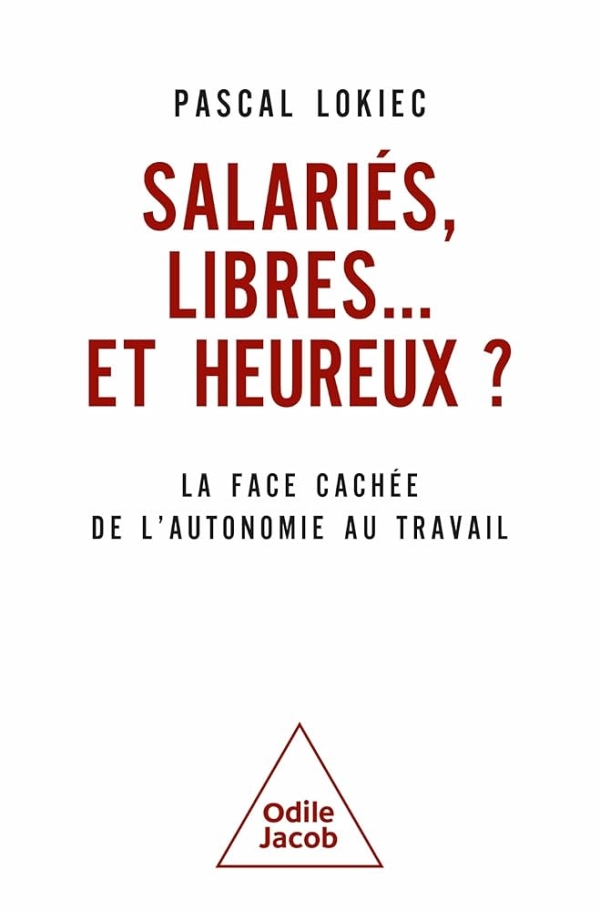
Article
Pascal Lokiec pose les termes d’un débat susceptible de concilier les intérêts de l’entreprise et le pouvoir d’agir des salariés.