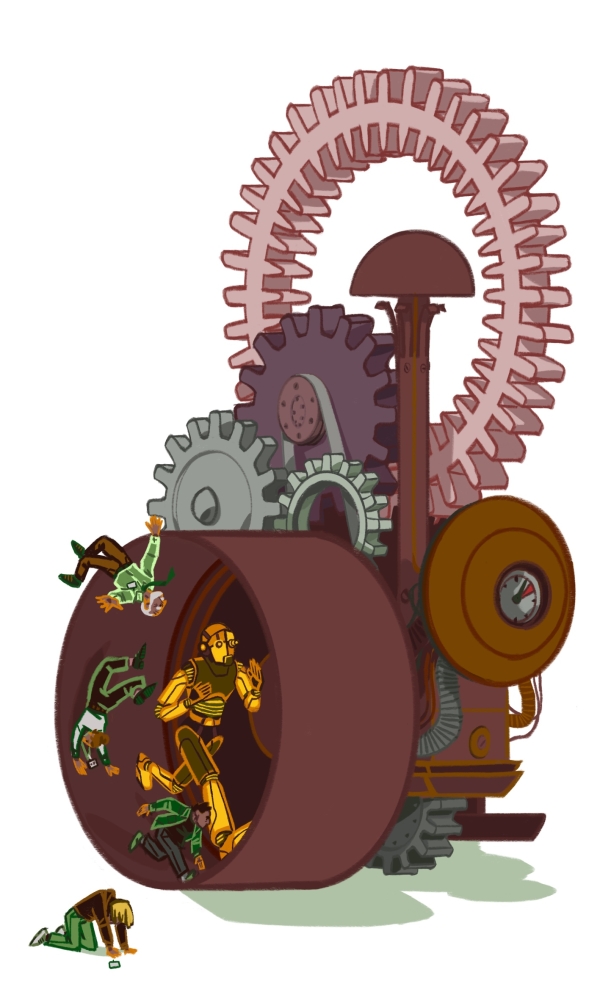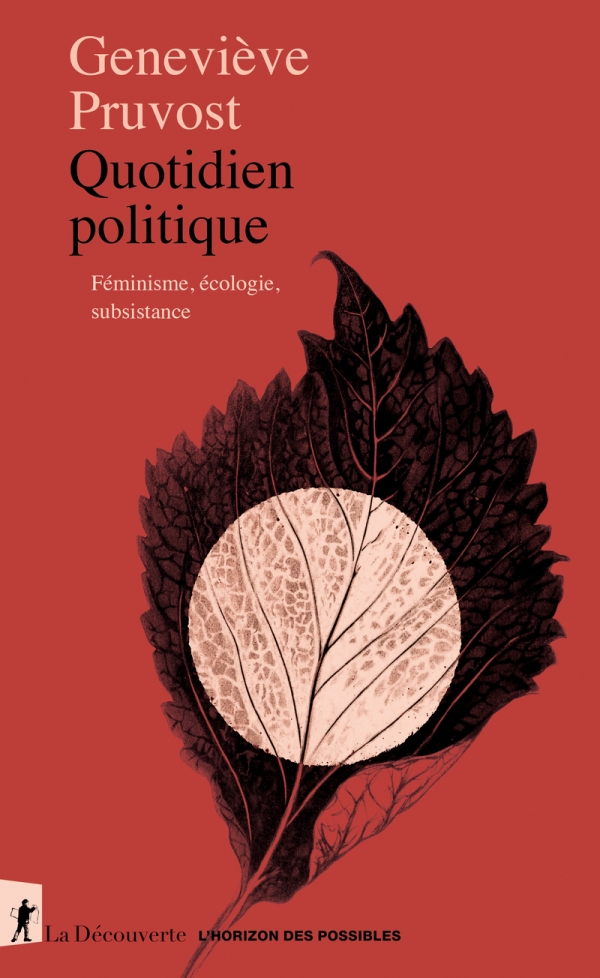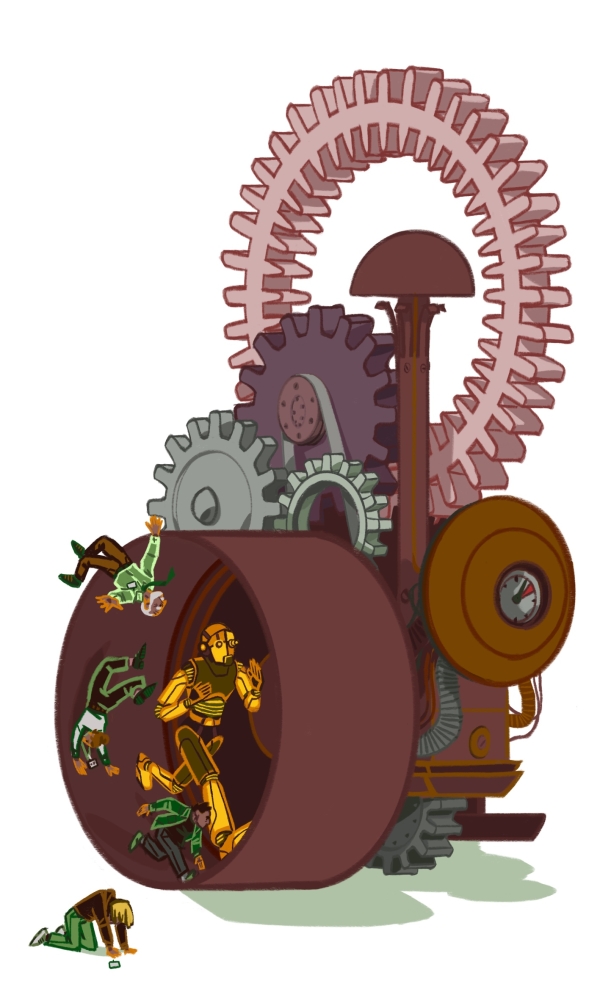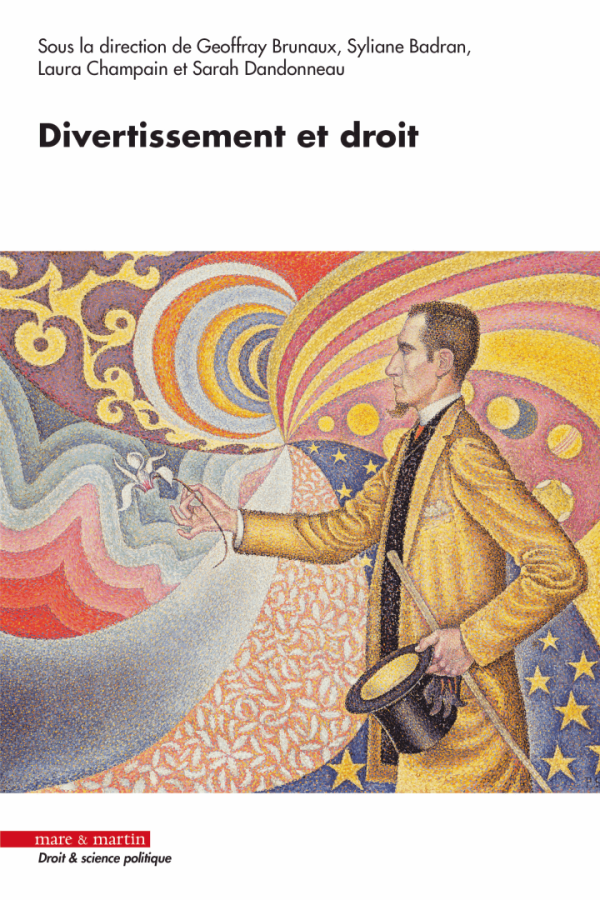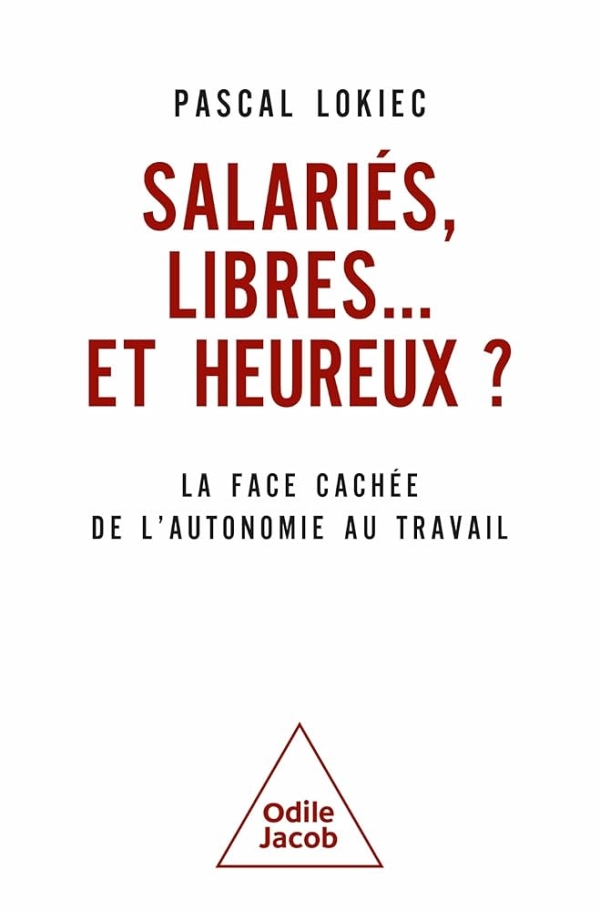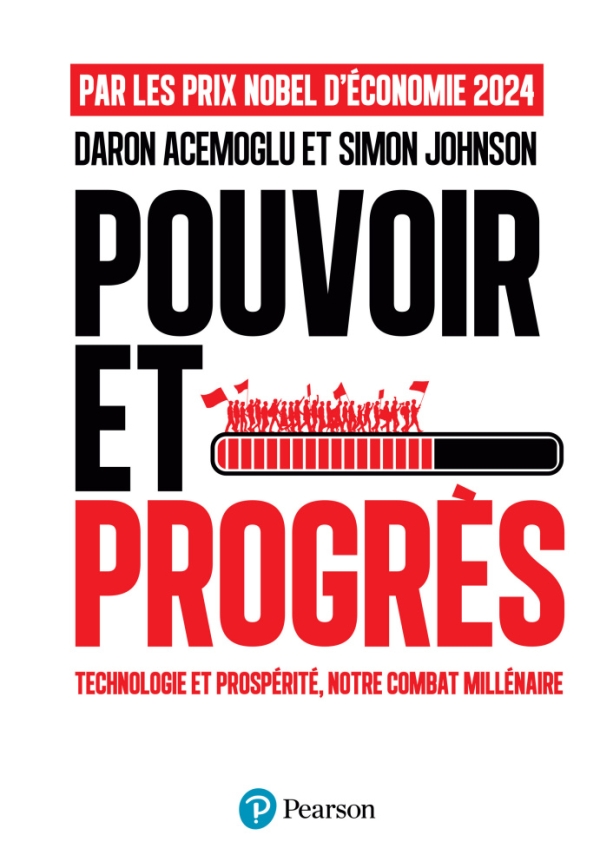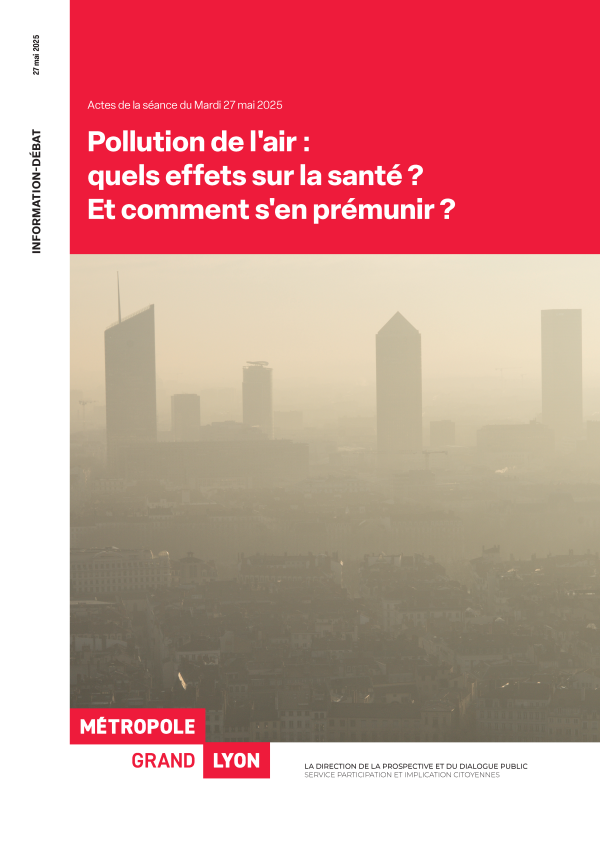La sociologue du travail Geneviève Pruvost, médaille de bronze du CNRS, directrice de recherche au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS) et diplômée de permaculture, est l’autrice de deux ouvrages visant à comprendre le travail du quotidien en termes politiques - La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte ; Quotidien politique. Féminisme, écologie et subsistance. Ses travaux de recherche étudient les raisons pour lesquelles le socle matériel, alimentaire et vestimentaire de notre quotidien nous soit devenu étranger.
Entre la croissance du marché du bricolage, le recours massif à l’autofabrication (Do It Yourself), ou l’étude du développement des pratiques alternatives d’agriculture, passant notamment par l’autoconstruction paysanne, l’époque porterait au « faire » contre le « consommer ». Cette aspiration s’expliquerait à la fois par des raisons économiques, par le développement d’une conscience écologique et plus profondément par une transformation à bas bruit de notre rapport au travail.
Chez Michel Lallement, qui étudie ce mouvement du « faire » issu de la contre-culture libertaire dans la région de San Francisco, comme chez Catherine Guesde qui cherche à penser avec le punk, cette réappropriation se manifeste comme un refus d’abandonner son sort aux mains de l’industrie. « Il est grand temps de saisir que le punk consiste à faire par ses propres moyens. À être créatif et non pas destructif », peut-on ainsi lire chez Fabien Hein. Des aspirations qui manifestent non seulement une volonté de réappropriation, mais aussi un rejet du travail dans son acception la plus évidente, le salariat.
Ainsi, on a pu noter en 2021, en plus du Quotidien politique de Geneviève Pruvost, les publications concomitantes de Troubles dans le travail : sociologie d’une catégorie de pensée de Marie-Hélène Dujarier ou encore de Travailler moins pour vivre mieux, par la philosophe Céline Marty. L’année suivante « Le sujet du travail » faisait l’objet d’un ouvrage dirigé par Alexis Cukier, Katia Genel et Duarte Rolo, pour tirer cet objet loin de son appréhension directe et commune, jusqu’à y inclure la gestation pour autrui par exemple.
Dépossession progressive et fin des sociétés paysannes
Pour Geneviève Pruvost, « La norme occidentale contemporaine d’existence, c’est la méconnaissance des mains qui agencent, fabriquent et nettoient les objets de la vie quotidienne. » S’appuyant sur les travaux d’Ivan Illich et suivant une approche écoféministe inspirée de Silvia Federici et de l’école de Bielefeld, Geneviève Pruvost soutient que la dépossession de la vie quotidienne, loin d’être un simple effet collatéral du progrès, résulte d’un processus historique de séparation entre les individus et les conditions matérielles de leur subsistance. Ce processus repose sur une délégation croissante à des professionnels anonymes, au nom d’une expertise qui uniformise et dépossède chacune et chacun de savoirs vernaculaires acquis jadis dans des maisonnées, des champs ou des ateliers.
La division du travail, la fermeture des espaces communs — le mouvement des enclosures, qui transforma du 12e au 16e siècle le système coopératif des paysans anglais en délimitant les propriétés de chacun —, ou encore la spécialisation et l’encastrement des infrastructures, invisibilisent les gestes et rompent les chaînes de transmission. Dès le Moyen Âge, puis de manière accélérée à partir du 17e siècle, les logiques industrielles, patriarcales et marchandes auraient ainsi méthodiquement disqualifié l’économie paysanne, les solidarités domestiques, les outils « conviviaux » et les rôles féminins dans la reproduction sociale.
Cette disqualification n’est pas neutre : elle a permis de créer des dépendances structurelles, en transformant des communautés autonomes en populations clientes, tout en redéfinissant le quotidien comme un ensemble de services à acheter plutôt que de gestes à partager.
Recodage des activités de subsistance en outil de domination
Dans les sociétés préindustrielles, rappelle Geneviève Pruvost, les maisonnées constituaient des milieux d’apprentissage informel, diffus, où les gestes de la vie quotidienne — se nourrir, bâtir, entretenir — se transmettaient sans formalisme, dans une quotidienneté ancrée à un lieu et peuplée d’humains, d’animaux et de végétaux.
Cette immersion partagée dans les gestes faisait des femmes des actrices centrales de la subsistance, comme le rappelle Alain Testard dans son étude pionnière de la division sexuelle du travail. Loin d’être cantonnées à l’espace domestique au sens moderne, les femmes serves étaient ainsi moins dépendantes de leur compagnon que les femmes dites libres, rappelle Silvia Federici dans Caliban et la Sorcière, Femmes, corps et accumulation primitive.
À partir de la fin du 18e siècle, le modèle paysan a ainsi été démantelé par l’industrialisation et l’économie de marché, qui ont disqualifié les pratiques vivrières et communautaires en les assignant à la sphère privée. Plus encore, le travail a été considéré comme une manière de limiter le temps libre des agents, donc de les priver, autant que faire se peut, d’une vie publique détachée de la consommation.
À ce titre, les travaux de Gunnar Adler Karlssonn, notamment, Western Economic Warfare 1947-1967, soulignent la prégnance de la fin des sociétés paysannes et le recours massif à la consommation dans l’équation de la croissance occidentale des Trente Glorieuses. Un constat que partage Edgard Pisani, ministre de l’Agriculture en France entre 1961 et 1966. En 1994, dans Pour une agriculture marchande et ménagère, il regrettait sa propre contribution au développement d’une agriculture productiviste concentrant l’emploi agricole autour du seul « chef d’exploitation » (lire masculin), au détriment du travail familial, historiquement associé à cette production, et du salariat des femmes.
Geneviève Pruvost lit cette évolution comme l’une des sources du patriarcat moderne. Elle se rattache au féminisme de la subsistance théorisé par Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen et Claudia von Werlhof, à qui elle emprunte le concept d’housewifization pour décrire ce basculement historique : la réduction des femmes à un rôle d’épouses au foyer, séparées du travail productif et rendues dépendantes du salaire masculin au sein d’une économie déterritorialisée.
Cette dépendance des femmes ne sera paradoxalement pas rompue, mais redéployée, à partir de la Première Guerre mondiale, lorsque leur entrée massive dans le salariat industriel ne rétablira pas leur autonomie, mais prolongera au contraire la logique d’assignation à des fonctions subalternes, désormais dans l’espace public. Dans cette nouvelle phase de la housewifization,le travail féminin, loin de constituer une émancipation, devient le vecteur d’une double charge, productive et reproductive, dans un monde inlassablement structuré par l’imaginaire patriarcal.
Vers une réappropriation de la vie quotidienne
Le malaise croissant dans le monde du travail, particulièrement chez les jeunes actifs, ouvre la possibilité d’un basculement vers des formes d’activité restructurées autour de l’idée d’autonomie, expliquent Thomas Coutrot et Coralie Perez dans Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire. Par ailleurs, selon une enquête menée par Audencia en 2022, 92 % des répondants considèrent le sens au travail comme une préoccupation majeure. Parmi eux, 50 % se posent des questions sur le sens de leur activité professionnelle et 42 % ont déjà entrepris une transition professionnelle.
Dans les motivations évoquées, on note la volonté de « contribuer aux enjeux de la transition écologique et/ou sociale » (57 %), suivie par le besoin de « se sentir utile » (53 %) et de « concilier vies professionnelle et personnelle » (37 %). Cette question du sens du travail se manifeste de façon symptomatique par le phénomène du « brown-out », défini comme une perte de motivation due à l’absurdité des tâches confiées.
C’est là que ces préoccupations rejoignent les aspirations contenues dans la notion de subsistance, telle que développée par Geneviève Pruvost. Celle-ci désigne un mode d’organisation matérielle de la vie, reposant sur des activités concrètes et permettant de subvenir collectivement à divers besoins, sans passer par les circuits marchands ou les institutions professionnelles. Elle s’inscrit à rebours de l’autoproduction individualiste ou de l’idéal d’autosuffisance, en affirmant la réalité d’une « entre-subsistance », une interdépendance assumée entre maisonnées et voisinages, incluant des cycles de vie non humaine.
La subsistance comme éthique de travail
Cette économie ancrée dans un lieu de vie, impliquant des savoirs vernaculaires, c’est-à-dire populaires, traditionnels et endogènes, se distingue du travail domestique moderne, car elle ne se résume pas à une activité gratuite de reproduction au sein du couple, mais à une fabrique collective, égalitaire et politique, de la vie quotidienne.
À ce titre, la subsistance permet de faire des économies importantes, non en générant du profit, mais en réduisant les besoins de consommation externe. Elle est enfin indissociable d’un rapport sensible et situé au monde, où les gestes se transmettent dans une maisonnée élargie, plutôt que par délégation à des professionnels anonymes ou via des institutions.
Geneviève Pruvost souligne que la subsistance contient une dimension éthique vis-à-vis du travail. Si notre rapport à la production est en partie responsable de la crise écologique, il marque aussi, dans une lecture matérialiste, la séparation sociale entre classes et les inégalités qui en découlent.
Avec Veronika Bennholdt-Thomsen et Maria Mies, Geneviève Pruvost soutient donc l’idée d’une « sweat equity » (l’équité dans la sueur) entre peuples, classes sociales, hommes et femmes. Une perspective élargie par Amzat Boukari-Yabara dans Terres et liberté, qui voit dans l’usage direct des ressources de nos environnements une manière de lutter contre une économie coloniale, caractérisée par une production destinée à l’exportation et une dépendance internationale aux produits manufacturés.
Ils rejoignent là l’appel de Céline Marty, à une dé-spécialisation des métiers et secteurs en comparant la monoactivité professionnelle à la monoculture dans le domaine agricole. Plus encore, en prônant la « subsistance », que l’on pourrait lire comme un synonyme de la « suffisance » chez André Gorz, Geneviève Pruvost retrouve la critique du productivisme et soutient, avec Ivan Illich, une économie conviviale qui « suppose des rapports autonomes et créateurs entre individus, et avec leur milieu ».
Les métropoles, centres de gravité de ces nouveaux rapports au travail ?
La bascule urbaine est concomitante de la fin des « sociétés paysannes » et de ses mécanismes de subsistance. Cet appel à une redéfinition du travail interpelle en ce sens les collectivités citadines à plusieurs niveaux.
Citoyen d’une part. Les sociabilités urbaines se sont institutionnalisés via la forme associative, au détriment de solidarités plus informelles, interpersonnelles et micro-politiques. Celles-ci interrogent les politiques publiques de solidarité, notamment dans la reconnaissance, relativement récente, des « aidants-familiaux », et leur éventuelle évolution à des échelles plus communautaires.
Démographique aussi, avec les migrations internes mises en lumière par les médias à la suite des confinements de 2020, qui voyaient certains habitants des métropoles devenir des « néo-ruraux » ouverts aux activités de subsistances. En 2022, Olivier Roussel, ancien directeur en charge du dialogue territorial de l’Agence urbaine de Lyon, analysait ce phénomène comme un mouvement de fond, révélateur d’une bascule du modèle de la métropolisation à celui de la communauté, renvoyant à la La Revanche des villages théorisée par Éric Charmes, directeur de recherche à l’ENTPE.
Éducatif enfin. L’analyse de Geneviève Pruvost soulève le point de la transmission de savoirs vernaculaires, manuels, de subsistance. À ce titre, les initiatives œuvrant pour une autonomisation des citoyens ou collectifs (technologique — Atelier Soudé, la MYNE, etc. —, en matière de mobilité — CLAVette —, de bricolage — Bricole Social Club, l’Atelier Nouveaux Designs — ou culinaire — les Petites Cantines) peuvent être lues comme participants à l’éducation à une « économie domestique », dont l’enseignement n’est pas prévu par les programmes scolaires en France.
La subsistance comme objet de transmission
Malgré cet angle mort de l’éducation nationale, le phénomène des « tutos Youtube » ou l’immense succès en Catalogne de l’ouvrage de la cheffe Maria Nicolau, Cuisine ou barbarie (éditions Arpa 2025), laissent penser qu’une demande existe, résonnant avec l’idée de subsistance. « C’est cuisiner qui nous rend humains, si on cesse de le faire, on finira par manger du foin fourni par dix entreprises qui auront provoqué notre acculturation. C’est ça, la barbarie (…), la cuisine importante est celle de la maison, celle qu’on prépare pour ceux qu’on aime », explique Maria Nicolau.
Notre présent urbain est récent, et nous avons tous des héritages « paysans ». Pourtant, depuis l’après-guerre et, « trop souvent encore, les politiques publiques sont élaborées à partir d’un cadre d’analyse opposant ville et campagne », déplore Monique Poulot, présidente du Conseil scientifique de France Ruralités. Son rapport, rendu en mai 2025, appelle à dépasser la « mythologie CAME » - Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence, décrite par Olivier Bouba-Olga - et à rompre avec l’illusion du ruissellement des richesses urbaines.
Elle invite aussi à sortir d’une lecture misérabiliste du rural, en réactivant, à la suite de Majid Rahnema et Jean Robert, la distinction entre « misère » vécue comme perte des capacités d’agir, et « pauvreté », qui entraînerait certes une faible consommation monétaire, mais assurerait une plus forte autonomie.
Ainsi, la subsistance permet de penser l’interface ville-campagne comme un continuum. On peut le voir à travers des structures citoyennes mettant en place des « Greniers » collectifs visant à améliorer l’autonomie alimentaire des personnes les plus dépendantes ou des collectifs en grève. De même, Céline Marty soutient que l’instauration à Lyon des Vergers urbains (l’association du même nom promeut ces dispositifs à l’échelle nationale) et l’ambition de rendre la ville « comestible » vont dans ce sens. Elle rappelle entre autres l’omniprésence des vignes à Paris et dans sa banlieue au 19e siècle. Notons que les zones agricoles s’entremêlent aux faubourgs jusqu’à leur remplacement à l’Après-guerre par les « grands ensembles », ces quartiers dont les noms rappellent régulièrement, mais discrètement, l’héritage rural.
Le collectif, levier principal d’une stratégie d’atténuation
Dans les configurations contemporaines de la vie quotidienne, la notion de subsistance telle que reformulée par Geneviève Pruvost ouvre une brèche conceptuelle. Elle permet de penser la recomposition d’un tissu socio-économique à partir d’une articulation entre « travail » et « activité », deux modalités que la modernité industrielle a tendu à disjoindre, voire à opposer.
Par travail, il faut entendre ici l’ensemble des tâches exécutées en vue d’une compensation monétaire, dans un contexte où l’acquisition de revenus devient la condition exclusive d’accès aux biens et services. Ce glissement a pour effet de soumettre les existences à un régime de dépendance marchande intégrale.
À l’opposé, ce que Geneviève Pruvost nomme activité relève de ce qui est accompli sans visée marchande directe, mais qui produit néanmoins de la valeur d’usage : cultiver, entretenir, transmettre, prendre soin. Dans ce cadre, la subsistance, ne se présente ni comme une utopie autarcique ou survivaliste ni comme une nostalgie préindustrielle, mais comme une tentative de rééquilibrage fonctionnel entre « travail » et « activité ». Elle vise à réduire le périmètre des besoins solvables, c’est-à-dire ceux qui supposent l’achat, en réintégrant dans l’espace domestique, collectif ou territorial, une part croissante de fonctions vitales.
Du fait de la faible empreinte carbone des modes de vie qu’elle inspire, la subsistance offre une stratégie disponible pour l’atténuation du changement climatique, voire une manière de s’y adapter, mais plus encore, elle permet d’éviter la dépendance salariale. Non par refus du travail, mais par pluralisation des modes de contribution à la vie matérielle. En cela, elle relève d’une logique de relocalisation des compétences, de requalification des pratiques ordinaires et de réactivation de communs productifs.
À moyen ou long terme, ce qui se joue ici est un potentiel changement de paradigme : à la consommation intégrale de la vie se substituerait une économie de la capacité partagée, soit l’ensemble des compétences, savoir-faire, ressources et puissances d’agir qui ne résident pas dans des individus isolés, mais dans des collectifs interdépendants, capables de produire, d’entretenir et de transmettre les conditions matérielles de leur existence, sans dépendance exclusive au marché ou à l’institution.