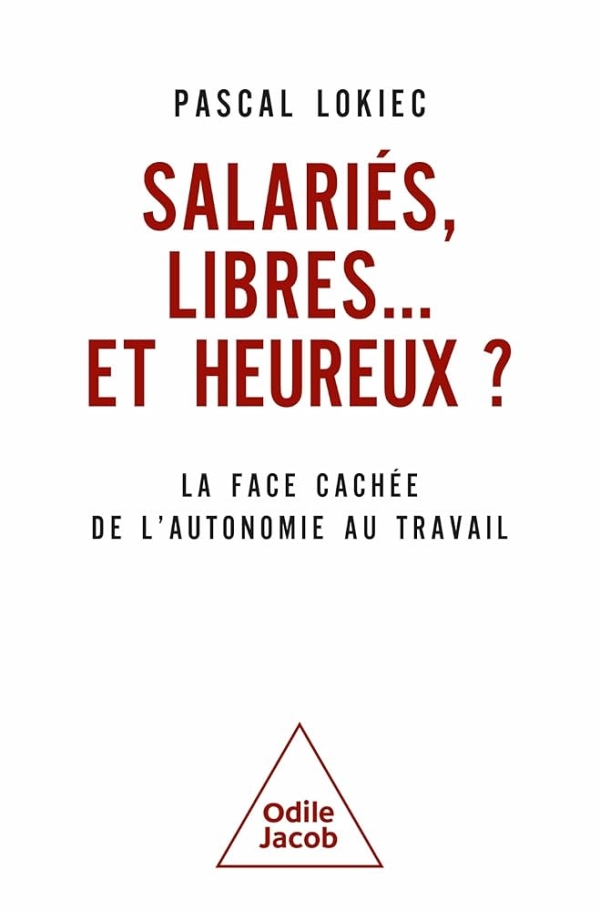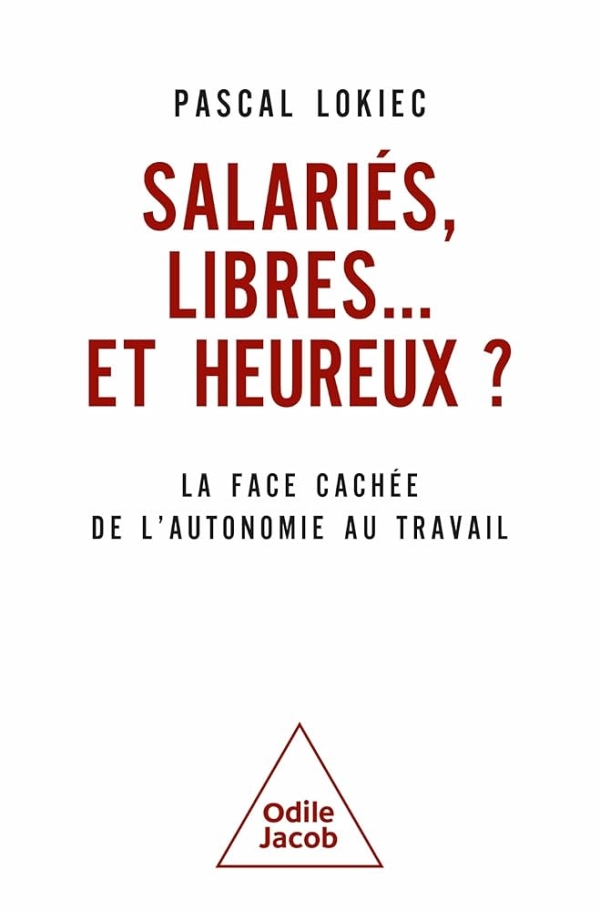Est-ce son destin exemplaire de « transfuge de classe » qui séduit encore aujourd’hui ? Sa vulnérabilité assumée face aux affres de l’existence ? Le mépris des intellectuels au moment de son prix Nobel, puis la qualification de « philosophe de classes terminales » par Jean-Jacques Brochier dans un essai de 1970, qui expliquent son succès posthume ? Est-ce son goût pour le réel, qui en fait un auteur touchant le cœur et l’esprit de toutes les générations ?
En ce premier quart de 21e siècle, Albert Camus est partout : dans les mangas japonais, dans les citations partagées sur les réseaux sociaux, dans la musique pop, dans les sphères du développement personnel autant que dans les discours des militants pour le climat.
Pour sa fille Catherine Camus, il « parlait en être humain pour les êtres humains. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit autant aimé à travers le monde, et il le sera encore longtemps puisque ses écrits semblent être faits pour être lus aujourd’hui, à l’aune des crises sanitaires, géopolitiques, existentielles que nous traversons » (2022).
Durant la pandémie de Covid-19, c’est La Peste (1947), relu massivement, qui a marqué les esprits tant les étapes décrites faisaient écho à l’actualité : « les premiers signes, la menace qui se précise, l’anxiété générale, l’évidence irréfutable ». Actuellement, quand il s’agit de décrire et de tenter de comprendre un quotidien routinier et/ou au rythme effréné et son impact, on se réfère à l’essai Le mythe de Sisyphe (1942).
Sisyphe, un travailleur en quête de sens ?
« Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne d’où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu’il n’est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir » (A. Camus). Car après cet effort, Sisyphe ne peut que redescendre à son tour et se remettre à la tâche, aussi vaine soit-elle. « L’ouvrier d’aujourd’hui travaille, tous les jours de sa vie, aux mêmes tâches et ce destin n’est pas moins absurde. Mais il n’est tragique qu’aux rares moments où il devient conscient », soulignait l’écrivain.
80 ans après l’écriture de ce texte et malgré les évolutions du travail, c’est encore lui qui est mis en cause. Dans son roman À la ligne. Feuillets d’usine (2019), largement inspiré de son expérience au sein de conserveries de poissons et d’abattoirs, Joseph Ponthus donne à voir les gestes répétitifs, la fatigue, la souffrance des journées qui finissent par toutes se ressembler :
Une journée ordinaire
Comme il y en a tant d’autres
Tous les jours presque
Sans ces microévénements qui méritent d’être racontés
Un nouvel atelier une saillie d’un collègue un lendemain de match ou d’élection
Tâcher de raconter ce qui ne le mérite pas
Le travail dans sa plus banale nudité
Répétitive […]
L’usine est
Plus que tout autre chose
Un rapport au temps
Qui ne passe pas
Éviter de trop regarder l’horloge
Rien ne change des journées précédentes
Entre les lignes, on y trouve la colère face à ce temps accaparé par des tâches n’ayant pas de fin. Mais le plus douloureux se situe peut-être ailleurs : « Qu’est-ce qui est le pire, le mal de dos ? Les insomnies liées au travail posté de l’industrie ? Non ! Le pire, c’est la résignation ! Se contenter de ce qu’on a alors que l’on possède sans doute d’autres talents. Voilà le pire. Il y a une frustration indescriptible à faire un travail répétitif dénué de sens quand on a des idées plein la tête, mais le cerveau embué » témoigne Pierre Gwiazdzinski, ouvrier décédé cet été à l’âge de 27 ans, dans une lettre rendue publique par sa famille et lue sur France Culture.
On voit bien combien la charge de travail physique et son pendant, la charge de travail mentale, se conjuguent. Cette dernière, sans spécification de genre, englobe les capacités d’attention, de concentration, de compréhension, de traitement d’informations, nécessaires à la réalisation d’une tâche, mais aussi la gestion des contraintes temporelles, des relations avec la hiérarchie et les autres interlocuteurs de l’environnement professionnel.
La souffrance liée à l’intensification des rythmes de travail et de vie, ainsi qu’à la charge de travail physique et mentale, n’est bien sûr pas l’apanage des hommes. Elle touche aussi de plein fouet les femmes, d’autant plus qu’elles sont concernées par une autre forme de charge mentale, à savoir le travail « d’organisation et de gestion de l’ensemble des activités de la vie domestique d’une famille, au quotidien et sur le moyen terme ». Celle-ci n’a été « ni partagée ni reconnue, et peu conscientisée, car elle fait partie de l’ordre des choses » au moins jusqu’aux années 1980, comme le relate la sociologue Monique Haicault (2022) dans l’ouvrage Récits de la charge mentale des femmes.
C’est Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman, présenté à Cannes en 1975 et ayant une seconde vie actuellement, ou encore La femme gelée d’Annie Ernaux, publié en 1981, où la narratrice, après des études d’un niveau égal à son mari, exerce son activité professionnelle, comme lui, mais doit assumer seule la gestion de leurs enfants et du foyer.
Et si Sisyphe était une femme ?
Malgré une prise de conscience croissante, le partage des tâches domestiques et familiales quotidiennes se heurte encore à « des résistances » d’après l’Insee, ou serait même « au point mort » depuis 2003 selon l’Observatoire des Inégalités. Cela entretient la pression temporelle pesant sur les femmes et réduit vraisemblablement leur repos et leur temps libre.
Mais d’autres facteurs se conjuguent et expliquent pourquoi les femmes sont plus vulnérables à l’intensification des rythmes de vie. Elles occupent en effet plus souvent des métiers non télétravaillables, passent plus de temps dans les transports et dans des conditions potentiellement difficiles. Elles sont aussi plus nombreuses à travailler pour plusieurs employeurs ou à exercer plusieurs professions, des situations qui conduisent à cumuler horaires atypiques et grand nombre de trajets, à l’instar des professionnelles du care.
Rappelons aussi que 82 % des familles monoparentales ont une femme à leur tête, qui assume au quotidien la charge parentale. Pour retrouver un peu de latitude, certaines optent pour le temps partiel. Qu’elles le choisissent ou le subissent, elles compromettent ainsi leur carrière, diminuent leur niveau de vie et minorent leurs droits de retraite (CESE).
Enfin, les deux tiers des personnes soutenant un proche en situation de handicap, en perte d’autonomie ou porteur d’une maladie chronique ou invalidante sont des femmes. Et lorsque l’aidance s’élève à 2 h ou plus par semaine, trois aidants sur quatre sont des femmes (France Stratégie). Encore souvent « naturellement » désignées pour prendre soin de leurs proches, certaines quadragénaires ou quinquagénaires s’occupent à la fois de leurs parents et de leurs propres enfants, subissant de plein fouet l’épuisement de cette génération « sandwich », comme l’ont appelée les sociologues américaines Dorothy Miller et Elaine Brody.
Invisible work
Pour réellement comprendre l’impact de ces inégalités de genre, il faut tordre le cou à une idée encore répandue : il ne s’agit pas d’« une double journée » faite de tâches circonscrites ou encore de leur inégale répartition entre les hommes et les femmes. S’appuyant sur une enquête sur le travail des femmes et la division sexuée du travail professionnel et domestique, la sociologue Monique Haicault utilise pour la première fois en 1984 la notion de charge mentale pour désigner celle spécifique des femmes à la fois mères et en activité, et l’explicite ainsi :
L’enjeu consiste à organiser, donc à faire tenir ensemble, les successions de charge de travail, à les imbriquer, à les superposer, ou, au contraire, à les désimbriquer, à fabriquer des continuités, sortes de fondus enchaînés, à jouer sans cesse sur ce qui marche ensemble et ce qui est incompatible
La notion a été plus récemment popularisée par Emma, autrice de bande dessinée, dans une publication intitulée Fallait demander (2017). Le titre fait allusion aux remarques des hommes assumant des tâches domestiques qu’après une demande explicite de leur compagne. À noter que ce concept a tellement été repris par les médias qu’il s’est vu galvaudé jusqu’à perdre son sens.
La charge mentale ne vient pas de la difficulté à gérer un grand nombre d’activités professionnelles puis domestiques, et vice-versa, mais bien à assumer simultanément ces responsabilités, à les organiser, les ajuster et les effectuer, et ce, à court, moyen et long termes. Et même si des hommes prennent en charge ces tâches, les femmes sont encore majoritaires à les impulser et à les manager.
Cela implique de mobiliser des compétences : « des capacités mentales de gestion et d’organisation, mais aussi de prévision, de mémorisation, de coordination, de réponse aux imprévus. Elles supposent aussi la maîtrise des temporalités multiples propres aux activités de chacun, leur agencement au sein de l’espace global couvert par leurs lieux de vie où s’inscrivent différentes mobilités. Il s’agit en outre de capacité d’empathie, de disponibilité affective pour maintenir en bon état physique et moral les membres de la famille, sur le court et le moyen termes » (M. Haicault).
Dernière précision expliquant combien la charge mentale peut être minimisée, voire tournée en dérision : elle touche à l’ordinaire, un ordinaire d’une « faible racontabilité », comme l’analyse la maîtresse de conférences Sylvie Patron. Il s’agit d’un travail invisible tant qu’on ne l’a pas pris en charge. L’expression invisible work ou invisible labour est d’ailleurs plus utilisée par les Anglo-saxons que mental load.
« Futur désirable » pour les uns, « avenir confisqué » pour les autres ?
On ne peut évoquer les difficultés d’une pression temporelle quotidienne et d’une vie où les contraintes prédominent sans s’interroger sur le rapport à l’avenir des individus, sans distinction de genre. Conserve-t-on un sentiment de maîtrise ? Développe-t-on au contraire la conviction de subir un destin implacable sur lequel on n’a que peu de prises, pour soi-même et ses enfants ? Cette subjectivité reflète l’intensité vécue des inégalités, notamment de classe sociale, comme le démontre le sociologue Nicolas Duvoux, dans L’avenir confisqué (2023). Elle permet de mieux saisir les contraintes sociales vécues par les classes populaires et moyennes et leur fragilisation, qui échappent partiellement aux indicateurs usuels de pauvreté et d’inégalité (A. Perrin-Heredia). Elle complète ces données objectives, comme la température ressentie par rapport à la température réelle.
Les milieux sociaux les plus pauvres, ou s’estimant pauvres, et aux conditions d’existence difficiles, se caractérisent par un avenir confisqué, comme s’ils étaient « dépossédés des possibilités de se projeter dans l’avenir et de s’accomplir. Cette dépossession est dépendante de leurs conditions d’existence dégradées ; elle rejaillit sur l’ensemble de leurs pratiques et de leurs valeurs » (N. Duvoux).
Quand la boucle du présent inhibe le « pouvoir d’agir »
On aurait tort de sous-estimer l’impact de cet enfermement dans le présent sur les individus, les relations individus-institutions et le collectif. Sans prétendre à l’exhaustivité, rappelons tout d’abord que certaines aides institutionnelles sont précisément conditionnées par l’existence d’un projet. C’est le cas de l’ARE avec son projet personnalisé d’accès à l’emploi, et du RSA et son contrat d’engagement précisant ses objectifs d’insertion sociale et professionnelle.
Si cette assistance est indispensable, elle « suscite une gratitude ambiguë, mais aussi une colère qui ne peut s’exprimer qu’en se retournant sur elle-même », d’autant plus quand les conditions de sortie de ces dispositifs d’aide ne peuvent être réunies (N. Duvoux). En outre, dans un contexte de stagnation des salaires et d’augmentation des dépenses contraintes, cette situation attise le ressentiment des classes populaires fragilisées à l’égard des « assistés ».
Ensuite, la perte de confiance en l’avenir peut se transmettre à l’entourage et aux enfants, décourager leurs efforts, puisque tout semble joué d’avance, et venir entamer un peu plus les chances d’ascension sociale d’enfants confrontés déjà à des conditions de vie difficiles.
Enfin, parce que les difficultés à se projeter dans l’avenir entravent la construction d’un imaginaire commun, quel qu’il soit, mais a fortiori celui de la transition écologique, elles freinent l’action. Même si « les milieux populaires portent le souci du futur de leurs enfants » et ont l’expérience de la sobriété — imposée —, leur mobilisation dans la redirection écologique se décline sur l’« agir ici et maintenant en marge des pouvoirs publics » et « ces initiatives restent parsemées et fragiles financièrement ».
La reconnaissance et la prise en compte des paroles et pratiques écologiques des milieux populaires sont encore trop rares. Pourtant, elles pourraient être décisives pour réconcilier les conceptions populaires et dominantes de l’écologie et écrire des récits de la transition écologique mobilisateurs.
Sisyphe, absurdement heureux ?
Comment envisage-t-on un quotidien possiblement pesant à l’heure où la santé mentale semble particulièrement fragilisée et où 7,2 % des 18-24 ans déclaraient en 2021 avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois ? Les Sisyphe du 21e siècle sont-ils condamnés à la quête d’un espoir de jours meilleurs, à la résignation, ou à la prise de conscience qu’il est possible de vivre avec passion le moment présent, comme le défend Albert Camus ? « Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. […] La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux ».
Marquée par l’épuisement des générations précédentes et elle-même confrontée à l’intensification des rythmes de vie, la jeune génération ne semble pas disposée à accepter ce destin. Sera-t-elle plus à même de ralentir son tempo et de défendre sa qualité de vie ? Pour 53 % des jeunes actifs de moins de 31 ans, l’aspiration à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est un critère à prendre en compte dans le choix d’un emploi. Les jeunes femmes sont plus enclines à privilégier cet aspect : 57 % d’entre elles se déclarent attentives à ce critère contre 46 % des jeunes hommes (Credoc-Injep, 2023). Cette aspiration progresse chez l’ensemble des actifs depuis une trentaine d’années en France, mais plus encore chez les jeunes.
En revanche, la nouvelle génération se distingue du reste de la population active par des préférences qui traduisent sa volonté de préserver un équilibre de vie, telles que la recherche d’horaires de travail fixes et leur appétence pour le télétravail, recherché par 74 % des moins de 30 ans. Les jeunes se disent aussi davantage prêts à démissionner en cas de stress ou d’une trop grande surcharge de travail (Credoc-Injep, 2023).
Ajoutez à cela la recherche d’un partage équitable des tâches domestiques et le soutien de mesures visant une meilleure conciliation des temps de la vie (ex. semaine de 4 jours, congé parental allongé et réparti entre les parents), nul doute que la jeune génération semble bien décidée à faire bouger les lignes.