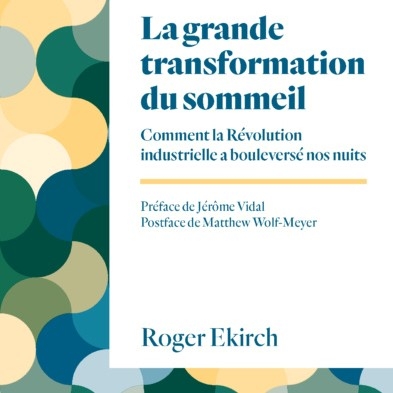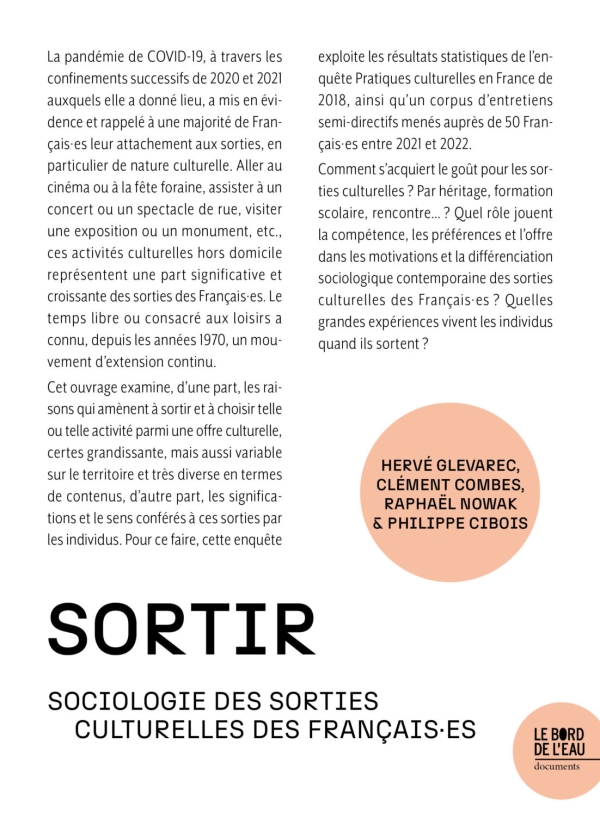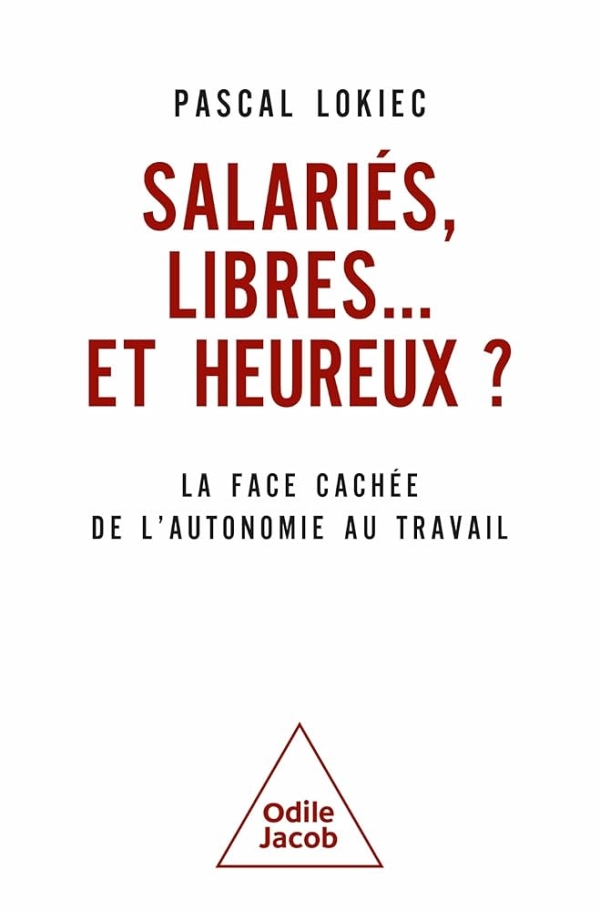Guy, retraité
« Pour sortir de ce merdier, il faut ralentir ». La conclusion de l’anthropologue Sonia Lavadinho réveille les esprits las d’une matinée d’échanges sur les politiques temporelles. La jeune femme blonde à l’élégance discrète suspend son stylo, coupe son dictaphone. Elle transcrira plus tard « Nous sommes dans la situation actuelle parce que nous avons voulu aller trop vite. La meilleure façon de retrouver l’équilibre de nos vies et de notre planète est de ralentir ».
« Ralentir ». En voilà une idée tendance depuis déjà quelques années, entre péril écologique, slow life, « grand ralentissement », éloge de la lenteur ou du retard. Mais qui est vraiment prêt à lever le pied ? Pas les voyageurs aux regards désapprobateurs croisés ce matin : « Pourquoi les retraités viennent-ils encombrer les transports en commun aux heures de pointe ? » Certes, j’avance à pas mesurés, ma canne encombre. J’appartiens désormais à la catégorie des « lents », des lourdauds et des balourds, des indolents et des mous. De celles et ceux qui vous ralentissent, donc vous agacent et que l’on contourne d’un pas vif.
J’incarne ce que la modernité honnit : la lenteur, le rythme brisé, la cadence rompue. La verve de Filippo Tommaso Marinetti et de ses Manifestes du futurisme me revient : « La vitesse, c’est l’espérance de l’Occident », celle qui « sauvera l’homme de la décomposition déterminée par la lenteur ». Voilà résumés en quelques mots des siècles d’imposition de la vitesse comme outil de hiérarchisation, comme référence indépassable. Pourtant, à l’origine, la lenteur se paraît des vertus du roseau, flexible et résistant. Autant de points communs avec un autre concept à la mode : celui de la résilience.
Dans une époque accroc à la vitesse et à la précocité, ne pas suivre le rythme imposé, voire même dormir, font quasiment figure d’actes subversifs. Je leur aurais bien agité sous le nez l’ouvrage de Laurent Vidal, en leur rétorquant qu’en dépit de ces « bien nommés Temps modernes, qui ont érigé la domination de la vitesse en modèle de vertu sociale », la « force est du côté des lents ». Assumer la lenteur pour suivre son rythme propre nécessite d’avoir compris que la vitesse est une figure imposée, mais nullement incontournable.
Manon, étudiante et animatrice périscolaire
Tous les mardis, courir pour embaucher à temps. C’est encore plus serré depuis le décalage des horaires de cours du matin pour « lisser l’hyper-pointe », comme nous l’ont expliqué universités et opérateurs de transports. Plus besoin d’être stratège pour rentrer dans le métro, mais les horaires des écoles n’ont pas changé et la cantine n’attend pas. Tout est minuté, les services s’enchaînent à flux tendus : maternelle, primaire, collège.
À peine sortis de classe, les élèves perdent le rythme, se dispersent et se relâchent, bavardent et jouent. Ils « prennent leur vie », comme ils disent. C’est normal, c’est pour ça qu’ils aiment manger à la cantine. Pas d’autre choix que d’être en mode « surveillante en chef » pour expédier lavage de mains, enfilage de manteaux, mise en rangs, canalisation des excités, stimulation des léthargiques, top départ et parcours d’obstacles en plein rituel de midi !
Manger avec eux, c’est ce qui me plaît. Mais comment, en 30 minutes chrono, les éduquer au goût, transmettre des normes nutritionnelles et sociales, tout en veillant à ce qu’il reparte l’estomac plein ? Les parents ont lancé une pétition pour que tous les enfants aient suffisamment de temps pour déjeuner.
Sur le chemin du retour, excitation générale. Que fabrique cet homme avec l’horloge ? Je m’amuse à leur répondre qu’avec son drôle d’attirail, il répare le temps, en le prenant, vu ses gestes posés. Peut-être que, si je demandais à bénéficier de l’aménagement des études pour les étudiants salariés ou de l’expérimentation « Include », je serais moins débordée. Des apprentissages asynchrones, rien que le titre me… « EMMA ! NON, LÉO ! STOP ! »
Nicolas, artisan horloger
Prendre soin des choses, les maintenir en bon fonctionnement, agir avant la rupture, la casse, la panne. Je ne chôme pas avec l’engouement pour la belle mécanique horlogère, de luxe ou de seconde main. L’invisibilité est mon quotidien davantage que les likes des influenceurs du bricolage, de l’upcycling et autres appels à un usage durable des objets.
Mes aïeux « horlogiers » m’ont transmis l’art de réparer ces instruments datant d’une époque où avoir son propre outil de mesure du temps était la marque d’un statut social élevé. En 1650, à Lyon, un seul marchand possède une horloge de chambre ! Entre l’arrivée des premières horloges au 13e siècle, celle des montres au 16e et les 9,6 millions de montres vendues en France en 2020, quelques centaines d’années auront suffi pour que chacun ressente la nécessité d’avoir son propre « garde-fou temporel », même si les rues sont encore pleines de Lapins blancs toujours pressés.
Nous en sommes aux montres connectées, traquant les rythmes les plus intimes. Écouter ce fameux temps biologique, non plus de l’intérieur, mais de l’extérieur, via des données chiffrées, précises, prescriptives. Est-ce une déclaration d’autonomie, un acte de résistance face à ce que Laurent Vidal appelle le « pouvoir social des horloges » cherchant à imposer la synchronie de tous et partout ?
Prendre soin des temps, c’est prendre soin de la vie ensemble, instaurer de la synchronie, voire des rites, dans un monde qui s’en éloigne. J’aime ce rendez-vous avec l’horloge monumentale : entrer dans la pénombre de son fût, gravir l’étroite échelle en fer, ausculter la mécanique des cadrans. Je pense au maire Étienne Marin, qui l’a commandée au début du 20e siècle et y voyait un moyen de faire de la République la nouvelle « maîtresse des horloges ». En pleine époque de séparation des pouvoirs entre États et Église, il importait de donner une heure « laïque, républicaine et allégorique » !
Mais Laurent Vidal le retrace bien. Loin de s’émanciper d’une « rythmique chrétienne scandant les temps forts de la vie sociale (travail, devoirs religieux, fêtes…) », cette pulsation séculière va finalement incarner celle de la modernité industrielle : « impulsée depuis les usines, les ports et grands centres industriels et commerciaux, ce rythme se diffuse peu à peu à toutes les sphères de la vie sociale. Et ce mouvement s’accompagne d’une forme de dépréciation de ceux qui ne sont pas en phase avec son intensité, le subissant plutôt que le contrôlant ».
Les lents sont alors disqualifiés : à la paresse dénoncée par le discours religieux pour sa dangerosité sur l’équilibre social, s’ajoutent l’inefficacité, l’inadaptation des corps et des gestuelles aux principes mécaniques. Rien dans les évolutions contemporaines n’a vraiment pris le contre-pied de ce biais.
Nous sommes de plus en plus nombreux à choisir l’artisanat, à devenir des « hommes immobiles connectés », comme le formule la sociologue Florence Cognie. Pour elle, cet essor est cohérent « avec les exigences du “nouvel esprit du capitalisme” » que sont, entre autres, l’autonomie, la production à la commande, l’ancrage local, etc. Peut-être. Moi, j’aime à penser que nous avons à cœur de réhabiliter la durée, l’attente, le temps incompressible de la matière, du geste qui la modèle, avec lesquels nul ne peut transiger.
Paula, artiste
J’ai eu raison de me replonger dans l’ouvrage de Laurent Vidal. On allait oublier le rôle des villes dans la construction de la figure du lent : « Qu’elles soient métropoles continentales ou port maritime, ce sont les véritables plaques tournantes de la mondialisation culturelle entreprise par cette bourgeoisie occidentale qui « a modelé le monde à son image ». Le monde, mais aussi le temps !
C’est incroyable : 25 pays se réunissent en 1884 pour partager le globe en 24 fuseaux horaires et faire du méridien de Greenwich la référence universelle. Ce sont encore eux qui ont porté d’autres mouvements de fond : le nouvel impérialisme colonial, substituant à la croix, le droit, le marché et la violence, la nouvelle division internationale du travail, nourrie par les colonies, les migrations et le racisme scientifique, qui classait le vivant pour mieux le dominer.
La technologie, les horloges, les chronomètres, voire le fouet, s’allient pour mettre au travail tous ces indolents des colonies, ces hommes de l’inattention, ces vagabonds et autres contemporains inutiles, supposés incapables d’adopter une discipline de travail, d’associer temps et argent, performance et vitesse.
L’idéologie vitaliste exclut ces « asociaux », prostituées, musiciens de rue, sans-domicile ou sans-emploi, tous ces « réfractaires au travail », aux modes de vie paresseux et lents. Mais pour les tenir à distance, les sociétés vont plutôt utiliser le cantonnement spatial. En banlieue, à la campagne, éloigner pour limiter la fréquence de leur présence.
Je l’ai aussi entendu ce discours… « Graffeuse, ce n’est pas un métier, c’est pour les cancres, les fainéants. Comment tu vas vivre ? Et si t’as des mômes ?… » Je me retrouve dans les formes de résistance développées par mes compères de lenteur : résister par le rythme, déployer un art de la brèche pour fissurer le temps dominant. La grève du zèle, la grève tout court, le débrayage, le mouvement Go Canny, le Saint Lundi, la nuit comme espace de liberté, et moins frontalement, la syncope, le ragtime, la habanera, la samba…
Autant d’allégories de « ce temps haché, précaire, fait de ralentissements et d’accélérations, d’attente… », comme l’analyse l’ouvrage. Pourtant, c’est bien ce que tout le monde cherche en ce moment : redevenir maître d’un temps non linéaire, choisir ses rythmes de travail, slasher…
Josiane, bibliothécaire
Me voilà en week-end. Hier soir, à la médiathèque, le public était au rendez-vous pour la nocturne. C’est un peu compliqué en termes d’organisation du travail, mais ça en vaut la peine. Comment la ville construit le temps de celles et ceux qui la vivent et l’habitent ? Voilà un sujet que je n’imaginais pas si attractif, quel que soit l’âge ou le style des participants.
Cela semble évident avec le recul et pourtant, la préoccupation pour la qualité des temps urbains a attendu les années 90 et le ras-le-bol de ces nouveaux Sisyphes féminins. Basta, ont dit les Italiennes ! Mais comment considérer les temporalités de nos journées, maintenant que les hommes ne sont plus les seuls à travailler ?
Comment trouver de la synchronie dans une société et un monde du travail qui se fragmente ? 20 ans que des villes réfléchissent à la qualité du temps qu’elles offrent, à la manière de concilier services publics et urbanisme avec les attentes et contraintes individuelles ou catégorielles. La ville s’est rêvée polyvalente, vivante 24/24 h, accessible, servicielle et coproduite, et même village. Les outils et concepts fleurissent : schémas de cohérence temporelle, politiques de Haute Qualité temporelle, capabilité rythmique, résonance, polyrythmie des espaces, chrono-urbanisme…
Ce soir, autour d’un ouvrage de l’historien Laurent Vidal, on s’est décentré en rappelant que notre Chronos, cette mesure linéaire au tic-tac lancinant, a deux frères : Kairos et Aiôn. Kairos, cet art d’agir au bon moment, et donc de l’attendre, bouscule les calendriers rodés de nos vies et des politiques publiques. Mais les bénéficiaires et les professionnels des politiques sociales ou d’emploi ne trouveraient-ils pas là matière à valoriser des évolutions, aussi minimes soient-elles ? Quant à Aiôn, cyclique et long, il est celui du système Terre et de l’humanité. Celui que nous peinons le plus à saisir.
Comment cette triade pourrait-elle permettre d’ouvrir de nouveaux horizons de pensée pour distinguer la dimension temporelle des enjeux contemporains ?
Tommaso, lycéen
Entorse du genou. Je suis en plein Kairos… L’avant et l’après de l’accident. Il a fallu que je m’adapte, mais, si tout va bien, ce ne sera que temporaire. Heureusement que Papé est là. D’habitude, c’est plutôt moi qui l’aide, quand sa prothèse le gêne.
Demain, je lui raconterai cette soirée. Je lui parlerai de l’ouvrage de cet historien présenté par la bibliothécaire, Laurent Vidal je crois, pour qui « Les Gilets jaunes ont inventé […] un outil rythmique de contestation sociale en s’installant sur des ronds-points. Ces ronds-points, qui ont été inventés pour fluidifier la circulation, ils les ont utilisés différemment pour ralentir, se faire voir et se faire entendre ». C’est vrai qu’il n’y a jamais de quémandeurs aux ronds-points. Nul endroit pour échanger trois mots avec les conducteurs pressés ou stressés, raconter un périple, des difficultés, se rencontrer.
Pourtant, selon lui, c’est bien dans ces espaces-temps de la polyrythmie, de la déviance aux rythmes imposés que le lien social peut se réinventer. Finalement, Papé ne dit pas autre chose depuis qu’il a lu La ville relationnelle, de Sonia Lavadinho, Pascal Le Brun-Cordier et Yves Winkin : « La Ville relationnelle bâtira le XXIe siècle comme la ville fonctionnelle a bâti le XXe siècle ». Il faut du temps pour voir les autres dans l’espace public, aider une personne à traverser, orienter un touriste égaré, partager des expériences fugaces ou prometteuses de liens.
Il faudra aussi autoriser d’autres rythmes, comme nous l’expliquait un participant de cette soirée : les villes lentes, les espaces urbains des métropoles rendus à la métrique piétonne, et donc à une certaine lenteur, favorisent la reconstruction de communs, ou la création de nouveaux qui, eux, nous aideront à freiner, et donc à nous rencontrer.
J’ai hâte…