Économie circulaire : des ressources pour aller plus loin

Article
Poursuivez votre découverte des enjeux de l’économie circulaire, avec nos conseils de lecture.
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Dominique Bourg
<< L’économie circulaire redonne du sens… à condition qu’on ne la dévoie pas >>.
Dominique Bourg est professeur à la faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne. Il s’intéresse notamment à l’économie perma-circulaire.
Dans cet entretien, il revient sur les différents niveaux de circularité, et en particulier sur celui de la perma-circularité, dont les enjeux se situent à l'échelle de la planète et de la maîtrise des flux d'énergies et de matières dans le système économique.
Vous étiez parmi les premiers à utiliser le terme d’économie circulaire en France, dans les années 2000. Dans quel contexte vous êtes-vous intéressé à cette question ?
Je me suis intéressé à ces questions car je me rendais compte que les autres stratégies de dématérialisation restaient très sectorielles. Avec l’écologie industrielle et les écoparcs, on sentait qu’on ne pouvait pas aller très loin car c’est extrêmement rigide et les gains de matière et d’énergie réalisés tournent autour de 10% au mieux. En plus, il s’agit de sites comprenant plusieurs entreprises, donc si une entreprise s’en va, l’ensemble de la symbiose explose. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire, mais ce n’est pas à la hauteur des défis. De son côté, l’économie de fonctionnalité s’est développée de manière assez modeste avec le B to B. On pouvait imaginer aller plus loin avec une extension au B to C, sur un nombre d’objets plus importants, mais cela n’a pas vraiment décollé. Et quand bien même elle se développerait, là encore, elle ne permettrait pas de répondre, isolément, à l’essentiel des problèmes : elle ne constitue pas une réponse à l’effet rebond [1] ; seul un contrôle de ce qui entre dans le système économique le permettrait. On voyait bien qu’on ne pouvait pas en rester à des échelles purement industrielles et très sectorielles : ce genre d’approche n’est pas inutile en soi, et c’est très bien de le faire… mais on est à mille lieues de la réalité des défis.
[1] L’effet rebond désigne un phénomène très courant et largement documenté, qui se caractérise par le fait que les progrès en termes d’usage des ressources (éco-conception, recyclage, réemploi, réparation…) sont annulés par l’accroissement de la production et de la consommation.
Dès cette époque, vous associez donc l’économie circulaire à l’idée d’un dépassement des approches sectorielles telles que l’écologie industrielle ou l’économie de fonctionnalité ?
Oui, bien sûr. D’ailleurs, aujourd’hui je ne parle même plus d’économie circulaire, mais, avec mon co-auteur Christian Arnsperger, d’économie « permacirculaire ». Une économie circulaire serait une économie dont le taux de croissance de consommation d’une matière donnée reste en deçà d’1% par an, car si on excède ce niveau, même en recyclant 80% de la matière, cela ne changerait pas grand-chose.
Voilà ce qu’est pour moi l’économie « circulaire » aujourd’hui : un système qui permet d’arriver à un début de circularité de l’économie dans l’usage des matières non renouvelables. Si on parvenait à cela, on obtiendrait alors une consommation de flux à peu près constante. Mais le problème est que la quantité de flux de matières et d’énergie que l’on connaît aujourd’hui nous a amenés à dépasser les limites planétaires et à créer des irréversibilités : on ne pourra pas revenir à la composition chimique de l’atmosphère ou au niveau de biodiversité des années 1950. Une fois ces limites franchies, on change le système lui-même et on ne revient plus en arrière. Si on veut que l’économie soit en harmonie avec les capacités du système Terre, il faut donc non seulement stabiliser, mais aussi réduire éminemment les flux qui entrent dans le système économique : à savoir l’énergie carbonée, bien entendu, mais aussi toutes les matières. Il faut donc réduire les volumes de toutes nos activités – et sans doute aussi notre démographie.
Un indicateur qui peut être intéressant pour y parvenir, c’est l’empreinte écologique : l’idée est de revenir en vingt ou trente ans à une consommation de ressources et de rejets équivalents à ce que la planète peut soutenir. Cela ne permet pas de revenir à l’état antérieur, mais cela permet de progressivement restaurer un espace de sécurité planétaire : c’est ce que nous avons appelé l’économie permacirculaire. Une telle économie ne se contente pas de circulariser l’essentiel des flux non renouvelables, elle prend en compte les raisons des difficultés dans lesquelles nous nous enfonçons et elle cherche à répondre à ses causes premières : à savoir des flux d’énergie et de matières totalement disproportionnés par rapport à ce que la planète peut encaisser. Une fois revenu à un tel niveau, on devrait s’approcher de ce que pourrait être une économie stationnaire.
Entre l’approche institutionnelle qui revendique la croissance verte et l’économie permacirculaire que vous prônez avec l’économie stationnaire, il y a un gouffre…
Oui. L’approche de la Fondation Ellen MacArthur, par exemple, repose sur l’idée que le système peut se poursuivre indéfiniment : il s’agit d’une approche purement industrielle dans laquelle on porte l’analyse à l’échelle d’un produit ou, au mieux, à l’échelle d’un site. Mais dans ce cas, on fait comme si l’effet rebond n’existait pas ! Or, ce qui détruit les conditions de vie sur le système Terre, c’est une fois de plus la hauteur des flux générés, ce qui veut dire que l’objectif premier doit consister à réduire ces flux globaux. Or ce n’est pas du tout ce que l’économie circulaire prend en compte, en tout cas pas dans sa version la plus soft, telle que prônée par la Fondation Ellen MacArthur, où on se contente de circulariser certaines opérations à l’échelle de la production. Mais cela ne mène à rien de significatif. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas le faire, bien entendu, mais il faut intégrer cette démarche « micro » dans un système économique « macro » dont on contrôle les flux d’entrée et de sortie : alors seulement les gains de productivité réalisés pourront déboucher sur des gains absolus.
Si je comprends bien, vous distinguez donc trois « niveaux » de circularité, trois écoles de pensée ?
Oui. Il y a un premier niveau d’économie circulaire, qui est le niveau sur lequel tout le monde s’entend aujourd’hui, c’est-à-dire la croissance verte, l’économie verte : on circularise des éléments épars à l’échelle des sites de production, mais sans aucune vision systémique des flux globaux.
Il existe ensuite une deuxième vision, plus intéressante, qui se concentre sur les flux globaux et se focalise sur les matières en préconisant que le taux de croissance de consommation des matières n’excède pas 1%, au mieux 0,5% par an ; à cette condition, on parvient à circulariser une partie de l’économie.
Le troisième niveau, c’est ce que nous appelons l’économie permacirculaire, qui considère le retour à une croissance de 0,5% par an comme une première étape, avec comme perspective de faire descendre les flux qui sous- tendent nos activités à hauteur de ce que permettent les limites planétaires. On peut se référer aux limites planétaires proposées par Johan Rockström et ses collègues, qui délimitent un espace de sécurité planétaire. En termes de stocks toutefois, pour le carbone et la biodiversité déjà détruite, nous ne reviendrons pas en arrière, en tous cas pas à l’échelle historique. Il convient de ne pas franchir les autres limites et surtout de revenir à des niveaux de flux, que nous n’aurions jamais dû dépasser. Il faut donc faire en sorte que les flux de matières non renouvelables n’augmentent plus, et ensuite qu’ils diminuent, ainsi que le volume de nos activités matérielles. Quant aux matières biologiques, il faut s’engager sur des pratiques régénératives comme l’agroécologie et la permaculture, qui permettent de rétablir des équilibres écologiques, de restaurer les sols, la faune des sols, etc.
Vous renvoyez systématiquement à des enjeux globaux. L’économie circulaire classique travaille trop à l’échelle micro, sans se préoccuper de ses effets globaux ?
Une fois de plus, ce travail à l’échelle des process de production n’est pas inutile, mais ce n’est qu’un élément de la circularité. C’est pour cela qu’avec Christian Arnsperger, nous proposons trois niveaux d’indicateurs : des indicateurs « micro », à l’échelle des process et des entreprises, mais aussi des indicateurs « méso » et « macro » qui vont mesurer de quelle manière on réduit les flux à l’échelle d’un secteur, d’une nation, puis in fine à l’échelle globale. On propose même d’ajouter un quatrième niveau d’indicateurs, davantage culturel, car pour parvenir à réaliser un tel projet il faut une conscience plus réflexive (nous ne pouvons plus faire comme si nous étions seuls, des milliards consomment comme moi !), un ensemble de valeurs qui changent, un modèle d’accomplissement de l’humanité qui s’éloigne du consumérisme.
A propos de dimension culturelle, le terme d’économie permacirculaire renvoie à la permaculture : est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
L’intérêt de la permaculture est qu’elle renvoie à une relation de l’homme avec la nature. Il faut d’ailleurs être prudent avec l’usage de ce terme : la plupart des démarches qui s’en revendiquent sont en réalité davantage en lien avec une forme d’agriculture biologique assez intensive. La permaculture réelle renvoie à l’idée d’une nature qui travaille pour ainsi dire toute seule : on n’est pas très loin de l’agriculture sauvage telle que prônée par Masanobu Fukuoka, un agriculteur et auteur japonais qui prône les vertus d’une agriculture dite naturelle, reposant sur le minimum d’interventions humaines.
Dans notre cas, il s’agit plus simplement de tendre vers une économie régénérative. Bien entendu, on ne peut pas régénérer les métaux, mais en revanche on peut se fixer comme objectif de ne plus puiser dans le stock et de gérer l’existant, ce qui est déjà extrait. Pour l’énergie, il s’agit de la décarboner, et d’interdire par exemple à l’horizon de vingt ans quasiment toute énergie fossile. On ne peut pas avoir le même degré d’exigence à l’égard de ces différents enjeux, mais la permaculture renvoie à cette idée de régénérer ou de restaurer. Il y a des choses que l’on peut régénérer sur un temps relativement court, comme les sols justement avec la permaculture et plus généralement l’agroécolgie, et d’autres qui prennent des millénaires, comme l’atmosphère.
Quelle différence faites-vous entre ce projet de régénération de la nature et celui de réparation, voire de maîtrise de la nature, que proposent les tenants de la géoingénierie [1] ?
Sur ce sujet, mon positionnement est philosophique : il faut arrêter avec l’illusion de la maîtrise. Quand on pensait pouvoir maîtriser la nature, on s’imaginait cette dernière comme une immense horloge, complètement mécanique, dont nous étions nous mêmes exclus. On pouvait alors imaginer qu’il était possible d’intervenir sur des éléments du tout, sans incidences sur le tout. Mais on ne peut plus soutenir cette idée aujourd’hui, car on sait que la Terre est un système, et le propre d’un système est d’agir sur ses éléments – ce qu’on appelle la causalité descendante. Le propre d’un système c’est aussi de connaître des franchissements de seuil déclenchant des ruptures au sein du système, qu’on est rarement capables d’anticiper. Donc pour autant que l’on fait partie du système et que l’on agit de l’intérieur et, qui plus est aujourd’hui de façon massive, on suscite une réaction non moins massive de celui-ci – réaction qu’on est rarement capable d’anticiper et en aucun cas de contrôler.
[1] La géoingénieurie consiste en des techniques visant à moduler le climat de la Terre en captant massivement les émissions de CO2, ou encore en réduisant le rayonnement solaire atteignant les basses couches de l’atmosphère.
On ne peut pas maîtriser la nature à l’échelle des enjeux actuels ?
Il n’y a aucune maîtrise : la maîtrise suppose d’être en dehors du système, mais nous sommes dedans ; nos actions suscitent des réactions, auxquelles nous réagissons, etc. La seule chose à faire consiste à essayer de revenir à un certain nombre de mécanismes et d’équilibres qu’on connaît bien et dont on sait qu’ils n’entraînent pas de perturbations trop importantes : cela suppose des sociétés qui stabilisent leur empreinte matérielle, de vivre avec un certain type d’infrastructures et de perturber le moins possible le système qui les fait vivre.
D’ailleurs, les promoteurs de la géoingénierie avouent qu’on ne pourra au mieux qu’écrêter le phénomène du réchauffement, pendant un temps assez court… ce qui est absurde, car si on atteint un réchauffement de cinq degrés au siècle prochain – conséquence d’un réchauffement de trois degrés en fin de vingt-et-unième siècle – alors cela durera selon nos modèles cinq mille ans : écrêter pour un temps court, je ne vois pas bien ce que cela signifie.
Quel rôle les acteurs publics peuvent-ils avoir afin de favoriser cette transition vers une économie authentiquement circulaire ?
Même une économie « moyennement circulaire » ne peut pas se faire sans qu’on intervienne sur la taxation des matières premières afin de rendre leur prix dissuasif, et sans que les acteurs publics investissent dans les infrastructures permettant de circulariser l’économie. Une économie circulaire qui serait une pure économie de marché, cela ne marche pas. C’est au contraire une économie qui est enchâssée dans la sphère publique, avec des acteurs publics qui organisent les choses. Et bien entendu, pour aller vers une économie permacirculaire, il faut organiser la baisse des flux de matière et d’énergie, ce qui ne peut s’entendre qu’avec une intervention des institutions publiques.
A quelle échelle faut-il imaginer une telle intervention ?
C’est tout l’objet de notre bouquin : s’il faut renverser le capitalisme pour commencer à circulariser l’économie, ce n’est pas demain la veille ! Nous proposons donc de partir de l’état actuel des économies.
Il y a trois secteurs à prendre en compte : le secteur capitalistique traditionnel, ultra dominant aujourd’hui ; le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui n’est pas négligeable ; et enfin ce qu’on appelle le secteur expérientiel, par exemple ce qui relève de l’agroécologie, certains fablabs, les éco-hameaux, etc. Notre idée c’est qu’il faut favoriser tout ce tiers secteur. On aurait donc une sorte de métavision, correspondant à ce qu’avaient par exemple proposé les Verts suisses, à savoir l’objectif d’atteindre un niveau de consommation équivalant à une planète en 2050. Cet objectif serait non négociable. En revanche, si vous êtes fanas d’écologie industrielle par exemple, ou fanas d’économie verte, alors d’accord, pas de problème. Mais ce qui nous intéresse, c’est de savoir où on en est en termes de flux à une date donnée. Si vous prétendez que c’est avec un système capitaliste échevelé qu’on y parviendra le mieux, alors prouvez-le. Nous, on contrôle et on sanctionne quand on est au-dessus des seuils visés. On peut laisser ces trois secteurs se développer dans ces conditions.
Quel impact une telle économie pourrait-elle avoir sur l’aménagement du territoire, les formes urbaines ?
Prenons l’exemple de l’éolien ou du photovoltaïque : c’est évidemment ce qu’il faut développer, mais en terme de retour sur investissement énergétique, le bilan est relativement faible. En plus, même si on a besoin de moins de métaux semi-précieux aujourd’hui dans le photovoltaïque, il en reste encore, et on est confronté à une croissance exponentielle du coût en énergie de l’extraction minière. L’énergie étant ce qu’elle est sur Terre on devrait donc disposer à l’avenir de moins d’énergie qu’on en a eu. Cela rend beaucoup plus difficile le fonctionnement des mégapoles, on devrait donc avoir un aménagement du territoire avec des mégapoles qui se réduisent, des villes moyennes qui reprennent un peu leur souffle, et peut-être aussi le redéveloppement d’une agriculture de semi-subsistance.
On a pourtant longtemps promu la densité urbaine au nom du développement durable. Est-ce qu’une économie circulaire plus résiliente supposerait moins de densité ?
De manière générale, je pense que les grandes tendances dont on dit qu’elles vont continuer – la croissance des flux, celle du PIB, le développement des mégapoles de plus en plus grandes, etc. – ne correspondent pas du tout à ce qui va se passer. On arrive à un point de bascule, un point de rupture.
C’est ce que signifie l’anthropocène : la planète va être différente – elle l’est déjà par certains aspects, mais on n’en subit encore pas vraiment les conséquences, qui vont se révéler dans les décennies qui viennent, si bien que les tendances économiques et démographiques antérieures ne pourront pas se maintenir. Si on prend l’exemple de l’agroécologie, même avec de la permaculture, il y aura forcément davantage de main d’œuvre. L’agriculture urbaine se développe, pour plein de raisons, mais on ne peut pas exclure une revitalisation des campagnes, avec des pôles urbains plus petits mais plus diversifiés ; c’est plutôt un paysage de ce type que j’imagine à l’ère de l’anthropocène, et pas du tout des mégapoles énergivores.
Pour en revenir aux difficultés de l’économie circulaire, on constate que certains secteurs comme la réparation sont paradoxalement en régression. Comment l’expliquer ?
Toute l’industrie moderne a fait en sorte qu’il n’y ait plus de réparation possible. À partir du moment où on est censé rester sur un jeu de matière constant, la logique s’inverse : il va falloir produire pour faire durer davantage, de façon plus modulaire, en imaginant des solutions de réparation à tous les niveaux. Notre idée, c’est que cette société serait tout de même une société d’activité – pas forcément de travail salarié – parce que l’inactivité est une espèce de poison destructeur. Donc une société d’activité et d’entraide.
Une de mes collègues, Sophie Swaton, a publié un ouvrage qui s’intitule « Pour un revenu de transition écologique » : elle a repris notre principe en le transformant en proposition consistante et construite. Elle envisage, en s’inspirant de l’existant, sur cette base une société d’entraide, l’idée étant de ne laisser personne seul sur le carreau. Il y aurait toujours des collectifs pour réinsérer et redonner de l’activité aux gens. Avec elle, nous proposons une société d’entraide, ne laissant personne en dehors. L’abandon des gens étant une des causes de la montée aux extrêmes.
Mais comment concilier au sein de l’économie circulaire le privé, le public et tout le secteur émergent de l’ESS ? Est-ce qu’il n’y a pas un risque de concurrence ?
Cela suppose une forme d’organisation de la société très différente. C’est ce qu’explique par exemple Eloi Laurent, en montrant que depuis 40 ans la croissance a vu ses fruits devenir des poisons les uns après les autres. C’est ce que montre également Robert Gordon : il y avait un lien entre le bien-être des gens et la croissance économique lorsque la croissance d’après-guerre se faisait sur des infrastructures et des services publics. Quand l’industrie se focalise sur la production de gadgets, cela change totalement : le sentiment de bien-être disparaît alors petit à petit, si bien que la croissance va plutôt générer du mal-être.
Mais la croissance est également supposée créer de l’emploi et favoriser la redistribution…
La croissance débouchait sur une création nette d’emplois, mais depuis vingt ans cela ne marche plus. Andrew McAfee et Erik Brynjolfsson ont par exemple montré que la croissance du PIB débouche sur une destruction nette d’emploi. Et la nouvelle vague numérique devrait plutôt accentuer le phénomène. Enfin, la croissance permettait de réduire les inégalités, mais depuis dix ans au moins, ce n’est plus le cas – les États-Unis sont revenus au niveau d’inégalités qui était le leur avant la grande vague de croissance de plus de 2 % qui commence en 1920. Donc on ne doit plus piloter l’économie comme on la pilotait avant, il faut la piloter en regardant les vrais indicateurs (qui ne sont pas purement monétaires) et il faut aussi avoir une action monétaire : surtaxer les produits les plus impactants sur l’environnement, taxer les robots car ce sont des facteurs de production, taxer les ressources, etc.
Quels messages prioritaires faut-il aujourd’hui faire passer sur l’économie circulaire ?
On n’a pas le choix pour éviter une catastrophe : au mieux, si on est très vertueux dès aujourd’hui, on atteindra 2,5°C de réchauffement climatique à la fin du siècle, ce qui suppose 4°C pendant les cinq mille années qui suivront. Donc, on n’évitera plus la catastrophe. Par contre, on peut éviter une sur-catastrophe. Nous avons environ dix à vingt ans pour essayer de changer de cap. L’économie circulaire est donc une façon de redonner une signification et des finalités d’ensemble à toutes sortes d’instruments isolés les uns des autres. L’économie circulaire permet de reglobaliser, ou de refaire le lien entre nos actes de production et de consommation et les grands enjeux globaux. C’est une expression facile à comprendre pour beaucoup de gens, elle peut aider à mobiliser, mais à condition qu’on ne la dévoie pas et qu’on imagine bien la circularité à l’échelle du globe et pas seulement à l’échelle d’un site de production.
○ Retrouvez ICI l'intégralité du dossier Économie circulaire : au-delà du recyclage, comment transformer l’économie ?

Article
Poursuivez votre découverte des enjeux de l’économie circulaire, avec nos conseils de lecture.
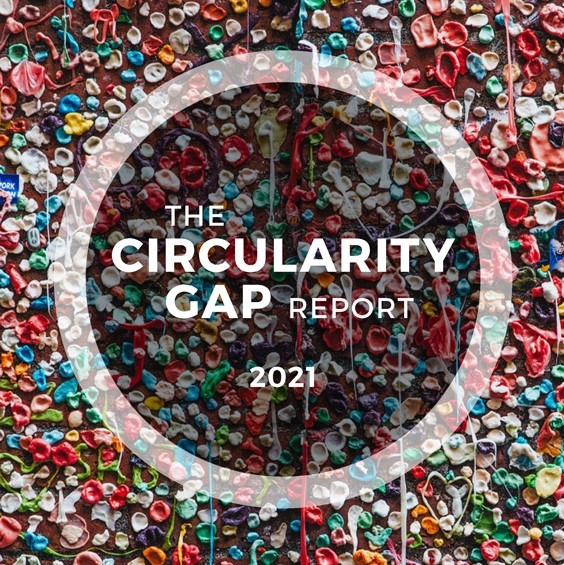
Article
Enseignements tirés de l’édition 2021 du « Circularity Gap Report », publication de référence en matière de circularisation de l’économie mondiale.

Article
Croissance économique ou respect de l’environnement ? L’économie circulaire nous propose de sortir de ce dilemme, pour le meilleur et pour l’avenir.

Article
Alors que l’économie circulaire est de plus en plus reconnue comme une évolution nécessaire de nos modes de production, sa mise en œuvre se confronte encore à certains obstacles.
.jpg)
Article
Découvrez les forces et faiblesses des quatre approches principales de l’économie circulaire, telles que débattues dans les sphères académique, politique et économique.

Étude
Evaluer l'empreinte matérielle des importations pour mieux cerner le niveau de dépendance extérieure de l'économie lyonnaise et identifier les flux d'importations générant les principales vulnérabilités et opportunités pour l'économie lyonnaise.

Étude
La place incontournable des flux de ressources naturelles dans le processus de création de richesses amène à poser la question de leur soutenabilité.
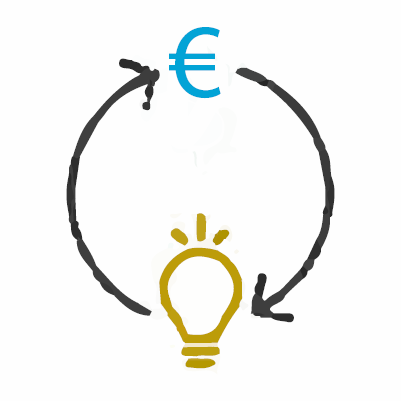
Étude
Et si on rallongeait la vie des produits tout en diminuant nos besoins en matières premières !....Tendances prospectives.

Interview de Dominique Bourg
Professeur à la faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne
"Le problème est que la quantité de flux de matières et d’énergie que l’on connaît aujourd’hui nous a amenés à dépasser les limites planétaires et à créer des irréversibilités"

Interview de François Grosse
Président et co-fondateur de Forcity
"L’économie circulaire suppose une transformation profonde de la société "

Interview de Philippe Bihouix
Ingénieur spécialiste de la finitude des ressources minières
« Le low tech, c’est davantage une démarche centrée sur la question des ressources et de leurs limites »

Interview de Alexandre Monnin
Directeur du POPSU Transition Nice Côte d'Azur, Membre du comité scient. de CY École de design et France Villes et territoires Durables
Arrivés aux limites du système terre, et si nous nous intéressions maintenant à cet espace oublié : ce qui est à garder, ce qui reste ?
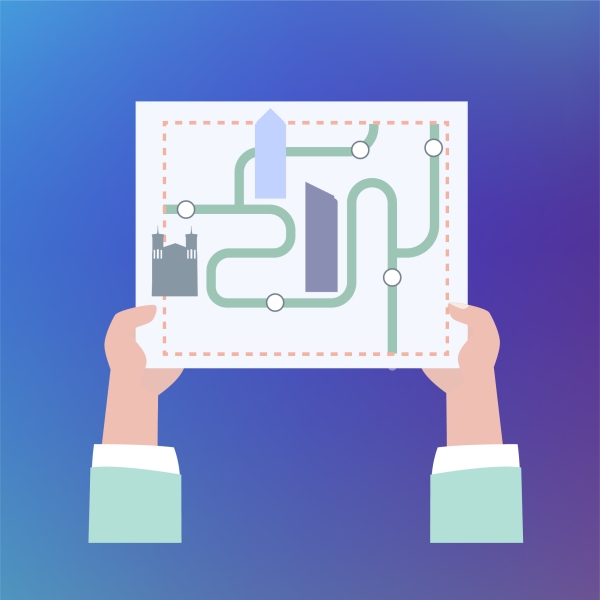
Article
Entre soutenabilité et exploitation des ressources, chaque décision ouvre la porte à un dilemme !
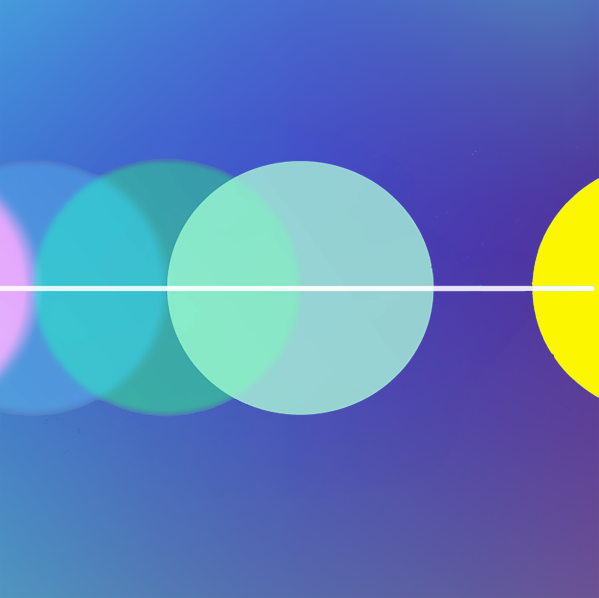
Dossier
Ce dossier donne de premières clefs pour interroger de manière lucide les leviers de transformation de nos entreprises et de leurs modèles.

Article
La pollution de l'eau pourrait coûter très cher à la société.

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?

Article
Pollueur-payeur : un outil efficace contre la pollution de l’eau et les micropolluants ?

Article
Plongée dans les profondeurs d’un modèle économique où les mots « commun » et « besoin » sont remplacés par « offre » et « demande ».

Interview de Jacques Mathé
Économiste
"Le territoire est porteur d’une image qui peut accroitre la valeur immatérielle des produits qui en sont issus".

Interview de Michel H. Shuman
Expert du développement économique local
« Tout l’enjeu est de développer les instruments financiers permettant de faciliter et sécuriser l’investissement de l’épargne locale dans les entreprises locales ».