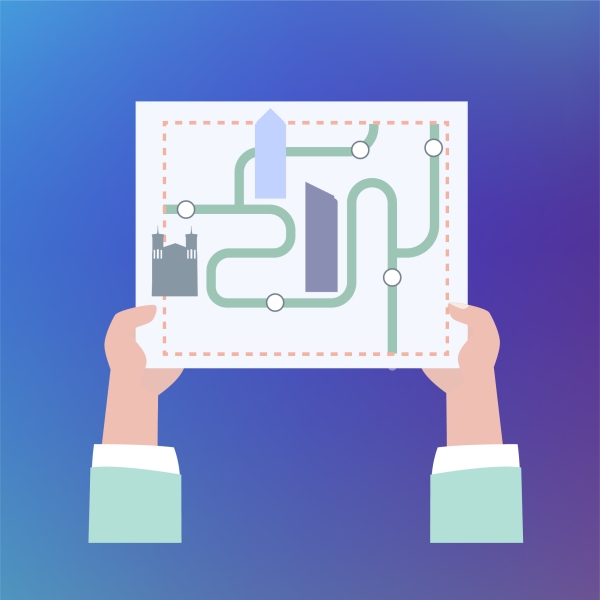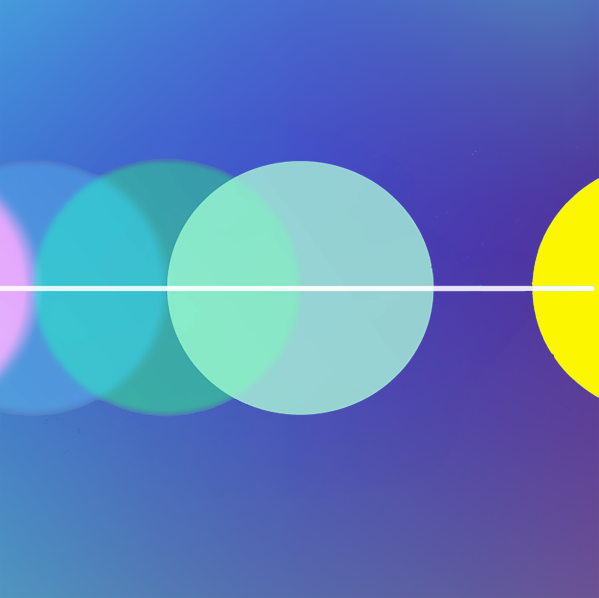De mon point de vue, on peut distinguer quatre principaux enjeux. Le premier est celui de l’échelle. Beaucoup d’expérimentations intéressantes démontrent aujourd’hui la viabilité de nouvelles approches à petite échelle en matière de production, distribution, services et vente d’alimentation dans les villes. Néanmoins, un trop grand nombre de ces initiatives a été développé en tant que projets à but non lucratif ou la question de l’équilibre financier et la réalisation de bénéfices est pensée après coup. Il est nécessaire de passer de projets informels à des entreprises solidement construites, capable de dégager les ressources nécessaires à leur développement. Nous sommes dans la même situation que lorsque Thomas Edison a inventé les ampoules, avant l’apparition de General Electric et Westinghouse. Les personnes menant ces expérimentations doivent désormais se penser comme des entrepreneurs en capacité de développer massivement leurs activités dans beaucoup d’endroits.
Le second enjeu clé est celui de l’entrepreneuriat. De nombreux innovateurs dans l’alimentation locale se positionnent comme des pionniers sociaux mais pas en tant qu’entrepreneurs. Ils leur manquent les compétences et le cadre de pensée pour s’inscrire dans une logique entrepreneuriale sans laquelle leur projet peut rencontrer des difficultés pour se pérenniser, se développer et atteindre pleinement ses objectifs. Seuls quelques-uns développent ces compétences naturellement dans leur travail. Certains sont assez intelligents pour recruter des hommes d’affaires pour les assister mais la plupart se contente de rester des bricoleurs. Nous avons besoin de systèmes de formation permettant de transformer ces pionniers sociaux en entrepreneurs. Or, la plupart des écoles de commerce forment des managers pour des grosses entreprises, mais pas des entrepreneurs de petites entreprises. J’ajoute que la plupart des pionniers sociaux manquent de temps ou de ressources pour suivre une formation diplômante en entrepreneuriat.
Troisièmement, le capital. Les systèmes de capitaux sont défavorables aux petites entreprises locales. Les dirigeants de ces institutions croient, incorrectement, que ces entreprises (notamment les entreprises alimentaires, par opposition aux entreprises high-tech) ont un faible potentiel de profits. Mais ils préfèrent aussi, ce qui est compréhensible, effectuer une diligence raisonnable pour un gros emprunteur plutôt que pour 1 000 petits. Presque tous les éléments d'un écosystème sain de capitaux - banques, titres, bourses, fonds, investissements institutionnels - doivent être réinventés. Les lois, les politiques, les programmes et les pratiques doivent être révisés.
J’observe qu’aux États-Unis les politiques publiques sont systématiquement orientées vers les grandes entreprises non locales. La plupart des développeurs économiques croient, malgré toutes les preuves du contraire, que la clé de la prospérité est d'attirer et de conserver de grandes entreprises sur le territoire. Dans le domaine de l'alimentation, ces entreprises incluent les fermes industrielles, les grands fabricants de produits alimentaires, les chaînes d'alimentation et de restauration. La version « dure » de l'attraction / rétention consiste à verser de l'argent aux entreprises sous forme de subventions, de prêts, de garanties de prêt, d'améliorations de l'infrastructure et d’allègements fiscaux. La version « douce » consiste à fournir une aide en nature avec, par exemple, le développement de la main-d'œuvre, du logement et de l'infrastructure. Les limites de cette approche sont bien établies. Les promesses faites sont rarement tenues. Les coûts sont plus élevés que prévu. La corruption et le secret sont courants. Et les coûts d'opportunité – les entreprises locales apportent plus de bons emplois pour moins d'argent - sont perdus. D’une manière générale, tous ces soutiens apportés aux grandes entreprises rendent les petites entreprises locales relativement moins compétitives. De plus, il existe de nombreuses politiques locales très spécifiques qui font obstacle aux entreprises du secteur alimentaire : les restrictions de zonage qui limitent l'agriculture urbaine ; les exigences de licence qui ralentissent leurs lancements ; des règlements en matière de santé et de sécurité plus adaptés pour les grandes entreprises qui peuvent se permettre les contrôles nécessaires ; des règles d'approvisionnement qui favorisent les offres non locales.