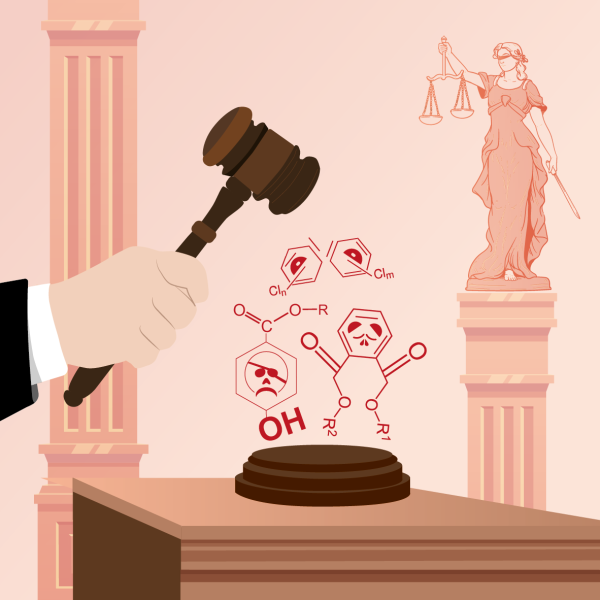Le secteur public s’est fortement déployé à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, une longue séquence de privatisations et d’ouvertures à la concurrence s’est étendue sur deux décennies jusqu’au début des années 2000. Actuellement, nous ne sommes plus à l’ère de grands mouvements structurels. La vague des privatisations dans les télécoms et les énergies des années 1980 à 2000 est close, avec la cession par l’État du gaz et de l’électricité.
Depuis, nous observons un statu quo au niveau national, ponctué d’actions pragmatiques des pouvoirs publics, comme l’illustre la renationalisation d’EDF pour des raisons non idéologiques. L’objectif alors était de résoudre des problèmes énergétiques et de réduire un mur de dettes lié aux erreurs de l’ouverture à la concurrence.
Aujourd’hui, nous sommes entrés dans un âge de maturité. La société a pris conscience que la privatisation et que l’ouverture à la concurrence ne constituent pas des solutions universelles. Dans le transport, par exemple — les chemins de fer plus précisément, qui n’a jamais été un secteur bénéficiaire et qui ne le sera sans doute jamais —, le fait de confier la gestion au privé se traduit soit par une hausse marquée des tarifs, soit, à l’inverse, à une dégradation du service. Dans les deux cas, les objectifs des politiques publiques de faciliter les voyages en train sont mis en échec.
Certains pays ont donc fait d’autres choix. En Angleterre, par exemple, les chemins de fer ont commencé à être renationalisés en novembre 2024. La South Western Railway a été la première compagnie à être reprise par l’État britannique et d’autres suivront d’ici 2027, avec une double ambition : améliorer la performance du réseau ferré et permettre aux contribuables d’économiser 3 milliards d’euros par an.
En France, un mouvement comparable s’observe à l’échelle locale. Un phénomène de « remunicipalisation » est en cours, particulièrement pour la gestion de l’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées. Ce courant est assez étonnant dans notre pays, puisque la France, contrairement à ses partenaires européens ou aux États-Unis, n’avait jamais nationalisé l’eau au 19e siècle.
Ce secteur était resté traditionnellement aux mains d’acteurs privés. Or, aujourd’hui, de nombreuses municipalités, comme Paris ou Grenoble, ont repris la gestion directe le service des eaux, pour garantir un service public efficace et de qualité. Cette remunicipalisation a d’ailleurs favorisé la baisse des prix.
Dans le même temps, on observe des dynamiques inverses, comme l’ouverture du transport en commun à la concurrence par la Région Île-de-France, qui met fin au monopole historique de la RATP. D’abord les bus en 2021, puis le Transilien en 2025, le tramway en 2031, jusqu’au métro de Paris à plus long terme en 2040. Là encore, l’idée est d’améliorer la qualité de service et la couverture horaire et territoriale, mais cette fois par l’intervention d’opérateurs privés.