Le rapport des Français à l’autorité, à la fraude et à la surveillance

Article
À qui fait-on confiance ?
Interview de Alain Eraly

Sociologue et économiste belge, Alain Eraly est professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles (ULB), membre de l’Académie royale de Belgique. Il est l’auteur de Autorité et légitimité. Le sens du collectif (2015), de Une démocratie sans autorité ? (2019), et avec le psychiatre et psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, de Réinventer l’autorité. Psychanalyse et sociologie (2021).
Ancien directeur de cabinet du ministre chargé de la Mobilité et de l’aménagement et de l’urbanisme à la Région bruxelloise, il a par ailleurs présidé un groupe de travail relatif à la gouvernance des établissements scolaires lors de l’élaboration du Pacte pour un enseignement d’excellence.
Dans cet entretien, il nous expose le cadre dans lequel il cherche à renouveler la réflexion sociologique sur l’autorité. Émanent d’une forme de légitimité, ne peut-elle pas être comprise comme un outil de construction du collectif ?
Comment la question de l’autorité s’est-elle imposée dans vos recherches ?
De trois façons. D’abord, j’ai assumé une série de responsabilités dans diverses institutions, les plus marquantes étant la gestion des ressources humaines de ma propre université, l’ULB, et la fonction de directeur de cabinet d’un ministre. J’ai pu constater, sur le terrain, l’extrême difficulté d’exercer l’autorité. Ensuite, et depuis une trentaine d’années, j’associe à mon enseignement à l’université et à ma recherche une pratique de formation, de consultance et d’intervention dans les secteurs public et privé associatifs.
Au fil du temps, j’ai dû côtoyer plus d’un millier de responsables de toutes les sphères : la police, les écoles, les hôpitaux, les administrations, etc. Et ce qui m’a frappé, c’est la convergence des problèmes auxquels ils étaient confrontés. Beaucoup d’entre eux exprimaient une profonde perplexité, quelquefois des peurs, de l’anxiété, de l’amertume. Bien sûr, chacun d’eux le vivait à sa manière jusqu’au point de se remettre en question et parfois de perdre confiance en soi.
Mais pour l’observateur extérieur que j’étais, la convergence des témoignages était évidente. J’en ai conclu qu’il y avait là les signes d’un malaise contemporain concernant l’autorité — d’un malaise qui dépasse largement ce que peuvent nous enseigner les théories psychologiques du leadership ou du charisme. En réalité, il m’apparaissait que tous ces responsables, dans leurs milieux respectifs, avec leur biographie et leur style propres, affrontaient une même problématique.
Plus récemment, mon travail d’accompagnement de la réforme du système scolaire belge francophone, qui concerne 2 500 établissements, a été une troisième source d’inspiration. Je passe beaucoup de temps avec les directions d’écoles, les fonctionnaires de l’administration scolaire et quelquefois les parents.
L’école est un lieu d’observation très intéressant, une sorte de poste avant-coureur des évolutions sociétales. Là encore, j’ai été frappé par les difficultés, la perplexité, parfois le désarroi des enseignants et des directions d’école. La question de l’autorité m’est finalement apparue comme une question centrale.
Vous avez consacré trois ouvrages à la question de l’autorité, Autorité et légitimité. Le sens du collectif, puis Une démocratie sans autorité ?, et enfin Réinventer l’autorité. Psychanalyse et sociologie. Forment-ils des jalons dans votre réflexion ?
Le premier, vous allez sourire, a été écrit alors même que j’avais pour projet d’écrire le deuxième. Parti pour décrire la crise de l’autorité, il m’est apparu que je devais commencer par définir clairement ce qu’est l’autorité. Et c’est en cherchant à clarifier le concept que j’en ai découvert l’incroyable complexité, en particulier l’infinie diversité des formes d’autorité selon les époques, les cultures, les mondes sociaux.
Un paysage immense s’ouvrait devant moi et j’ai pris conscience qu’il me fallait consacrer un premier livre entier à comprendre le phénomène de l’autorité, avant d’aborder la crise de l’autorité qui traverse le monde occidental. Dans ce premier livre, j’ai interrogé prioritairement l’anthropologie. Que nous disent les anthropologues sur l’autorité ? Quelles formes prend-elle à travers les époques et les sociétés ? Ce n’est qu’armé intellectuellement de ce premier exercice de clarification que j’ai pu aborder la question de la crise de l’autorité.
Le troisième livre est issu de la proposition de Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste, qui, dans l’intimité de son cabinet, est lui-même confronté tantôt aux difficultés vécues par les personnes qui occupent, comme parents ou dans le cadre de leur travail, des positions d’autorité, tantôt à celles des patients qui souffrent d’avoir été privés, dans leur enfance, d’une autorité parentale digne de ce nom. En partant de ces points d’observation différents, nous nous sommes lancés dans un dialogue autour de la possible réinvention de l’autorité.
Quelle est votre définition de l’autorité ?
Nous confondons constamment des termes comme autorité, pouvoir, domination, emprise, et cette confusion est le signe même de la crise de l’autorité ; beaucoup de nos contemporains ne comprennent même plus ce qu’elle recouvre !
Avant d’en arriver à une définition, laissez-moi commencer par une intuition à laquelle nous ne songeons pas nécessairement. Toute institution, le mariage, la famille, l’école, l’administration, la justice sont muette — seuls les êtres humains parlent. Pour qu’une institution existe, elle doit posséder un pouvoir de parole.
L’institution du mariage, par exemple, suppose qu’une personne autorisée, devant une assemblée, prononce les mots : « Je vous déclare unis par les liens du mariage ». S’il n’y a pas quelqu’un qui parle au nom de l’institution du mariage, il n’y aura pas mariage.
De même, si la justice n’est pas dotée d’un pouvoir de parole, s’il n’y a pas un juge pour énoncer la sentence, l’institution judiciaire n’existe pas. Toute institution doit s’incarner dans des êtres parlants. À partir de cette intuition, on peut proposer une première définition : l’autorité est le pouvoir et la légitimité de parler au nom de l’institution. Qui dit institution dit autorité.
Vous invitez à sortir de l’abstraction : il n’y a pas d’autorité de l’État, par exemple sans des personnes qui parlent en son nom.
Exactement. Une autorité est nécessairement incarnée — incarnée dans une personne ou dans un groupe. Dans la théorie restrictive que je défends, l’État lui-même doit s’incarner. Parler de l’autorité de l’État, c’est nécessairement parler de l’autorité de ceux qui l’incarnent. Lorsque nous parlons d’autorité, nous parlons nécessairement de l’incarnation d’institutions telles que l’État, la justice, l’armée, l’université. En l’absence d’incarnation, on peut appliquer le terme à tout et n’importe quoi.
On parlera d’autorité des marchés ou d’autorité de la technologie, des formulations qui n’ont pour moi aucun sens. Il y a d’autres concepts pour qualifier la prédominance de certains phénomènes ; on peut parler de l’influence des marchés, de la domination des technologies, mais certainement pas de leur autorité. L’autorité est avant tout la parole légitime au nom du collectif et c’est une évidence, toute parole émane d’un corps parlant.
L’autorité est avant tout une légitimité, la légitimité d’une personne qui occupe une position d’exception. Partout des positions reconnues confèrent ce droit à parler au nom d’un collectif : parler au nom d’une école, d’une classe, d’un hôpital, d’un service de l’hôpital, d’une église, d’un groupe de scouts, d’une entreprise.
Même lorsqu’une telle position n’existe pas, au sein d’un groupe informel, par exemple, vous observez que si le groupe se trouve confronté à un problème, une personne finit par émerger et devient en quelque manière son porte-parole. Et là où cela ne se produit pas, le groupe lui-même se désagrège, il ne parvient pas à s’instituer en tant que groupe.
Liée à cette position d’exception, il y a toujours un rôle à assumer, une fonction à accomplir. Exercer l’autorité, c’est transcender les intérêts personnels au nom du collectif. C’est un point fondamental. Celui qui exerce l’autorité assume un rôle et il le fait toujours au nom d’un intérêt qui le dépasse et qui dépasse son vis-à-vis. L’autorité s’exerce au nom d’un groupe, d’une communauté de valeurs, de lois qui vont au-delà de celui qui les porte. En l’absence de cette légitimité, mieux vaut parler de pouvoir ou de coercition. En somme, l’autorité est la légitimité d’une parole qui transcende les intérêts personnels.
Une autorité se définit-elle aussi par son pouvoir de sanction ?
C’est une question plus complexe qu’il n’y paraît. Dans mon premier livre, je décris des sociétés dans lesquelles l’autorité a été totalement ou presque totalement dissociée du pouvoir de sanction, ce pouvoir étant assumé par d’autres membres. Dans ce cas, l’autorité assume avant tout une fonction rituelle et symbolique.
Dans nos sociétés occidentales, cette séparation radicale est assez rare, mais je voudrais rappeler qu’en Belgique, nous avons un roi qui exerce une autorité de représentation symbolique et ne détient aucun pouvoir exécutif ou judiciaire.
Tout au plus a-t-il une influence discrète lors de la formation du gouvernement fédéral. Mais en dehors de ces cas limite, le pouvoir de sanction forme l’horizon nécessaire de l’autorité. L’autorité étant garante des valeurs, des lois, des règles du groupe, il vient toujours un moment où quelqu’un transgresse une norme essentielle, mettant l’autorité au pied du mur.
Il n’y a pas d’autre choix pour elle que de rappeler la règle et, le cas échéant, de sanctionner le contrevenant — à tout le moins de déclencher le processus de sanction. Pour cette raison, il est trompeur d’opposer, comme on le fait souvent, l’autorité et le pouvoir, l’un comme charisme et l’autre comme sanction : la sanction, je le répète, est l’horizon nécessaire de l’autorité.
Vous relevez plusieurs grandes dynamiques sociohistoriques qui mettent l’autorité en situation de crise. Pouvez-vous les préciser ici ?
Au fil de ma réflexion et de mes lectures, il m’est apparu que je pouvais distinguer plusieurs composantes dans cette crise de l’autorité — disons des pistes d’analyse. Cette crise me semble liée avant tout à notre modernité démocratique. Je précise que mon analyse de la crise de l’autorité est centrée sur l’Occident, mais que cette crise dépasse le monde occidental.
Nous l’observons dans des pays comme la Chine, en Afrique du Nord, ou encore dans la société iranienne, qui est travaillé par des valeurs d’égal respect et de liberté qui poussent notamment les femmes à remettre en cause l’autorité patriarcale et cléricale.
La première composante de cette crise de l’autorité, je l’ai appelée le reflux de la transcendance. Toute autorité suppose d’incarner une figure du collectif et d’exercer un pouvoir en son nom, elle implique donc une forme de transcendance. Cette transcendance qui s’impose à l’individu a longtemps été de nature divine avant de se reporter sur le collectif : transcendance de la Nation, des Valeurs de la République, de la Loi avec un grand « L » ou même de l’Entreprise en tant que communauté.
Dans ma jeunesse, j’ai encore connu cette transcendance de l’entreprise, le sentiment d’appartenance et de loyauté qu’elle pouvait générer, l’esprit maison, comme on disait, la culture d’entreprise, l’identité professionnelle, tous ces phénomènes qu’étudiaient les psychosociologues et qui se sont largement estompés au cours des dernières décennies.
Quel rapport avec l’autorité ? L’autorité pouvait s’exercer naturellement au nom du Collectif — au nom de cette puissance qui s’imposait aux individus. C’est encore cette transcendance, celle de la Nation, qui permet à Margaret Thatcher d’envoyer des soldats aux Malouines en disant : « L’Angleterre vous sera éternellement reconnaissante ». C’est elle encore qui permet aujourd’hui d’envoyer des djihadistes à la mort au nom de Dieu.
C’est elle toujours qui subjugue et transcende une nation entière comme l’Ukraine. Au fil du 20e siècle, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, et plus encore après Mai 1968 qui marque le passage à ce que certains philosophes appellent la modernité radicale, ou la surmodernité, la transcendance n’a cessé de refluer.
Le triomphe de l’individualisme libéral centré sur les intérêts de l’individu et de l’individualisme psychologique dans lequel le collectif tend à se réduire à l’interpersonnel, c’est-à-dire au lien entre des individus, contribue puissamment à ce reflux de la transcendance. Un reflux qui prive les dirigeants, les responsables à tous niveaux, de la possibilité d’exercer un pouvoir « naturel » au nom du collectif. Telle est, me semble-t-il, la première dimension de la crise de l’autorité. Marcel Gauchet a beaucoup écrit sur ce thème.
La deuxième dimension est proche de la première, c’est la crise de la représentation du collectif, une crise que des philosophes du politique comme Pierre Rosanvallon ont bien cernée. Ce n’est pas seulement que le collectif ait perdu l’essentiel de sa transcendance, c’est aussi que nous avons de plus en plus de mal à nous le représenter. Nous ne savons plus à quoi nous appartenons.
Pouvez-vous donner des exemples ?
Qu’est-ce par exemple qu’une entreprise ? Mes parents en avaient encore une représentation très claire : un patron, une structure hiérarchique, des salariés, des métiers typiques, un espace délimité, un dedans et un dehors, une marque, des produits.
Aujourd’hui, il est encore possible de se représenter une PME, mais qu’est-ce qu’une grande entreprise ? Renault ne fabrique plus elle-même que 20 % des composants de ses voitures, tout le reste est sous-traité dans un vaste réseau de relations de sous-traitance à l’échelle du monde entier. Comment construire un « nous » à l’intérieur d’un complexe de relations d’interdépendances ?
Partout, les institutions perdent en lisibilité et en sentiment d’appartenance : la construction du « nous » y devient précaire. L’État lui-même s’est prodigieusement complexifié, ne cessant de diversifier ses structures et ses modes d’action, au point qu’il devient difficile pour un chercheur en sciences politiques de savoir où il commence et où il s’arrête, et même pour un ministre de mesurer exactement les structures qu’il chapeaute, donc l’étendue de son pouvoir.
Si l’on ajoute à cela que nos sociétés n’ont cessé d’ajouter des niveaux de pouvoir, du local et du régional aux organisations internationales, on atteint une complexité qui dépasse les capacités de représentation du citoyen. Ce déficit de représentation du collectif est au cœur de la crise de l’autorité.
D’autres phénomènes encore y contribuent, comme la diversité et la mobilité. Un collectif suppose un minimum d’homogénéité, d’intercompréhension et de stabilité d’appartenance. Par exemple, la Région bruxelloise ne compte pas loin de 180 nationalités différentes, et la mobilité touche toutes les catégories de population et pas seulement les fonctionnaires européens. Comment dire « nous » pour désigner une telle communauté urbaine ?
Comment construire un espace public commun, un sentiment d’appartenance dans un contexte de ghettos urbains et de fragmentation médiatique qui permet aux différentes communautés de s’ignorer les unes les autres — qui permet aux Turcs, aux Marocains, aux Portugais, etc., de ne regarder que la télévision turque, marocaine, portugaise, de ne fréquenter que les réseaux sociaux dans leur langue, etc. Cette fragmentation du monde commun n’est pas sans conséquence pour la crise du collectif !
Voyez-vous d’autres valeurs issues de la modernité démocratique qui mettent à mal l’autorité ?
Oui, nos sociétés démocratiques sont travaillées par une valeur fondamentale : l’autodétermination. Initialement, l’autodétermination a été pensée comme pouvoir du peuple souverain sur la puissance publique. La collectivité est la source ultime des lois et des décisions qui la gouvernent, et les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques. Le préalable du consentement populaire s’étend désormais à chaque décision publique et voue nos sociétés à une interrogation permanente sur la légitimité, donc à une remise en cause perpétuelle.
Le travail de justification devient permanent, comme le flot des critiques qui accompagne les moindres décisions, et cela pour une raison simple : il est impossible de soumettre toutes les décisions publiques au consentement populaire. Il y a trop de décisions, et ces décisions sont trop complexes, outre que nombre d’entre elles doivent être prises dans l’urgence et dépendent du contexte international.
Les acteurs politiques ont beau publier leur programme, expliciter leurs intentions durant la campagne électorale, dès qu’ils annoncent, une fois en poste, leurs premières décisions, c’est l’éternel concert des protestations qui se lève : « Au nom de quoi ? De quel droit ? C’est un scandale ! » Cela conduit bien des dirigeants à une fatigue nerveuse qu’on sous-estime.
Mais surtout, cette logique de l’autodétermination ne conditionne pas seulement l’exercice de l’autorité politique, elle tend à se diffuser dans des sphères jusqu’alors régies par des formes d’autorité plus traditionnelles, comme la famille, l’école, l’administration, l’entreprise, l’Église ou même l’armée.
Il en résulte un flux permanent de remise en cause et de contestation. La position hiérarchique ne suffit plus : les gens ne se sentent plus tenus d’obéir loyalement à une décision qui leur est imposée sans consultation formelle et sans justification. Pour le meilleur et quelquefois pour le pire, la valeur d’autodétermination induit une disposition presque mécanique de chaque citoyen, de chaque salarié, à rejeter ou critiquer toute mesure à laquelle il n’a pas participé.
Partout le même concert : « On nous impose ceci sans nous demander notre avis », « je n’ai pas été consulté », « je n’ai pas donné mon accord ». Dans les familles aujourd’hui, on voit des enfants exiger de participer aux choix des repas ou des vacances.
L’aspiration à l’autodétermination est donc une aspiration sans fin et je m’excuse de devoir le dire, une aspiration largement abstraite et irréaliste. Un citoyen dans son pays ou dans sa ville, un salarié dans son entreprise, un professeur dans son université, un médecin dans son hôpital ne peuvent prétendre participer à l’ensemble des décisions pour la raison simple qu’ils n’ont ni le temps ni la compétence ni souvent la motivation de le faire — ce qui n’exclut pas de mettre sur pied des assemblées citoyennes, des comités de quartier, des conseils consultatifs pour certaines décisions.
S’il avait fallu gérer démocratiquement la crise du Covid, autrement dit si l’on en était passé par le débat et le consentement populaire, combien de centaines de milliers de morts aurions-nous connues ? Dans un pareil contexte, les autorités publiques, s’appuyant sur l’avis des experts, devaient décider très rapidement. Bien sûr, pour nombre de citoyens, un tel pouvoir s’apparentait à la dictature.
L’individualisme contemporain est souvent mentionné quand il s’agit d’expliquer pourquoi l’autorité est contestée. Notamment quand il prend la forme d’une aspiration à être maître de ses choix.
Quelles sont ces valeurs de l’individualisme contemporain dont nous sommes les héritiers — des héritiers d’ailleurs très heureux et fiers de l’être ? Je me borne aux plus centrales, celles qui sont au cœur de notre modernité démocratique. D’abord l’égalité en droit et l’égal respect. L’égal respect commande nos jugements les plus spontanés, il s’enracine dans le droit comme dans les mœurs, il nous enjoint de traiter chacun avec la même considération, les mêmes égards, la même civilité, qu’il soit enfant ou vieillard, riche ou pauvre, ministre ou mendiant.
Rien ne blesse davantage nos sentiments que les passe-droits, les dénis de justice, les expressions de supériorité sociale, d’arrogance, de déni, de mépris : « Pour qui se prend-il ? Tu as vu comment il me parle ? Cette façon qu’il a de prendre les gens de haut ! » Selon le premier article de la Déclaration universelle des droits humains : « Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit ». L’égalité en droit et l’égal respect sont deux valeurs essentielles auxquelles nous sommes viscéralement attachés.
Intimement liée au respect, l’autonomie est une autre valeur clé de la modernité : le pouvoir de décider par soi-même de s’organiser, de prendre des initiatives, de faire des propositions, de partir de sa libre volonté pour mener son existence et contribuer à la vie collective, de se réaliser. En témoignant du respect aux autres, nous les reconnaissons implicitement comme les auteurs, au moins potentiels, de leurs paroles et de leurs actes. Et qui dit autorité dit responsabilité : le fait d’assumer les actes et les conséquences des actes dont nous sommes les auteurs.
À ces valeurs fondamentales, on peut encore ajouter la reconnaissance comme valorisation de l’individu : à la fois la reconnaissance que l’on témoigne aux personnes pour des paroles, des actions, des accomplissements, des qualités, des mérites qui les distinguent des autres et l’empathie comprise comme la faculté de reconnaître la situation d’autrui, ses émotions, ses difficultés, et de lui manifester cette compréhension. Ou encore l’équité comme juste rapport des contributions et des rétributions, des actes et des sanctions.
Et finalement, la discussion, comme le droit d’être informé, d’être écouté, de donner son avis, de participer à la décision, de trancher les questions litigieuses par des échanges d’arguments rationnels plutôt que par des arguments d’autorité (une valeur très liée à l’autodétermination).
Ces quelques valeurs qui forment notre héritage démocratique le plus précieux, on comprend qu’elles mettent constamment l’autorité au défi, qu’elles en contraignent l’exercice, qu’elles s’y opposent potentiellement. L’égalité en droit délimite strictement ce que le pouvoir peut nous imposer. L’égal respect suppose une égalité de statut et de considération qui s’oppose potentiellement à l’asymétrie de la relation d’autorité. L’autonomie nous incite à n’obéir qu’à nous-mêmes et à vivre toute espèce d’ordre et de consigne comme une atteinte à notre liberté.
La reconnaissance est une aspiration à être reconnue dans sa singularité indépendamment des normes du groupe. L’empathie requiert de l’autorité une attitude de compréhension qui n’est pas toujours en adéquation avec les exigences des règles et du travail. Quant à l’équité, elle prédispose les membres du groupe à se comparer sans cesse les uns aux autres, à l’affût des moindres différences, dès lors vécues comme des injustices. Cette brève analyse nous permet de comprendre en quoi les valeurs de l’individualisme contemporain, qu’on appelle parfois « droits moraux », sont susceptibles de « travailler » l’autorité, de la mettre en cause en permanence, et finalement de l’épuiser.
En quoi poser comme valeur intangible que tous les êtres humains naissent égaux en dignité, ce que vous nommez l’égal respect, remet-il en cause l’autorité d’une institution, quelle qu’elle soit ?
Soit un exercice très simple que j’ai eu l’occasion de réaliser près d’une quarantaine de fois dans des institutions publiques de tous types. Je rassemble les participants par groupes de trois et leur demande de réfléchir à des situations typiques de travail qui ont l’heure de susciter leur indignation. Ensuite, de quoi, je leur demande de partager ces situations avec le reste du groupe en nommant la valeur qui, à leurs yeux, a été transgressé. L’indignation est en effet le signe même qu’une valeur a été transgressée. Eh bien, la question de l’égal respect et de la reconnaissance arrive toujours en tête !
Cette question du respect et de la reconnaissance est obsédante. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, recevoir un ordre est vécu comme une forme d’irrespect ou d’humiliation — le seul fait d’ailleurs de se trouver dans une relation asymétrique peut déjà être vécu comme humiliant. En exacerbant la valeur d’égal respect, nos sociétés ont simultanément étendu le champ de l’humiliation potentielle et de la violence symbolique. Pour les cinquante années qui viennent, sauf retour à la barbarie, cette question-là ne cessera de travailler nos sociétés.
Regardez aujourd’hui, en France en particulier, la récurrence très édifiante — et je m’empresse de dire très légitime — de la mise en cause de l’autorité dans le monde culturel, artistique, cinématographique, la mise en lumière des abus de pouvoir en général, et du harcèlement sexuel en particulier.
Tout récemment, et pour la première fois, des grands acteurs et réalisateurs, des artistes se sont retrouvés devant une commission d’enquête parlementaire pour répondre des violences endémiques dans le monde du cinéma, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Les uns à la suite des autres, ils ont été sommés de s’expliquer sur ces sujets.
Toutes les institutions, dont l’Église, affrontent la puissance des valeurs d’égalité en droit, d’égal respect et d’autonomie, et toutes les formes d’emprise sont dénoncées, qu’elles soient d’origine amoureuse, artistique, religieuse, psychanalytique, sportive, médicale, scientifique, etc. Les affaires s’enchaînent presque journellement, et cela depuis des années.
On s’indigne que la justice ne soit pas toujours au service de l’égalité en droit, on dénonce les responsables qui, sans avoir commis d’abus eux-mêmes, ont préféré ne rien savoir, fermer les yeux, camoufler les scandales. Partout, l’autorité est mise en cause. Comme si nos sociétés avaient choisi collectivement de se hisser pour de bon au niveau des idéaux et des valeurs qu’elles se sont historiquement données. Cette vague de fond est assurément un fait de haute civilisation, mais elle a des effets dévastateurs sur l’autorité.
Pour autant, devons-nous en conclure que le moment est venu de se passer carrément de l’autorité s’il est vrai que les abus sont légion et que toute asymétrie est potentiellement humiliante ? Ce serait là commettre une erreur majeure de raisonnement. Tous ces bouleversements ne prouvent pas que nous puissions nous passer de l’autorité, seulement que nous avons besoin d’une autre autorité ! D’une autorité qui est la garante des valeurs.
Du reste, toutes les voix, tous les mouvements qui s’élèvent pour protester contre les abus s’adressent bel et bien à une autorité : celle des juges, celle d’une commission parlementaire, celle des dirigeants des institutions, celle des hauts responsables de l’Église.
Ces valeurs n’ont rien de naturel et de spontané : retirez la police des rues, vous n’aurez pas la sécurité et la civilité, retirez l’autorité du monde du travail et vous n’aurez pas l’équité, retirez l’autorité dans la gestion d’une réunion et vous n’obtiendrez pas magiquement l’écoute mutuelle et le respect des meilleurs arguments, retirez les surveillants des cours de récréation et vous n’aurez pas l’autonomie des enfants, mais la loi du plus fort et très vite la barbarie. Ainsi, nous débouchons sur un paradoxe apparent : l’autorité est remise en cause par ces valeurs mêmes dont elle est la condition du respect.
C’est ce paradoxe que nous essayons de dépasser dans l’ouvrage Réinventer l’autorité où nous montrons que non seulement l’autorité est conciliable avec les valeurs démocratiques, mais qu’elle en est, en même temps, la condition. Et cette réconciliation n’a rien d’une utopie.
Partout, dans la famille comme à l’école ou au travail, je vois des « chefs » qui sont capables de respecter ceux dont ils ont la responsabilité, d’imposer le respect non seulement à leur égard, mais entre les membres du groupe, et par là de construire les conditions du respect de soi. Des chefs qui parviennent à articuler les valeurs de l’individualisme libéral avec les exigences de la vie collective.
Avant d’en venir à ce sujet de la réinvention de l’autorité, voyez-vous d’autres tendances qui travaillent l’autorité ?
Le déclin des figures du savoir est une autre dimension importante de la crise de l’autorité. La science, l’expertise, la figure professorale sont mises durement en cause aujourd’hui au nom de l’égal respect : « J’ai le droit de croire à ce que j’ai envie de croire ». Je vois là un glissement aux conséquences dramatiques. On est passé de l’expression : « J’ai le droit d’exprimer mon opinion » à l’expression : « J’ai le droit de croire à ce que j’ai envie de croire », voire à l’expression : « J’ai droit à ma propre vérité ». Nous assistons à l’essor de la vérité subjective : est vrai ce qui flatte mon ego et mes croyances.
C’est l’une des voies sans issue dans lesquelles nous nous engageons aujourd’hui. Elle se traduit, selon de multiples observateurs, par une précarisation de la discussion : les enjeux de reconnaissance et d’identité l’emportent sur les enjeux de vérité ; l’égal respect devient la déférence qui est due à mes convictions : à chacun sa vérité. Les discussions deviennent plus longues et plus stériles, les gens ne s’écoutent pas, ils s’écoutent parler. On finit par éviter les sujets qui fâchent, sans cesse plus nombreux.
Nous avons de plus en plus de mal à discuter. Et cet essor de la vérité subjective est un nouveau défi pour la vérité. Pour simplifier à l’extrême, imaginons qu’au sein d’un groupe, une personne dise : « Napoléon est mort en Corse ». Une autre répond : « Tu te trompes, Napoléon est mort à Sainte-Hélène ».
Cette parole de simple expertise historique et qui réfère à une vérité factuelle devient potentiellement humiliante pour son interlocuteur dans la mesure où elle relève son erreur, ce qui peut l’amener à rétorquer : « Eh bien, moi, si j’ai envie de croire qu’il est mort en Corse, c’est mon droit le plus strict ! » Lorsqu’on en arrive là, lorsque la vérité n’est plus que « ce qui me convient », « ce que j’ai envie de croire » ou encore « ce qui conforte mon identité », alors la vérité commune s’effondre, et la vie collective avec elle.
De façon plus générale, on observe que même l’autorité scientifique, celle de l’historien, du physicien, du climatologue, du biologiste, ou du médecin, qui parle en se basant sur des faits reconnus à travers des procédures objectivables et reproductibles, cette autorité est remise en question. Tout se vaut : le créationnisme et la théorie de l’évolution, le réchauffement climatique et le climatoscepticisme.
Le sujet est souverain : il a le droit d’avoir raison contre les conclusions d’une communauté scientifique tout entière. C’est là un tournant anthropologique incroyable, qui m’effare personnellement, et qui part de ce que j’ai appelé l’effacement de la responsabilité langagière. Cet effacement signifie que le sujet n’est plus tenu d’assumer ses paroles : Trump a le droit de dire n’importe quoi et de se contredire d’une semaine à l’autre sans devoir se justifier.
Sans qu’aucune institution n’ait le droit de le confronter à ses mensonges. J.D. Vance, son vice-président, auquel des journalistes reprochaient d’être à la source du mensonge concernant les immigrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, qui, selon lui, mangent les animaux de compagnie des habitants, a déclaré : « Si je dois créer des histoires pour que les médias américains prêtent réellement attention à la souffrance du peuple américain, alors c’est mon devoir de le faire ». En gros, j’assume de mentir en prétendant que c’est dans l’intérêt de mon pays.
On assiste à une dégradation spectaculaire du rapport à la vérité, et cette dégradation est au cœur de la crise de l’autorité. Peut-il y avoir discussion si les participants n’assument pas leurs paroles ? S’ils ne reconnaissent pas en être les auteurs ou n’acceptent pas de donner les bonnes raisons pour lesquelles ils disent ce qu’ils disent et croient ce qu’ils croient ?
Dans certains entretiens, Jürgen Habermas a montré une pointe de détresse devant l’effondrement de cette éthique de la discussion qu’il a si profondément analysée dans ses livres. Remarquons que cet effacement de la responsabilité langagière s’observe de façon chronique sur les réseaux sociaux, puisqu’il est possible de se cacher derrière des pseudos afin de proférer les pires absurdités. En Belgique, une ministre a pour ambition de mettre fin à cette possibilité d’anonymat : elle a déjà reçu des menaces de mort…
Pour les partisans de Donald Trump, le caractère véridique de ce qu’il dit n’est peut-être pas ce qui les intéresse en premier.
Oui, le rapport à la vérité s’est fortement affaibli. L’essor de l’extrême droite et du populisme autoritaire s’analyse d’abord comme la prise de contrôle et la mobilisation industrielle des machines du ressentiment.
Nombre de partisans de Trump adhèrent à ce qu’il prétend et promet, non parce que ces discours leur semblent logiques, vraisemblables et scientifiquement fondés, mais d’abord parce que cela satisfait en eux des pulsions de ressentiment et des envies de vengeance. « Je suis votre guerrier, disait Donald Trump dans sa campagne. Je suis votre justice. Et pour ceux qui ont été lésés et trahis : je suis votre vengeance. »
Dénigrer encore et toujours, dramatiser les différences culturelles, exalter l’imaginaire d’un peuple victime des élites et des étrangers, arracher la parole publique aux normes de la raison et de la civilité, attiser la haine et promettre la vengeance. Nos sociétés ont contribué à affaiblir l’autorité dans tous les secteurs pour la faire renaître sous une forme hystérique et dictatoriale. Tant il est vrai qu’il existe un lien dialectique entre la crise de l’autorité et sa résurgence populiste.
L’imaginaire du grand leader s’exacerbe dans l’ordre de l’imaginaire politique à mesure qu’il s’affaiblit dans l’ordre des pratiques sociales. L’imaginaire politique prend alors l’allure d’une formation réactionnelle : une réaction régressive, affective et morale, à l’évidence du recul du collectif et de la destruction des modes de vie, une manière de dépasser dans l’imaginaire ce qui s’impose à nous dans la réalité. La parole de l’autorité politique n’est plus vérité, mais simple exutoire des frustrations.
À l’issue de cette crise, l’autorité se réinvente-t-elle ?
Oui, sans nul doute. Elle se réinvente un peu partout : dans les hôpitaux, les institutions publiques, les associations, les écoles, les entreprises. Je veux dire qu’apparaît une nouvelle génération de responsables plus soucieux du respect des droits moraux (égal, respect, autonomie, empathie, etc.), mais aussi de leur articulation aux contraintes de la vie collective.
Le fait-elle en renonçant à des fondamentaux qui la constituaient jusque-là ?
Je crois que ma définition de départ reste parfaitement applicable : l’autorité est la légitimité qu’une personne acquiert par une position d’exception qu’elle occupe, un rôle qu’elle joue, un pouvoir qu’elle exerce, une responsabilité collective qu’elle assume. Tous ceux qui réinventent l’autorité commencent par accepter et assumer pleinement leur position d’exception.
Dans les formations, il nous arrive de rappeler aux participants leur devoir d’assumer leur position sans jamais l’esquiver. « Vous n’êtes pas un médiateur, un psychothérapeute, un coach, un assistant social, un copain, vous êtes le chef, le responsable de votre service (de votre association, de votre commissariat, etc.) et vous devez l’assumer. » Chez certains, cela crée un petit choc.
Seulement, le rôle s’est complexifié : l’autorité est bien plus difficile à exercer que par le passé. Elle impose un travail plus important de clarification des valeurs, des finalités, des missions qui nous rassemblent, et ce travail de clarification doit s’effectuer collectivement. À mesure que ce travail de représentation et de clarification du collectif s’effectue (rappel des missions, diagnostic partagé, fixation d’objectifs et de stratégies, etc.), c’est une forme de transcendance qui peut renaître, un sens de l’intérêt général, de la mission, qui surpasse les intérêts particuliers.
L’autorité est alors mieux armée pour rappeler les règles, les normes, les objectifs, et le cas échéant pour sanctionner. Ce travail de réinstauration du collectif permet finalement aux responsables de reconstruire une forme de légitimité. Pour autant, l’autorité s’inscrit dans des limites plus étroites : elle doit respecter et faire respecter les valeurs, se montrer elle-même exemplaire, accepter de rendre des comptes et de justifier les décisions — ce qui lui confère une dimension plus verbeuse et plus modeste. En somme, l’autorité doit être autorisée.
Notez bien que cette analyse concerne essentiellement l’autorité au sein des institutions. Je suis beaucoup plus perplexe sur la réinvention de l’autorité politique…
Faut-il vraiment restaurer l’autorité ? Si l’on prend l’exemple de l’école, il est souvent relevé que l’autorité de l’enseignant est davantage contestée par les parents et les élèves que par le passé.
D’abord, je ne crois pas qu’on puisse à proprement parler de « restaurer » l’autorité si l’on entend par là un retour aux anciennes formes d’autorité. L’histoire ne fait jamais marche arrière. Si, par impossible on prétendait en revenir à l’autorité qui prévalait dans les écoles dans les années soixante, elle ne tiendrait pas une semaine. Ce n’est pas seulement les élèves, mais leurs parents qui se révolteraient !
Si restauration il y a, ce sera nécessairement sous la forme d’une réinvention et dans le respect des valeurs évoquées ci-dessus. L’école était naguère une sorte de sanctuaire, les parents n’y mettaient pas les pieds, ou alors, avec un grand respect, le savoir était le monopole des enseignants, lesquels jouissaient du soutien implicite ou explicite des familles. Tout cela a évidemment a disparu.
Ce n’est pas seulement les élèves qui compliquent la vie de l’école, mais leurs parents aussi bien. Il me semble que la réinvention de l’autorité à l’école suppose de ressouder collectivement l’école autour de sa propre utilité, de clarifier sa responsabilité collective autour d’objectifs partagés.
Cela peut inclure l’introduction d’indicateurs qui permettent de mesurer la contribution de l’école à ses missions (apprentissage, réduction du redoublement et du décrochage, égalité des chances, inclusion, etc.). Il convient ensuite d’articuler la responsabilité personnelle de chaque enseignant à cette responsabilité collective, tant il est vrai qu’il n’est pas de responsabilité collective sans responsabilité personnelle.
Cela passe par une reddition des comptes, un dialogue régulier sur le travail, le perfectionnement à travers la formation continue, les échanges entre collègues, éventuellement la sanction de certains enseignants. Ce dernier point reste un tabou, mais je rappelle que l’autorité suppose l’exercice d’un pouvoir de sanction. Il doit arriver quelque chose à celui qui s’assied sur les missions et l’intérêt général, et cela demande du courage à ceux qui sont dépositaires de l’autorité.
Dans les expériences de rénovation de l’école qui ont lieu un peu partout en Europe, que voyons-nous ? L’enseignant est arraché à son isolement et redevient un acteur collectif, ce qui implique de recréer des relations entre les enseignants au sein de l’école par des mécanismes d’entraide, de soutien, de cohésion, d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, de supervision mutuelle, de coaching des jeunes enseignants par les enseignants plus expérimentés. L’enseignant n’est désormais plus seul devant sa classe et devant les parents : il a le collectif et l’institution derrière lui. L’autorité personnelle s’alimente à la force et la cohésion du collectif.
Certaines écoles, en particulier dans les quartiers défavorisés, décident de s’ouvrir radicalement à leur environnement : elles développent des relations avec le voisinage, les familles, les parents, en sorte de recréer, par-delà l’autorité de l’enseignant, la cohérence de l’autorité des adultes autour de l’enfant. Il y a là un enjeu considérable, il consiste à reconstruire des figures d’autorité collective. Une petite anecdote pour me faire comprendre.
Quand j’étais enfant, je devais avoir sept ou huit ans, il m’arrivait de devoir aller chez le dentiste pendant les heures scolaires. J’avais la permission de quitter l’école et me rendais à pied chez le dentiste. Je me souviens d’adultes qui m’arrêtaient dans la rue : « Que fais-tu là, mon garçon ? Tu devrais être à l’école. » Je leur expliquais la raison de ma présence en rue et, bien sûr, ils me laissaient passer. Aujourd’hui, l’adulte passerait son chemin en se disant que cela ne le regarde pas.
Nous étions dans un monde où l’autorité des adultes était assumée collectivement, que ce soit dans la rue, dans l’autobus, dans les parcs. Les voisins pouvaient nous faire des remarques quand nous jouions dehors et ils avaient le droit de le faire.
Les adultes se sentaient collectivement responsables du monde dans lequel les enfants évoluaient — pour rejoindre une idée d’Hannah Arendt dans son texte La crise de la culture. Pouvons-nous reconstruire, au moins à petite échelle, cette autorité collective et cohérente des adultes autour de l’enfant ? C’est un enjeu important, me semble-t-il.
En France, il a été remarqué que de plus en plus de gens interviennent quand, dans le métro, se produisent des violences sexistes ou sexuelles. Comment l’interpréter ? Est-ce aussi l’indice d’une autorité assumée collectivement ?
Cet exemple est important. Tout progrès dans l’exercice de la responsabilité collective apporte un supplément de civilisation. Un autre exemple que j’ai pu observer à Vancouver. Dans certains autobus, le conducteur ne quitte pas son arrêt sans avoir vérifié que les passagers sont installés correctement.
Si d’aventure, comme j’ai pu le voir, il aperçoit une femme enceinte ou un vieillard obligé de voyager debout, il quitte son siège et invite les plus jeunes à céder leur place. Tout cela se passe dans la bonne humeur et l’harmonie. Le conducteur du bus ne se borne donc pas à transporter les passagers, il assume l’autorité et la responsabilité de leur bien-être. Et chacun qui descend du bus lance un tonitruant Thank you ! On demanderait la même chose aux conducteurs de bus à Bruxelles, je pense qu’ils partiraient de suite en grève !
Dans cette crise de l’autorité, voyez-vous des éléments absolument dissolvants pour l’autorité, sur lesquels il faudrait revenir ?
Trois éléments. D’abord, la sacralisation du ressenti propre à notre culture psychothérapeutique qui a pour effet de ruiner toute espèce de transcendance collective, y compris celle du savoir. Si chacun, désormais, se prévaut de son ressenti pour exercer son pouvoir personnel et défendre sa vérité, toute réalité commune se fissure et s’émiette ; le monde devient ingérable. Et cette voie ne mène pas au respect de l’individu, mais au refus de l’altérité.
L’argument du ressenti est imparable, il sert à se soustraire à la discussion et à disqualifier ses interlocuteurs. Il est en effet toujours possible d’imposer aux autres sa propre loi en excipant de son ressenti : « Je ne me sens pas respecté/reconnu/estimé/compris quand tu me fais telle remarque/quand tu étales ton savoir/quand tu me donnes un conseil/une directive/un ordre. »
Le ressenti est indubitable, donc potentiellement totalitaire. Il permet de soustraire à la discussion des éléments que l’on pose comme des axiomes. Énorme défi pour l’autorité : le ressenti ne peut faire loi à la place de la loi.
Autre défi, celui que la culture victimaire pose à l’autorité. Dès lors que l’individu s’installe dans une culture victimaire, tout ordre, tout interdit, tout reproche, tout rappel à l’ordre, et même toute évocation d’une règle ou d’une loi devient une source potentielle d’oppression. C’est là une autre source de la crise de l’autorité.
Un troisième élément à signaler concerne l’interprétation de la crise de l’autorité. Il est coutumier de rapporter la crise de l’autorité aux difficultés causées aux responsables (parents, enseignants, patrons, managers, élus) par ceux sur lesquels ils s’efforcent d’exercer l’autorité (enfants, élèves, travailleurs, patients, citoyens).
En réalité, la crise de l’autorité réside d’abord dans la tête de ceux qui l’exercent et ne résulte que secondairement de la contestation des enfants insupportables, des adolescents qui n’entendent pas raison, des salariés déloyaux, des patients irréalistes, des citoyens qui se défient des gouvernants.
S’il fallait résumer le malaise de l’autorité aujourd’hui, je dirais que notre évolution culturelle a privé les responsables de réponses claires à ces deux questions : « Au nom de quoi puis-je imposer ou interdire ? » et « Qui suis-je pour le faire ? » La première question pose la question des valeurs, la deuxième celle de la reconnaissance de sa position d’exception.
Au nom de quoi puis-je interdire à mes enfants les réseaux sociaux ? À quoi bon risquer l’affrontement ? Et qui suis-je pour le faire, moi qui suis pour mes enfants un copain, un confident, un complice plutôt qu’un père ? Comment vont-ils le prendre ? Et s’ils refusent d’obtempérer ? Nos grands-parents ne se posaient pas ce genre de questions ! Aujourd’hui, tout s’est brouillé.
Pour finir, vos analyses sur l’autorité et sa crise suscitent-elles des controverses, voire des désaccords avec d’autres chercheurs qui travaillent sur ce sujet ?
Non, je m’excuse de le dire aussi clairement, mais, alors que l’autorité était un concept central des sciences sociales depuis les travaux de Max Weber, la question de l’autorité, comme d’ailleurs celle de légitimité qui lui est liée, est proprement écartée, je dirais presque niée, depuis les années 1980 au profit des notions de domination, d’emprise, de contrôle et de surveillance. Seuls les historiens et les théoriciens du management font exception.

Article
À qui fait-on confiance ?
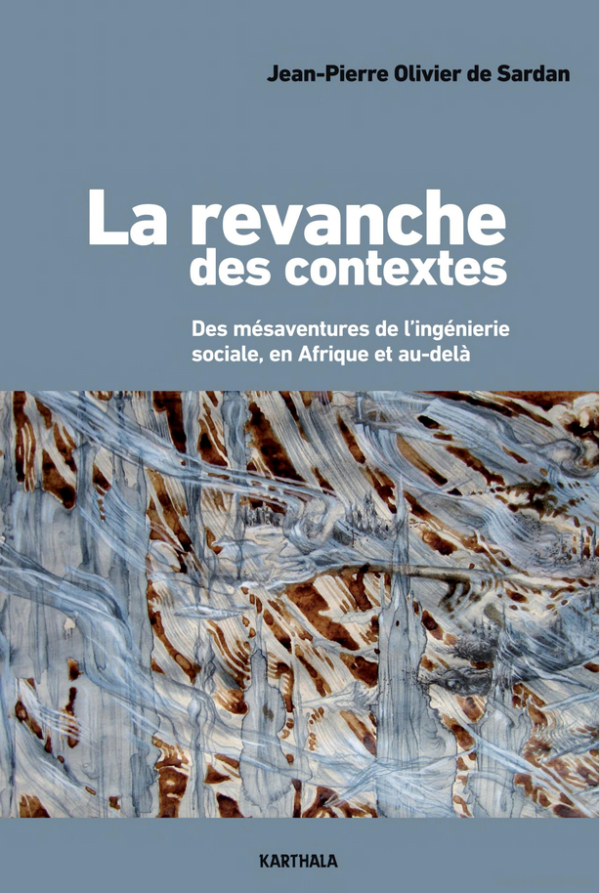
Article
Le concept de « normes pratiques » est intéressant pour qui veut déployer un dispositif de contrôle et de sanction.

Étude
Les apsirations et clivages dans la société française.
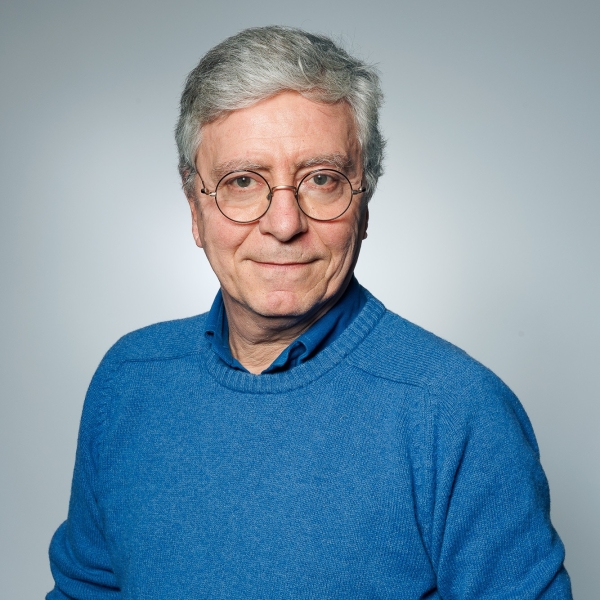
Interview de Laurent Toulemon
Démographe et directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED).
La population totale en 2070 pourrait être la même qu’en 2024.
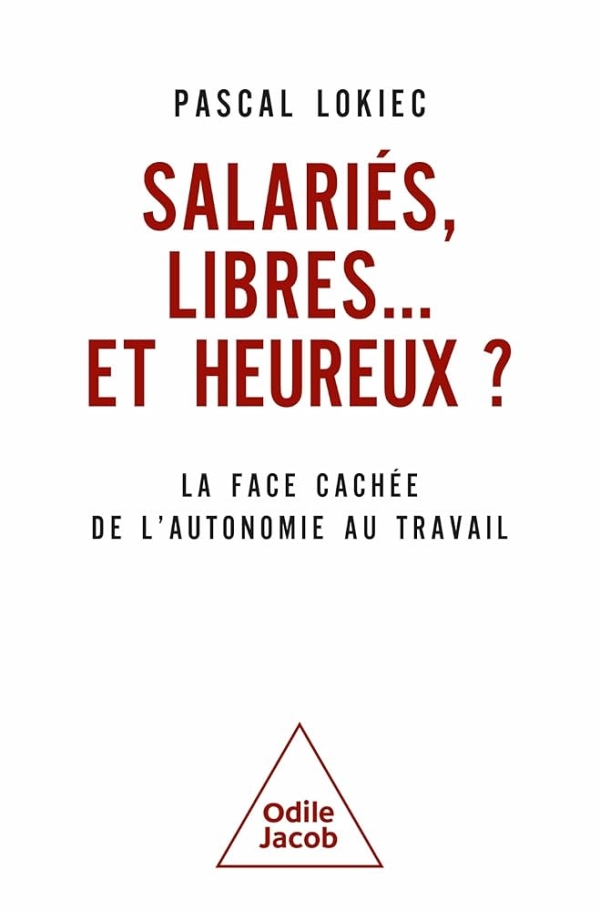
Article
Pascal Lokiec pose les termes d’un débat susceptible de concilier les intérêts de l’entreprise et le pouvoir d’agir des salariés.

Interview de Florian Fomperie
Directeur d’antenne de Radio Anthropocène
Une multitude de médias associatifs, locaux et citoyens pourrait-elle un jour constituer un rempart contre la désinformation et le manque d’indépendance des médias mainstream ?

Interview de Vincent Dubois
Professeur à l’Université de Strasbourg et membre du laboratoire SAGE
Retour sur le renforcement du contrôle et de la sanction des assistés sociaux depuis les années 1990, jusqu'à la mise en place d’une politique organisée du contrôle.
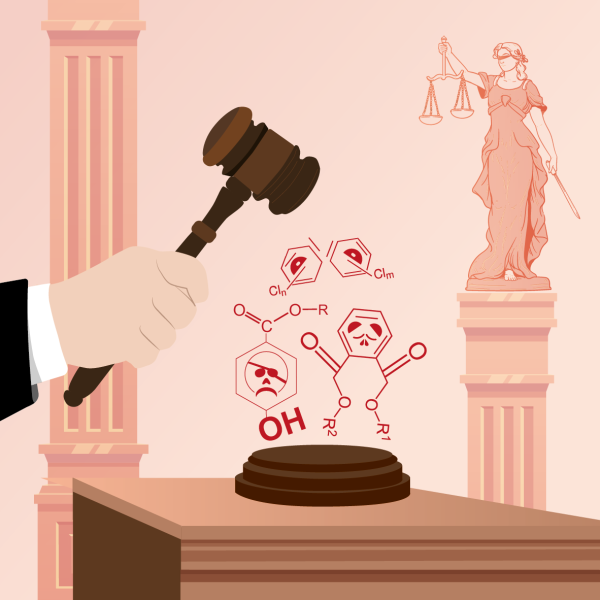
Article
Entre intérêt général et intérêts particuliers, le droit de l’environnement trace lentement sa route.

Article
Un rapide tour d’horizon des luttes contre les pollutions toxiques qui permet d'identifier des types de mobilisations citoyennes