Le rapport des Français à l’autorité, à la fraude et à la surveillance

Article
À qui fait-on confiance ?
Interview de Florian Fomperie

Une multitude de médias associatifs, locaux et citoyens pourrait-elle un jour constituer un rempart contre la désinformation et le manque d’indépendance des médias mainstream ?
Avec pour seule ambition de diffuser les informations qu’ils ne trouvent pas ailleurs, assumant leurs partis pris, sans chercher d’autres recettes que celles permettant leurs activités, des « pure players » plus ou moins professionnalisés se multiplient, comme au temps des fanzines et des radios libres.
Parmi eux, implantée à Lyon : Radio Anthropocène.
Pas un site en propre, ni une marque à retrouver sur les plateformes de streaming : Radio Anthropocène prend corps sur une simple page du site de Cité Anthropocène, l’association héritière de feu l’École urbaine de Lyon.
Sur « Radio A° », des entretiens, de la musique captée en live, des lectures, quelques autres objets sonores hybrides, diffusés sous forme de podcasts bruts, mais ni publicité ni fake news, c’est promis !
Dans cet entretien, Florian Fomperie, son directeur d’antenne, nous présente l’histoire, les moyens et les objectifs d’une radio qui n’en est pas encore tout à fait une, mais qui œuvre au service d’un public déjà bien présent.
Comment est née Radio Anthropocène ?
Au départ, on était encore l’École urbaine de Lyon. Radio Anthropocène est née d’un projet avec Radio Bellevue Web. L’idée était de proposer aux doctorants de l’école, dont je faisais partie, de réaliser des émissions dans le cadre d’ateliers, pour s’entraîner à vulgariser leurs recherches, à parler en public, au micro, etc. Un petit noyau dur s’est pris au jeu, on s’est mis à faire des émissions régulières. Ça a tenu jusqu’à la fin de l’École urbaine en 2022.
Une partie de l’équipe a eu envie de poursuivre l’aventure autour des formats précédemment proposés, tels que le festival À l’École de l’Anthropocène, la collection éditoriale À partir de l’Anthropocène chez les éditions 205, etc. C’est comme ça qu’a été créée l’association Cité Anthropocène. J’étais investi dans la radio, alors j’ai proposé de les rejoindre pour prendre en charge Radio Anthropocène. Ils ont accepté et on s’est lancé à fond dans ce projet.
Cela fait plus de deux ans que l’on travaille à développer cette radio, qui a connu des formats assez différents. Au début, comme nous étions assez disponibles, elle était un peu plus fournie. Il y avait une part de rédaction interne, on était beaucoup à travailler sur les émissions.
La radio m’a pris énormément de temps, j’ai arrêté ma thèse. Petit à petit, nous avons développé d’autres activités au sein de l’association, ce qui fait que l’équipe de radio en tant que telle s’est réduite, mais nous avons augmenté le nombre de partenaires qui produisent les émissions avec nous.
Parler et faire parler de l’Anthropocène, puisque vous l’évoquez dès le nom de votre média, c’est parler de quoi au fond ? Quel est le périmètre qui vous concerne, à partir du moment où vous vous situez à une échelle… géologique ?
Oui, géologique ! Le périmètre est étendu… Mais en fait, l’Anthropocène, selon nous, c’est plus large que l’échelle géologique. Il s’agit plutôt de réfléchir à la façon dont l’être humain impacte son environnement au sens large, c’est-à-dire son environnement physique, géophysique, chimique, biologique, etc., jusqu’aux relations entre l’être humain et la nature, entre les êtres humains, et comment cela bouleverse les équilibres de notre planète.
Globalement, on ne se revendique pas comme militants, mais il y a des questions qui sous-tendent notre action, comme réfléchir à l’exploitation des classes dominantes sur l’homme et sur son environnement, que ce soit la question raciale, les questions de genre, les questions environnementales, ou comment différentes formes d’exploitation se sont mises en place. Ces questions-là se jouent aussi à une échelle culturelle. Pour nous, c’est cela l’Anthropocène.
Comment pourrais-tu alors nous présenter votre ligne éditoriale ?
L’idée est de croiser la science avec des démarches intellectuelles, artistiques et citoyennes, pour mieux comprendre les grands enjeux de notre époque. Pour tout ce que l’on produit, notre point de départ, c’est : « Où en est la science aujourd’hui ? ». Ensuite, on s’intéresse à la manière dont différentes approches, issues des mondes associatif, culturel ou académique, nous renseignent sur l’évolution de nos sociétés, tout en jonglant en permanence entre l’échelle locale et les bouleversements globaux.
À partir de là, nous nous déplaçons sur des événements ou dans des lieux spécifiques pour réfléchir aux différentes perceptions du monde, pendant des plateaux publics de deux, trois, quatre ou cinq heures, toujours diffusés en direct, comme une radio hertzienne à l’antenne en continu. Après, on les rediffuse en podcasts, en conservant l’empreinte du live. On y gagne en fraîcheur, tout en évitant un surplus de travail lors du montage, ce qui permet plus de réactivité.
Tu évoquais les grands enjeux de la société et de l’époque. De votre point de vue, quels sont-ils ?
Quand on parle d’Anthropocène, beaucoup de personnes entendent dans un premier temps la question environnementale. C’en est clairement une, que ce soient les enjeux de réchauffement, de changement climatique ou d’effondrement de la biodiversité, mais cela va beaucoup plus loin.
Si l’on prend l’effondrement de la biodiversité, il n’est pas dû qu’au changement climatique, mais aussi à des pratiques qui peuvent être industrielles, agricoles, qui entraînent également des problèmes sanitaires et impactent les écosystèmes. Ces bouleversements sont créés par des systèmes sociaux qui, d’une certaine manière, exploitent aussi bien l’environnement et la nature que les êtres humains entre eux. Et cela inclut les questions raciales, coloniales, les questions de genres et de classes sociales, également.
Ce sont ces sujets que l’on essaie de traiter et de croiser pour explorer la complexité du monde. Nous ne sommes pas une association environnementaliste, mais on va essayer de partir de cette question, de comprendre comment toutes les interactions du monde montrent des réalités beaucoup plus complexes, et qui impliquent en réalité tous les champs de la société. Penser l’Anthropocène implique de raccorder tous les champs de la société et toutes les échelles.
Concrètement, nous sommes basés à Lyon, et cela nous intéresse aussi de creuser nos questions globales à partir d’un territoire. Ce qui se passe à l’échelle planétaire a des répercussions locales, donc les renseigner nous permet de comprendre aussi la complexité du monde à grande échelle.
Comment se distinguer dans une offre foisonnante de médias en ligne ? Comment tirer son épingle du jeu et promouvoir une image de marque qualitative ?
Effectivement, c’est compliqué. Lorsque tu regardes aujourd’hui, le problème de la masse, il faut passer par les réseaux sociaux, qui ont une façon de fonctionner très particulière, qui nécessite de rentrer dans leurs algorithmes, et de participer un petit peu à ce jeu, en « spectacularisant » ce que l’on fait.
C’est assez contradictoire avec ce que nous avons envie de montrer, de créer, de produire. Ce qui nous intéresse, c’est vraiment la nuance, la réflexion, la complexité du monde et la multiplicité de voix dissonantes, et qui ne sont pas forcément antagonistes. Avoir une approche de la nuance, ce n’est pas forcément la chose la plus évidente pour ressortir des algorithmes des réseaux sociaux.
C’est vrai, on a un petit peu de mal à se situer en matière de communication. On y réfléchit souvent, et parfois, on publie des posts, des émissions, des titres, etc., pour essayer d’attirer un public différent. Mais on se dit, en même temps, « Est-on vraiment rigoureux, est-ce que l’on ne voulait pas être plus nuancés ? » Ces questions reviennent un peu tout le temps et ce n’est pas évident. Aujourd’hui, le travail que l’on mène, c’est vraiment a minima de toujours rester rigoureux, de toujours appliquer les valeurs qui sont les nôtres, en permanence.
Sur le territoire lyonnais, comme à une échelle plus large, plein de gens cherchent aussi une approche aidant à comprendre le monde et sa complexité. Ce public, en restant fidèles à ce que l’on propose, nous finissons par l’accrocher et le fidéliser.
Vos activités rencontrent donc un public ouvert à des contenus exigeants ?
Oui, je pense qu’il existe encore un public pour les choses complexes. Que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de podcasts, les bons contenus ont encore de bonnes audiences. Les gens tentent de sortir de l’atonie générale des médias, qui cherchent beaucoup d’audimat, de public, en proposant des contenus qui pourraient s’empiler d’une certaine manière, en étant juste dans le message publicitaire un peu global et qui permettraient de se positionner très rapidement.
Ces gens en ont assez d’une certaine parole médiatique et politique extrêmement clivante, qui ne permet pas de se situer dans les marges, en finesse, sur les sujets qui touchent tout le monde, que ce soient les sujets sociaux, économiques, environnementaux, à l’écart de grands slogans un peu binaires.
C’est en continuant à proposer ces choses-là que, justement, on ne rend pas les armes, on ne laisse pas le champ libre à ces médias. Notre approche, c’est d’entrer par la société civile associative et par le monde culturel, par des voies différentes, qui ne sont pas celles des scientifiques ou des politiques, et qui touchent différemment des populations différentes.
Quand on fait une émission qui regroupe autour de la table un scientifique et un artiste contemporain, de musique actuelle, que ce soit du rock, de l’électro, du rap, peu importe, ça nous permet d’aller chercher des publics différents, eux aussi très intéressés par cette pluralité de regards.
Dans une époque où le do-it-yourself massifie la concurrence, et où « l’économie de l’attention » pousse à monétiser des audiences transformées en marchandises classiques, quel est votre mode de financement ?
On ne fait pas de pub du tout, sur aucune plateforme. Ça fonctionne avec un peu d’adhésions, des partenaires des émissions qui adhèrent et qui nous soutiennent, celles et ceux qui produisent des émissions chez nous. On se charge de la diffusion, de la production technique et de la médiatisation, eux créent les contenus.
Il s’agit de partenaires académiques, universitaires, des labos, des doctorants, des chercheurs, des associations environnementalistes ou intéressées par les questions urbaines, des enjeux plus sociaux, comme les sans-abri, etc. Il y a également le service archéologique de la Ville de Lyon qui travaille avec nous par exemple, des gens très différents, des médias aussi, et tout ce petit monde qui vient produire des émissions avec nous nous soutient.
On se rémunère plus sur les autres activités de l’association que sur la radio actuellement. On fait de la formation aussi, à l’université, sur les enjeux du journalisme et de l’Anthropocène. On propose des plateaux publics, qui servent aussi à nouer des partenariats et qui nous permettent de nous rémunérer un petit peu. Nous avons aussi quelques subventions, mais c’est très à la marge. Voilà un petit peu notre modèle économique, mais je ne le conseille pas. Si tu veux monter ton petit média indépendant, je te souhaite bien du courage, de l’envie, de la passion et de la persévérance, en gros.
Peut-on qualifier Radio Anthropocène de média indépendant ?
Je ne sais pas exactement ce que veut dire l’indépendance, on en parlait la semaine dernière justement avec Rue89-Lyon, et Coop-médias, une coopérative créée pour aider les médias indépendants. Être indépendant, c’est être libre sur sa ligne éditoriale, ce qui est notre cas. Quand nous avons des choses à raconter, nous le faisons.
Mais est-ce que l’on est complètement indépendant ? Je ne sais pas où se situe le curseur. Sur la ligne éditoriale, c’est un peu particulier parce que, comme je le disais, on produit quelques émissions en interne avec les forces vives de l’association, mais beaucoup le sont par des partenaires.
Ces partenaires, on les aide d’un point de vue technique, nous pouvons les former aux méthodes de la radio, de la prise de parole, etc., de la construction des émissions. Par contre, nous les laissons libres dans le choix des sujets. Le seul impératif, c’est que ce soit vérifiable, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de fake news colportées sur notre radio, et que ça n’aille pas à l’encontre du consensus scientifique actuel, notamment sur les questions environnementales. Ça, c’est très important pour nous.
Je dis environnemental, mais cela concerne tous les thèmes. C’est un point sur lequel nous sommes intransigeants, et donc ce sera la seule limite fixée à nos partenaires. Mais sinon, ils restent très libres dans le choix des sujets à traiter. On les incite juste à proposer des sujets très variés, qui permettent justement d’entendre cette conflictivité du monde et cette diversité de façons avec laquelle il est appréhendé.
Cette toile de fond orwellienne de « post-vérités », pour ne pas dire de mensonges, quelle place occupe-t-elle dans votre esprit ? C’est sur le long terme que l’on gagne une réputation de médias fiables, et voilà ? Portez-vous un questionnement par rapport à cela, autour de la consolidation ou de la vérification des bases sur lesquelles vous traitez un sujet ?
Sur cette question, je pense que nous sommes avant tout touchés en tant que citoyens. C’est un sujet qui nous anime en permanence, sur lequel on échange, on se renseigne, on travaille très régulièrement, parce que c’est une question qui pèse énormément sur la société.
Oui, cette réputation de médias sérieux, qui vérifie ses sources, se construit seulement au long cours. Des gens qui ont encore envie d’informations sûres et vérifiables, oui, il y en a. Mais tous ces mécanismes de biais de confirmation, où les gens sont beaucoup plus attirés par des informations qui confirment leur opinion, qu’elle soit vraie ou fausse, effectivement, ça nous effraie un petit peu.
La société semble de plus en plus polarisée. Dans la dimension « militante » de votre démarche, ce n’est pas un peu tentant l’entre-soi ? Ne sommes-nous pas aujourd’hui à un moment où tactiquement, chaque camp assume d’avoir ses propres relais, ses argumentaires, avec une certaine volonté d’hégémonie ?
Sur la polarisation de la société, c’est plus la vision, en tout cas l’image, qui est renvoyée par les médias et les réseaux sociaux. Mais je crois que, selon les études d’opinion en globalité et les récentes études de sociologie, la polarisation n’est pas si importante. Les gens restent assez ouverts d’esprit et ont des opinions beaucoup moins tranchées que ce que l’on peut entendre dans les médias.
Sur l’entre-soi, nous avons une culture de la radio marquée par les médias publics. Aujourd’hui, ils touchent avant tout une certaine catégorie de la population que l’on pourrait considérer comme un entre-soi, mais nous pensons le service public comme un service de vision publique.
Par notre culture, parce que nous sommes nombreux à venir des universités, nous sommes convaincus de la nécessité d’être en mesure de parler à tout le monde. Nous nous pensons comme un média d’utilité ou de service public, donc l’entre-soi, c’est quelque chose que l’on n’a jamais souhaité et sur lequel nous avons toujours cherché à nous distinguer. C’est peut-être confortable, mais ce n’est pas du tout notre ADN.
Pour finir, vers quels « futurs désirables » souhaitez-vous aller, pour vous, Radio Anthropocène ? Quelles sont vos perspectives de développement ?
Nous voulons devenir une vraie radio locale, avec une fréquence. On fait des démarches dans ce sens. Pour y parvenir, nous devrons encore élargir le champ des partenaires, travailler avec plus de labos, d’universités, de médias locaux, pour devenir une chambre d’écho ouverte à toutes les personnes sur le territoire métropolitain et au-delà, qui ont envie de collaborer avec nous et qui travaillent sur ces problématiques.
Le but est d’être en mesure de fédérer cette communauté et de porter une programmation quotidienne et continue de qualité, qui renseigne celles et ceux qui nous écoutent sur ces enjeux, en s’inscrivant dans le jeu médiatique à l’échelle du territoire grand-lyonnais.
Nous sommes convaincus de la nécessité de médias comme ça à Lyon, solubles dans la vie démocratique, par de la réflexion, du débat intelligent et intelligible, par la rencontre des divers acteurs du territoire. C’est ce que nous nous souhaitons donner à nos auditeurs et nous devons continuer à nous développer dans ce sens. Si ça ne se passe pas dans l’année, ça se fera un peu plus tard, mais j’espère y arriver. On est prêt pour ça, pour trouver des moyens financiers, de nouveaux partenaires, élargir l’équipe et nous donner les moyens de ces ambitions.

Article
À qui fait-on confiance ?
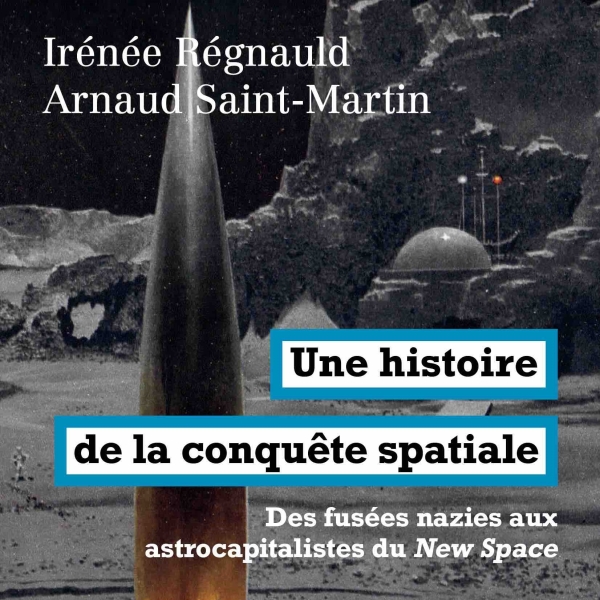
Article
La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article
Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?
Texte de Michel WIEVIORKA
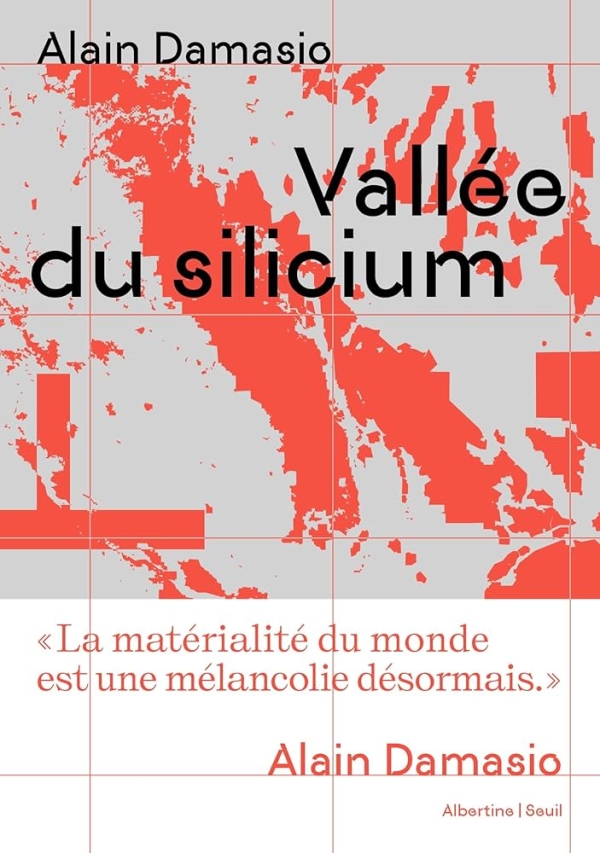
Article
Le progrès technologique nous éblouit. Se pourrait-il qu’il nous aveugle en plein jour ?

Interview de Alain Eraly
Professeur de l’Université libre de Bruxelles (ULB), membre de l’Académie royale de Belgique
Partout, l’autorité est mise en cause.

Interview de Vincent Dubois
Professeur à l’Université de Strasbourg et membre du laboratoire SAGE
Retour sur le renforcement du contrôle et de la sanction des assistés sociaux depuis les années 1990, jusqu'à la mise en place d’une politique organisée du contrôle.

Interview de Olivier Aïm
Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, chercheur en théorie des médias et industries culturelles
Quelles sont les grandes évolutions en matière de surveillance ?
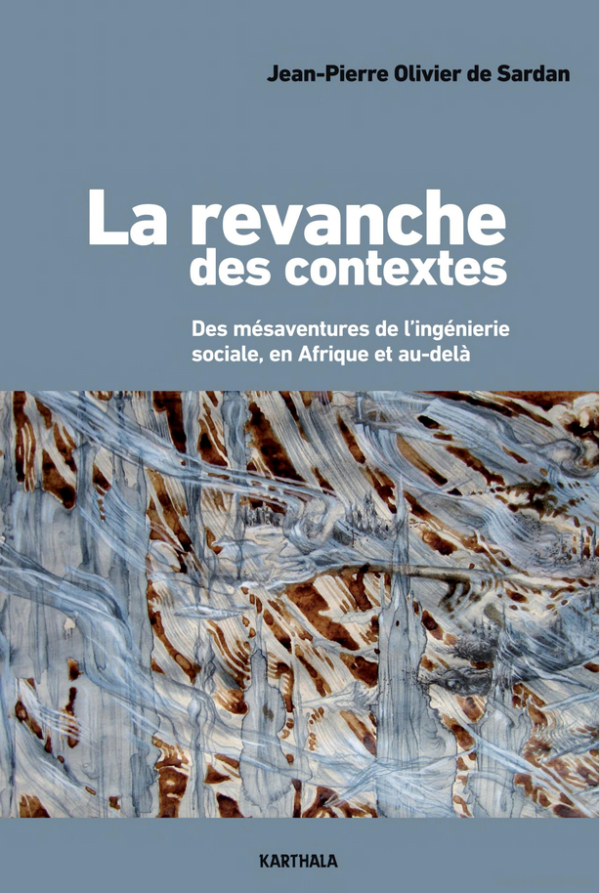
Article
Le concept de « normes pratiques » est intéressant pour qui veut déployer un dispositif de contrôle et de sanction.