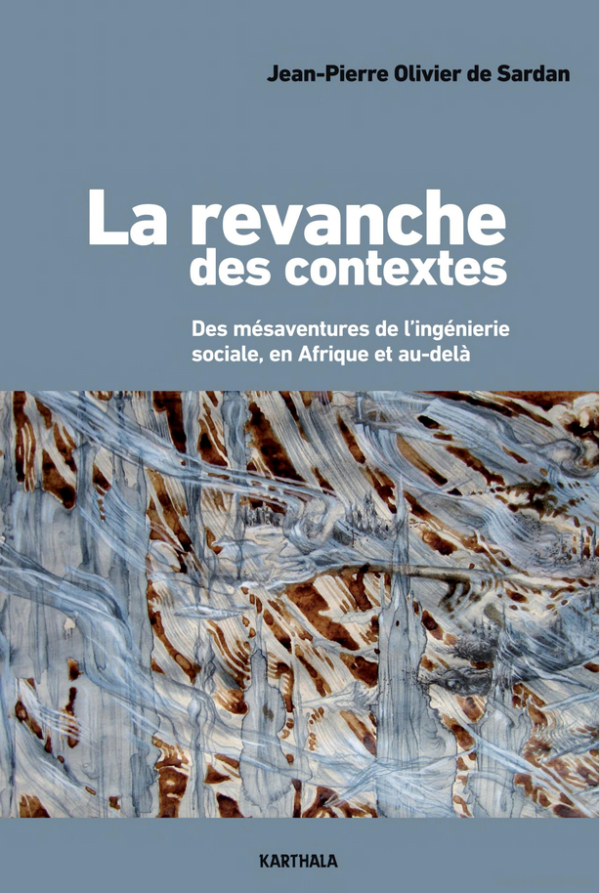L’interculturel déborde toutes ces questions de santé, de médecine, de rapport au corps. Tout d’abord, les mots des maux ne sont pas les mêmes. Ici, nous avons un chat dans la gorge, un mal de chien, des fourmis dans les jambes… Dans d’autres pays, ce sont d’autres expressions. Un médecin occidental parti au Kenya témoignait ainsi de son incompréhension face à une patiente lui disant avoir un serpent dans la tête. Il pensait problème psychologique quand elle lui parlait de maux de tête…
En dehors de cette question linguistique, le principal obstacle est celui de la suprématie totale conférée à notre mode de pensée scientifique, rationnelle. Tout ce qui n’est pas dans ce mode de pensée n’est pas pensable ou acceptable. Or, de nombreux professionnels, qui accompagnent des populations ayant d’autres modes de pensée (comme la pensée magique), ont du mal à admettre que ce mode de pensée puisse être entendable. « Entendre », cela ne veut pas dire adopter ce mode de pensée, mais bien en tenir compte pour comprendre les situations.
J’ai un bel exemple donné par un éducateur de Protection judiciaire de la Jeunesse. Il accompagnait une jeune fille venant du Congo RDC et qui avait échappé aux passeurs. Elle n’allait pas bien. L’éducateur veut donc l’emmener voir un médecin généraliste et se voit opposer un refus, car elle veut voir un médecin traditionnel, un marabout, « celui qui soigne ».
Plutôt que de refuser, l’éducateur lui propose d’aller voir un marabout et ensuite un médecin généraliste, ce qu’elle a accepté. C’est très rare comme démarche, et pour le coup cela a permis de surmonter les peurs de cette jeune fille et de déceler une maladie qui n’aurait sans doute pas pu l’être autrement.
L’ethnopsychiatre George Devereux a tenté de faire entendre au monde scientifique que la psychologie et la psychiatrie ne sont pas plus universelles que les codes culturels de nos sociétés occidentales. Le centre Georges Devereux œuvre à la transmission de cette approche, mais la psychiatrie classique ne lui fait pas de place, alors que les besoins sont criants. La France manque cruellement d’ethnopsychiatres : il y a bien quelques initiatives, comme la Maison de Solenn, le travail mené par la professeure Marie Rose Moro sur Paris, ou encore sur Lyon les travaux de l’observatoire Orspere-Samdarra, mais c’est insuffisant.