Repenser les métiers du prendre soin à l’aune des théories du care

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?
Interview de Nicolas FIEULAINE

<< Les politiques sociales telles qu’elles sont construites fondent une architecture de choix dissuasive qui suscite un niveau élevé de non-recours aux droits sociaux >>.
Une interview effectuée dans le cadre du chantier "connaissance des usagers de l'action sociale et de leurs relations à l'institution". Ce chantier est construit autour du recueil des enquêtes réalisées sur ce sujet par divers organismes en France.
Chercheur au Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) de l’Université Lyon 2, Nicolas Fieulaine analyse les dimensions psychosociales des inégalités sociales (santé, droits, justice…) à travers le prisme de la temporalité. Il mène notamment des recherches sur l’impact de l’insécurité sociale et de la précarité sur le rapport au temps, étudiant alors les mécanismes à l’œuvre dans le non-recours aux droits sociaux. Il anime depuis 2008 des sessions formations pour les travailleurs sociaux.
Sur quels thèmes portent vos recherches ?
Je travaille depuis ma thèse de doctorat sur la précarité et les processus de précarisation, et leurs effets psycho-sociaux sur le vécu des gens. La mise en précarité concerne des pans entiers de population, certaines personnes sont dans des formes d’emploi très précaires, alors que d’autres le sont moins mais se sentent menacées à plus ou moins long terme. Les situations de précarité ont en commun l’instabilité et l’incertitude générées par la déstabilisation des trajectoires sociales. La précarité et l’instabilité peuvent concerner tous les domaines d’existence, revenus, emploi, logement, protection sociale… Le cumul des instabilités provoque d’une part une fragilisation à l’égard des risques de difficultés sociales (pauvreté, exclusion, déclassement), et d’autre part une plus grande probabilité d’être exposé à des situations aux conséquences négatives, une plus grande gravité de ces conséquences, et une diminution des possibilités de mobiliser des ressources face à ces difficultés et leurs conséquences.
Quelles sont les conséquences psychologiques de la précarisation ?
Les soubassements psychosociaux de l’individu sont mis à mal. Le rapport à soi (image de soi entamée sur le plan social), le rapport aux autres (univers déserté par l’autre), le rapport au temps (incapacité à se projeter dans l’avenir) et à l’espace (contraction des horizons) sont modifiés par l’incertitude et le délitement des liens qui va de pair avec la mise en précarité. Dans le rapport à l’espace physique, on observera par exemple des fonctionnements très rigides dans les parcours, si on demande à la personne de faire un petit détour, elle ne le fera jamais ou difficilement, parce que l’espace est fermé tout autant que les liens sociaux, limitant l’accessibilité subjective des lieux et des autres…
En quoi ces apports de la recherche peuvent-ils servir aux travailleurs sociaux dans leurs pratiques ?
Par la prise en compte des temporalités en jeu dans l’accompagnement des populations confrontées à la précarité, on esquisse par exemple des angles d’analyse utiles pour l’intervention sociale. De manière plus large, l’analyse des soubassements psychosociaux permet d’outiller les travailleurs sociaux, et peut leur donner une grille de lecture psychosociale qui restaure du contrôle. Rien à voir avec l’approche intuitive revendiquée par certains (« je sens bien les gens, j’ai de la psychologie »), qui est la meilleure manière de mettre les travailleurs sociaux en tension, le jour où cela dysfonctionnera, parce qu’ils seront alors seuls personnellement responsables et donc attaqués dans leur identité propre. Cela remet aussi du monde commun, déspécifie, permet par exemple d’avoir un accueil compréhensif plus ouvert et moins excluant.
Quel éclairage apporte la psychologie sociale sur les politiques sociales et leurs logiques ?
Pour en rester aux questions de temporalités, l’usage du temps dans les politiques sociales vient parfois totalement contredire, ou se situer en opposition avec la temporalité induite ou imposée par les situations de pauvreté, de précarité, d’insécurité sociale. Dans ces situations, le présent est marqué par l’instabilité et l’insécurité, et le futur par l’aléatoire et l’incertitude. La précarité pose un ensemble de questions à l’aide et à l’accompagnement socio-sanitaire, et oblige à repenser en partie leurs modes d’action.
Ces logiques temporelles s’appliquent également aux rapports que les bénéficiaires entretiennent aux dispositifs. Avoir recours à l’aide ou aux droits sociaux, c’est s’engager dans une pratique de planification, où la mise en œuvre d’actions au présent se fait en vue de transformer l’avenir. Ainsi, le projet est un outil phare de la mise en œuvre de l’action sociale par les agents qui sont au contact des usagers. Ils ont besoin du projet. J’ai travaillé à partir de la première convention Unédic qui plaçait le « projet personnalisé » au centre du contrat liant la personne en recherche d’emploi et le dispositif d’accompagnement. Cette logique de projet entre totalement en contradiction avec ce que produit la précarité.
Pourquoi ?
Le projet établit un certain rapport à la réalité, il renvoie aussi à un certain usage du futur. Quand je réalise des entretiens avec des publics des politiques sociales (missions locales, CCAS, associations d’insertion, CAF, agences pôle emploi, PIMMS, guichets politique de la ville…), je me rends compte que le seul mot projet a le pouvoir absolument hallucinant d’induire, selon les cas, soit de la soumission, soit de la résistance. Des gens s’y plient « oui j’ai un projet » et le normalisent de manière très artificielle, d’autres répondent « ne me parlez pas de projet ».
Chez ceux qui ont le plus souffert, la motivation première est rarement d’atteindre un objectif, de construire un projet, elle est plutôt d’éviter des obstacles et des problèmes. Quand on leur dit qu’il faut trouver un emploi, ils vont trouver menaçant la motivation à aller vers le mieux. Ils seront plus sensibles au message « évitez / n’allez pas vers » qu’au message « faites/ allez vers ».
Dans ce cadre, la relation dans le travail social s’articule autour de phases que j’identifie comme celles de l’accueil, du support et du renforcement : accueillir consiste à prendre l’usager tel qu’il est à partir d’une analyse pertinente de sa situation de départ, le support consiste reconnaître et à soutenir les capacités existantes, le renforcement consistant lui à accompagner le re-développement des ressources psychosociales mises à mal par les situations de précarité... Par exemple, les signes du futur ne peuvent s’imposer normativement, ils doivent venir progressivement, et concerner à partir du présent d’abord le futur immédiat. Mieux vaut commencer par « revenez demain » que vouloir planifier des RV sur l’année.
Quand vous mettez en cause la logique du projet lors des formations avec les professionnels du social et du médico-social, quelles sont les réactions ?
Tout le monde est déstabilisé. Mais on passe vite à l’étape suivante, celle du questionnement : quel sens donnez-vous à l’accompagnement long, au projet, où trouve-t-il sa source, et comment est-il mis en actes, quels sont les outils que vous avez pour le développer ? Le projet, est-ce seulement de la rhétorique ou est-ce de la pratique ? Et là on tombe sur des contradictions sévères. Dans leurs pratiques, les professionnels du social et du médicosocial sont dans des dispositions qui rejoignent celles de leurs publics, ils sont précarisés par l’absence de financement et de moyens de résolution, ils agissent au cas par cas, au coup par coup, sont centrés sur l’interaction immédiate avec la personne, avec beaucoup de difficultés à la situer dans des trajectoires longues. Sur eux pèse une norme qui provient de la conception des politiques publiques, et va à l’inverse de ce qu’ils peuvent déployer sur le moment. Finalement, ils n’ont, pas plus que leur public, d’espace psychologique. En un sens, les usagers sont devenus de plus en plus ressemblant aux travailleurs sociaux. On observe donc la rencontre entre deux formes de temporalités restreintes. Il y a là quelque chose qui relève du partage d’une situation immédiate.
Qu’est-ce qui vous frappe dans l’évolution du travail social et dans la relation aux publics ?
Sans doute l’hétérogénéisation des usagers, qui supprime la possibilité d’une paresse mentale qui consistait à penser que la figure de l’usager que l’on avait en tête permettait d’assurer le train-train quotidien dans les interactions. Or les conditions de mise en œuvre des politiques sociales conduisent les travailleurs sociaux à ne plus pouvoir faire face à la diversité des publics. Le travail à réaliser avec une personne hautement qualifiée qui traverse une période de chômage passagère et dont la demande est très bien cadrée, n’a rien à voir avec le travail à réaliser avec un chômeur de longue durée en situation de grande détresse. La question devient, face à cette diversité grandissante des profils : comment les travailleurs sociaux d’abord peuvent comprendre cette diversité, et ensuite y ajuster la relation pour proposer des droits, les rendre accessibles, disponibles sur le plan cognitif, d’autant que les RV peuvent se succéder sans que le travailleur social ait le temps d’opérer le basculement psychologique nécessaire. Il y aurait un besoin accru de prise de distance et d’analyse, de temps de repositionnement avec tant de différence d’un usager à l’autre, alors même que les moments de recul, d’analyse de la pratique, d’échange, se contractent, par la diminution des moyens et l’augmentation des « portefeuilles » d’usagers.
La perte de sens du travail social est une autre évolution notable.
Comment se manifeste la perte de sens ?
Dans les formations que j’anime, j’observe le glissement de la plainte au cynisme. On me dit : « nous essayons de tenir, mais nous n’en pouvons plus, parce que les usagers ne nous suivent pas, et nous comprenons d’ailleurs qu’ils ne suivent pas : nous n’avons pas grand chose à leur donner et nous manquons de temps pour développer des solutions ». Maintenant, dans le travail social comme dans le monde médical, pointe le cynisme, stade avancé du désengagement, qui précède la démission ou le burn out. « Ce que je fais ne sert à rien », c’est une perte de sens du travail aux effets dévastateurs dans des métiers de la relation, qui ont précisément besoin de donner sens à cette relation. Le travailleur social perçoit le problème parce qu’il tient encore à quelque chose, il se prépare à renoncer à donner du sens à son travail, mais évidemment n’y arrive pas. Quand un espace s’ouvre et permet de recréer du sens, du champ, du contrôle, des possibilités d’action, l’appel d’air est incroyable. Je ressors des formations avec un fort optimisme sur la créativité des travailleurs sociaux dans la conception d’outils qui les aide à lire les situations et à y ajuster leur pratique, sans proposer des solutions rigides. Mais souvent les directions des structures ne suivent pas et il manque un opérateur qui les prenne au sérieux. La Métropole de Lyon pourrait être demain cet opérateur. Le besoin d’ouvrir des espaces pour travailler sur des approches et des outils est manifeste. Un outil est expérimenté, il fonctionne ou ne fonctionne pas, mais dans tous les cas ce n’est pas la personne qui est en cause, c’est l’outil, cela change tout.
Vous faites le portrait de travailleurs sociaux qui ne croient plus à la possibilité de réinsérer, d’inclure la personne dans le monde « ordinaire » ?
Historiquement, le travail social établit un pont pour ramener les personnes du « out » au « in ». Il s’agit d’inclure, de (ré)insérer. Or, dans le travail social comme dans bien d’autres domaines, tout le monde veut être sur le pont. Les travailleurs sociaux le disent : on n’a plus envie d’insérer, de ramener vers le droit commun, parce que c’est un monde violent, les gens pour lesquels on a trouvé une solution reviennent dans un état qui est parfois pire que l’état de chômage, ils sont tabassés par le monde du travail. Par ailleurs, ils ne veulent pas non plus qu’elles retombent dans de « grandes problématiques ». A l’image de ces ponts habités à Vérone, on se met à habiter sur le pont, qui est plus confortable que les deux rives qu’il relie. Dans les chantiers d’insertion, dans les structures d’accueil, à pôle emploi, dans les dispositifs les plus divers, les gens tendent à rester, ils créent des relations, trouvent leur rythme, et finalement tout le monde perd de vue qu’il fallait aller quelque part.
Qu’est-ce qui, d’après les enquêtes, suscite du non-recours aux droits sociaux, et fait « fuir » l’usager de manière assez récurrente ?
Les travaux sur le non-recours montrent que le temps de la relation est décisif. A côté du non-recours par méconnaissance ou incompréhension, le non-recours frictionnel est important, c’est-à-dire d’abandon de droits dès lors que le bénéficiaire potentiel a eu un contact avec les opérateurs des politiques sociales. C’est là qu’il est utile de chercher à comprendre à la fois l’espace psychologique dans lequel les personnes inscrivent leurs démarches mais aussi les formes de ressources psychosociales qu’ils ont à disposition (solidarités intrafamiliales, etc.), pour ajuster l’action et la manière dont les professionnels vont présenter, proposer, et rendre disponible des droits.
Il est évident que la contre-demande fait fuir, a fortiori quand elle se présente sous la figure du projet. Une personne vient faire une demande, et en retour on lui demande quelque chose, remplir un dossier, faire montre du projet qui devrait exister derrière sa demande, donc finalement de justifier sa demande, non par le présent, mais par le futur. Si on dit « ce n’est pas juste pour vous nourrir que l’on vous donne un colis, derrière on a un projet pour vous, on va construire un projet ensemble », cela peut faire fuir… Quand les travailleurs sociaux en prennent conscience, ils sont assez terrifiés, ils ont le sentiment que si on enlevait la logique du projet, on supprimerait le sens propre de leur action. Toute la question est alors : comment peuvent-ils conserver ce sens, tout en ne le mettant pas dans la relation ? C’est compliqué, parce que cela va venir interroger la confiance. La confiance, c’est déposer quelque chose en l’autre, que je peux retrouver, si je le revois plus tard ou ailleurs. Or la confiance n’est pas quelque chose de pertinent pour les personnes les plus en difficulté, parce qu’il n’y a pas de plus tard ni d’ailleurs, elles sont assez souvent dans l’aujourd’hui, dans l’immédiateté. Y compris au regard des droits eux-mêmes : je ne sais pas ce que je vais obtenir, et combien de temps j’obtiendrai ce que j’obtiendrai, je ne me projette pas dans ces droits sur la durée, il y a là un vrai différentiel de perception avec le travailleur social.
A partir de là, que faire ?
Comme le pouvoir est du côté des politiques sociales, la question est : comment accueillent-elles ces formes de temporalités totalement contradictoires ? Comment les travailleurs sociaux prennent-ils acte de la centration sur un présent immédiat ? En travaillant sur le centre d’échange de Perrache, j’avais observé que les plus précaires demandaient non pas plus d’action des associations, mais la création d’une agence d’intérim au RC, soit une forme de rapport au travail complètement à rebours de ce que proposaient certains travailleurs de rue qui, une fois le contact établi, essayaient d’aller vers le projet. L’intérim est, pour les travailleurs sociaux, à l’inverse du projet. Il y a là de vrais conflits de normes.
Quel rôle joue l’accueil dans la relation usager/travailleur social et dans le non-recours aux droits ?
Quand nous avons construit en salle d’expérimentation une relation qui potentiellement rend éligibles les gens à des droits, nous nous sommes aperçus que la question de l’accueil était primordiale. Il est possible d’aborder le futur dès lors qu’il y a eu le temps de l’accueil avec une prise en compte de la temporalité propre des individus. Toutes les études montrent qu’une proposition orientée vers l’avenir faite à des personnes ou des groupes sociaux centrés sur le présent créé de la dissuasion. Il est également avéré que les inégalités sociales de santé sont en partie produites par les campagnes de santé publique qui délivrent un message du type « arrêtez de fumer, c’est un peu difficile sur le moment, mais cela vous évitera un cancer dans 15 ans ». Une personne dont la temporalité est de l’ordre de l’immédiateté, parce qu’elle ne sait pas si son CDD sera reconduit à la fin du mois, entendra la première partie de la proposition « c’est difficile sur le moment », mais pas la seconde partie qui concerne le futur. Dans le cadre de la prévention sanitaire, le message cherchant à convaincre d’abandonner des conduites à risque, ou de s’engager dans des conduites de prévention repose souvent sur cette idée que ce que l’on fait au présent engage l’avenir. Les politiques sociales créent ainsi des « affordances », c’est à dire des situations qui par leur conception induisent une pertinence d’usage pour les usagers, ou au contraire les dissuadent et qui sont dès lors incapables d’avoir les effets souhaités.
Sur l’accueil proprement dit, voyez-vous des éléments de fuite ?
La déconstruction du risque de stéréotype et de stigmatisation est essentielle pour concevoir un accueil. Les structures qui se cloitrent derrière des miroirs sans tain délivrent un message immédiat : nombre de personnes disent avoir fait demi-tour immédiatement. Les aspects défensifs pour accueillir certaines personnes délivrent des signaux similaires. Les gens vont souvent construire leur demande sur le moment, et la vision du lieu a de l’influence. Selon l’urgence, faut-il que l’accueil soit avancé ou reculé ? Saisit-on les gens dans l’immédiat, en leur donnant le signe qu’ici, aucun temps ne sera perdu, sans laisser la possibilité de prendre le contrôle, de regarder, mettre leurs idées en place. Dans maints endroits, ils seront d’emblée accueillis par un « que voulez-vous ? ». Dans certaines missions locales par exemple, on estimera qu’il ne faut surtout pas laisser des jeunes sans surveillance et pour cela qu’il convient de surtout ne pas les faire attendre.
Vous remettez en cause un fondement du travail social en posant ce regard critique sur la notion de projet, que l’on retrouve dans les idées d’accompagnement, de travail sur la personne elle-même pour la faire évoluer…
Les travailleurs sociaux disent que si les gens ne sont plus acteurs, l’éthique de leur profession disparaît. Or ce que je questionne en premier lors des mes formations, ce sont les mots « projet » et « acteur ». Que veut dire être acteur ? Acteur signifie participer à la logique « je te donne, tu me rends », qui est au fondement de la contre-demande déjà évoquée. C’est assez similaire à un échange monétaire : il faut un échange équilibré. « Je vous donne, donnez-moi aussi, il faut me rendre, parce qu’au bout d’un moment je vais arrêter de donner ». Cela interroge : que signifie alors la relation d’aide ? Un autre effet de cette pensée en terme d’acteur est la stigmatisation, parce que si l’on considère la personne comme acteur, sa situation va informer sur son identité. Ce qu’elle vit dit quelque chose de ce qu’elle est. Cela n’est possible que si on situe une responsabilité et donc une part active des individus dans leur situation. Dans le champ du travail social on est nécessairement dans une relation d’aide. L’usager a tout intérêt à attribuer son « problème », jamais glorieux, à l’environnement social, pour que ce problème ne se mette pas à peser sur son identité. Dès lors qu’il s’en rend responsable, sa situation sociale informe sur ce qu’il est : il est au chômage donc il est fainéant, il est malade donc il n’a pas fait attention, etc. Or la première chose que fait un travailleur social, c’est travailler sur ce sens de la responsabilité : « nous allons voir ce que vous avez pu faire pour être dans cette situation », ce qui est à l’origine du développement d’une identité sociale négative. Alors que des gens expliquent leur situation en la référant à la situation sociale, ils se voient répondre : « ce n’est pas uniquement la crise qui vous prive d’emploi, ce sur quoi on va travailler c’est comment vous, vous pouvez changer ça ». L’effet psychologique est redoutable.
Comment croire complètement à ce référentiel de l’acteur responsable de sa situation alors que tout le monde sait que la précarité et le chômage ont explosé depuis 30 ans ?
La première convention Unédic sur le projet personnalisé était accompagnée d’une recommandation : valoriser la prise de risque. C’est une façon de résoudre le paradoxe : le seul principe pratique à même de donner un sentiment de contrôle (donc d’être acteur) en contexte d’incertitude consiste à prendre des risques, à tenter le coup. C’est comme l’Euromillion, les gens ne croient guère qu’ils le gagneront, mais néanmoins ils jouent parce que dans le jeu il se passe quelque chose qui donne du sens. Agir par projet s’inscrit dans cette logique, on n’est pas dupe mais on va pourtant faire quelque chose ensemble, cela restaure de l’action, et cela peut faire du bien. Il est vrai qu’il se passe des choses, et si cela était assumé, il se passerait de plus belles choses encore. Des associations l’ont compris, l’objectif n’est pas d’insérer, mais de faire des choses ensemble, c’est le « faire expérimenté ». Je pense à Creative Roots installé depuis peu à Lyon, ou à des associations qui travaillent à la reprise de possession de l’espace public, sur un mode très éphémère (plantation de graines, construction de meubles en carton…), avec une immédiateté qui est en phase avec le rapport au temps des publics les plus fragiles. L’action dans l’immédiat restaure quelque chose, même si c’est seulement dans l’immédiat.
Il faudrait donc rentrer directement dans une relation d’aide, sans passer par un jugement qui impute à la personne la responsabilité de sa situation ?
Le jugement est paradoxal. Une personne qui dira être responsable de ce qui lui arrive sera jugée positivement, parce qu’elle incarnera un ordre social qui s’exprime dans les maximes « quand on veut on peu », « le monde est juste quelque part », traductions d’un accord psychosocial vital, puisque si on veut prendre part au jeu il faut avoir cette croyance, même si elle est illusoire.
En formation, je ne demande pas aux professionnels d’abandonner cette croyance, mais de croiser responsabilité et temps. Les situations d’instabilité sociale et de précarisation tendent à faire que la personne se focalise sur le passé, dans la rumination des événements négatifs et dans le sentiment d’avoir raté quelque chose (elle ne sait pas forcément quoi, la vie normale sans doute). Parce que tout le monde l’enjoint à faire des projets, et qu’elle ne voit pas du tout vers quoi l’avenir la mène, l’intention va se tourner vers le passé : « j’aurais du faire », « si j’avais su j’aurais fait », ce qui ne permet pas d’aller vraiment vers l’action. La responsabilité dans le passé doit être totalement levée. Quel intérêt il y a à rendre quelqu’un responsable de son passé ? Ceci étant posé, cela permet de reconsidérer certains outils, comme le curriculum vitae. Dans le cadre de l’aide au retour à l’emploi, la logique temporelle d’une intervention fondée sur le CV pour élaborer un projet professionnel est d’établir une continuité entre le passé et un futur. Or les vécus précaires, constitués de multiples expériences hétérogènes, ne correspondent pas à la linéarité et à la narrativité attendue dans le CV, sensé représenter une expérience sociale cumulative, une « carrière ». Tout comme le projet, le CV s’établit comme une contrainte temporelle qui s’oppose aux vécus des publics à qui on en fait la demande. Ce conflit temporel instaure des relations de pouvoir qui favorisent le non-recours et l’abandon des droits.
Dans les métiers du social, il y a des fonctionnements divers, tous ne sont pas dans la logique de responsabilisation, de projet, avec une volonté de « changer » la personne…
Même si la tendance va clairement dans ce sens, il y a en effet des relations d’aide qui peuvent ne pas fonctionner sur le principe de la délégation du contrôle à l’aidé. Au contraire, c’est l’aidant qui prend en charge, le contrat est clair. Il ne s’agit pas de rendre la personne responsable, mais de prendre en charge son « irresponsabilité » via la relation d’aide. Ces dispositifs n’ont pas comme prérequis de rendre la personne actrice dès le départ. On pourrait presque rendre compte du champ des politiques sociales avec un schéma à quatre axes : dirigé vers le futur ou peu, suscitant beaucoup de contrôle ou peu. Cela permettrait d’évaluer à quel type de public et de dispositions s’ajustent ces politiques et quels efforts elles demandent.
Des chercheurs indiquent que le principe de l’activation est de plus en plus central dans les politiques sociales et d’emploi, exigeant des bénéficiaires qu’ils fournissent davantage d’efforts, par exemple pour intégrer le marché du travail. Voyez-vous dans les pratiques des travailleurs sociaux ce référentiel de l’activation mis en œuvre ?
Ce que j’observe, c’est la figure centrale de l’acteur, qui voudrait que les usagers des politiques sociales soient acteurs. Dans les faits, c’est la même chose que le reste à charge dans la consultation chez le médecin. Il faut que le patient paye, même un tout petit peu. Dans les formulaires, cela va se traduire par une partie qui restera à remplir par l’usager, sans que cela ne se justifie, sinon par la raison suivante : « lui aussi, il faut qu’il fasse quelque chose, je ne vais pas tout faire ! » On observe les effets délétères du reste à charge sur les plus fragiles dans le non-recours. Si l’évaluation des capacités de la personne n’a pas été faite, et qu’on laisse le dernier tiers du formulaire à remplir par la personne pour co-construire le projet, l’effet est désastreux. Lors de mises en situation, les professionnels du social ne pouvaient expliquer pourquoi ils agissaient ainsi, sinon par les formules « il faut quand même que les bénéficiaires donnent/fassent un peu », « je ne vais pas tout faire non plus », ce qui est aberrant alors que sur ce projet c’est le travailleur social qui a complètement la main. Je pense que cette façon de raisonner existait avant même que le référentiel de l’activation arrive.
A travers la logique du reste à charge, est-ce de l’adhésion qui est recherchée ?
Oui, mais il faut voir que l’adhésion sous la contrainte est une injonction paradoxale, d’autant que l’on veut que les gens soient partie prenante du projet. Quand le travailleur social attend que la personne remplisse elle-même un formulaire, recherche-t-elle la didactique par l’exemple et l’exercice (du type, je fais, après vous le ferez vous-même), ou le savoir expérientiel (la personne doit faire l’expérience de …). ? Si on veut de l’expérientiel, pourquoi ne pas faire autre chose de plus constructif, et en amont réfléchir au sens de cette participation ? Si l’on veut de la contrainte, il faudrait assumer qu’on est dans un système de contrainte, au lieu de faire semblant d’être dans une éthique de la participation. Ces objectifs ne produisent pas les mêmes effets, et renvoient au débat qui devient inévitable en psychologie sociale, celui des incitations et des nudges.
Que sont les nudges ?
Ce sont des systèmes de cadrage de l’architecture des choix, qui amènent des gens à faire ce qu’ils ne font pas spontanément en influençant la situation de choix, et ce sur la base de ce qu’ils ont pu exprimer à un moment comme étant leur propre intérêt. Les individus n’ont pas conscience qu’ils sont soumis à une situation qui les influence dans un sens déterminé, et qui produit ensuite leur engagement par rationalisation. Les nudges sont utilisés sans vergogne dans les politiques publiques au Royaume-Uni. Pour réduire le non-recours, une solution très simple est mise en œuvre : le droit est activé par défaut, si on veut le refuser, il faut se désinscrire (op-tout). Les usagers sont poussés à agir (nudge signifie « coup de coude » en anglais) par les concepteurs des politiques publiques, de manière volontaire, mais non transparente.
D’où viennent ces principes ?
Ils proviennent d’une synthèse des travaux en psychologie sociale et en économie comportementale, réalisée par Richard Thaler et Cass Sustein1, qui les amène à proposer un nouveau paradigme pour l’action publique : le paternalisme libertarien. Il s’agit de prendre acte du fait que toute situation exerce une influence sur les choix, que celle-ci soit volontaire ou pas. La manière dont on présente des options ou des alternatives, dans les discours ou dans les faits, détermine la réponse « dominante » c’est à dire celle qui sera plus facilement choisie par une majorité d’individus. Sans rien changer aux options proposées, ni entamer la liberté de choix, il s’agit d’obtenir le choix souhaitable en fonction d’intérêts exprimés par les gens eux-mêmes. D’inspiration libérale, cette approche rejette toute régulation (le « libertarien ») tout en assumant la directivité de l’action publique (le « paternalisme »). Au-delà du plaidoyer libéral, le concept de nudge a le mérite de souligner l’apport de la psychologie, sociale en particulier, à la conception de l’action publique. Par défaut, la conception des politiques publique court le risque de produire ce qu’on a appelé avec Frédéric Martinez des nudges dissuasifs, c’est à dire des architectures de choix qui décourage le recours et l’adhésion à l’action publique.
Auriez-vous des exemples appliqués aux politiques sanitaires et sociales ?
Cela consisterait par exemple à activer par défaut les droits sociaux pour les personnes éligibles, libre à elles ensuite de choisir de renoncer à ces droits. Autre exemple de nudge, l’expérimentation conduite en ce moment à la Guillotière, qui a consisté à habiller d’une fresque un escalier, pour influencer le choix de l’utiliser plutôt que l’escalator, afin d’encourager une activité physique gratuite et pourtant efficace pour réduire la prévalence de certaines pathologies. Il y a également tout ce qui relève de la communication et de la relation, qui consiste à ajuster des arguments (framing) ou le contexte dans lequel on communique (priming) afin de réduire l’effet dissuasif de communications mal ajustées, voire pour augmenter leur impact persuasif. Par exemple, le rapport au temps étant marqué par l’immédiateté, en particulier dans les situations de précarité sociale qui empêchent une projection sereine dans l’avenir, les arguments dirigés vers le futur pour justifier des pratiques coûteuses sur le moment (typiquement, supporter un emploi ou une formation sans intérêt dans l’espoir de renouer dans le futur avec le marché de l’emploi…) ne sont pas seulement inefficace, mais dissuasifs. Ces éléments amènent à repenser le cadre dans lequel on communique et on agit en fonction des dispositions psychosociales des publics ou usagers concernés par l’action publique. Enfin, dans un autre domaine, la référence à des normes sociales peut constituer un levier extrêmement efficace pour persuader des gens à s’engager dans des comportements considérés comme souhaitable (partager sa voiture, trier ses déchets, réduire sa consommation énergétique….). Toutes ces stratégies peuvent être conçues de manière plus ou moins participative et transparente. Tout l’enjeu éthique des nudges se situe à ce niveau-là. Quant aux enjeux théoriques, ils sont multiples, les nudges ne relevant d’aucune définition conceptuellement claire en psychologie sociale, mais regroupant des processus très divers et parfois théoriquement contradictoires. Reste qu’il s’agit d’un mouvement utile de prise en compte des apports de la psychologie sociale à l’action publique, qui existe depuis des décennies au Etats-Unis par exemple (à l’image de la Society for the Psychological Study of Social Issues), et qui commence seulement à émerger en France.
L’utilisation possible des nudges provoque-t-elle des débats ?
En France le débat viendra mais il n’est pas encore là, alors qu’au Royaume-Uni des actions collectives sont envisagées contre l’Etat pour avoir mis en place ces formes d’incitation comportementale. Les nudges interrogent assez loin l’éthique et la pratique des politiques publiques. Les politiques sociales telles qu’elles sont construites fondent une architecture de choix dissuasive qui suscite un niveau élevé de non-recours aux droits sociaux. La posture de l’acteur autant que la démarche de projet amènent ceux qui en ont le plus besoin à renoncer. Quand on le sait, on ne peut pas laisser l’architecture telle qu’elle est, c’est d’ailleurs ce qui amène les travailleurs sociaux qui en ont pris conscience à changer de comportement, en s’inventant des outils sur le rapport au temps, à l’espace, aux autres. Ils engagent une réflexion sur l’accueil (réaménagement de l’espace), sur la manière d’amorcer la relation, sur l’organisation de leur agenda, sur le message qu’ils vont porter dans leur institution sur la question du temps long, le tout sans renoncer à l’efficacité, au contraire. Cela peut par exemple amener à réduire les « portefeuilles » (nombre de personnes suivies) tout en augmentant le taux de sortie positive.
L’ouvrage Nudge de Richard Thaler et Cass Sunstein (New Haven, Yale University Press, 2008) est une référence en la matière. Il propose des solutions à des problèmes de santé publique, d’épargne ou d’écologie. Les options par défaut, les incitations financières, les mécanismes de feedback, les effets d’entraînement sociaux sont des nudges au sens où ils pèsent sur nos décisions tout en nous laissant apparemment libres de choisir. Thaler et Sunstein ont choisi le terme de « paternalisme libertarien » pour désigner cette doctrine, qu’ils définissent comme « une version relativement modérée, souple et non envahissante de paternalisme, qui n’interdit rien et ne restreint les options de personne ; une approche philosophique de la gouvernance, publique ou privée, qui vise à aider les hommes à prendre des décisions qui améliorent leur vie sans attenter à la liberté des autres ». Les politiques publiques peuvent par conséquent exploiter la passivité des individus en mettant en place d’office les options par défaut qui les poussent à prendre des décisions jugées plus avantageuses. Le cadrage (framing) est également un nudge efficace qui consiste à guider la pensée par l’utilisation du langage (la métaphore républicaine employée pour parler de réduction d’impôts « tax relief », rapidement passée dans le langage courant, suggère un soulagement d’une charge excessive, et crée un cadrage définissant de façon très péjorative le fait de payer ses impôts). Les auteurs estiment que l’organisation du contexte dans lequel nous prenons nos décisions peut nous orienter dans une direction donnée.

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?

Étude
Comment le care peut renouveler notre rapport à l’autre, à la société, à la nature et aux objets ?

Interview de Ariella Rothberg
Psychologue clinicienne et anthropologue
Est-ce que de l’information, de la sensibilisation aux différentes cultures est suffisante ?

Interview de Hélène Monier
Enseignante chercheuse à BSB école de commerce de Dijon
Comment gérer les incidents du facteur émotionnel face à des incidents sur le lieu de travail dans des métiers à risque ?

Étude
Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant

Texte d'Anouk JORDAN
Les violences avec le public témoignent de la difficulté d’exercer le métier de travailleur social dans les organisations concrètes du travail que sont les collectivités territoriales.
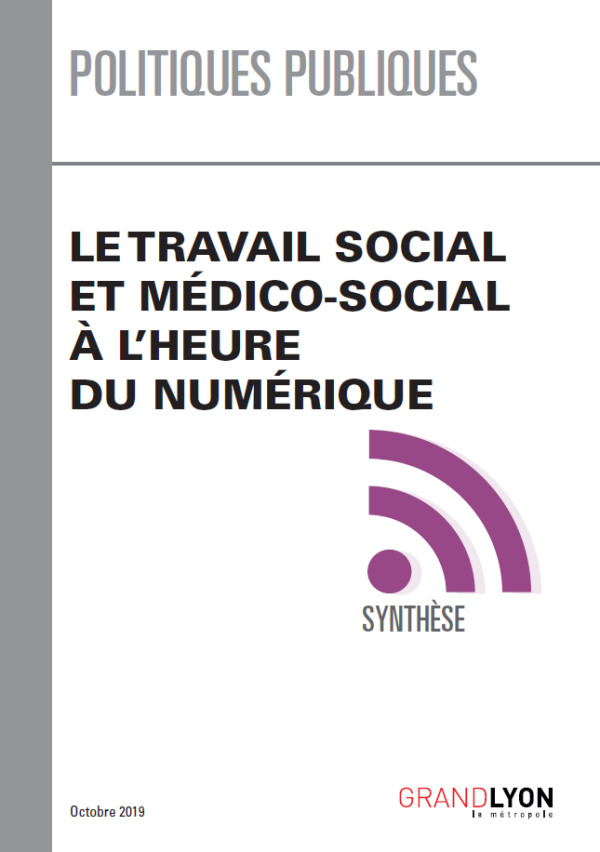
Étude
Cette synthèse explore l’impact du numérique sur le travail social et médico-social auprès des services publics locaux.

Interview de Johann Rony et Olivier Carbonnel
Assistants de service social et psychologue
« Le numérique est aujourd'hui un territoire supplémentaire à aller investir pour faire de la prévention »

Interview de Jean-Pierre Rosenczveig
Ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny