Un exemple de mobilisation contre les dysfonctionnements des lignes TER par une association d'usagers

Interview de Jean-Pierre Frencel
Président de l’Association de Défense des Usagers de la ligne Lyon / Ambérieu-en-Bugey (ADULA)
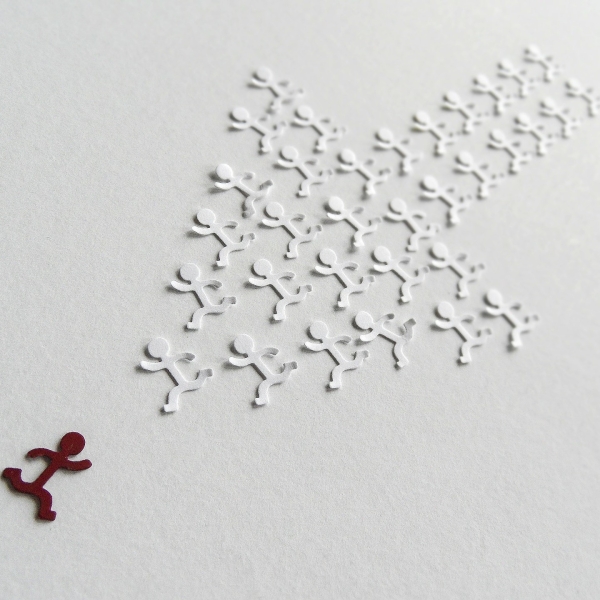
Dossier
Dans le sillon des expériences initiées dans le cadre de la politique de la ville depuis les années 80, se mettent en place dans les collectivités territoriales une panoplie de dispositifs participatifs visant à corriger le plus efficacement possible les failles de la démocratie représentative. Or ce phénomène s’accompagne d’un certain nombre de paradoxes soulevés par Loïc Blondiaux lors du débat rétro-prospectif organisé par le Grand Lyon en février 2010, « le Grand Lyon qui dialogue »: à la fois irréversible et impliquant des transformations réelles de concevoir l’action publique et construire les politiques publiques, la participation citoyenne suscite par ailleurs des critiques permanentes et un désenchantement certain au regard des limites éprouvées dans la pratique.
Parmi ces limites, la peur du conflit et du rapport de forces qui conduit trop souvent - le plupart du temps de façon non consciente - les institutions publiques à organiser des scènes de participation visant la production de consensus et le lissage de controverses. Celà entraîne un décalage croissant avec une demande sociale façonnée notamment par les réseaux sociaux et les mobilisations collectives spontanées fondées sur l’instauration de rapports de force avec les pouvoirs publics.
Face à ce relatif épuisement du modèle de démocratie participative à la française, de nouvelles expériences montent en puissance, en partie inspirées du monde anglo-saxon ou des pays du Sud. Regroupées sous la bannière de l’empowerment — ou renforcement du pouvoir d’agir des citoyens — s’appuyant sur des méthodes et des bagages théoriques issus notamment de la philosophie pragmatique, ces expériences renouent avec une approche de la démocratie plus conflictuelle que consensuelle.
Pour éclairer les modes d’agir politique qui se font ainsi jour aux marges du système représentatif, le Grand Lyon a souhaité explorer le sujet de la conflictualité autour de la chose publique. Où et quand se manifestent des conflits entre institutions et citoyens, sur la gestion de ce qui est considéré comme relevant du « bien commun » ? Comment se construisent des mobilisations collectives ou des rapports de force qui bouleversent parfois les conditions de la légitimité démocratique ou la conduite des politiques urbaines ? Quelles alliances, quelles compétences, quels registres argumentaires les acteurs impliqués mettent-ils en œuvre pour faire avancer leur cause ? En quoi ces conflits interpellent-ils le fonctionnement des collectivités locales ou des institutions en charge du service public ? Comment passe-t-on, parfois, du registre de la conflictualité à celui de la coopération, et à quelles conditions les conflits peuvent-ils être « créatifs » ?

Interview de Jean-Pierre Frencel
Président de l’Association de Défense des Usagers de la ligne Lyon / Ambérieu-en-Bugey (ADULA)
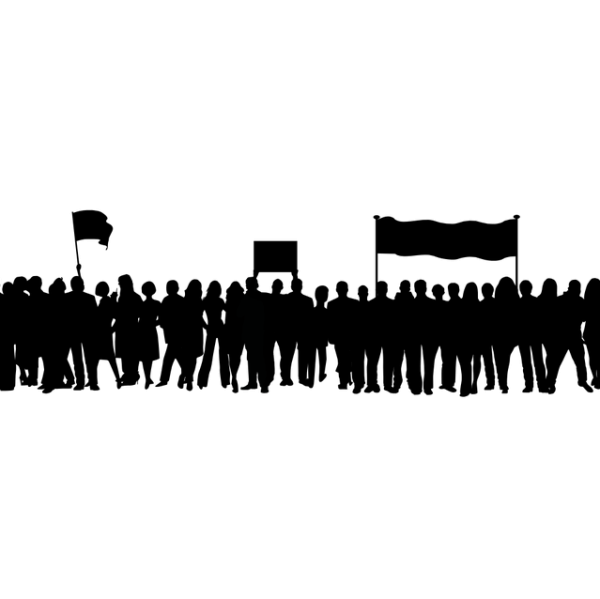
Interview de Mathieu Gouttefangeas
Porte-parole de l’Association de défense des usagers de la ligne Lyon / Saint-Etienne (ADULST)
![Couverture de l'essai "Le Conflit" de Georg Simmel [Circé I Poche]](https://millenaire3.grandlyon.com/var/m3/storage/images/_aliases/largeur_max_600/3/4/0/7/17043-2-fre-FR/Le Conflit.PNG)
Étude
Dans cet essai, Simmel met en évidence l’apport positif des conflits dans la vie sociale.
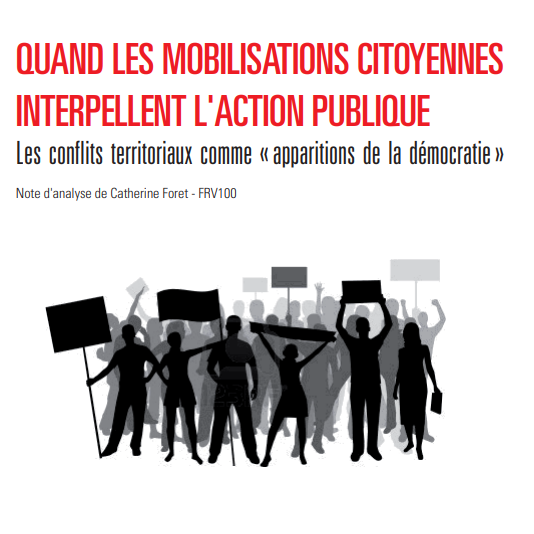
Étude
Cette note s’appuie sur diverses études de cas pour éclairer les registres d’action à l’œuvre dans les conflits territoriaux, ainsi que les évolutions qu’ils entraînent.
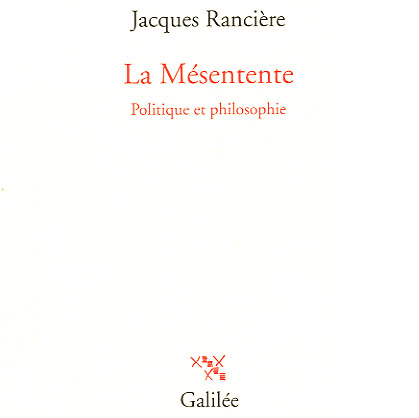
Étude
Jacques Rancière a développé une pensée originale du politique, qui postule la possible participation de tous à l’exercice de la pensée, donc au gouvernement de la cité.

Article
En cette ère où la technologie transforme comme jamais l’espace public et l’exercice du pouvoir, il devient indispensable de comprendre ces mécanismes.

Interview de Thomas Perroud
Professeur de droit public
Le droit privé encadre désormais une large part de l’action publique, notamment par le biais des privatisations, d’externalisations et de nouvelles formes de contractualisation.

Interview de Florian Fomperie
Directeur d’antenne de Radio Anthropocène
Une multitude de médias associatifs, locaux et citoyens pourrait-elle un jour constituer un rempart contre la désinformation et le manque d’indépendance des médias mainstream ?

Interview de Alain Eraly
Professeur de l’Université libre de Bruxelles (ULB), membre de l’Académie royale de Belgique
Partout, l’autorité est mise en cause.

Interview de David Le Bras
Délégué général de l’Association des directeurs généraux des communautés de France
Et si… la transformation écologique devenait la matrice des politiques intercommunales ? Retour sur cette réflexion collective.

Interview de Vincent Dubois
Professeur à l’Université de Strasbourg et membre du laboratoire SAGE
Retour sur le renforcement du contrôle et de la sanction des assistés sociaux depuis les années 1990, jusqu'à la mise en place d’une politique organisée du contrôle.

Article
À qui fait-on confiance ?

Article
Un rapide tour d’horizon des luttes contre les pollutions toxiques qui permet d'identifier des types de mobilisations citoyennes

Interview de Olivier Aïm
Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, chercheur en théorie des médias et industries culturelles
Quelles sont les grandes évolutions en matière de surveillance ?