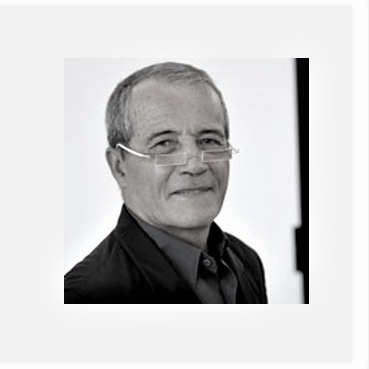Dans votre étude, vous émettez l’hypothèse que « L’art public est une discipline en mutations récurrentes ». Comment se caractérisent ces différentes mutations ?
On regarde trop souvent l’art public avec des valeurs contemporaines, dans un contexte où l’artiste a acquis une grande capacité à forger ses propres problématiques. Mais au moins jusqu’au XIXe siècle, l’artiste était le partenaire du pouvoir, qu’il soit temporel ou religieux. La nécessité d’incarner, de représenter, de symboliser le pouvoir était intimement mêlée à la dimension artistique. L’artiste n’était pas encore « autonome ». Cette dépendance aux pouvoirs est toujours pour partie vraie aujourd’hui s’agissant d’art public, ne serait-ce que parce qu’il faut des autorisations pour intervenir sur l’espace public.
Cela dit, un premier infléchissement se produit au XIXe, alors que les productions artistiques changent, qu’apparaissent de nouvelles formes esthétiques, qui contreviennent de plus en plus radicalement aux « canons » définis par l’Académie des beaux-arts. Toutefois, l’art public demeurera encore longtemps soumis aux formes académiques. Les innovations esthétiques, les conceptions nouvelles du rôle de l’art, les débats artistiques se tiennent dans un premier temps essentiellement par la peinture, l’art dans l’espace public demeurant très conventionnel.
De fait, il y a au moins cent ans de décalage entre les innovations esthétiques de l’art moderne et des avant-gardes et l’art qui est installé dans l’espace public. Le raccordement entre esthétique novatrice et commande publique ne s’esquisse que lors de l’entre deux-guerres. C’est aussi à ce moment-là que l’on commence à réaliser que les musées sont passés à côté des avant-gardes du début du siècle. Et en un sens, la puissance publique devient elle aussi très innovante, elle se dote d’outils qui lui permettent de « suivre » l’actualité de l’art. Est alors mis en place un mécanisme spécifique, le 1%, pendant que la commande publique est redéfinie, pour permettre de faire travailler des artistes en phase avec la contemporanéité.
Et ensuite, après la seconde guerre mondiale, la situation a-t-elle continué à se transformer ?
Oui, cela n’arrête pas de bouger… Pas de manière linéaire d’ailleurs, car on va trouver des expériences, qui sont effectivement novatrices, pendant que perdurent des projets plus conventionnels, qui auraient pu être faits 100 ans plus tôt ou je suppose, 100 ans plus tard… Cela dit, une seconde phase émerge dans les années 50-60 : les artistes les plus novateurs sont alors parvenus à faire valoir leur point de vue et on les invite à mettre en place leurs œuvres dans l’espace public. Il n’est plus alors question d’une relation directe au pouvoir, mais plutôt pour les collectivités publiques de montrer leur ouverture à la modernité. Ce faisant elles s’appuient souvent sur des artistes qui ont un style, une identité visuelle, et qui posent leur signature dans l’espace public. La question de savoir qui instrumentalise qui demeure pendante…
Puis, dans les années 70, sous l’influence du land art et de l’art conceptuel, on peut repérer une nouvelle direction de travail : on commence à dire qu’une œuvre doit être créée in situ, en relation avec son environnement. L’exemple le plus caractéristique est celui des Villes nouvelles, qui développent des projets très intéressants en termes d’intégration de l’artiste dans l’urbain, bien que ces projets soient aujourd’hui oubliés. Le projet Rives de Saône, qui se met en place le long des berges de la Saône sur l’agglomération lyonnaise, s’inscrit dans cette filiation. Mais on voit bien qu’on est dans une histoire lente : la pertinence de démarches qui conduisent à intégrer des artistes dans un projet d’aménagement urbain n’est que très progressivement appropriée par les décideurs, comme par les journalistes ou le public d’ailleurs.
Pourquoi, si la démarche in situ est selon vous la plus pertinente, n’est-elle pas davantage une évidence ?
Les objets réalisés dans ces conditions sont très largement hybridés. Or dans un pays comme le nôtre, où l’on aime les classifications, les catégories strictement définies, où l’on est cartésien jusque dans notre approche de l’art, on a beaucoup de mal à situer des projets qui ont des dimensions urbanistiques, architecturales sans parler de leurs résonances sociales ou politiques… Et le plus souvent, ils sont condamnés par la polémique au moment de leur apparition : ceci n’est pas de l’art puisque l’objet n’est pas produit selon le processus habituel.
Ce phénomène de rejet ou de minoration ne concerne pas seulement les arts plastiques. Si l’on regarde le Défilé de la Biennale de la danse, on constate qu’on a beaucoup de mal à trouver des discours, des approches qui appréhendent les différentes facettes de cette manifestation. En effet, le Défilé ressort à la fois de l’artistique, du politique, de l’urbain, du social, de la participation, et cette liste n’est pas exhaustive ! Là encore, les capacités d’appréciation ne changent que lentement et on ne reconnaît que depuis peu que pertinence esthétique et action sociale ne sont pas incompatibles.
L’agglomération lyonnaise s’est préoccupée un peu tard d’art public. Qu’est-ce qui vous semble le plus intéressant dans les réalisations d’art public à Lyon ?
Il me semble qu’il s’est passé quelque chose de très marquant à Lyon avec les parcs de stationnement de Lyon Parc Auto. Cette procédure, qui consiste à associer un artiste, un architecte et un maître d’œuvre, a été à la fois innovante et pertinente. Et une fois encore, elle trouve ses racines dans les expériences conduites dans les villes nouvelles dans les années 70. C’est donc en partie une résurgence d’une démarche intéressante à tous points de vue : pour les artistes, obligés à sortir des sentiers battus, pour le commanditaire, qui instaure un dialogue avec le projet d’un artiste et ne se contente pas de dire « posez vos rayures ici ! ». Ça montre que l’artiste est inscrit dans le champ social. Il ne se contente pas de mettre sa signature dans l’espace public.
N’est-ce pas paradoxal que le plus intéressant soit « caché » sous terre ?
Le fait que ce soit souterrain est peut-être révélateur d’une relation pas tout à fait assumée lorsqu’il s’agit de travailler avec des plasticiens contemporains, pourtant souvent très reconnus. Mais, paradoxalement, l’espace qui leur a été dédié a permis la qualité des œuvres. Auraient-ils été aussi créatifs sans ces conditions particulières de production ? Car les parkings étant des lieux très spécifiques, qui sont les derniers endroits où l’on voudrait mettre de l’art, les œuvres en sont d’autant plus singulières.
Et ce n’est pas parce qu’elles n’ont pas une grande visibilité qu’elles sont moins fortes. Je trouve que l'œuvre de Daniel Buren est beaucoup plus intéressante au parc des Célestins que sur la place des Terreaux, où elle est pourtant nettement plus visible. Dans le parking des Célestins, le dialogue artiste / architecte a magnifiquement fonctionné. Ça pourrait faire partie des monuments à visiter ! Et descendre en voiture le long de cette vis presque sans fin et remonter, voilà une performance en libre-service tout à fait excitante… C’est une superbe réussite qui n’est pas totalement vue à sa juste audace. C’est une démarche qui reste encore à la marge du monde de l’art et des territoires urbains.
Vous abordez aussi dans votre étude les réalisations non pérennes, événementielles ou « en kit » ; sont-elles des nouvelles tendances de l’art public ?
La période actuelle atteste à mes yeux d’une nouvelle mutation des arts publics. À côté des initiatives très institutionnelles, encadrées par des procédures nécessairement lourdes et complexes, on pourrait parler d’un « nouvel art public ». Ces productions explorent de nouvelles dimensions : l’éphémère, les tous petits espaces, les interstices urbains », les nouvelles technologies – et notamment le in situ relayé sur Internet –.
Ce ne sont pas uniquement des interventions plastiques ; beaucoup sont à la lisière du spectacle vivant. Je pense par exemple qu’on peut tout à fait envisager le flash mob comme un aspect de ce nouvel art public. De plus, ces démarches sont souvent hybrides. Certaines ont une dimension militante et portent en elles une critique de l’urbanisme actuel. Elles questionnent la ville dans la ville même. Autrement dit, le nouvel art public « dit » énormément de choses sur notre vie aujourd’hui, il est en prise avec le monde actuel. Et ces « objets », qui sont difficilement catégorisables, sont pas ou peu valorisés.
Vous estimez que « l’espace public redonne du sens à la notion même de transgression ». En quoi ?
L’artiste démiurge, qui développerait son propre « monde » est exceptionnel. De plus, c’est aujourd’hui une conception datée du travail artistique : envisager qu’un artiste cherche à développer un univers est une conception issue du romantisme. C’est au mieux un rêve, au pire une mystification. Il n’y a en effet quasiment plus d’œuvres qui ne soit pas en lien avec leur environnement, qui ne résultent pas, d’une manière ou d’une autre, d’une subvention, d’un sponsoring, d’une commande. Ce qui ne disqualifie en rien la qualité de ces productions, simplement, le mythe de l’artiste démiurge et souverain s’est affaiblit. Les œuvres intéressantes sont conçues dans la contrainte d’un contexte, en s’appuyant sur un environnement physique, social, etc.
J’ajouterais aussi, qu’à force de vouloir sanctuariser l’art, on prend le risque de le mettre sous cloche, d’en faire une expérience de laboratoire… Les promoteurs de l’autonomie de l’art sont aussi ses fossoyeurs : en le détachant de son environnement social, on l’affaiblit, ne serait-ce que parce que nous sommes dans une société où il faut sans cesse démontrer son utilité. Or, même si l’on se place uniquement sur la question du « beau », il est possible de démontrer son utilité. La contrainte étant productive, l’art trouve dans l’espace public un contexte particulièrement riche… Aussi, il peut y puiser des ressources pour être productif, inventif, pour réaliser le « pas de côté » qu’on attend des artistes. Il n’est donc pas forcément plus transgressif parce qu’il est dans l’espace public, mais il peut y trouver une pertinence particulière. Et si une œuvre est pertinente, c’est déjà beaucoup !
Au-delà des questions artistiques ou esthétiques, que révèlent selon vous ces nouvelles pratiques dans l’espace public ?
L’art dans l’espace public est un bon indicateur du fait que les pratiques artistiques, les envies de s’exprimer par le symbolique, ne sont plus réservées aux seuls artistes. De même que le journalisme n’est plus réservé aux seuls journalistes ou que la recherche n’est plus réservée aux seuls chercheurs, comme en attestent les sites collaboratifs du type Wikipedia, les blogs, etc. Cependant, c’est une chose de constater ce goût pour la participation, cette mise en place d’une société de la contribution, et c’en est une autre d’en tirer les conséquences en termes professionnels. On comprend sans peine pourquoi les acteurs qui ont un métier identifié, rechignent à regarder des productions qui peuvent s’avérer pertinentes et qui sont donc autant de « concurrents » potentiels.
Partager un monopole n’est jamais une démarche spontanée, cependant, le monde est ainsi aujourd’hui : il n’y a plus de chasse gardée, de positions acquises… Toutes les professions intellectuelles et artistiques sont soumises à ce nouveau tropisme. Cette dé-définition de la profession, cette capacité à s’exprimer dans un champ, alors qu’on est soi même issu d’un sérail différent est devenu une réalité, qui n’est pas encore prise en considération par les professionnels, pas plus que par les institutions et les politiques publiques. Mais avec Internet notamment, les individus ont une capacité inouïe pour s’exprimer. Et concomitamment, ils peuvent aussi faire leur propre promotion. Ils peuvent se dispenser en partie au moins des professionnels, de la grande presse. Ils contournent les relais de validation, ce qui remet en cause à la fois ces relais et les modalités de repérage des expressions nouvelles. À l’heure actuelle, on sait à peine que des gens s’expriment ! Il faudra bien un jour ou l’autre jeter un œil sur ce qu’ils font… Si de plus en plus de choses se produisent indépendamment des professionnels et des institutions, qu’est-ce que cela implique ? Il faut parvenir à analyser, à décrire, à valoriser ces productions. Il y a tellement de démarches intéressantes, amusantes, pertinentes et certainement aussi beaucoup sans grand intérêt… Mais est-ce parce qu’il y a « trop » d’initiatives et de démarches nouvelles, qui semblent partir dans tous les sens, qu’on ne doit pas les regarder ? Cette position ne me semble pas tenable très longtemps…
Comment repérer et valoriser ces nouveaux arts publics ?
Ce qui serait intéressant et nouveau, serait de porter un regard sur toutes ces expériences. L’agglomération pourrait être à l’initiative de ce processus de regard, d’analyse et de restitution grand public. Cela pourrait par exemple passer par une plateforme dédiée aux nouveaux arts publics via laquelle, des professionnels livreraient leur analyse. Des sociologues pourraient aussi être associés à ce travail. On y verrait sans doute plus clair dans la multitude de ces productions, qui n’émanent pas toutes de professionnels, loin s’en faut : amateurs, militants, collectifs, s’expriment aujourd’hui dans l’espace public. Comme je le disais, on les connaît mal, et ceci est d’autant plus surprenant si l’on considère l’ampleur de ce phénomène.
Actuellement, les professionnels de l’art contemporain n’arrivent pas à intégrer dans leur logiciel d’analyse toute une série de nouvelles démarches, qui mériteraient pourtant d’être qualifiées par des gens dont c’est le métier. Il faut trouver des professionnels ou des gens capables de parler de ces pratiques émergentes. Les professionnels de l’art sont souvent conformistes, même lorsqu’ils sont à la pointe de l’innovation. Une situation paradoxale quand on sait que ces acteurs ont pour ambition de repérer ladite novation. Si l’on constate qu’il se produit « quelque chose » sur l’espace public, les professionnels devraient s’en saisir et dire ce qu’ils en pensent, leur silence actuel ne peut pas être considéré comme une qualification ou une disqualification…
L’agglomération lyonnaise est-elle légitime à se positionner sur ce secteur ?
Il y a quand même une histoire sur les arts plastiques sur l’agglomération. On n’est pas tout nus ! Il y a le Musée d’art contemporain à Lyon, l’Institut d’art contemporain à Villeurbanne, la Biennale d’art contemporain, des centres d’art très pertinents dans la périphérie, une école d’art, des artistes et quelques galeries. Pour autant, l’agglomération n’est pas identifiée, et ne s’identifie pas elle-même comme un territoire d’arts plastiques. Or, si l’on essayait de travailler sur les nouveaux arts publics, le Grand Lyon pourrait sans doute à la fois se distinguer et entreprendre une action nécessaire, et qui plus est, pas nécessairement coûteuse. S’il devenait le territoire qui a su repérer et analyser les nouvelles pratiques artistiques sur l’espace public, il me semble que cela lui serait bénéfique.
C’est un peu ce qui s’est produit sur le hip-hop dans les années 90, il n’y avait pas de raison que l’agglomération deviennent « le » territoire du hip hop, mais grâce à l’action très originale menée par la Maison de la Danse et ses partenaires, la reconnaissance de cette émergence a été en partie au moins, initiée par ce territoire. Plus largement, je fais l’hypothèse que l’agglomération lyonnaise est parvenue au stade où elle peut faire prévaloir ses propres valeurs et non plus suivre des règles édictées ailleurs. Par exemple, est-il toujours indispensable de faire une Biennale d’art contemporain en se conformant sans inventivité aux règles professionnelles du monde de l’art ? Évidemment qu’il faut respecter les professionnels de l’art, mais proposer des inflexions, se tenir aux avant postes, c’est aussi une manière de faire très pertinente pour une collectivité publique. Ce serait une position originale en termes de politique culturelle : s’appuyer sur les ressources existantes, suggérer des pistes aux professionnels, les accompagner dans une prise de recul, eux qui sont trop souvent, de leur aveu même, « le nez dans le guidon ».