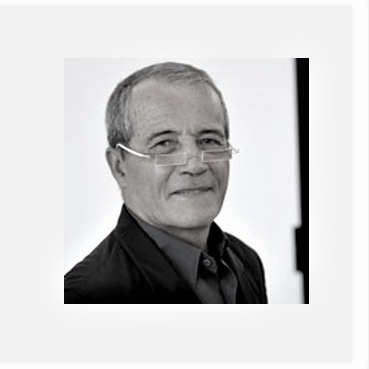Qu’est-ce qui caractérise l’art public à Lyon ?
Sa discrétion. A la différence de certaines villes qui ont vraiment affirmé cela dans leur politique comme Nîmes dans les années 86-90 ou Strasbourg – qui est à mes yeux exemplaire - Lyon a toujours été discrète.
Ce qui est très remarquable à Lyon, c’est la qualification des espaces publics, et notamment paysagers. Ainsi que la mise en lumière de la ville. L’art n’y est pas forcément visible, mais est ressenti dans la qualité même de l’environnement, par la mise en lumière des bâtiments, le traitement rigoureux ou poétique du végétal, des parcs et des jardins, l’harmonisation de la signalétique comme du mobilier…On peut citer également les interventions artistiques dans les parkings publics lyonnais, liées à une architecture soignée et une signalétique sobre et discrète. Elles sont enviées par bon nombre de villes françaises ou étrangères.
La qualification s’est donc ancrée dans l’aménagement urbain. Dans le travail demandé à un paysagiste comme Michel Corajoud par exemple. Et moins dans l’appel à des artistes pour créer des œuvres monumentales.
On a presque préparé le terrain pour qu’après, les œuvres s’inscrivent dans cet espace. Je pense à la Cité internationale. Ce n’est qu’en fin de réalisation du Grand Amphi de la Cité internationale qu’est intervenu l’artiste Xavier Veilhan au titre du 1% ; cette œuvre, dispersée dans l’espace de la Cité est drôle, dérangeante et juste dans le jeu sur les échelles.
A Lyon, les interventions artistiques dans l’espace public sont donc discrètes, mais multiples et diffuses…
Il s’est fait effectivement beaucoup de choses, mais il n’y a jamais eu de communication globale, de valorisation de cette politique. D’où le grand mérite de Marianne Homiridis et Perrine Lacroix d’avoir recenser toutes les œuvres existantes dans le précieux guide : « l’art contemporain dans les espaces publics/ Territoire du Grand Lyon – 1978/2008».
Comment s’est développée cette politique d’art public à Lyon ?
L’événement fondateur fut le 1er Symposium de sculptures en 1978 : quelques œuvres sont restées. Puis en 1980, beaucoup ont été installées dans le quartier de la Part-Dieu : politiquement, il était important de tenter de faire en sorte que la population s’approprie ce quartier qui était très décrié. Il s’agissait d’ « adoucir » peut-être la brutalité architecturale et urbanistique de ce nouveau quartier. Le 2e Symposium a davantage éparpillé les œuvres, et créé des parcs de sculptures, sur le modèle américain : c’était au goût du jour. Francisque Collomb qui était amoureux d’Ipousteguy en a commandé peut-être plus que de raisons : on en compte 4 à Lyon, ce qui fait beaucoup !
Villeurbanne a eu une politique beaucoup plus raisonnée, avec une volonté affichée de présence de l’art dans l’espace public, et l’idée de faire intervenir les artistes à un certain nombre de carrefours dans l’aménagement urbain. C’est ainsi qu’ont été réalisées, dans les années 1987/89 les œuvres d’Etienne Bossut (« Autour d’un abri jaune »), de Patrick Raynaud (« Giratoire ») et de Jacques Vieille.
Vénissieux, grâce à Madeleine Lambert, a eu la volonté de mettre la population en habitat social en contact avec les œuvres. Quand les tours des Minguettes ont été rénovées, Vénissieux a voulu introduire de manière très vigoureuse la présence de l’art.
Je me souviens du projet « Tour blanche » de Jean-Pierre Reynaud en 1984. C’est une œuvre emblématique de la réponse très violente et très belle d’un artiste à un problème social très violent. Il s’agissait de recouvrir de carreaux blancs et ainsi magnifier une des tours, vouée à la destruction. Mais il fallait que le ministre de la Culture, Jack Lang, s’engage dans le projet en convaincant l’agglomération. Or, on n’a pas été suivi au plus haut niveau.
Est-ce que les murs peints relèvent de l’art public selon vous ?
Ça ne rentre pas dans le champ de l’art car il n’y a aucun lien avec le contexte de l’habitat et du lieu. La fresque des Lyonnais, c’est complètement démagogique. Ça ne change pas la vie des gens.
Quelle est à vos yeux la fonction de l’art public ?
Pour moi, la condition première de l’art public, c’est d’apporter du sens à un quartier. C’est une manière de dire aux habitants quelque chose qui peut perturber leur existence et leur rapport à leur quartier. Créer un lien avec leur passé, ou un lien imaginaire. L’art public les interroge et les ramène à une question de fond : comment est-on dans la vie ? Quel est notre rapport au monde ? C’est très utopiste !
La 2e partie des interventions artistiques effectuées autour du tramway à Strasbourg est fondée sur ça : changer le regard porté sur le quartier, l’environnement. Mais cela demande une préparation très exigeante. Il est important de préparer le terrain, d’associer des historiens, voire des représentants des habitants, etc…
Au fil des périodes, percevez-vous des évolutions dans les interventions artistiques dans l’espace public ?
Les artistes ont des modes d’expression de plus en plus divers, s’appuyant notamment sur les nouvelles technologies ou l’image mobile. Ils prennent en compte de façon plus aiguë les grands problèmes écologiques, sociaux, politiques, etc. qui se posent. Car les modes d’expression le permettent : photo, vidéo…
Le champ d’intervention et les préoccupations des artistes se sont considérablement élargis. On en a terminé avec ce que les Anglo-Saxons appellent les « dropped sculptures », posées dans un quartier sans lien réel avec le contexte. L’art dans la ville est aujourd’hui plus diffus, mais aussi à mon sens plus concernant.
Il est important également qu’à une commande publique s’agrègent des graphistes, des designers pour la signalétique, la lumière, etc.
Certaines œuvres d’art dans l’espace public sont en piteux état ; comment l’éviter ?
L’entretien, la protection et la restauration des œuvres « publiques » constituent un véritable problème qui aujourd’hui préoccupe fortement les commanditaires. La fragilité est souvent proscrite dans les clauses du cahier des charges, surtout quand il s’agit de bâtiments d’enseignement dans le cadre de la procédure du 1%. Dans les clauses du contrat passé avec les artistes, il est indispensable d’engager la responsabilité des commanditaires pour éviter de revoir tant d’œuvres abîmées, enlevées, laissées à l’abandon. Tout contrat passé avec un artiste pour la réalisation d’une œuvre dans l’espace public doit contenir un descriptif précis des conditions d’entretien
Que pensez-vous des deux principaux projets actuels d’art public dans le Grand Lyon : Rives de Saône et 8e art ?
Pour le « 8ème art », j’ai eu l’occasion de discuter avec Yvon Deschamps qui porte, au nom de Grand Lyon Habitat, ce grand projet. Ce qui me semble remarquable dans cette opération, c’est qu’elle s’inscrit dans un quartier en pleine mutation qui peut s’appuyer sur un contexte historique, un bel exemple architectural d’une cité HBM achevée en 1934 ; sur le travail, dans les années 80, de la Cité de la Création, sans doute plus critiquable, (je n’aime pas les murs peints !), travail qui a eu le mérite d’impliquer la population, au moment de la réhabilitation de la Cité ouvrière ; sur l’existence du Musée urbain Tony Garnier qui devrait être un bon relais d’information. L’existence d’un comité de pilotage, s’il est suffisamment impliqué et s’il est un lieu de réelle discussion autour des artistes choisis, veillant à ce que l’installation des œuvres soit intelligemment préparée par des rencontres des artistes avec la population, me semble être une garantie. Le souci d’Yvon Deschamps, comme des élus je l’espère, c’est d’accompagner ces commandes d’infrastructures culturelles susceptibles d’être de bons relais (ateliers d’artistes, petits lieux d’exposition, information régulière sur le déroulement des commandes et leur réalisation) essentiels dans l’acceptation des œuvres par la population du quartier.
Sur le projet Rives de Saône, j’ai beaucoup moins d’informations. Si l’on en juge par la réussite de l’aménagement des rives du Rhône (grand projet, énoncé dès le début des années 80, par notre regretté Jacques Moulinier, en charge de l’urbanisme à la Ville de Lyon), faire que la ville, mais aussi tous ses abords septentrionaux, se réapproprient cette magnifique rivière, si chargée d’histoire, c’est un projet fantastique. J’ignore comment la réflexion est organisée en amont du projet ; cela me paraît fondamental qu’un pilotage historique, scientifique, sociologique, urbanistique, voire littéraire, soit mis en place, traçant une ligne conductrice forte afin d’éviter la multiplicité de projets tant artistiques qu’architecturaux désordonnés. Car ce projet est porteur d’un tel potentiel d’utopie qu’il peut y avoir du meilleur comme du pire ! Je suivrai ce projet de loin, en tant que citoyenne particulièrement attachée à « Lyon et ses fleuves » (titre d’une exposition que j’avais organisée en collaboration avec Pierre Plattier à l’Elac dans le début des années 80 !), et à l’embellissement de sa ville d’adoption.
Quelle serait selon vous une politique d’art public novatrice et judicieuse, prenant en compte l’existant et traçant des voies nouvelles, sur un territoire comme le Grand Lyon ?
Voilà une question complexe à laquelle je ne m’aventurerais pas de répondre précisément car c’est une problématique qui va bien au-delà de la simple commande publique.
Je poserais avant tout des principes que toute personne en charge de commande publique artistique doit avoir en tête :
Une réflexion globale s’impose sur la manière dont on veut faire évoluer la ville, en s’attachant aux problèmes environnementaux, à la question des déplacements de la population, à la qualité de la vie urbaine. On ne peut pas faire l’économie d’un travail de collaboration entre architectes, urbanistes, paysagistes et personnalités de l’art contemporain mais aussi historiens, sociologues traduisant (c’est déjà largement entrepris dans le cadre des grands projet du Grand Lyon) une « volonté d'équilibre destinée à maintenir une bonne qualité de vie au sein de la métropole, par un agencement approprié entre les espaces verts, les lieux culturels et de loisirs, les habitations, les entreprises et les transports en commun ». Cette réflexion stratégique doit éclairer une politique de commandes à des artistes qui auront le souci de répondre artistiquement à ces questions de société.
Mais il est indispensable qu’un projet global de commande publique soit avant tout porté par le politique qui doit être convaincu de la nécessité de l’art dans l’espace de la ville, et de celle de la culture en général, comme participant au mieux-être de ses habitants.
Une exigence de qualité à toutes les phases de la commande, tout en sachant qu’il y a des compromis à accepter, mais en se gardant de mettre l’artiste en difficulté ou de l’instrumentaliser.
L’idée de parcours, ou en tous cas, de fil conducteur doit aussi présider à la réflexion. Chaque œuvre doit pouvoir prendre sens dans l’espace qui est assigné à l’artiste ou qu’il aura choisi tout en ayant une bonne connaissance du projet global et du contexte local.
Je ne pense pas que cela soit réellement novateur ni judicieux, je ne fais qu’enfoncer des portes ouvertes ! L’aspect novateur se trouve, à mon sens, dans la démarche artistique choisie, dans les préoccupations plastiques, politiques et éthiques de l’artiste, dans sa capacité à traduire plastiquement des réponses sociétales ou tout simplement humaines… Et le judicieux vient de la justesse de la réponse, si la question est correctement posée !
Il me semble également important, dans un monde qui va très vite, dans lequel le sentiment d’ubiquité induit par l’envahissement d’Internet et des technologies de l’information et de la communication, constitue un changement majeur de notre société, que cette question soit également prise en compte par l’artiste. C’était le cas lors de la passionnante Biennale de design 2010 « Imaginaire de la mobilité », et de la journée sur le numérique organisée par le Grand Lyon fin 2010.