Veille M3 / La subsistance, levier d’un prochain rapport au travail ?
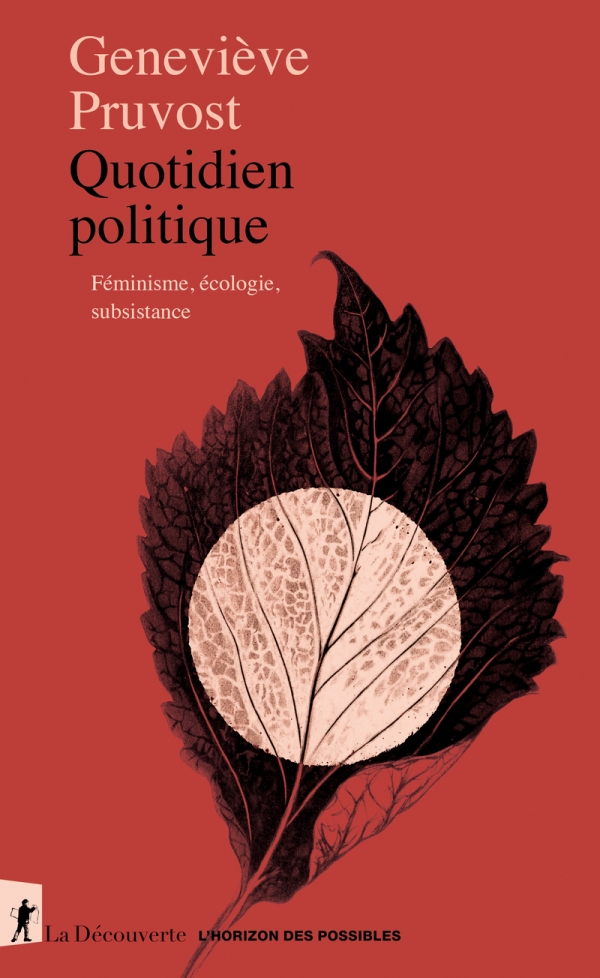
Article
Comment les acteurs publics peuvent-ils accompagner ces profondes transformations du rapport au travail ?
Interview de Noé Guiraud

Noé Guiraud est géographe et économiste, consultant au sein du Groupement régional pour l’alimentation de proximité. Il est spécialisé sur les questions de relocalisation alimentaire et de transition agricole et alimentaire des territoires.
Titulaire d’un doctorat en sciences économiques et d’un master en géographie, il a récemment mené une recherche-action sur la résilience alimentaire en milieu rural avec la Ville de Dieulefit, durant laquelle il a co-réalisé une série podcast dont un épisode parle du « prix du local »
Dans le cadre de cette recherche, il a suivi la création d’un marché solidaire et a été amené à travailler sur la construction des prix alimentaires, notamment pour accompagner des paysans et commerçants à expliquer leurs prix auprès des consommateurs.
Dans cet entretien, Noé Guiraud revient sur les mécanismes de fixation des prix dans le domaine de l’alimentaire, notamment dans un contexte inflationniste, et les leviers d’action à disposition des collectivités locales.
Le prix d’un produit alimentaire reflète-t-il son coût de production ou son « utilité » pour le consommateur ?
En préambule, je pense fondamental de souligner que les prix ne doivent pas être perçus comme une expression froide de lois quasi physiques, usuellement présentées comme la libre définition par le marché et la résultante équilibrée d’une rencontre de l’offre et de la demande. Au contraire nous sommes devant un phénomène éminemment social, tel que nous le rappelle Paul Jorion dans son ouvrage Le prix (Champs essais, 2010), les prix sont construits par des rapports de force entre acteurs (vendeurs et acheteurs) et déterminés par un ordre sociopolitique.
Les prix reflètent différents aspects dont les coûts de production forment un socle auquel s’ajoutent des coûts liés à la transformation, au transport, aux services (marketing etc.), ce qu’on appelle des marges, que chaque intermédiaire définit et négocie. Ces coûts forment un prix de revient du produit final qui pourra être modifié par le jeu du commerce : négociations commerciales (rabais, promesse de vente ou d’achat, prix assurés dans le temps etc.) et pratiques marketing pour renforcer l’attrait d’un produit (prix à 0,99 €, 3 pour le prix d’1, multiplicité des options, etc.).
Comment se forme un prix alimentaire ?
Pour bien se rendre compte de la variabilité importante des prix, il est intéressant de se mettre à la place d’un agriculteur qui veut fixer le prix de vente de sa production pour des consommateurs finaux, pour son étal de marché par exemple.
La logique voudrait qu’il ait calculé son coût de revient : on peut le définir comme étant la somme des coûts engendrés par la production et la distribution d'un bien. Dit autrement, la logique du coût de revient implique de penser l'ensemble des ventes comme devant payer les charges de production et de gestion de la ferme ainsi qu'une rémunération du travail. La détermination d'un coût de revient doit permettre d'éviter de vendre à perte et d'adapter ses prix en fonction de l'évolution des coûts de production, et donc d'expliquer ces variations.
Toutefois l’agriculteur peut aussi regarder quels sont les prix pratiqués par ses collègues sur ce même marché ou ceux des marchés avoisinants - c’est ce qui est fréquemment fait - et il y a de cette manière une forme de contrôle social à l’établissement des prix, avec une attention à ne pas casser les prix ou ne pas être « trop au-dessus » pour ne pas perdre des clients. Il peut encore se référer à un prix de référence formalisé.
Cela revient un peu à fixer son prix selon la concurrence, mais de façon plus explicite : les marchés de gros par exemple produisent des mercuriales [les prix officiels du marché] ou des suivis des prix pratiqués qui permettent d’avoir une idée des pratiques à un instant t dans une région donnée. Ces prix sont l’expression de négociations entre fournisseurs et acheteurs.
L’agriculteur peut aussi ajuster ses prix en fonction de son rendement, s’il a eu une production plus importante que prévue et qu’il craint de ne pas pouvoir l’écouler par exemple il peut vendre au rabais. Dans ce cas, c’est le fameux effet d’offre et de demande qui s’exprime par une baisse délibérée du prix de vente.
Enfin, on peut fixer un prix arbitrairement faible à certains produits pour inciter les clients à acheter d’autres articles plus chers dans son panier. Ces différentes manières de fixer le prix peuvent se cumuler et varier. Mais il faut bien avoir conscience qu’on a plus ou moins le choix, selon le type d’acheteur en face et le contexte économique et politique.
Que reflète la différence de prix entre un produit bio et un produit conventionnel ?
Les prix ont une variabilité importante pour toutes les raisons que j’ai expliqué, et les prix de vente au consommateur final d’un même produit, d’une même marque, peut varier d’une épicerie à une autre dans une même ville, comme a pu le montrer de façon très fine une étude INRAE sur Montpellier. Toutefois la valeur – qu’on peut appeler utilité aussi – qui lui est attribué est censée être plus stable : si l’intérêt pour un produit disparaît, le prix ne peut se maintenir. Finalement, le prix n’est plus l’expression d’un coût mais celle d’une possibilité de vendre ou non.
Par ailleurs, si l’intérêt est là, il est plus ou moins modulé par ce qu’on appelle une fonction d’utilité en économie : chaque consommateur est prêt à payer plus ou moins cher un produit. Enfin, c’est la théorie néoclassique, car de fait l’hypothèse de pure rationalité des consommateurs et la notion d’utilité ne sont pas observables et rendent caduques bien des modèles. Ce que l’on peut/doit retenir, c’est que l’utilité est une construction sociale et qu’à cela s’ajoutent des effets de contexte beaucoup moins rationnels dans l’explication des comportements des consommateurs.
Toutefois, cette idée de l’utilité va guider la manière dont des vendeurs fixent leur prix, et dans cette mesure, elle a un impact. L’utilité est par conséquent relative à nos positions sociales et non absolue : d’après les niveaux de production et de richesse de notre société en général nous devrions en théorie tous manger à notre faim et à un prix raisonnable, ce n’est pourtant pas le cas. Les prix ne reflètent donc pas correctement l’utilité du consommateur.
être liés à trois facteurs : les économies d’échelle, l’offre disponible et l’utilité perçue par le consommateur.
D’abord des questions d’économie d’échelle : les modèles de production bio et conventionnels sont différents et pour une partie importante des exploitations en agriculture biologique on a des coûts de production plus élevés pour un même volume de produit. De la même façon, pour un certain nombre de produits les filières réalisent moins d’économies d’échelles qu’en conventionnel du fait de leur organisation. Toutefois, avec l’essor de l’agriculture biologique industrielle et l’optimisation des filières locales, ces écarts tendent à diminuer.
Ensuite, pour certains produits, la faiblesse de l’offre implique la pratique de prix de vente plus élevés. Si personne ne propose des purées de wasabi bio, vous aurez tendance à avoir d’une part des coûts de production plus forts tels qu’expliqués ci-dessus (car vous n’avez pas accès à des filières bio appropriés pour votre produit) d’autre part vous voudrez bénéficier de la position de monopole ou quasi-monopole que vous offre ce contexte : vous pourrez décider le prix sans compétition directe.
Enfin, l’utilité pour le consommateur se traduit par une propension (plus ou moins forte) à payer plus cher des produits bio que conventionnels. Effectivement, a priori, le consommateur y gagne la certification du non-usage de pesticides. Par ailleurs les consommateurs types des produits « AB » étaient jusqu’à présent très marqués par leur classe sociale, par conséquent en tant que distributeur, vous savez que vous avez en face des consommateurs prêts à payer plus cher. À partir de là, vous pouvez marger plus sur le produit.
Quels rôles jouent les prix alimentaires dans les choix de consommation des Français ? Les écarts de prix entre la bio et le conventionnel expliquent-ils la faible part de la bio (moins de 7 %) sur le marché national ?
Le prix est le premier critère de sélection d’un aliment pour les ménages, mais il n’est pas le seul et selon les situations sociales et culturelles des consommateurs, il est articulé à de nombreux autres qui peuvent parfois prendre le pas sur le prix : fraicheur, critères de qualité, régimes, connaissance du vendeur, etc. Par ailleurs, au-delà du produit, la proximité géographique et culturelle peut beaucoup jouer sur l’accessibilité des consommateurs à certaines gammes de produits dont le bio : pour un grand nombre de personnes, il n’est pas imaginable d’aller dans un magasin Bio, « ce n’est pas pour eux », et encore moins de faire de la distance à cette fin. Ces facteurs peuvent jouer avant même que le consommateur ait pu aller observer directement les prix. Et c’est très dommageable pour la consommation de produits bio.
Les écarts de prix entre la bio et le conventionnel doivent être contextualisés. La situation n’est pas la même selon les types de débouchés. Les ventes de produits Bio se font majoritairement via la grande et moyenne distribution : en 2017 (Agence Bio / ANDi 2017) les grandes et moyennes surfaces (GMS) cumulaient 46 % du chiffre d’affaires de l’agriculture biologique réalisé directement dans les magasins des enseignes généralistes et 36 % par des distributeurs spécialisés bio qui appartiennent pour une part à des groupes de la grande distribution. Or, la bio est une gamme sur laquelle ces distributeurs généralistes margent beaucoup notamment parce qu’elle concerne une catégorie de clients qui sont moins susceptibles de faire attention aux prix.
Il est clair que les écarts de prix sont un frein à l’augmentation des achats de la bio dans les dépenses des ménages, mais il faut l’attribuer en grande partie aux pratiques des GMS. Par ailleurs, j’attire l’attention sur le fait qu’il existe aussi des écarts de prix entre deux produits bio a priori équivalents : en effet, il est fréquent de payer des produits bio dans des circuits courts à des prix plus bas que les produits bio en GMS et parfois à prix équivalent que le conventionnel. Enfin, les écarts de prix et les marges pratiquées ne sont pas équivalentes si l’on parle de produits transformés, voire ultra transformés ou de produits frais.
Le budget relatif consacré à l’alimentation des ménages a fortement diminué depuis les années 1960. Toutefois, en tenant compte de la forte progression du pouvoir d’achat dans son ensemble (inflation comprise), ce budget alimentaire aurait plutôt stagné voire augmenté en valeur absolue. Comment l’expliquer, alors que la productivité agricole a considérablement augmenté sur la même période ?
Aujourd’hui l’alimentation correspond à 20 % du budget des ménages français, cette part était de 35 % il y a 60 ans. Pourtant, nous consommons plus d’aliments en volume qu’il y a 60 ans et notre nourriture n'est pas moins chère (ce sont les prix alimentaires en valeur absolue qui ont plutôt stagnés voire augmentés) : alors comment est-ce possible ? C’est d’abord une question de proportion, ce sont les autres postes de dépense budgétaire qui ont pris une place beaucoup plus importante dans nos dépenses, en premier lieu le coût du logement et de l’énergie. Et ces postes de dépenses ne sont peu, voire pas compressibles pour les ménages, qui se retrouvent à ajuster leurs dépenses sur l’alimentation lorsque leur pouvoir d’achat diminue.
Dans le même temps, les prix agricoles eux ont énormément baissé au profit principalement d’une marge commerciale qui a explosé en particulier après les années 90 : de 1978 à 2005, les prix agricoles à la production ont effectivement diminué, en termes réels, de près de 50 % alors que la baisse des prix à la consommation alimentaire est inférieure à 10 %. La baisse des prix agricoles est notamment supportée par une augmentation des aides agricoles européennes à la production. Les coûts intermédiaires ont énormément augmenté, en particulier les coûts de service. On sait que plus les produits sont transformés, moins les matières premières pèsent dans le prix final. Pour le dire rapidement, les grains de productivité réalisés dans l’agriculture depuis 60 ans n’ont pas ou peu bénéficié aux consommateurs finaux.
Il faut comprendre que l'industrie et la grande distribution n'ont pas intérêt à ce que les agriculteurs aient une production modeste ou juste nécessaire à nourrir la population. Si les producteurs ont des excédents importants, ils n'ont plus de pouvoir de négociation, et ils sont contraints d’écouler ! L'industrie, elle, peut toujours aller acheter ailleurs, dans la région, ou le pays, ou ailleurs en Europe, voire dans le monde.
Par exemple, les laiteries profitent énormément du fait que le lait européen est bon marché et produit en très gros volumes, en exportant partout dans le monde du lait ou des produits à base de lait. On voit là que la question de l’utilité du consommateur n’est pas corrélée aux prix, nous sommes face à une logique capitaliste classique, d’optimisation d‘un secteur de production pour en tirer des revenus. Dit autrement, notre alimentation est un secteur rentable et dont le fonctionnement est largement orienté pour produire du capital.
Cela fait plus d’une décennie que le marché de la consommation bio connaissait une hausse régulière, de 15 à 20 % par an. En 2021 et 2022, on a observé un retournement de la tendance et un recul de la consommation. Quelles hypothèses formulez-vous pour expliquer ce renversement ? L’inflation y est-elle pour quelque chose ?
Ne nous méprenons pas, la croissance de la consommation des produits des 10 dernières années est en partie liée aux GMS. N’oublions pas qu’elles (Envergure, Leclerc, Horizon et Intermarché) concentrent toujours 92 % des dépenses alimentaires en France. Avec son entrée dans les grandes et moyennes surfaces, la bio s’est démocratisée tout en s’industrialisant, cela a boosté les ventes à l’échelle française et permis de toucher un public jusque-là peu tourné vers ce type de produits. Et les GMS ont largement profité de cet essor.
Alors pourquoi cet arrêt, s’il y a eu démocratisation ? Je ne pense pas avoir toute la réponse, mais on peut au moins mettre en avant plusieurs facteurs qui expliquent en partie la contraction du marché bio.
Pour moi, le premier facteur est la façon dont la grande et moyenne distribution répercute l’augmentation des coûts sur les prix finaux, qui est inégale et parfois exagérée. La bio est une gamme sur laquelle ils margent beaucoup, et dans le contexte inflationniste, il est possible qu’ils aient particulièrement augmenté les prix des produits bio. C’est une hypothèse que je me permets sachant qu’une étude de la Commission Européenne (2008) à la suite de la précédente inflation concluait : « quand le prix des matières premières s’accroît, toute la chaîne en profite pour augmenter ses marges ». Effectivement, en 2008, l’explosion des cours des matières premières aurait dû entraîner une hausse moyenne de 5 % des prix des produits alimentaires mais l’augmentation constatée fut de 7 %.
Plus récemment, le média spécialisé Biolinéaires soulignait que l’inflation des produits bio a atteint 3,8 % en magasins spécialisés fin octobre 2022, contre 10,4 % dans les grandes et moyenne surfaces. Ces pratiques montrent que les GMS sont ainsi largement responsables de l’idée général que la bio est trop chère. Aujourd’hui tout consommateur a en tête que la bio, c’est bien mais c’est trop cher. L’effet psychologique de cette antienne n’est pas à négliger sur les comportements de consommation. Paradoxalement, aujourd’hui avec l’inflation, certains produits bio se retrouvent moins chers que les produits conventionnels.
Les autres facteurs sont particulièrement liés à l’inflation :
Jean-Baptiste Say, premier économiste français de l’école classique, a écrit : « De ce que le prix est la mesure de la valeur des choses, et de ce que leur valeur est la mesure de l’utilité qu’on leur a donnée, il ne faudrait pas tirer la conclusion absurde qu’en faisant monter leur prix par la violence, on accroît leur utilité. […] Si, par une cause quelconque, l’acheteur est obligé de [payer un produit] au-delà de ce que vaut pour lui [l'utilité de ce produit], il paie une valeur qui n’existe pas, et qui, par conséquent, ne lui est pas livrée. » L’inflation alimentaire actuelle exemplifie-t-elle cette affirmation ?
Ce que je comprends de cette citation de Jean-Baptiste Say, c’est que le lien entre valeur et prix n’est pas une relation qui fonctionne dans les deux sens : le prix qu’on est prêt à payer reflète la valeur qu’on donne au bien, et cette valeur est déterminée par l’utilité qu’on en perçoit. Et j’insiste sur la perception, tel qu’expliqué plus tôt : cette utilité est une construction sociale. D’ailleurs, il existe des stratégies pour que le consommateur perçoive à travers un prix élevé une utilité plus forte qu’elle n’est réellement. La partie délicate dans cette affirmation est d’estimer cette fameuse utilité, elle n’est pas la même pour tout le monde, ni la même dans le temps pour une même personne. C’est une question au fondement de l’économie et qui nourrit bien des débats.
L’inflation actuelle illustre cette logique dans la mesure où de nombreux consommateurs n’achètent plus certains produits du fait de leur prix : ça veut dire que le prix a dépassé son utilité. Mais en fait c’est déjà le cas tous les jours, l’inflation ne fait que déplacer la référence.
Surtout, l’organisation actuelle de notre système alimentaire produit des distorsions importantes entre le prix et la valeur des produits alimentaires, au même titre que les autres biens de consommation et sans égard pour la dimension vivante et vitale de ces produits. Si l’on considère que notre alimentation est, toujours pour le moment, disponible en quantité et en qualité (bien que cette qualité soit discutable au vu du coût sanitaire désastreux de notre alimentation aujourd’hui), nous lui donnons une valeur somme toute réduite et peu corrélée à l’utilité de l’aliment. J’ai entendu un jour un médecin dire : « Tant que s’acheter un steak-haché ou des nuggets sera moins cher que d’acheter deux choux fleurs bio, il y aura des problèmes de santé publique lié à notre alimentation ».
Peu de personnes réalisent que lorsqu’elles achètent de la viande ou du fromage, le prix payé rémunère bien des choses sauf le travail de l’éleveur.se, qui vit grâce aux aides publiques. Pas plus tard que la semaine dernière, un éleveur laitier me disait « sans les primes, non seulement je ne peux pas me payer mais en plus mon exploitation ne peut pas tourner », c’est-à-dire que la moitié des primes lui servent à assumer son coût de production.
Ce qui m’amène à une autre citation, d’Adam Smith, que j’emprunte à Benoit Prevost (en exergue de son article sur le juste prix) : « La seule équité, d’ailleurs, exige que ceux qui nourrissent, habillent et logent tout le corps de la nation, aient, dans le produit de leur propre travail, une part suffisante pour être eux-mêmes passablement nourris, vêtus et logés. » (Adam Smith, 1776).
Je crois que l’inflation actuelle met en lumière les inégalités, terribles, qui sont entretenues, voire creusées, par l’organisation économique et politique de notre système alimentaire. Derrière l’argument libéral tant rabattu que le marché est le moyen le plus efficace de fixer des prix, notre société laisse un secteur vital et d’intérêt général être une source de profits considérables pour une minorité (la concentration vertigineuse du secteur n’est plus à démontrer).
Ce qui est consternant, c’est que nos politiques encouragent depuis des décennies cette orientation par des aides publiques qui maintiennent cette situation derrière l’illusion des prix faibles. Et les chantres de la grande distribution ont beau jeu de se faire les défenseurs des consommateurs, c’est un comble !
Quelles sont d’après vous les leviers d’action les plus efficaces à disposition d’une Métropole comme le Grand Lyon pour relancer la consommation de produits bio ? Faut-il prioritairement agir sur l’image de la bio, sur son accessibilité économique, ou sur son accessibilité physique ? Comment ?
Il faut articuler l’ensemble de ces leviers. Il est fondamental de soutenir les filières locales de la bio, parce qu’elles, pour rester sur la question du prix, distribuent plus équitablement les marges aux différents acteurs de la chaine et contribuent directement au développement local. Par ailleurs, ce modèle agricole qui en profite bénéficie au territoire dans lequel on vit. Contrairement au bio importé, dont la marge profite aux grandes enseignes et qui contribue au développement d’une agriculture certes bio mais aussi industrielle à l’échelle internationale.
La collectivité a différents outils à sa portée : concernant l’accès aux produits, elle peut facilement réglementer la publicité qui a un impact important sur nos comportements d’achats. Il est aussi fondamental de privilégier les produits bruts et peu ou pas transformés. Cuisiner est une façon de mieux contrôler le coût de son alimentation.
Enfin il faut comparer ce qui est comparable : on ne peut pas tout focaliser sur la bio, il me paraît important de communiquer beaucoup plus sur les externalités négatives des aliments issus du modèle agro industriel, directement pour le consommateur (santé) ou indirectement (environnement).
Un enjeu complexe pour l’essor des filières agroécologiques locales est la logistique. La favoriser est à la fois un moyen de soutenir un changement d’échelle des filières de proximité notamment en optimisant les coûts logistiques mais aussi en favorisant la disponibilité d’une gamme plus importante de produits bio et locaux dans les points de vente.
Personnellement, je pense qu’il y a aussi un très gros travail à faire sur la déconstruction des prix. Pour l’avoir pratiqué moi-même, la comparaison des prix pratiqués est toujours riche d’enseignements. Alors pourquoi pas construire un observatoire local des prix alimentaires à l’échelle de la métropole de Lyon ? Cela serait un levier intéressant pour amener une information fiable et neutre aux consommateurs et contraindre à plus de transparence les distributeurs. Il me semble que c’est d’utilité publique. Au lieu d’envoyer des demandes d’évaluation des commerces à base de pouce vers le haut ou le bas, on pourrait demander aux gens le prix au kilogramme d’un ensemble de produits du panier. Des indicateurs peuvent être imaginés pour aiguiller le consommateur, comme le pourcentage du prix qui paye le travail agricole, par exemple.
Enfin, et surtout de façon plus globale vis-à-vis du système alimentaire, la collectivité peut soutenir des expérimentations de la sécurité sociale alimentaire (SSA). Il s’agit de la proposition la plus ambitieuse à ce jour pour répondre à la fois au besoin d’accessibilité des aliments de qualité pour le plus grand nombre et à la fois au besoin de sécurisation des débouchés pour les filières agroécologiques locales. Les deux doivent avancer main dans la man. Localement, la collectivité peut ainsi contribuer à imaginer des dispositifs, des caisses locales de l’alimentation comme il y a eu des caisses de travailleurs, et favoriser par là même une plus grande démocratie alimentaire. Car derrière les prix, ce sont des questions d’inégalités sociales qui se jouent. Et de mon point de vue il n’y aura pas de transition écologique sans justice sociale.
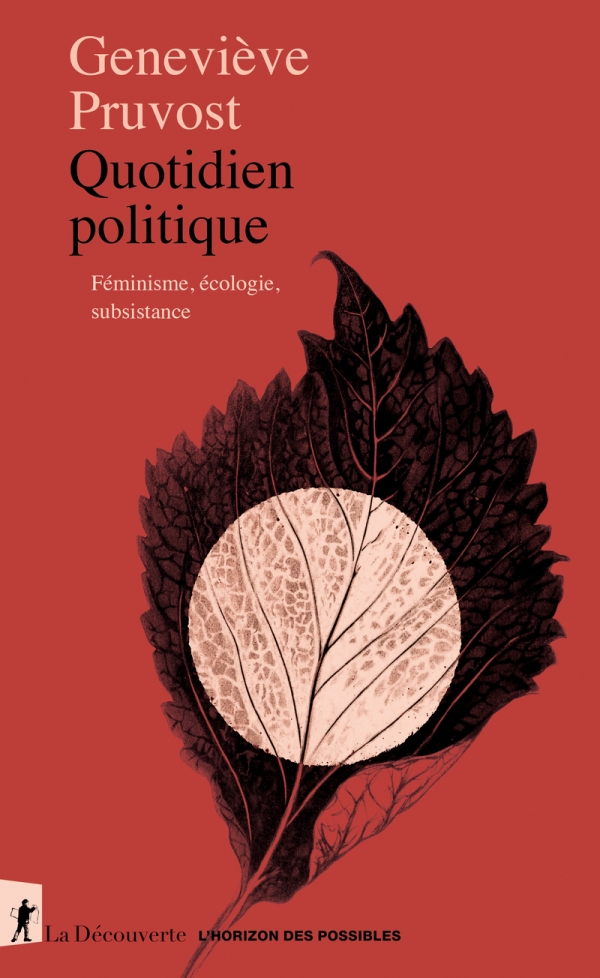
Article
Comment les acteurs publics peuvent-ils accompagner ces profondes transformations du rapport au travail ?

Étude
Qu’en est-il des impacts environnementaux sur la biodiversité et les ressources naturelles ?

Article
À l'ère des polycrises, l'urgence est de repenser le développement économique des métropoles

Article
La pollution de l'eau pourrait coûter très cher à la société.

Interview de Philippe Chamaret
Directeur de l’Institut écocitoyen de Fos-sur-Mer
Au cœur du fonctionnement se dessine une démarche ambitieuse d’implication des habitants et de partage d’informations avec le territoire.

Article
Un rapide tour d’horizon des luttes contre les pollutions toxiques qui permet d'identifier des types de mobilisations citoyennes

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?

Article
Pollueur-payeur : un outil efficace contre la pollution de l’eau et les micropolluants ?

Article
Cette infographie vous éclaire sur les micropolluants, leur diffusion et leurs impacts, ainsi que sur les moyens d’action déployés par la Métropole de Lyon pour limiter leur propagation.