Cycle de l’azote, cycle du phosphore, aérosols : quelles évolutions et quels enjeux pour la Métropole de Lyon ?

Article
Quelles perspectives pour la Métropole de Lyon ?
Interview de Louis-Edouard POUGET
<< La stratégie déchet, ce n’est pas de l’innovation mais c’est une démarche originale qui nous rendra capables de suivre dans la durée l’évolution de nos performances >>.
La stratégie déchet de la direction de la Propreté témoigne de la capacité des services communautaires à gagner en performance sans forcément innover, au sens classique du terme. Louis-Edouard Pouget, responsable du service recherche & développement à la direction de Propreté, en fait la démonstration.
Parle-t-on d’innovation à la direction de la Propreté ?
On utilise peu ce terme. Même s’il y a de l’innovation, quand on teste des procédés dans des déchèteries pour mieux positionner les bennes, lors de la conception des chariots de la propreté, sur les procédés expérimentés pour la viabilité hivernale — pour accroître la rémanence du sel et ne pas tuer les arbres —, lors de l’expérimentation du camion benne hybride de Renault Trucks, ou par la quantification de toutes nos actions sur le plan environnemental, calcul du bilan carbone, des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau… pour se donner des outils d’aide à la décision.
Quand le Grand Lyon votera les actions de son Plan climat, cela signifie que vous serez en capacité de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de la direction de la Propreté par exemple ?
Tout à fait ! On travaille avec Pierre Crépeaux, chef du projet Plan climat et Stephan Weiss, chargé de mission Agenda 21 du Grand Lyon sur ces questions, et on les fait même avancer sur leur cahier des charges à partir de notre expérience sur le bilan carbone, ou sur l’empreinte écologique, dont on sait désormais que c’est plus un outil de communication qu’un outil d’aide à la décision.
Pourquoi la direction de la Propreté dispose-t-elle d’un service de R&D ?
L’organisation de la direction de la Propreté a été refondue en 2005, en séparant la collecte/traitement des déchets d’un côté, du nettoiement de l’autre. Le bureau d’études « Propreté études qualité », jusqu’alors rattaché au traitement, l’a été à l’ensemble de la direction. C’est aujourd’hui un service transversal, ressources, qui travaille aussi bien pour la collecte, que pour le nettoiement et le traitement ou pour des aspects d’organisation de service.
Quelle est, selon vous, l’innovation la plus significative à la direction de la Propreté ?
On réalise une grosse étude sur la stratégie déchet. C’est de la prospective pure. A partir de nos tonnages de déchets et d’une extrapolation de ces tonnages à 10/15/20 ans, en fonction des paramètres que l’on connaît, nous essayons de simuler ce que cela donnera au niveau de l’incinération, de l’enfouissement, du recyclage, pour essayer de bien dimensionner les futures installations. On anticipe le fait que l’on va renforcer la valorisation en déchèterie de certains matériaux, par exemple le plâtre et le bois que l’on enfouissait auparavant…
Le tableau qui en ressort est notre feuille de route en quelque sorte. On se centre sur les gros tonnages et l’on cherche comment on peut améliorer leur valorisation.
La stratégie déchet, ce n’est pas de l’innovation mais c’est une démarche originale qui nous rendra capables, avec l’outil de simulation des tonnages et le catalogue des actions, de suivre dans la durée l’évolution de nos performances. Nous avons par exemple pris tous les objectifs de l’Union Européenne et du Grenelle de l’environnement et essayé chaque fois de voir comment on se situait et en quelle année on les atteignaient. C’est aussi un outil didactique vis-à-vis des élus. Pour nous c’est surtout un outil d’aide à la décision. Bref, il permet de comprendre un sujet difficile, de savoir où on se situe, et donne des éléments pour décider.
Quand vous dites que le plâtre et le bois ne sont plus enfouis, cela signifie que des innovations sur les procédés ont été réalisées ?
Oui, c’est un très bon exemple. Une nouvelle législation interdit d’enfouir dans les centres de stockage des déchets le plâtre en vrac avec le reste, imposant du coup de faire une alvéole spécifique, et une augmentation des coûts d'enfouissement de ce type de matériaux. Les industriels qui vendent du plâtre se sont inquiétés car leur plâtre risquait d’être refusé dans la construction, en raison des contraintes fortes à la démolition. Ils ont travaillé en R&D pour savoir comment réutiliser les déchets de plâtre. Ils ont trouvé des solutions, pour les réinjecter à hauteur d’un certain pourcentage, dans le plâtre neuf, comme on l’a fait pour le plastique. Alors qu’à la direction de la Propreté nous étions en pleine réflexion sur le comment sortir le plâtre qu’on enfouissait encore, nous avons rencontré ces entreprises, et nous sommes rendus compte qu’elles cherchaient des gisements de plâtre de deuxième main. Nous avons alors fait des tests de tri dans les déchèteries pour savoir si nous étions capables de le séparer. C’était possible et, en 2008, nous avons sorti 162 tonnes de plâtre. C’est pas énorme, mais c’est déjà autant qui ne part pas en enfouissement et qui sera recyclé. C’est la même chose pour le bois et d’autres matériaux. Sans arrêt, nous essayons de voir s’il y a moyen de faire valoriser les tonnages qui ne le sont pas.
Pourquoi tous les déchets ne sont-ils pas recyclés ?
Il faut toujours trois conditions pour recycler un déchet : une structure de collecte, un financement, et un industriel qui soit capable de le prendre en charge. Le financement est soit assuré parce qu’il y un intérêt économique — le Grand Lyon a ainsi intérêt à recycler le bois, qui nous coûte 120 euros la tonne à enfouir, contre 45 euros à valoriser —, soit est assuré par l'application de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP). Ce concept désigne des dispositifs, comme l’écotaxe, qui transfèrent la responsabilité en matière de gestion des déchets des municipalités vers les producteurs. Il repose sur une logique d'internalisation des coûts. Une avancée s’est faite récemment dans le recyclage des déchets électriques et électroniques : il y avait une loi, mais elle n’était applicable à défaut de système de financement ; quand le financement est arrivé, les industriels qui étaient prêts à investir ont développé les filières de valorisation. A Feyzin, une société a construit une usine de démantèlement des déchets électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage.
Pour chaque type de déchets actuellement non valorisé, vous cherchez des solutions ?
Oui, en s’appuyant parfois sur les autres services du Grand Lyon. Alors qu’il nous restait les déchets issus des balayeuses, je savais, venant de la direction de l’Eau, qu’une unité y lavait les sables des désableurs, dont la nature physico-chimique est assez proche. On leur a demandé à réaliser des tests, leur avons amené quelques balayeuses qui ont été traitées par leur machine. Cela marchait, sauf qu’on plantait la machine à cause de la présence de fibres. Lorsque la direction de l’Eau a fait reconstruire la station d’épuration à Pierre-Bénite, elle a intégré dans son cahier des charges notre problématique des déchets de balayage. Actuellement, leur unité de valorisation des sables mène, en lien avec nous, une série de tests.
Est-il courant de mener ainsi des tests communs à plusieurs directions ?
Oui, on travaille aussi avec nos collègues de la Voirie pour améliorer le traitement des mâchefers par exemple. Mais la voie la plus prometteuse actuellement consiste sans doute à se donner des outils et des objectifs communs. On rédige, avec les directions de l’Eau et de la Voirie, un « guide des prescriptions » des services urbains. L’idée est de faciliter le travail des aménageurs, confrontés à des demandes et besoins différents selon les services et d’aider aussi aménageurs et élus à valider les projets concernant les matériaux, les dimensionnement des voies et les coûts. Nous avions déjà travaillé sur ces référentiels et réalisé un guide pour se rapprocher des aménageurs. N’oublions pas qu’à la Propreté, on est la dernière roue de la charrette !, on nettoie les espaces que d’autres ont construits, nous ne sommes pas toujours consultés lors de la conception de ces espaces. Pourtant ensuite le citoyen attend une maintenance de cet espace, alors que nous n’avons en charge que son nettoyage. Supposons que les services du Grand Lyon réalisent une place magnifique, avec des matériaux très clairs. Si elle accueille un marché alimentaire, avec cerises, fraises, poissons… on ne saura pas la nettoyer et elle ne restera pas belle longtemps… Il nous faut donc essayer d’anticiper l’usage, dès le moment de la conception.
Nous voulons aussi arriver à régler nos problèmes de compétence, en mutualisant nos moyens, et en contractualisant avec les communes pour s’engager à atteindre un résultat donné. Nous avons fait réaliser une petite enquête sociologique : c’est quoi, une rue propre ou une rue sale ? On s’est aperçu que lorsqu’un mur est tagué, le piéton considérera que la rue est sale, même si ce n’est pas de la compétence de la Propreté ; ou que des maires estiment qu’une rue est sale dès lors qu’ils ne voient plus les cantonniers à pied.
Finalement, à travers ces exemples, on a l’impression que les avancées en matière de propreté passent plus souvent par les comportements, l’organisation que par des aspects techniques…
Il faut les deux, mais il est indéniable que nos problèmes sont davantage organisationnels que technologiques. Quand on expérimente du matériel de nettoyage pour gagner en performance et réduire le bruit, derrière la machine, il y a des questions de locaux, de parcours, de formation de personnel… Nous testons ainsi une petite balayeuse de trottoir, fort utile pour nettoyer des voiries étroites. Elle nous a obligé à revoir les locaux. Pourquoi ? Parce qu’elle roulait à 25 km/h, et ne pouvait donc pas prendre les autoroutes pour vider sur notre dépôt à Rillieux-la-Pape… Et pour éviter qu’elle traverse tout Lyon pour se rendre au garage, nous avons installé des points relais pour le premier niveau d’entretien. Alors qu’il est rapide de choisir un matériel, il est bien plus long de faire évoluer l’organisation générale : un local ne se trouve pas du jour au lendemain, dans le premier ou le quatrième arrondissement de Lyon !
Sur le plan des technologies malgré tout, quelles avancées peut-on attendre dans les prochaines années au Grand Lyon en matière de propreté ?
Des innovations technologiques apparaissent sur les techniques de collecte et sur les modes de traitement des déchets.
Parmi d’autres villes, Barcelone a opté pour une collecte pneumatique des déchets : au lieu de collecter les ordures ménagères avec des camions, les habitants jettent leurs déchets dans des bornes où un système souterrain d'aspiration automatisé les achemine vers une centrale. Nous avons envisagé d’implanter ce système dans des quartiers nouveaux, au Carré de Soie et à Lyon Confluence. Ce qui bloque, c’est le coût, multiplié par 3 ou 4 par rapport à une collecte classique. Dans ce cas, seule une volonté politique peut conduire à opter pour cette technique.
Concernant le traitement des déchets, le tri mécano-biologique a pour objectif de séparer, dans les ordures ménagères non triées, les déchets organiques des matières inertes. Les matières inertes seront triées et le reste sera composté. Des élus du Grand Lyon, de retour de visite dans des villes qui se sont lancées dans cette forme de tri, nous ont demandé de voir si cette technique était adaptée au Grand Lyon. Nous avons réalisé des études, et nous suivons les expériences en cours dans d’autres villes comme Lilles ou Montpellier afin de profiter de leur expérience, repérer les embuches et les problèmes rencontrés. A Lyon, nous ne sommes pas dans l’urgence pour décider, car on a la chance d’avoir des anciens qui ont pris les bonnes décisions. Nos équipements sont modernes, bien dimensionnés et adaptés aux besoins, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de grandes villes, qui nous envient par exemple notre parc de 17 déchèteries. Nous ne sommes pas pris à la gorge, mais il ne faudra pas louper le virage. Les enjeux financiers sont énormes, une nouvelle usine d’incinération, c’est 200 millions d’euros !
Vous attendez, pour profiter de l’expérience des autres ?
Oui, nos usines d’incinération ont encore 15 ans de vie ; sachant qu’on met 5 ans pour les construire, nous avons donc 5 ans pour réfléchir à ce que l’on fait après… On surveille par exemple le PCI (pouvoir calorifique inférieur) des déchets à incinérer. Le pouvoir calorifique des déchets s’est accru au fil des ans, ce qui impliquera, demain, de construire des fours qui soient adaptés à ce type de déchets. Nous réalisons des études de caractérisation de nos déchets pour mesurer ce PCI, quels sont les déchets dont le PCI tend à baisser ou augmenter, est-ce que le fait de mettre en place la collecte sélective le modifie… Ce travail ponctuel à toutes les étapes est notre part d’innovation.
L’évolution des modes de vie vous pousse-t-elle à innover ?
C’est l’un des déclencheurs « classiques » de l’innovation. Dans les services urbains, on raisonnait « technique » — à un problème, on cherchait des solutions… forcément techniques — et/ou « communication ». Aujourd’hui on se rend compte que cela ne suffit plus, on commence à penser marketing, on prend conscience aussi de la nécessité de communiquer davantage vis-à-vis de notre propre personnel, pour valoriser les métiers.
Les autres déclencheurs de l’innovation sont la législation en matière d’environnement, et la réduction des coûts. Nous essayons toujours d’anticiper l’arrivée des législations, par exemple sur les DEEE, déchets des équipements électriques et électroniques dont je vous ai parlé, nous savions que la directive européenne de 2001 devait être transcrite dans le droit français en 2005. Du coup, nous avions déjà réservé dans les déchèteries, en construction ou en rénovation, un espace qui permettrait, dans l’avenir, de traiter ce type de déchet.
On réalise aussi du lobbying, en donnant notre avis dans les structures qui sont interrogées dans le cadre de la mise en place de nouvelles lois. Alors qu’on parle par exemple aujourd’hui beaucoup de collectes de déchets dits fermentescibles, qui peuvent être compostés, nous avons signalé qu’une loi qui s’appliquerait à toutes les collectivités ne serait pas fondée, car ce type de collecte ne marche pas du tout en zone urbaine dense.
En fonction des modes de vie, on peut supposer que la nature des déchets change. Vous l’anticipez ?
Avec la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) du Grand Lyon, on a monté un groupe déchets sur leur réduction à la source, qui répond à un de nos objectifs stratégiques. La CCSPL regroupe des associations comme la FRAPNA, « Que Choisir », des associations de quartier… , c’est un bon relais pour envisager des actions auprès des citoyens, pour qu’ils fassent eux-mêmes pression pour ne pas acheter un produit gros producteur de déchets. Nous allons aussi sélectionner des foyers témoins dans l’agglomération pour envisager ce qu’il serait possible de faire pour réduire la production de déchets.
Vous travaillez donc de moins en moins seuls…
Oui, c’est une tendance. Le partenariat a de multiples avantages, et en interne il apporte une stimulation des services. On est dans du partenariat pour chacune des trois recycleries mises en place. Nous avons passé une convention tripartie avec la société qui gère la déchèterie (gardiennage, accueil, transport des déchets…) et une association caritative (Armée du Salut, Notre Dame des Sans Abris). L’association récupère certains déchets — c’est d’autant moins pour nous — et remet des gens au travail, soit sur place, soit dans des ateliers et recycleries. Dans ce type d’action, on est à la fois dans l’environnemental, l’économique et le social, donc en plein dans le développement durable.
Comment percevez-vous le rapport à l’innovation du personnel de la direction de la Propreté : une crainte, un appétit… ?
Le changement est toujours une étape délicate. Quand on a testé GALIMEDE, outil innovant pour optimiser nos 2500 km de circuits de collecte, il a fallu l’expliquer à nos agents pour qu’ils comprennent que notre objectif n’était pas de les surveiller… Il y a une vraie volonté d’innover à la direction de la Propreté, mais elle est freinée par la lourdeur de notre organisation — on est plus de 2000 personnes ! —, par la dissémination du personnel sur le territoire ce qui rend difficile d’avoir une information qui parte de la direction et aille jusqu’au bout, par l’absence de culture de l’écrit pour une partie du personnel, par les changements fréquents dans les équipes, alors qu’il faut du temps et de la continuité pour innover… Par conséquent, on réfléchit à deux fois avant de mettre quelque chose en place ! Les cadres des subdivisions, très sollicités par la gestion du personnel de terrain, ne sont pas demandeurs d’innovations, si après on les laisse se débrouiller seuls. Ils attendent qu’à notre niveau, on réfléchisse à toutes les conséquences d’une innovation technique, sur le métier, l’organisation, la santé… L’innovation technique par elle-même n’est pas grand chose par rapport aux problèmes à régler autour !
A la Propreté, quelles entités innovent le plus ?
L’innovation peut venir de partout, il n’y a pas de règles, cela peut même être une subdivision qui, sur le terrain, va jusqu’à la phase de test sur quelque chose d’assez simple. Je pense à une subdivision qui, en cherchant à valoriser les déchets d’ébouage, a organisé une mini déchèterie. Notre service R&D l’a aidé à résoudre ses problèmes lors de l’expérimentation, et à étendre la solution aux autres subdivisions. Quand une innovation vient directement du terrain, on est sûr qu’elle répond vraiment à une demande !
L’innovation peut-elle venir d’une seule personne ?
Oui, Gérard Hodoul l’a montré avec le chariot de la propreté, de même des collègues du garage poids lourds ont beaucoup apporté pour équiper les camions dans le cadre du projet GALIMEDE, également c’est une personne en charge du SIG qui nous a apporté des solutions pour régler nos problèmes sur les circuits de viabilité hivernale… On expose un problème, et cela fait tilt chez quelqu’un ! Mais je suis convaincu que le plus intéressant vient d’un travail d’équipe. Chaque fois qu’une innovation a bien marché, elle a été porté par un groupe, même petit, qui a été jusqu’au bout de sa démarche. Avec le temps, des personnes, complémentaires, acquièrent collectivement des compétences, jusqu’au moment où le groupe atteint sa maturité et devient capable de produire beaucoup.
Quels sont les facilitateurs de l’innovation, et inversement les freins ?
Pour moi, l’innovation c’est tout ce qui fait que l’on améliore, au bout d’une chaîne, un fonctionnement. Je regrette aujourd’hui que l’on innove surtout pour communiquer dessus… avec l’effet pervers de ne pas se soucier du devenir. Dans tous les cas, il me semble indispensable que l’innovation se traduise par un résultat concret et que l’on soit capable d’évaluer son gain, à la manière de ce que nous réalisons avec notre stratégie déchet.

Article
Quelles perspectives pour la Métropole de Lyon ?

Article
La limite juste et sûre pour le climat : comment l’appliquer à la Métropole de Lyon ?

Article
Quel état du cycle de l’eau pour les territoires ?

Article
Comment s’est déroulée l’aventure de la création et de l’installation de la nouvelle collectivité ? Pour quelles raisons ces deux institutions décidèrent-elles à la fois fusionner et de se séparer ?

Interview de Christophe Chabrot
maître de conférences de Droit public à l’Université Lumière Lyon 2

Article
Peut-on mesurer la responsabilité d’un territoire dans ce dépassement ? Et quelles leçons en tirer ?

Étude
Quels défis liés à l’utilisation des matériaux dans la construction et la rénovation ?

Article
2 vidéos pour expliquer cette histoire singulière.
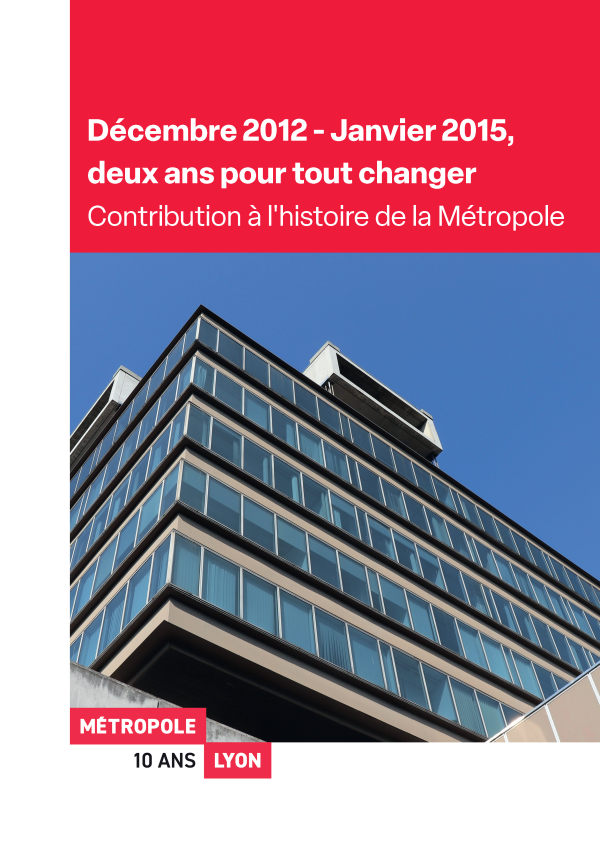
Étude
Rédiger une loi, évaluer et répartir des moyens, bâtir une architecture budgétaire et administrative, poser un organigramme, organiser les mobilités professionnelles, assurer la continuité du service public... comment de tels défis ont-ils été relevés ?