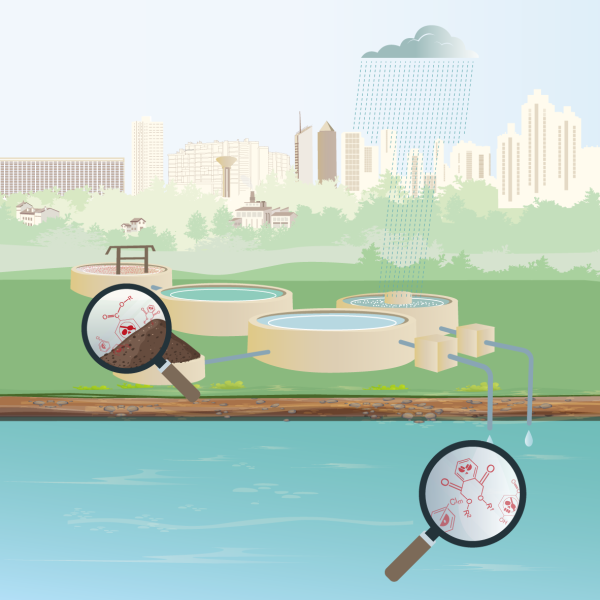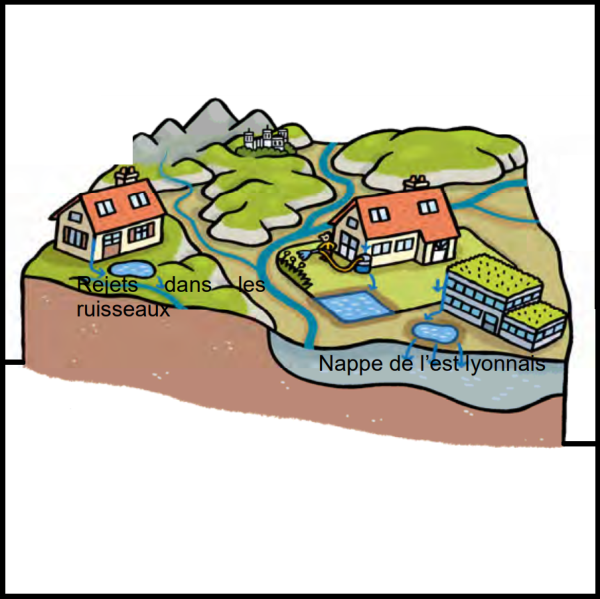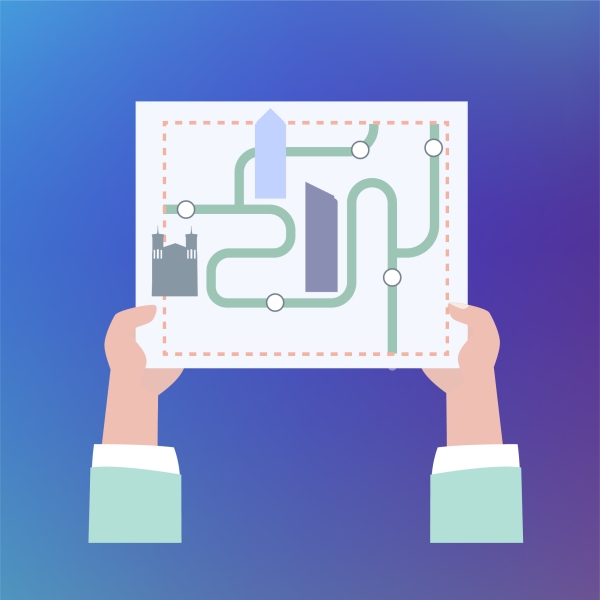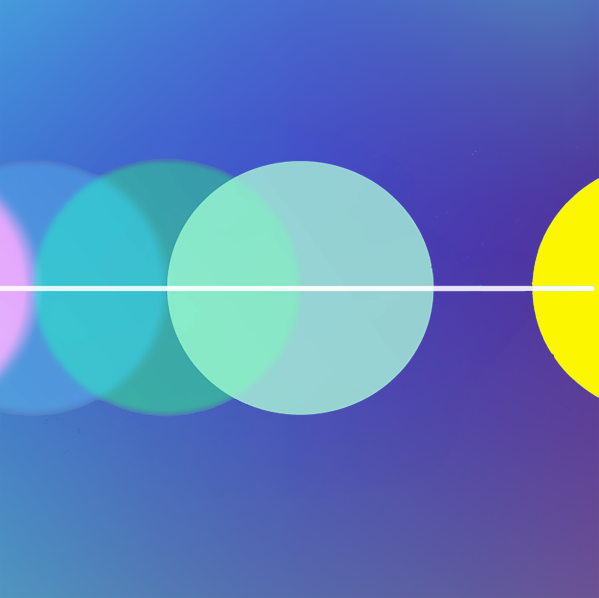J’estime que la géographie, c’est la science sociale de l’habiter humain. À elle de comprendre comment les êtres humains en société organisent leur habitat. Et l’habitat, c’est l’espace de vie d’une espèce, ce qui vaut y compris pour l’espèce humaine. Je m’inspire très directement là encore du philosophe Henri Lefebvre, qui a publié en 1974 un livre fondamental, La production de l’espace. L’un des tout premiers, il affirme que l’espace géographique est celui de nos vies individuelles et sociales. C’est un espace dont nous ne pouvons jamais nous affranchir, qui fait partie de notre existence. Produit par les individus en société, il assure la possibilité pour la société de fonctionner et de se reproduire.
Mon hypothèse, et j’admets qu’elle puisse désorienter ceux qui ne partagent pas ma conception de la géographie, est que chacun de nous est en quelque sorte un cohabitant, il habite avec d’autres, et coproduit ou coconstruit l’habitat dans lequel il s’inscrit, à travers ses pratiques. Il en découle que face à l’insoutenabilité de l’habiter, j’estime qu’il est indispensable que les cohabitants décident ensemble de la manière dont ils cohabitent. C’est une des raisons du point d’exclamation au titre Cohabitons ! Je prends très au sérieux l’idée que nous sommes véritablement des producteurs d’habitats, à partir de nos pratiques de cohabitations.
À partir de là, je mets en place toute une série de concepts, dont l’habitat, qui est l’espace et le temps de vie de chaque individu, de chaque groupe social, de chaque société, et de l’espèce humaine tout entière. L’habitat relie l’individu à plus grand que lui, c’est-à-dire au groupe, à la société et à l’espèce. Je retrouve des intuitions d’Edgar Morin, quand il dit que chaque individu est relié à l’espèce. L’habitat me relie également à divers ordres de grandeur géographiques : mon espace-temps de vie, l’espace-temps de vie du groupe, l’espace-temps de vie de la société, l’espace-temps de vie de l’espèce.
L’habitat est relié aussi à des échelles de temps distinctes, parce que mon espace-temps de vie est celui de mon actualité, de ma biographie, de la biographie de ma famille, de mon groupe social, de ma société qui me dépasse, et c’est enfin l’espace-temps de l’espèce. Vous voyez, l’habitat est un concept très riche.
L’habitation, c’est l’action d’habiter. C’est tout ce que nous sommes obligés de mettre en œuvre, au jour le jour, pour organiser nos espaces et nos temps de vie. Comme je le montre dans L’Avènement du monde, c’est très consommateur d’énergie individuelle et sociale, de temps, de ressources et de compétences, ce que j’appelle les compétences élémentaires d’habiter. Il nous faut apprendre à organiser nos espaces et nos temps de vie. Nous l’apprenons en éduquant les enfants, nous l’apprenons en déménageant d’une ville à une autre. Il faut aussi pour habiter des compétences cognitives. Savoir prendre le métro à Tokyo est loin d’être évident.
Je fais référence aussi à ce que Cornelius Castoriadis appelle des imaginaires sociaux instituants : chaque individu, pour habiter, s’inscrit dans les imaginaires socio-instituants dans lesquels il va trouver des systèmes de valeurs, des jeux de références qui vont lui permettre par exemple de justifier telle ou telle manière d’habiter dans un moment donné. Et comme on n’habite jamais seul, l’habitation est toujours une transaction entre soi et d’autres humains, une transaction entre soi et des organisations ou institutions, tels l’hôpital, l’école, l’entreprise. Et cette cohabitation est également une interaction avec des non-humains.
L’action d’habiter est une activité politique, parce qu’en fonction de nos choix, nous orientons notre cohabitation dans des perspectives politiques différentes. Selon que j’accepte ou pas la présence à mes côtés de personnes d’un autre groupe social, je vais générer le cosmopolitisme ou la ségrégation. Quant à l’habitabilité, c’est tout simplement la capacité d’une espèce, en l’occurrence l’espèce humaine, à habiter de façon digne et juste son habitat. C’est cette habitabilité qui est en crise.