Quels modèles d'innovation aujourd'hui ?

Étude
Comment soutenir une dynamique d'innovation au sein de la métropole lyonnaise ?
Interview de Caitlin McMullin

Professeure agrégée, Caitlin McMullin a fait une partie de ses études au Québec (Canada), avant de réaliser sa thèse de doctorat en Grande-Bretagne, puis de s’installer au Danemark, où elle est Associate Professor au Department of Social Sciences and Business de l’Université Roskilde.
Son travail porte sur la coproduction des services, définie par les deux dimensions de conception et de fourniture, dont elle réalise une analyse internationale et comparative.
Elle a en particulier voulu comprendre comment les cultures sociales et administratives influent sur les pratiques de coproduction pour impliquer les citoyens dans la prise de décision et la prestation des services.
Elle est notamment l’autrice de Non-profit Organizations and Co-production. The Logics Shaping Professional and Citizen Collaboration (Routledge, 2023).
Comment définissez-vous la coproduction et comment la caractériser relativement à d’autres formes de service associant les usagers ?
Dans mon livre, j’ai défini la co-production comme « la fourniture de services dans le cadre de relations régulières et à long terme entre des prestataires de services professionnels et des utilisateurs de services ou d’autres membres de la communauté ». Avec cette définition, je veux souligner deux choses importantes. D’abord, si la production touche bien la phase amont, c’est-à-dire la conception du service (définir les besoins et les attentes, concevoir le service, etc.), elle engage aussi son exécution. En ce sens, et c’est le second point, la coproduction est un processus de long terme. L’usager n’est pas sollicité que pour réfléchir au service qu’il voudrait, il est aussi mobilisé pour le fournir.
Or, le vocabulaire français n’aide pas à comprendre cette dernière dimension et ce qu’y mettent les pays anglo-saxons. La littérature francophone emploie des termes comme « cocréation » ou « co-construction », présentés comme des équivalents de « coproduction ». Ces mots sont bien adaptés pour décrire l’implication amont des usagers : l’association les citoyens dans les décisions stratégiques en termes de priorités, de choix de services, puis de design. En ce sens, ils permettent de différencier la coproduction de service de la simple consultation ou de la concertation qui, en définitive, implique souvent assez peu les citoyens.
En revanche, les termes français de « co-production », « co-création » ou « co-construction » manquent la partie concrète de l’exécution du service dans le temps. C’est pour cela que j’insiste sur ce sens : la coproduction consiste aussi en la fourniture de services. Cela met l’accent sur le front line, c’est-à-dire la manière dont l’offre de services se déroule pratiquement, dans les faits, en bénéficiant de la collaboration entre professionnels et usagers. C’est cette difficulté de vocabulaire qui explique, en partie, que la France se soit davantage intéressée à la co-conception qu’à la co-prestation.
En France, favoriser la co-production des services trouve souvent son origine dans une volonté de démocratisation des institutions publiques. À quelles logiques correspond la co-production telle que vous l’avez vue ailleurs ?
Oui, c’est souvent aussi la volonté d’avoir des services plus démocratiques et qui constituent une réponse au discours d’un déficit démocratique des administrations. C’est important, mais ça n’est pas le seul intérêt et, surtout, ce n’est pas à sens unique. C’est-à-dire qu’il y a des avantages mutuels pour l’usager et les pouvoirs publics à cette coproduction.
Donner plus de place à l’usager dans le processus de prestation de service, c’est lui donner plus de pouvoir de faire et l’amener à avoir des services répondant mieux à ses besoins. En ce sens, impliquer plus les usagers peut conduire à avoir de meilleurs résultats les concernant, parce que cela leur donne plus d’influence dans tel ou tel domaine qui compte pour eux.
Du côté des pouvoirs publics, il y a bien sûr l’intérêt d’avoir des services mieux adaptés aux attentes du public. Mais il y a d’autres éléments, comme la question du coût, la question du recours, la question de l’allègement de la pression sur d’autres services, etc.
Ces questions intéressent beaucoup la recherche, mais ne sont pas complètement tranchées. Si on prend la question du coût. Il est possible qu’associer les usagers à la production des services permettent de faire des économies : une plus grande adéquation entre l’offre et les demandes de services et une meilleure connexion avec les besoins des citoyens peuvent éviter le gaspillage, baisser le non-recours, etc.
Pour autant, la coproduction a aussi des coûts, puisqu’elle prend du temps à mettre en place, qu’elle associe des non professionnels, etc. Et donc, ça reste une question ouverte qui dépend des situations particulières. En réalité, on a beaucoup de mal à le documenter parce qu’il y a des effets en cascade qu’on ne perçoit pas forcément.
Par exemple, créer un service pour des adolescentes enceintes, ça a certes un coût, mais l’aide qui leur est apportée peut soulager d’autres services, comme le logement, les services de santé, etc., et donc réduire la pression sur ceux-ci. Autre exemple, la coproduction des services de réinsertion impliquant d’anciens détenus peut réduire le risque de récidive et, ainsi, soulager les services de police, de justice et pénitentiaires. En ce cas, ce sont des coûts évités par la prévention apportée par le nouveau service, dont il faut tenir compte pour l’évaluation des coûts globaux et c’est toujours très complexe.
Une des difficultés régulièrement relevées des processus participatifs est de parvenir à associer réellement les citoyens. Souvent, ils n’ont qu’un faible pouvoir de décision sur le processus de production des services publics. Comment aller plus loin ?
En insistant, dans un premier temps, sur la co-création. Je reprends ici la distinction faite plus haut entre d’un côté la conception et, de l’autre, la fourniture comme couvrant les deux dimensions clés de la coproduction. Si l’on veut vraiment associer les usagers, alors il faut commencer par les impliquer dans la dimension amont de conception, à travers des partenariats stratégiques sur ce que l’on veut faire, pourquoi on veut le faire, comment, etc.
En Angleterre, on parle de co-commissioning (proche de la « commande publique » au sens large et de la coélaboration des services). Cela permet de faire ressortir l’enjeu d’une planification partagée ou commune des services au public. On est donc à un stade très amont, où avant même de décider quel design on donne à un service, on se questionne ensemble sur les attentes, la priorisation des services, etc., et on va jusqu’à intégrer le principe de la co-prestation.
Ce que j’ai vu, au Québec, c’est une vraie culture de la concertation et du partenariat social entre les acteurs, c’est-à-dire l’État du Québec, les syndicats, les organismes communautaires et les organismes de l’économie sociale pour concevoir les politiques publiques, puis, ensuite, construire des partenariats pour mettre en œuvre l’offre de services et la fourniture des services. C’est un contexte historique et social qui installe cela comme une norme de travail commune et où l’État du Québec est vraiment ouvert aux autres voix dans le secteur communautaire.
Mais cette volonté et cette culture de collaboration et de partenariat, on ne la trouve pas que dans le secteur public. Elle est présente aussi dans le secteur associatif, où il y a beaucoup d’organismes qui sont prestataires de services et qui vont également chercher à associer d’autres usagers. On a donc des mouvements « bottom up », d’associations qui vont mobiliser les pouvoirs publics, et « top down », où les pouvoirs publics vont solliciter les organisations communautaires.
J’ai étudié une organisation de développement communautaire qui a un programme qui s’appelle Décider Rosemont Ensemble. Rosemont est un quartier de Montréal, au Québec, où existe depuis 35 ans une Corporation de développement communautaire (CDC), qui regroupe des associations du quartier. Tous les cinq ans, cet organisme met en œuvre un processus pour co-élaborer avec les habitants, les associations, les parties prenantes, les « priorités de quartier » qui sont collectivement choisies lors d’un forum. Dans les cinq priorités, on trouve actuellement « S’assurer que Rosemont demeure un quartier accessible économiquement » ou « Faciliter l’utilisation du transport collectif et actif ».
À l’époque, j’avais étudié un projet de Resto populaire de quartier. Le principe est celui d’un lieu inclusif, proposant des repas de qualité à faibles prix. L’idée vient des citoyens, à partir des premiers travaux de la démarche Décider Rosemont Ensemble, en 2018. Mais si l’idée vient des habitants, sa mise en œuvre s’appuie également sur l’accompagnement d’associations locales et sur le soutien, notamment financier ou logistique, de l’arrondissement de Rosemont. L’arrondissement de Rosemont soutient aussi d’autres initiatives citoyennes, par exemple, créer des ruelles vertes qui sont cogérées par les habitants.
L’idée est que les citoyens réalisent eux-mêmes en partie le service. Pour le Resto populaire de quartier, comme pour d’autres initiatives co-portées, le principe est que le service est mis en œuvre par des citoyens bénévoles, habitants du quartier, avec la participation de professionnels salariés qui offrent du soutien administratif, opérationnel, etc. Mais c’est un projet, un service ou une ressource commune qui ne peut pas être accompli sans les actions et les ressources des citoyens eux-mêmes.
Dans cette coproduction, au sens de co-fourniture, vous parlez d’associer bénévoles et professionnels. Il n’y a pas un point de difficulté à gérer ce type d’équipes mixtes ? N’est-ce pas lourd de confier à des professionnels la responsabilité de non professionnels pour rendre un service ?
Oui, c’est un frein et il ne fait pas l’objet de remarques qu’en France. Il peut y avoir des réticences à travailler avec des usagers et, je l’ai noté, surtout dans des secteurs très professionnalisés, comme la santé. Les professionnels pensent : « Je suis l’expert de ce domaine, pourquoi impliquer les citoyens qui ne le sont pas ? ». Ils vivent cela comme une remise en question de leur expertise et de leur légitimité. Donc, oui, c’est un facteur de résistance.
Mais ce que je constate aussi, c’est une ouverture de plus en plus grande de ces professionnels experts qui commencent à reconnaître que des usagers ont des connaissances qu’ils tirent de leurs expériences et qui constituent des savoirs d’usage complémentaires à leur expertise. L’importance de ces savoirs situés dans le vécu des personnes est de mieux en mieux perçue. En fait, des recherches ont montré que, si les professionnels peuvent avoir envie de « faire différemment », il leur manque souvent les compétences, la formation et les méthodes nécessaires pour coproduire efficacement.
Est-ce que cette évolution est plus visible dans certains pays que d’autres, ou c’est plutôt des expériences particulières qui amènent les experts à changer d’avis ?
C’est lié à la fois aux domaines d’intervention et aux contextes sociaux. Comme je le disais, plus les secteurs sont techniques et professionnalisés, plus il peut y avoir de résistance à l’implication des citoyens dans la coproduction. Et, en même temps, il y a des contextes sociaux où l’on voit davantage d’ouverture à l’expertise des usagers. Au Québec, par exemple, cette culture est plus normalisée et on voit que les citoyens sont impliqués dans la prise de décision comme dans la prestation. De même en Grande-Bretagne. Il y a 15-20 ans, quand je travaillais sur le secteur associatif, je le voyais déjà.
Lorsque l’usager sollicite un service, il a souvent lui aussi un rôle à jouer, ne serait-ce que fournir des renseignements, remplir des papiers, réaliser des démarches, etc. Est-ce que cela renvoie à cette co-prestation ?
C’est un des débats dans la littérature sur la coproduction. D’une certaine façon, oui, il y a toujours une forme de coproduction. On cherche toujours l’implication de l’usager dans le service, sans quoi il n’est pas toujours possible de le fournir.
On peut prendre l’exemple de l’éducation. Quand un enseignant transmet un savoir à un étudiant, celui-ci doit participer (écouter, poser des questions, apprendre, faire ses devoirs, etc.) sans quoi le service est manqué. Donc, on peut dire que l’éducation est un service coproduit par le professeur et l’élève. On peut aussi le dire pour les services de santé : le médecin effectue une intervention médicale et le patient est mobilisé pour prendre ses médicaments. On pourrait appeler ça de la coproduction. Mais, pour ma part, ça décrit plutôt la prestation de services traditionnelle qui renvoie à une approche qui dilue le principe de coproduction.
Pour moi, la coproduction implique une collaboration à double sens. Or, ici, que donne l’étudiant à l’enseignant qui concourt réellement à la fourniture du service ? Pour avoir des services plus efficaces, plus démocratiques et plus inclusifs, il faut miser sur une collaboration plus forte dans la prestation de services.
Si je reprends l’exemple médical, je dirais que, pour que le service soit coproduit, il doit inclure un travail commun avec le corps médical et les usagers, comme concevoir un plan de soins médicaux où le patient participe à un groupe de soutien à titre de pair-aidant ou un programme de patients experts. Pour moi, ça, c’est vraiment de la coproduction. Cela suppose d’aller plus loin que la simple coopération dans l’interaction ponctuelle agent/usager, où ce dernier ne travaille qu’à la réalisation du service qu’il demande pour lui-même.
Pourtant, est-ce que reconnaître cette contribution un peu invisible de l’usager ne permettrait pas de poser une première étape pour montrer aux agents publics ou aux experts professionnels, dont vous parliez tout à l’heure, qu’ils sont déjà dans une situation où ils doivent compter sur la coopération de l’usager afin de l’impliquer ?
Oui, tout à fait. En fait, avec l’exemple des soins au patient, on peut dire que, oui, il est nécessaire que le patient soit inclus comme agent du processus de service médical parce que s’il ne prend pas ses médicaments, l’intervention médicale ne sera pas réussie.
Donc, il faut l’impliquer et on peut effectivement commencer avec ça, a minima. Puis on peut dire : « Oui, il prend ses médicaments, mais est-ce qu’il n’a pas autre chose à apporter au service ? » Comment travailler entre patients et médecins pour regarder s’il y a des changements de mode de vie chez le patient, s’il y a d’autres soutiens importants dont il peut témoigner et, in fine, améliorer le traitement médical. Et puis on peut se demander ce que le patient ou l’ex-patient peut apporter à ceux qui sont malades. Donc, oui, tout commence avec ces interactions dans le service, mais il faut aller au-delà de ça pour une réelle co-production.
Vous avez travaillé sur les différentes modalités de coproduction des services dans le monde, on l’a évoqué. Est-ce qu’il y a différents modèles ?
Ce que j’ai constaté, c’est qu’il y a différentes façons de faire de la coproduction et ça dépend un peu du contexte social, politique, administratif et culturel. Par exemple, en Angleterre, j’ai effectivement trouvé des exemples de coproduction très formalisés, comme des ateliers de co-conception des services, mais surtout de la coproduction informelle, qui se passe au quotidien entre les intervenants de services et les usagers. Et c’est un contraste avec ce que j’ai vu en France, quand j’ai travaillé sur les centres sociaux.
En France, j'ai constaté que la coproduction était beaucoup plus formalisée en termes de procédures. On faisait des votes pour décider des priorités de l’organisation, il y a des règles, des chartes, des statuts… S’il y avait des façons d’impliquer les citoyens dans les services qu’ils offrent, c’était vraiment beaucoup moins informel qu’en Angleterre. C’est lié à la culture des organisations et aux cultures administratives qui normalisent ces types d’implications.
Ce qu’on voit dans les différents modèles, c’est un spectre avec, d’un côté, de la coproduction au quotidien, peu ou pas formalisée ni codifiée. Un processus un peu ad hoc entre les intervenants et les citoyens, plutôt modèle anglo-saxon. Et à l’autre bout du spectre, une formalisation très forte des rapports entre les professionnels et les usagers, dans un cadre très normé. C’est surtout cette partie du spectre qu’on voit en France.
Est-ce qu’il y a des exemples de coproduction et d’amélioration continue des services publics qui reposent sur des liens peu formalisés ?
Oui, par exemple, Trondheim, une commune de Norvège, a fait le choix d’être une municipalité coproduite. C’est une démarche très formelle, mais à l’intérieur de laquelle il a été décidé de travailler sur la façon d’essayer de changer la culture de l’organisation. L’idée est de dire que, dans ce type d’organisation, on va soutenir les professionnels pour qu’ils retravaillent leur relation aux usagers et leur donner la possibilité de faire des coproductions plus informelles.
Le principe est que la coproduction soit soutenue par le haut, c’est-à-dire par la puissance publique, mais aussi dans l’espace plus informel des relations quotidiennes. Dans la pratique, ça signifie que les agents municipaux ne sont pas seulement des exécutants : ils doivent apprendre à travailler dans un cadre plus ouvert, où l’idée de service est coconstruite avec les usagers. Ils sont encouragés à valoriser des propositions citoyennes, à tester des idées et à s’investir dans des processus plus flexibles.
Vous insistez sur l’importance du cadre social et culturel. Quel est le poids du cadre français et du service public à la française sur les dynamiques de coproduction ?
De ce que j’ai observé, comme chercheuse étrangère en France, c’est que le manque de flexibilité est le principal frein. L’administration publique y est réputée hiérarchique et bureaucratique, et les notions d’intérêt général et de service public qui encadrent la prestation de services (égalité, continuité) ne favorisent pas le volet fourniture de la coproduction de service.
Bien sûr, c’est important qu’il y ait des structures, des règles et des statuts pour protéger le service public, mais ça peut aussi être un obstacle à l’innovation et à la coproduction, dès lors qu’il s’agit de faire les choses un peu différemment. De fait, oui, la souplesse qui permet la coproduction, peut conduire à des inégalités d’accès, à un service un peu différencié selon le lieu ou le temps. C’est, je pense, ce qui produit le plus grand frein pour la co-fourniture de services en France, quand je le compare avec d’autres contextes.
En Angleterre, où j’ai fait la plupart de mes recherches, ce n’est pas une question très discutée ! Parce qu’il y a beaucoup plus de responsabilisation des citoyens. L’État transfère des services publics aux communautés et décide de ne pas ou de ne plus les offrir lui-même. Certes, cela soulève beaucoup de critiques, mais cela évacue les réflexions autour des questions statutaires ou des problèmes de transfert de risque. Les questions d’égalités d’accès ne sont plus les siennes.
Le cadre même du service public à la Française paraît peu propice à la coproduction, et en particulier la co-fourniture, mais n’est-ce pas un signe de sa robustesse quand on voit que la coproduction des services britanniques est aussi née du désengagement de l’État ?
Effectivement, la coproduction a largement été promue, en Grande-Bretagne, en réponse à une évolution des administrations publiques, après les effets du Nouveau Management public des années 1980-90. C’est un mouvement vers la coproduction qui est alors lié, là-bas, à l’austérité budgétaire et à la privatisation des services.
Cela peut sembler paradoxal parce que, en même temps que la coproduction est une évolution que l’on peut souhaiter pour les usagers, il est difficile de la dissocier, en Grande-Bretagne, de ce contexte d’économie publique. On a alors des courants politiques qui, au nom de l’importance du pouvoir citoyen, assument de couper les financements publics affectés aux services…
C’est vrai que l’État-providence libéral peut être un facilitateur de la coproduction parce qu’il cherche à lever les contraintes réglementaires et qu’il offre plus d’opportunités de faire des choses différemment. En même temps, il faut aussi se rendre compte que cela a conduit à moins de services publics et plus de pression sur ceux qui continuent à exister.
Il y a donc un équilibre à trouver : la coproduction peut donner du pouvoir au citoyen, mais s’il n’y a pas assez de services et de financements des services, ça n’est pas vraiment donner du pouvoir supplémentaire. C’est du désengagement et du transfert de responsabilisation vers la société civile. On arrive à des situations extrêmes où, finalement, les collectivités publiques se défaussent sur l’usager dans l’autoproduction des services.
C’est ce que j’ai pu constater en Angleterre avec des bibliothèques publiques qui étaient transférées aux organismes communautaires. Or, ici, ce n’est pas une coproduction, c’est un transfert vers le privé ou vers la communauté — qui n’est pas nécessairement demandeuse — pour un motif d’économie budgétaire. C’est évidemment un problème qui montre que la coproduction doit reposer, au contraire, sur un engagement des collectivités publiques pour faire mieux en collaborant avec les usagers.
Vous évoquez aussi le rôle des modèles de protection sociale. Comment jouent-ils sur la coproduction des services publics ?
Là encore, c’est lié à la culture administrative et à la question de savoir qui est responsable pour la prestation des services publics. Les services, en Grande-Bretagne, ne sont pas toujours financés par l’État. Dans le modèle libéral, il y a plus de privatisation et moins de protection. En conséquence de quoi, il y a plus d’organisations privées qui assurent des services au public.
Les services que j’ai étudiés là-bas ne sont pas des services publics en tant que tels, produits et financés par l’État. Ce sont des services pour le territoire, pour les résidents, qui sont en partie subventionnés par l’État et en partie par des fondations, par des donations, etc. Or, ces organismes privés vont se manager comme tels, c’est-à-dire avec des logiques d’entreprises et non avec des logiques d’administration. Ça vaut pour la gestion, pour la prise de décision, pour la relation au client/usager, etc.
En Grande-Bretagne, il y a beaucoup de services publics qui sont confiés au privé. Donc, les municipalités utilisent des contrats de délégation pour attribuer tel ou tel service à telle ou telle organisation. Pour choisir, évaluer et contrôler, ils se réfèrent à des modèles de gestion de la performance du management des services calqués sur le privé.
On va travailler la relation à l’usager et chercher à l’associer, mais pour des raisons qui sont davantage liées à l’efficacité et à la satisfaction des « clients », qu’à une volonté de démocratisation, d’inclusion. C’est en cela que je dis que le modèle de protection a un impact sur la coproduction des services : le modèle de l’État-providence influe sur le modèle de prestations de services publics.
Cela signifie que la coproduction est un concept qui peut être mis au service de causes totalement différentes, voire antagonistes ?
Oui, la coproduction dans le secteur privé est un type de coproduction qui est plus pragmatique et qui se situe moins dans une logique d’empowerment. Et, effectivement, il n’y a pas beaucoup d’exemples d’organisations privées qui essaient de faire l’implication à long terme, de façon à soutenir les usagers qui en ont besoin. Mais ce n’est pas que le critère privé/public, car on voit des structures privées à but non lucratif qui mettent en place des programmes intéressants de coproduction.
Une étude comparative des modèles publics et privés non lucratifs sur les garderies en Suède conclut même que les organisations privées non lucratives ont de meilleurs résultats. En fait, on le voit un peu partout, les associations ont plus de capacité, par comparaison avec les agents publics, à entrer en relation avec les citoyens et à les mobiliser. Mais la question qui doit toujours être posée est celle de l’objectif recherché. Est-ce que l’on veut juste réduire les coûts, transférer la fourniture de service, ou améliorer la qualité de ceux-ci, donner plus de pouvoirs aux citoyens et renforcer le contrôle démocratique des services publics ?
Dans ce dernier cas, cela suppose de se donner des moyens, des méthodes, d’expérimenter. Ce que montre la recherche, c’est que les exemples de coproduction les plus réussis sont ceux où le risque d’échec avait été intégré et qui consistent donc à expérimenter des façons de faire nouvelles, en s’affranchissant des lourdeurs administratives.
Au Canada, il existe des méthodes qui peuvent être inspirantes pour la France, comme le développement communautaire fondé sur les ressources (asset-based community development, ABCD). L’approche ABCD est fondée sur l’idée de mieux valoriser les compétences et les savoirs des citoyens, en identifiant les ressources déjà présentes chez les résidents d’un territoire et les mettant à profit pour soutenir l’action collective. Pour les professionnels publics, cela suppose un management qui encourage l’écoute, le travail en réseau et une posture plus facilitatrice, où l’on soutient les initiatives locales plutôt que de tout piloter depuis l’administration.
Vous avez plusieurs fois mentionné les organismes communautaires. C’est un concept qu’on ne connaît pas en France. Est-ce que vous pouvez les décrire et préciser le rôle qu’ils jouent dans cette coproduction des services ?
Les organismes communautaires sont des organismes à but non lucratif. Je pense qu’il n’y a pas de différences majeures entre ces organismes et les associations en France. Simplement, l’idée de communauté et communautarisme est mal acceptée dans le contexte culturel d’une République laïque à la française. Ceci étant, peut-être qu’une différence est la prégnance plus forte du lien au territoire dans les organismes communautaires.
Ce sont des groupes démocratiquement organisés et créés à l’initiative des habitants ou d’une catégorie d’habitants. Ils vont se structurer autour des problèmes de la communauté et réfléchir pour savoir ce que les gens qui occupent ce même territoire peuvent faire ensemble sur tout le spectre de la vie de la communauté. C’est en cela que le contexte joue, c’est que les organismes communautaires du Québec sont pensés pour régler les problèmes de communauté de vie sur un même territoire alors que les associations françaises vont peut-être agréger des individus autour de thèmes ou de mobilisations de défense. C’est assez cohérent avec les cultures politiques de ces États.
Vous utilisez l’image d’un tandem pour illustrer la coproduction et l’ajustement des conditions pour la co-prestation dans le temps. Comment cela fonctionne-t-il ?
J’ai réalisé un schéma à partir de la synthèse de mes recherches portant les coproductions qui sont durables dans le temps. Parce qu’on trouve beaucoup d’exemples de projets de coproduction qui s’arrêtent après quelques mois ou quelques années. Or l’enjeu, c’est bien d’arriver à des services pérennes. Donc j’ai essayé de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent faciliter la durabilité de la coproduction. Et ce que j’ai trouvé, c’est qu’il y a quatre facteurs qui doivent être mis en cohérence pour s’assurer de la continuité du processus. D’abord, la combinaison de ressources (argent, temps, participants, etc.).
Deuxièmement, il faut avoir des compétences (skills), qui sont aussi bien celles des professionnels que celles des usagers citoyens engagés dans la production du service. Troisièmement, il faut une structure de coproduction, formelle ou informelle, mais cohérente avec les ressources et les compétences et les acteurs. Et, enfin, il faut un engagement mutuel des professionnels et des citoyens. C’est ce qu’illustre cette figure du tandem avec le cadre du vélo qui permet aux personnes d’activer les roues (compétences et moyens). Et si le cadre et les roues sont un prérequis, il faut avoir conscience que le vélo n’avance pas sans l’engagement mutuel (mutual commitment) des participants.

Étude
Comment soutenir une dynamique d'innovation au sein de la métropole lyonnaise ?

Interview de Bertrand Foucher
Directeur général d’ONLYLYON & CO
Comment mettre en œuvre une stratégie de robustesse ? Bertrand Foucher nous explique dans cet entretien les nouvelles modalités de son action.
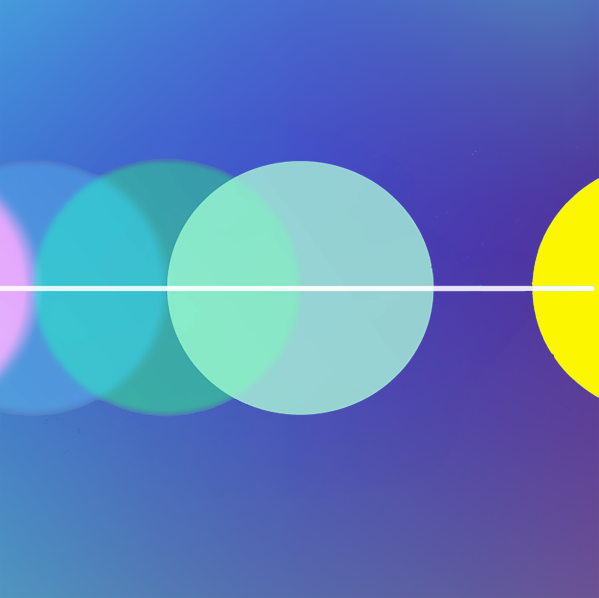
Dossier
Ce dossier donne de premières clefs pour interroger de manière lucide les leviers de transformation de nos entreprises et de leurs modèles.

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?

Interview de Philippe Huneman
Directeur de recherche CNRS à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques
Quel est le sens du mot profilage et quels sont ses principaux mécanismes ?

Interview de Fabrice Hamelin
Professeur de sociologie à l’Institut d’études politiques de Fontainebleau-UPEC
La politique de sécurité routière est une politique du quotidien.

Étude
Toute dépendance aux importations est-elle synonyme de menace pour la souveraineté économique ?

Étude
Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant

Texte d'Anouk JORDAN
Les violences avec le public témoignent de la difficulté d’exercer le métier de travailleur social dans les organisations concrètes du travail que sont les collectivités territoriales.