L'enjeu de l'adhésion des usagers pour les travailleurs sociaux

Interview de Nicolas FIEULAINE
Maître de conférences en psychologie sociale, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS), ’Université Lyon 2
Interview de Olivier Galland

<< Le sentiment d’injustice et de révolte d’une partie des Français tient pour une part au fait qu’ils ont le sentiment de ne pas être écoutés par un pouvoir central trop éloigné de leurs préoccupations. Le renforcement d’une véritable décentralisation serait donc une piste à creuser >>.
« Le sentiment d’injustice et de révolte d’une partie des Français tient pour une part au fait qu’ils ont le sentiment de ne pas être écoutés par un pouvoir central trop éloigné de leurs préoccupations. Le renforcement d’une véritable décentralisation serait donc une piste à creuser ».
Sociologue spécialiste des inégalités, Olivier Galland est directeur de recherche émérite du CNRS au Groupe d’Étude des Méthodes de l’Analyse Sociologique de la Sorbonne (GEMASS).
Il a notamment publié Sociologie des inégalités, avec Yannick Lemel (Armand Colin, 2018) et dirigé La France des inégalités. Réalités et perceptions (PUPS, 2016).
Pourriez-vous resituer la notion de « justice sociale » dans le contexte contemporain ?
Morton Deutsch avait proposé en 1983 une synthèse qui fait toujours référence. Il distinguait trois aspects dans les questions de justice : le mérite, l’égalité et les besoins. Ces trois aspects ont chacun leur légitimité. L’équité veut que le mérite soit reconnu et récompensé, notamment dans le domaine économique. Mais l’égalité peut prévaloir lorsqu’on compare des personnes hors de ces situations économiques. Par exemple Michel Forsé et ses collègues avaient montré que les enfants font prévaloir cette norme d’égalité lorsqu’il s’agit de répartir entre eux certaines gratifications. Elle peut prévaloir aussi lorsque l’inégalité va au-delà de ce qui est justifié par le mérite. Enfin la notion de besoin s’impose lorsqu’on considère le minimum vital auquel tout citoyen doit avoir droit pour préserver sa dignité personnelle, par exemple pouvoir se loger, se vêtir, s’alimenter, se soigner. Ces différents critères ne sont donc pas contradictoires, ils peuvent s’articuler en fonction des domaines et des situations considérées.
La notion de mérite est peut-être plus que d’autres objet de débats. Comment la définir ?
Sur ce plan, la contribution d’un économiste américain, John Roemer, est capitale. Il propose de distinguer ce qu’il appelle les circonstances et les efforts. Les circonstances sont tous les facteurs qui font varier une situation individuelle par rapport aux autres et sur lesquels l’individu ne peut exercer absolument aucune influence. Elles relèvent en grande partie des hasards de la naissance. Les efforts, c’est tout le reste, tout ce qui ne relève pas des circonstances, et sur lequel l’individu peut, a priori, exercer une influence pour améliorer ou non sa situation individuelle. Cette distinction est conceptuellement satisfaisante, elle permet de donner un cadre au concept d’égalité des chances. Une politique d’égalité des chances visera à réduire autant que possible l’impact des circonstances sur le destin des individus. Mais la notion est difficile à mettre en œuvre en pratique, car les « efforts » sont définis négativement (ce qui ne relève pas des circonstances) ce qui n’est pas très satisfaisant, d’autant que les limites du champ des circonstances peuvent être sujet de débat. Par exemple, les orientations de valeurs transmises par les parents à leurs enfants, font-elles sans discussion partie des « circonstances » ? Ne peut-on considérer que les individus ont la possibilité de s’en extraire si elles contribuent négativement à leur réussite, ou doit-on considérer qu’elles constituent au même titre que le capital génétique, une donnée sur laquelle l’individu n’a aucune prise ? L’idée qu’il faille s’appuyer sur le concept d’égalité des chances et sur les préconisations de John Roemer est assez largement partagée dans le cercle des économistes (voir par exemple les travaux d’Arnaud Lefranc très représentatifs de cette tendance). Cette orientation est cependant contestée par certains sociologues comme François Dubet qui incite à promouvoir l’égalité des places pour éviter, même au nom du mérite, de fabriquer des vaincus de la compétition sociale. Ce débat est évidemment largement ouvert.
Il semble que le débat, en France, se soit construit à partir du cadre d’analyse des « inégalités » (entendues comme une « différence jugée injuste ») plus qu’à partir du cadre d’analyse de la « justice sociale ». Comment l’expliquez-vous ?
C’est un peu un débat sémantique car, à partir du moment où on définit l’inégalité comme une différence jugée injuste, on introduit la notion de justice. Il y a deux façons de considérer la question de la justice sociale, une façon spéculative et une façon positive. La façon spéculative est celle des philosophes et, pour une partie d’entre eux des économistes, qui comme John Rawls tentent de définir des principes de justice. La façon positive est plutôt celle de la sociologie, du moins de ceux qui s’inspirent de Max Weber, et qui veulent respecter un principe de neutralité axiologique. Ils ne chercheront donc pas à définir in abstracto des principes de justice, mais à faire l’étude sociologique et historique de la variabilité de sa définition selon les sociétés et les époques. C’est un constat indéniable : les principes de justice socialement reconnus ont fortement évolué. Au temps de Marx on ne portait aucune attention aux inégalités de genre. Si l’on retient notre définition, cette inégalité n’en était pas une, au sens où elle n’était à l’époque pas reconnue comme injuste, mais pensée comme naturelle. On peut bien sûr la penser comme profondément injuste avec les outils conceptuels et la sensibilité contemporaine et cette démarche est tout à fait possible. Mais la démarche relativiste est également intéressante en ce qu’elle permet de prendre du recul par rapport à nos propres standards moraux. En réalité les deux démarches ne s’opposent pas.
Aujourd’hui les normes de justice sont-elles largement partagées ou assiste-t-on à leur individualisation, ce qui rendrait plus difficile de s’accorder collectivement sur ce qu’est une société juste ?
Il y a un assez large consensus sur les normes de justice. Nous avions fait ce constat dans les enquêtes que nous avions menées en 2009 puis en 2013 sur le sujet [1]. Les Français adhèrent assez massivement aux principes de justice énoncés par Morton Deutsch. Ils reconnaissent le mérite mais veulent aussi réduire les inégalités entre les hauts et les bas revenus (sans remettre en cause la hiérarchie et sans adhérer à une société égalitariste). Ils sont également très sensibles à l’idée d’assurer à chacun un minimum qui permette de vivre dignement.
En même temps, il est vrai que la question de l’égalité et de la justice se complexifie sous l’effet de plusieurs évolutions. Tout d’abord, la question de l’égalité et de la justice a débordé le champ de l’économie où elle était réduite depuis les analyses de Marx et au fil des luttes sociales qui ont émaillé le XIXème siècle et une grande partie du XXème siècle. En effet, une sensibilité nouvelle a fait apparaître la question des discriminations. C’est une question différente de celle de l’égalité. L’inégalité est une différence injuste au regard de la contribution apportée. La discrimination est une différence injuste au regard de l’identité de la personne : elle est traitée injustement en fonction de son sexe, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle… Cette sensibilité identitaire s’est considérablement élargie et elle contribue donc à démultiplier la question de l’injustice et à la faire sortir du strict champ économique.
Par ailleurs, sur le plan des inégalités, il y a un phénomène d’individualisation des risques. Les risques ne sont plus simplement associés à l’appartenance à une catégorie sociale, ils sont plus individualisés du fait du recul de la protection de l’emploi et de la fragilité plus grande des ménages sous l’effet de la montée de la divortialité et de la vie solitaire. Les pauvres sont souvent des personnes seules. Cette question de la solitude devient un nouvel angle d’étude des inégalités. Enfin, on pourrait ajouter qu’avec la mondialisation la question de l’inégalité se pose dorénavant à l’échelle planétaire : l’accroissement de l’inégalité dans les pays développés est probablement lié pour partie à la réduction de l’inégalité à l’échelle mondiale.
[1] "La France des inégalités, réalités et perceptions", PUPS, 2016
Pour favoriser une approche moins théorique que celle de la justice sociale, plus « positive », peut-on s’intéresser aux sentiments d'injustice vécus par les personnes ? Est-ce que cela ne permet pas de mieux comprendre ce que les gens trouvent juste ou injuste ?
Oui mais lorsque l’on fait des comparaisons internationales on voit que les sentiments d’injustice varient fortement d’un pays à l’autre et que cette variation est loin d’être corrélée à la mesure objective des inégalités. Par exemple, la sensibilité aux inégalités et à l’injustice sociale est beaucoup plus faible aux Etats-Unis qu’en France, alors que l’inégalité y est beaucoup plus forte. La sensibilité aux injustices dépend donc d’un contexte culturel et idéologique propre à chaque pays. Tocqueville l’avait déjà dit, la sensibilité aux inégalités est particulièrement élevée en France. Nous avons la « passion de l’égalité ». Lorsqu’on étudie les attitudes des Français à l’égard de l’inégalité on voit ainsi qu’elles sont relativement peu liées au statut social des personnes. Elles le sont beaucoup plus aux attitudes politiques et aux valeurs qui leur sont associées. La sensibilité à l’inégalité et aux injustices décroît lorsque l’on va de la gauche vers la droite, mais elle remonte fortement néanmoins à l’extrême-droite. C’est donc une courbe en U. Les personnes se situant à l’extrême-droite sont sensibles aux inégalités mais pas pour les mêmes raisons que ceux qui se situent à gauche. Ils mettent en cause les fraudes et les privilèges dont bénéficieraient abusivement certaines parties de la population et notamment les immigrés.
Quels sont les mécanismes qui produisent ses sentiments d’injustice ?
L’enquête Dynegal [1] montre que le statut social a un effet globalement faible sur le sentiment d’avoir subi personnellement des injustices. La catégorie socioprofessionnelle n’exerce pas d’effet significatif, le revenu en exerce un, mais relativement faible, concernant essentiellement les plus bas revenus. Ces résultats peuvent s’expliquer en partie par le rôle contradictoire du diplôme : les personnes les moins diplômées déclarent moins souvent avoir subi des injustices que celles plus diplômées. En effet, les aspirations s’accroissent avec le niveau de diplôme et avec elles, parfois, le sentiment de ne pas être récompensé à sa juste valeur.
En regard, les variables qui rendent compte d’un sentiment d’insécurité économique (la crainte d’une évolution défavorable de sa situation d’emploi) ou d’une grave perturbation de son itinéraire personnel (licenciement, maladie, décès d’un proche…) sont liées de manière beaucoup plus nette aux sentiments d’injustice. Cela fait écho à des travaux sur l’insécurité économique qui montrent que l’inégalité interindividuelle est plus fortement impactée qu’autrefois par des événements imprévus (perte d’emploi, divorce notamment) qui perturbent les itinéraires individuels. Des auteurs comme Bruce Western et ses collègues [2] proposent de renouveler l’analyse de la stratification sociale à partir du concept d’insécurité économique qui rend compte du risque de perte économique encouru par des acteurs qui font face à des événements imprévus et perturbateurs dans leur vie personnelle.
[1] « Le projet de recherche DYNEGAL (dynamique des inégalités - la formation des représentations), conjointement mené par le GEMASS (Groupe d'Étude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne), le CMH (Centre Maurice Halbwachs) et PACTE (Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires), a pour objectif d’identifier, d'expliquer les mécanismes de formation des représentations des inégalités », présentation du projet sur le site dynegal.org
[2] Western B., Bloome D., Sosnaud B. and Tach L. 2012, “Economic Insecurity and social Stratification”, Annual Review of Sociology, 38, 341-359
Quels sont, à vos yeux, les grands champs d’injustice et les risques qui y sont attachés ?
Sur le plan de l’égalité des chances, le niveau d’étude est un critère absolument discriminant pour plusieurs raisons. D’une part, de nombreux travaux (James Heckman en particulier) ont montré que, du point de vue des inégalités cognitives, tout se joue très tôt dans la vie, dès les premières années de la vie et qu’il est très difficile de réduire ces inégalités par la suite. D’autre part, dans un monde d’économie de la connaissance où les emplois peu qualifiés se réduisent (par exemple on estime qu’à terme le métier de caissière va disparaître) ne pas avoir un niveau minimum de qualification devient un handicap dirimant.
La vie solitaire et le sentiment de solitude qui s’accroissent sont un autre enjeu, très différent, mais également très important, car une personne seule, sans soutien de proches, a de grands risques de tomber dans une situation de précarité grave s’il / elle connaît une rupture professionnelle.
Quelle place tient la spécificité des territoires dans la formation du sentiment d’injustice ?
La question des territoires et des inégalités et de l’injustice est complexe et je ne suis pas un spécialiste du sujet. Néanmoins, ce qu’on dit sur la France périphérique me semble très sommaire. La question n’est pas duale et n’oppose pas de façon binaire le monde rural au monde urbain. Les grandes villes concentrent plus de richesse bien sûr, mais la pauvreté est également bien plus présente en ville que dans le monde rural. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France. Il y a des zones rurales qui se portent bien, souvent à proximité des aires urbaines et d’autres qui se sentent abandonnées et enclavées.
Comment ce sentiment d’injustice est-il pris en compte par l’action publique ?
Il y a deux façons d’y répondre, par la redistribution et par une action de plus long terme pour réduire l’inégalité des chances. La France est un pays où la redistribution est plutôt forte et atténue assez fortement les inégalités initiales (sans les annuler évidemment). Le gouvernement actuel a pris le parti, sans toucher à cet aspect redistributif, de mener une action structurelle sur la réduction de l’inégalité des chances, notamment via l’action sur l’éducation (dédoublement des classes dans le primaire, accent mis sur les apprentissages fondamentaux, etc..). Mais les résultats ne peuvent se sentir qu’à moyen terme. Pour le moment, les résultats de la France dans les enquêtes PISA restent assez moyens.
Quels sont leviers pour répondre aux sentiments d’injustice, si on part du principe qu’il existe une pluralité de normes de justice qui sont parfois antinomiques ? Est-ce que le politique n’est pas toujours piégé par cette question ?
Le sentiment d’injustice est une donnée structurelle et culturelle qu’il est très difficile d’entamer. Beaucoup de Français ont le sentiment de vivre dans une société de reproduction sociale qui ne donne pas sa chance à ceux qui partent du bas. C’est en partie vrai bien sûr (les enfants d’ouvriers n’ont pas les mêmes chances de devenir cadre que les enfants de cadres), mais cet écart se réduit. Pourtant les Français n’en ont pas conscience, ils sont très pessimistes, très méfiants vis-à-vis de la parole publique. Il y a d’abord un travail politique pour sortir de ce climat de défiance, mais c’est très difficile. Sur ce plan une conférence de consensus sur la question des inégalités et de la justice sociale qui rassemblerait des citoyens, des politiques, des associations et des experts serait sûrement très utile.
Est-ce que des enjeux comme l’environnement ou l’aménagement du territoire transforment la question de la justice sociale et les sentiments d’injustice ?
Concernant l’environnement je ne sais pas. Concernant l’aménagement du territoire oui car le sentiment d’injustice et de révolte d’une partie des Français tient pour une part au fait qu’ils ont le sentiment de ne pas être écoutés par un pouvoir central trop éloigné de leurs préoccupations. Le renforcement d’une véritable décentralisation des pouvoirs et pas simplement une déconcentration des administrations centrales serait donc une piste à creuser.

Interview de Nicolas FIEULAINE
Maître de conférences en psychologie sociale, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS), ’Université Lyon 2
Interview de François DEMONET
Sous-préfet à la ville
"Aujourd'hui les réponses aux problèmes d'exclusion qui ont du sens sont des réponses qui prennent en compte la globalité de la personne".

Interview de Laurent Toulemon
Démographe et directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED).
La population totale en 2070 pourrait être la même qu’en 2024.

Étude
Et si le turn-over et l’attractivité en berne des métiers du prendre soin était lié à des transformations organisationnelles et managériales ?

Étude
Comment le care peut renouveler notre rapport à l’autre, à la société, à la nature et aux objets ?

Article
Les chercheurs analysent l’évolution de nos loisirs, rappelant à quel point l’animation de temps non productifs pèse lourd dans la gestion d’enjeux collectifs.

Dossier
Comment agir pour ne plus seulement subir ce « quotidien » ?
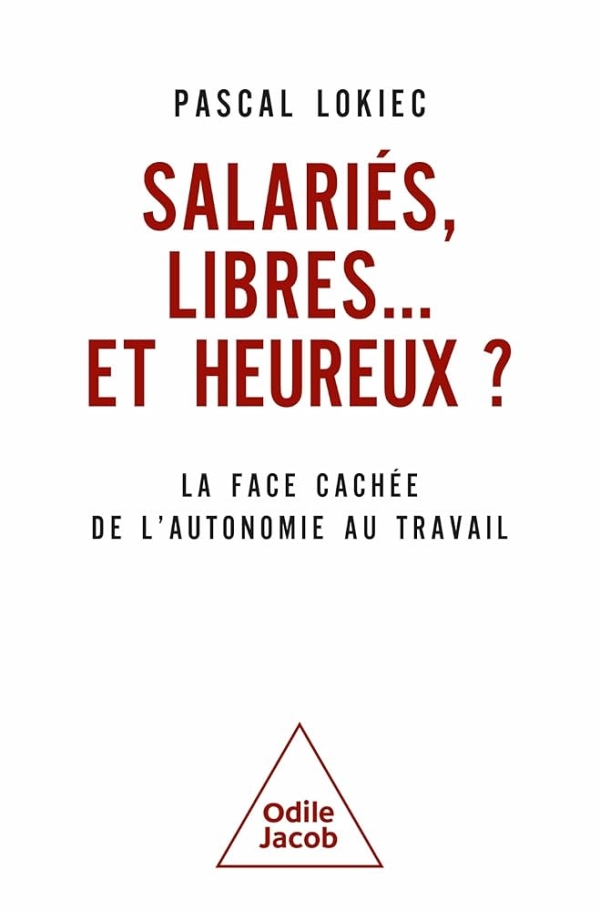
Article
Pascal Lokiec pose les termes d’un débat susceptible de concilier les intérêts de l’entreprise et le pouvoir d’agir des salariés.

Interview de Alain Eraly
Professeur de l’Université libre de Bruxelles (ULB), membre de l’Académie royale de Belgique
Partout, l’autorité est mise en cause.