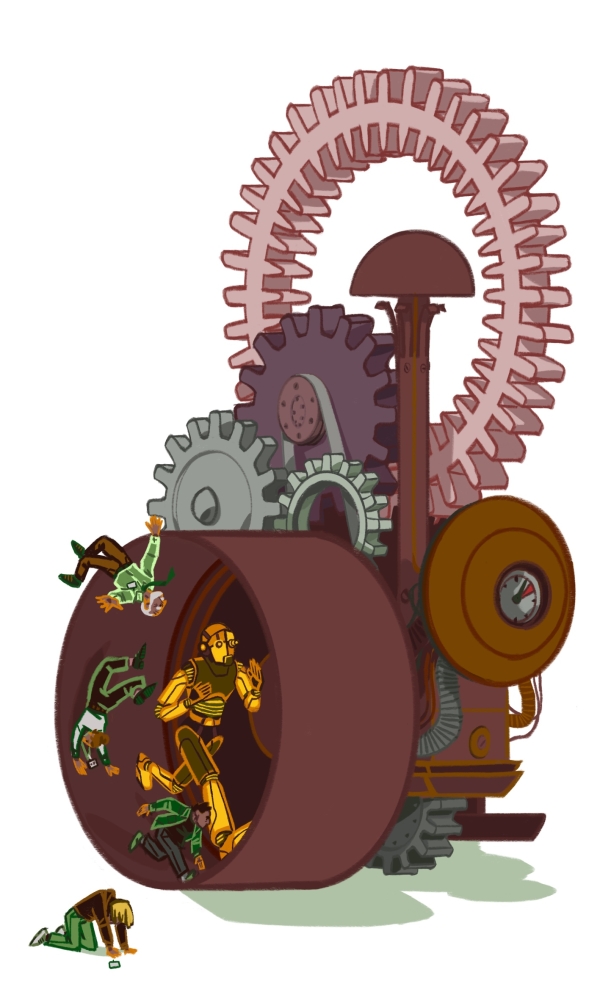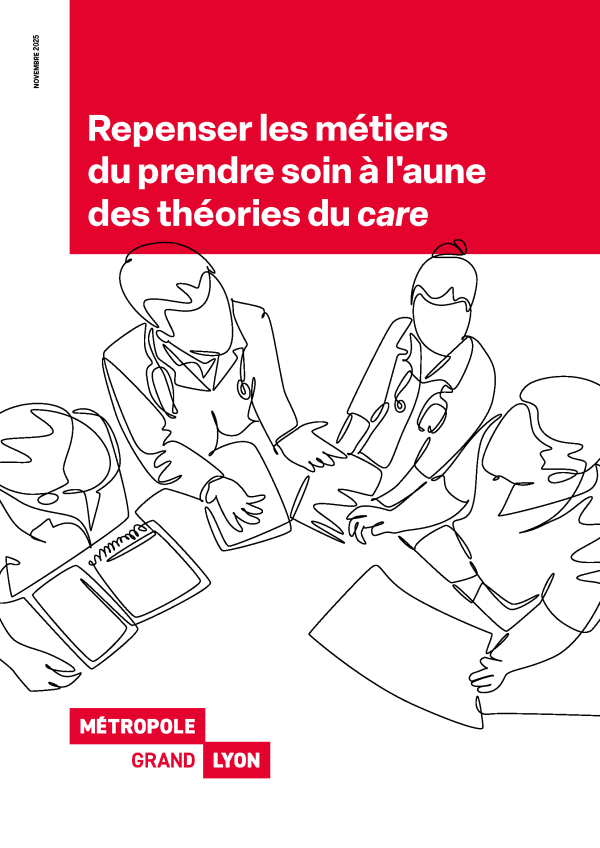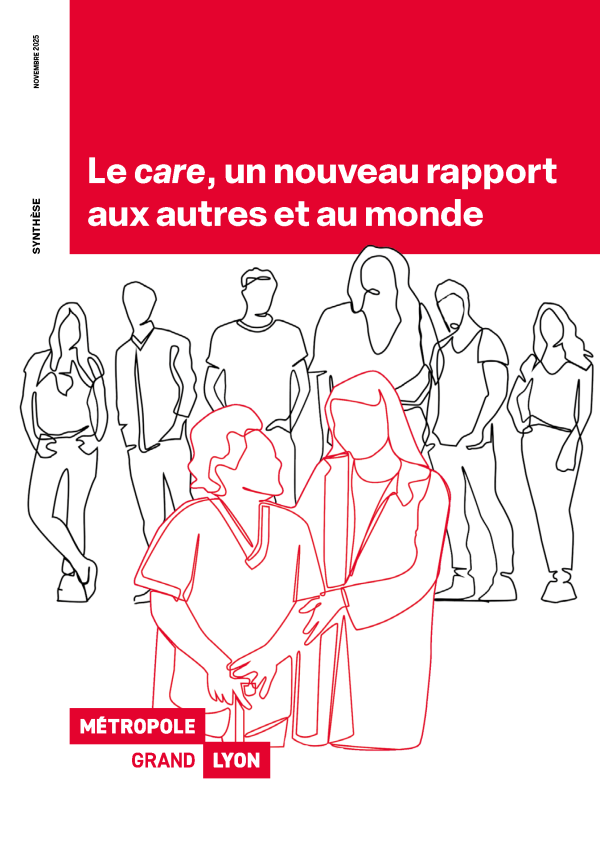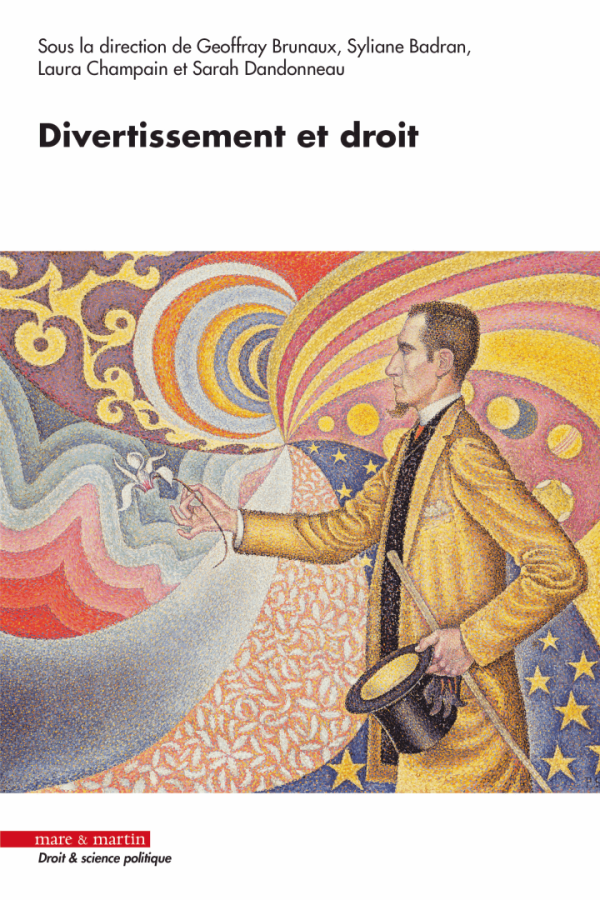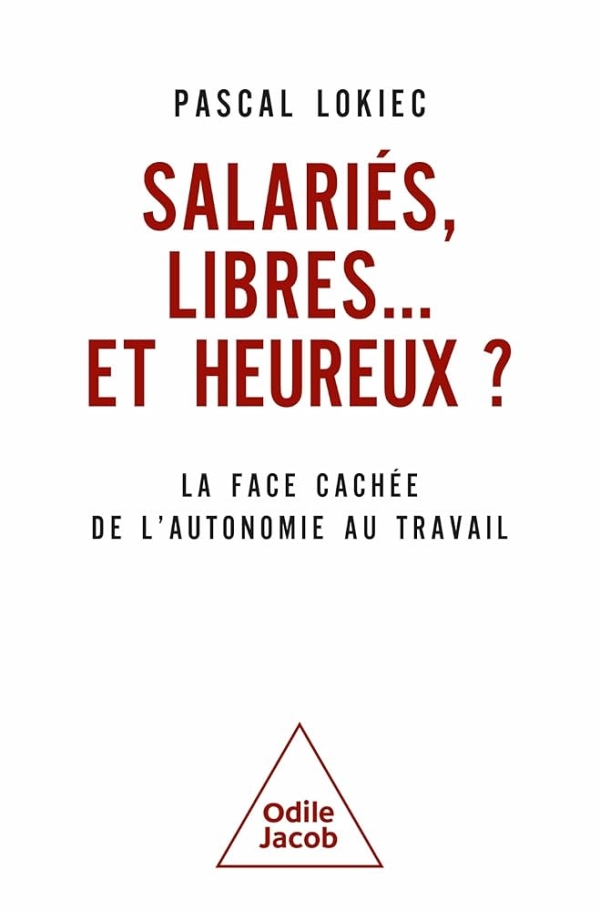Il faut distinguer plusieurs visions de la laïcité, liées à trois grands positionnements disciplinaires : philosophique, sociologique et juridique.
Selon l’approche philosophique, la laïcité est un concept et, comme tel, destiné à être en permanence discuté, renégocié, etc. Mais, si on lit les références philosophiques, on peut retenir deux grands éléments de définition. Le premier, c’est que la laïcité est un concept qui permet d’éviter l’imposition du religieux sur le politique. Cette dimension de sens de la laïcité, visant à détacher le politique du religieux, fait largement consensus. Le second élément de définition, est que le religieux doit sortir de la sphère publique pour être contenu à la sphère privée. Ce dernier point s’oppose avec la traduction juridique du principe de laïcité.
L’approche juridique reprend, le premier point de définition philosophique — la coupure entre État et religions — mais est attachée à la protection de l’expression religieuse des individus dans l’espace public. Contrairement à ce qu’on pense souvent, la liberté est la règle, la restriction est l’exception. Il est ainsi possible de débattre dans la rue, d’y manifester sa conviction ou sa religion, y compris d’y faire du prosélytisme, à condition qu’il ne soit pas abusif et violent. Tant qu’on ne porte pas atteinte à l’ordre public, on a le droit d’essayer de convaincre l’autre de ses croyances religieuses ou de ses convictions philosophiques.
Enfin, le troisième positionnement est sociologique. Il part lui-aussi du même principe de séparation de l’État et du religieux, mais avec l’idée qu’il est une façon pratique d’assurer le vivre ensemble, de s’assurer que le contrat social est bien respecté, etc.
C’est vrai qu’à première vue, il y a une opposition entre ces trois conceptions, mais je pense que cela peut être concilié. Il s’agit de trois situations différentes. Les philosophes, les analystes politiques, réfléchissent aux évolutions possibles de la laïcité, et à la manière dont elle est appliquée. Les sociologues, eux, sont là pour penser à sa finalité sociologique, c’est-à-dire le vivre ensemble. Les juristes ont pour tâche de comprendre comment se construisent les règles et comment elles sont traduites en droit. On a tort d’opposer ces visions. Il y a certes besoin d’un vrai débat sur la laïcité, mais à chaque fois, il faut essayer de bien comprendre la place de celui qui parle. Un philosophe n’aura pas le même type d’analyse qu’un juriste et tant mieux. Évidemment, ce sont des archétypes : il y a des juristes qui ont une sensibilité philosophique, des philosophes qui connaissent très bien le droit, etc., Mais il est vrai que le point de vue que l’on adopte change la façon d’analyser la laïcité, et je crois qu’on a besoin de ces trois façons-là de l’envisager.