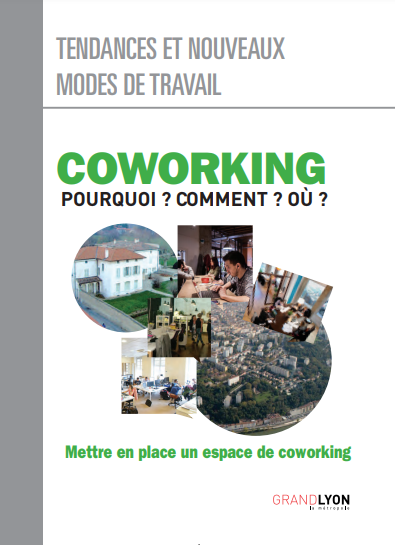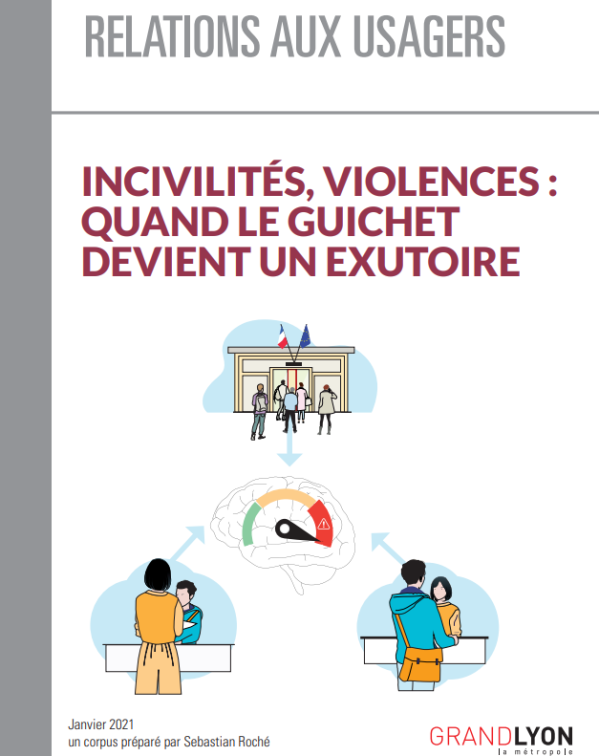Je pense que cela commence dès les années 90. Et cela n’est pas propre à la RATP, c’est un phénomène qui s’est produit un peu partout dans les grandes entreprises. Cela n’a pas non plus été vu comme un problème tout de suite, la prise en compte de ces manifestations a été lente, notamment parce que leur surgissement ne s’est pas fait brutalement, mais de manière incidente, presque sans bruit.
A la RATP, ces questions ont été prises en considération de plusieurs manières avant mon arrivée. Par exemple dès 2005, est intégré aux contrats de travail et aux règlements intérieurs une clause de respect de la laïcité au travail. En 2011, nous avons élaboré un code éthique, et en 2013, nous avons diffusé un guide pratique de la laïcité auprès des agents d’encadrement. Ces questions ont donc connu une lente montée en puissance, tout en étant traitées. Cependant, cela a été fait avec discrétion, par crainte peut-être d’envenimer le problème. Elles sont donc aussi restées largement masquées, jusqu’à la création de la délégation. En effet, ce n’est pas parce que vous éditez des documents, ou que vous inscrivez certains principes dans un contrat de travail, que le comportement des individus change ou que le management sait s’en servir.
Les agents n’avaient pas vraiment intégré les comportements à tenir et les règles à observer en cas de problèmes et n’étaient pas sûrs d’être soutenus ou accompagnés par leur hiérarchie et / ou par les syndicats. Ainsi, on avait bien édité des documents, mais on n’avait pas mis en place des procédures de suivi : l’entreprise n’était pas ouvertement et massivement engagée sur ces questions. Ensuite parce que ce sont des questions complexes, qui touchent aussi à l’intime aux valeurs personnelles : on peut craindre de se voir taxer d’islamophobie, voire de racisme, on peut craindre des représailles, on peut craindre de mettre en péril la cohésion d’un service, etc. Autrement dit, les réticences sont fortes et de nature diverses.
Et puis, il faut bien voir une chose, nos agents sont essentiellement guidés, et c’est normal, par leur volonté d’effectuer le travail qui leur est demandé. Que les métros se succèdent avec régularité, que les bus tournent avec efficacité, voilà leur priorité. C’est là aussi où l’on voit que la culture d’ingénieur à laquelle je faisais allusion s’illustre : l’entreprise fonctionne remarquablement bien s’agissant de ce pour quoi elle a été constituée, maintenant, si d’autres questions surgissent, elles sont souvent mises sur le côté.