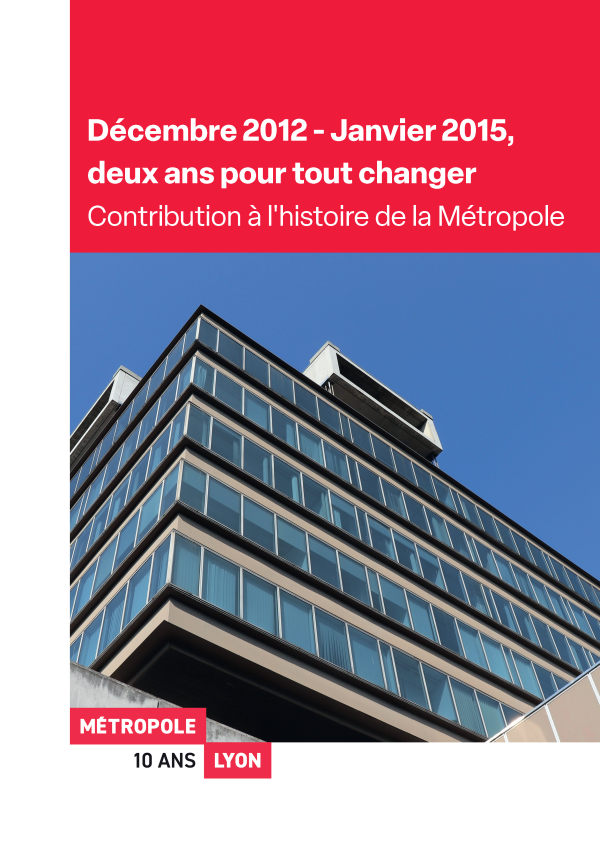Les marques sont devenues très puissantes au XIXe siècle suite aux trois temps convergents que furent les révolutions industrielle, commerciale, et politique.
D’abord, la révolution industrielle a fait advenir la capacité pour une organisation à reproduire un produit et donc une expérience. Elle a conduit à une société hyper industrielle dont le propre est l’hyper labellisation et la standardisation d’une expérience liée à la consommation d’un bien, que celui-ci soit un produit ou un service. Avec cet avènement, la première fonction d’une marque fut d’assurer la même expérience d’une fois sur l’autre. La fidélité à la marque renvoie d’ailleurs d’abord à l’idée de reproductibilité plutôt qu’à celle de l’attachement. Si l’on reprend les analyses éclairantes de Max Weber, cette notion de reproductibilité de l’expérience produit néanmoins nécessairement du désenchantement. En d’autres termes, l’économie des marques a substitué une société de la prévisibilité, et du contrôle à une société guidée par la poésie, la magie et la surprise.
Le deuxième moment correspond à la révolution commerciale qui a consacré les grands magasins, tels que Le bon marché ou Harrods, et le déploiement de l’économie du libre-service. L’accessibilité directe à la marchandise est devenue un phénomène très important qui a progressivement supplanté l’interface humaine. La marque a alors servi à remplacer une médiation humaine par une médiation symbolique. Le vendeur a été relayé par des éléments symboliques, comme le nom, le packaging, et ou encore les personnages de marques. L’économie des marques s’est ainsi structurée autour de cette incarnation de la marchandise. C’est même ce qu’on a appelé le « vendeur silencieux » (expression de Vance Packard, célèbre sociologue américain), c’est à dire un dispositif de médiation qui a eu pour fonction d’assurer une logique de séduction, et de captation esthétique de l’attention. Cette captation, fondée sur un modèle de captation érotique, a correspondu à l’érotisation de la marchandise (d’où plus tard également l’apparition des pin-up, des stars, des égéries, etc. construites par l’industrie cinématographique). La marque symbolise l’équation entre la captation d’une valeur libidinale, et la valeur économique. Pour ainsi dire, il s’agit aussi d’un dispositif de manipulation symbolique, au sens propre et comme au sens figuré car la marque a pour rôle de redonner la main à l’émetteur sur le distributeur, dans le cadre de ce rapport de force inédit entre les entreprises fabricantes, et les intermédiaires commerciaux. Les industriels ont créé les marques au XIXe pour reprendre la main sur le marché.
Troisième moment, la révolution politique et l’avènement d’un système démocratique, qui a remplacé un système verticalisé de relations sociales (dans lequel les individus ont leur place dans l’ordre social selon leur naissance) par un ordre social a priori horizontal. Ce système aristocratique a laissé place à un système démocratique fondé désormais sur un désir de reconnaissance de chaque individu, induisant pour lui une nouvelle problématique, celle de la quête de l’identité individuelle. Celle-ci se manifestant à travers une recherche de performance identitaire : à l’individu de montrer qui il est, qui il n’est pas, et de déployer une identité. De façon analogue, le capitalisme a alimenté cette fiction selon laquelle on existe en forgeant son identité, celleci se déployant essentiellement sous la forme d’une performance consommatrice. Autrement dit, consommer sert à se fabriquer une identité, à manager son image, soit en la réparant, soit en la renforçant, soit en la modifiant. La fonction essentielle d’une marque dans un espace démocratique est donc la reconnaissance : signifier aux autres et à moi-même que je suis quelqu’un.