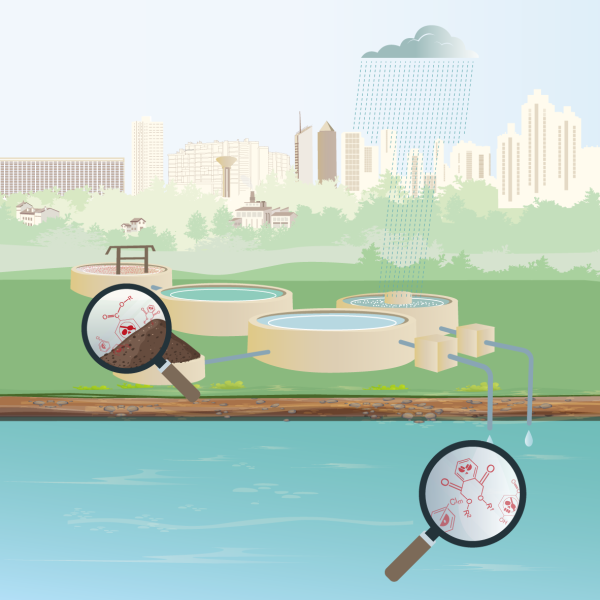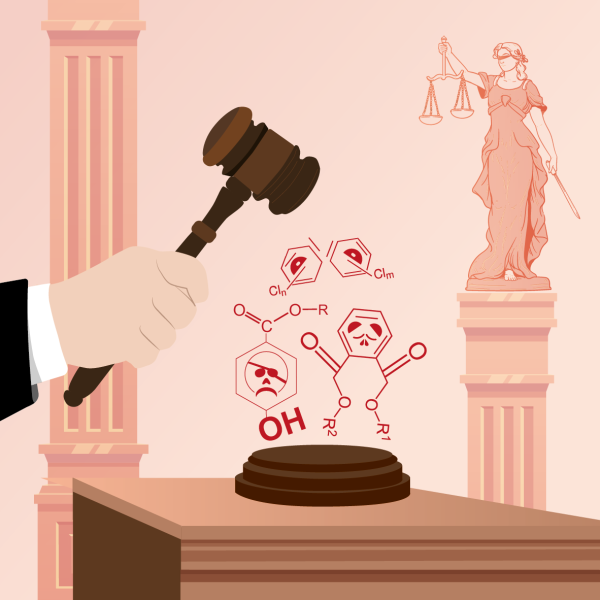Oui. Destruction et pollution arrivent en premier. Si on détruit un écosystème, il ne peut pas résilier. La résilience, c’est la capacité de quelque chose à revenir à un état plus ou moins proche de l’antérieur, après une agression. Si on détruit, on n’en parle plus. C’est ce qui se passe aujourd’hui : si vous coupez une forêt primaire à Bornéo, au Congo ou en Amazonie, vous détruisez l’écosystème. Il ne peut plus résilier. Et la pollution va souvent de paire avec la destruction. L’acidification des océans en est un exemple : on pollue l’océan avec du CO2, donc il réagit en faisant de l’acide carbonique qui aujourd’hui pose des problèmes.
Ensuite, arrive la surexploitation, dont les deux exemples les plus patents sont la pêche en mer et l’exploitation des forêts tropicales.
La troisième raison, plus insidieuse et moins connue du public, c’est la dissémination d’espèces partout sur la planète. On transporte tout partout, et malheureusement arrivent ainsi des espèces dans des milieux où elles n’étaient pas présentes auparavant, sans leurs prédateurs et sans leurs parasites. Alors, ces espèces explosent, détruisant les populations locales. Les cas les plus célèbres sont le lapin en Australie ou encore la jacinthe d’eau dans le Mississipi.
Enfin, le climat se dérègle et contribue également à des pertes de diversité biologique. Mais là aussi, il faut être très clair, le phénomène marche dans les deux sens : le climat qui se dérègle modifie et altère la biodiversité, en obligeant les espèces à migrer ; mais la biodiversité qui disparaît modifie également le climat. On le voit très bien avec les forêts tropicales, lorsque vous avez enlevé des forêts à Madagascar ou à Bornéo, ensuite il ne pleut plus. Vous avez donc totalement changé le climat local.