Ville intelligente, ville inclusive ?

Article
La smart city, concept apparu dans le sillage des nouvelles technologies numériques et de l’information, est-elle inclusive ?
< Retour au sommaire du dossier

Interview de Samuel Depraz
La Direction de la Prospective et du Dialogue public a engagé un travail de fond sur la question de la légitimité, qui apparaît comme une question centrale des prochaines années.
Dans cette interview, Samuel Depraz s’intéresse à une approche géographique des sentiments d’injustice, et le rôle du territoire dans l’égalité entre les citoyens.
Samuel Depraz est géographe, maître de conférences à l’Université Jean Moulin — Lyon 3. Il travaille sur les inégalités liées aux territoires et a publié La France des marges — Géographie des espaces « autres » (Armand Colin, 2017).
Comment la géographie s’intéresse-t-elle à la question de la justice sociale ?
La question des inégalités sociales est par essence sociologique et, de ce fait, relève principalement de cette discipline. Mais la géographie, qui était originellement très descriptive, a évolué vers les sciences sociales. Il ne s’agit plus d’étudier le territoire comme un donné naturel, physique, mais de voir ce qui dans le territoire relève du construit culturel. D’ailleurs, aujourd’hui, même ceux des géographes qui s’intéressent à la géographie physique intègrent de plus en plus de données sociales. Comprendre l’érosion, par exemple, implique de questionner l’action de l’homme sur les milieux naturels et les politiques de gestion des sols. Pour moi qui m’intéresse aux inégalités sociales, ce que j’observe ce sont les territoires en tant qu’ils traduisent des résultats des choix politiques et sociaux qui s’incarnent dans des formes et des modes d’organisation, d’inégalités, voire d’injustice. Pour le dire autrement, je m’intéresse à la dimension spatiale des faits sociaux.
Quelle approche théorique des inégalités sociales mobilisez-vous ?
Je travaille beaucoup sur la notion de justice spatiale telle qu’elle a été élaborée par les travaux sur la justice de John Rawls [1] et de Iris Marion Young [2]. Ces deux auteurs américains ont défini la justice sociale à partir d’une approche normative pour l’un – par un double principe d’égalité et d’équité – et par la négative pour l’autre, c’est-à-dire en identifiant l’injustice sociale. Ils montrent tous deux que toute société se construit inévitablement sur des différences ou des inégalités, parmi lesquelles certaines sont jugées justes et d’autres injustes ; dans ce dernier cas, il faut les corriger. Donc l’enjeu est double. D’abord, déterminer la limite entre inégalités justes et injustes, par exemple en délibérant sur la nécessité de l’accès des personnes à telle ou telle ressource. Ensuite, en déterminant les moyens de corriger ces inégalités injustes. Pour John Rawls, il faut sortir du mythe égalitariste – parce que l’idée d’une stricte égalisation des conditions de chacun est impossible, ne serait-ce que parce qu’on est différent en taille, en âge, etc., qu’on n’habite pas les mêmes lieux, etc. – pour privilégier celui de l’équité, en donnant plus à celles et ceux qui ont moins. Tout le travail est donc de réfléchir aux conditions d’un accès équitable de tous aux ressources en corrigeant les inégalités par des processus de compensation, de dotation, de péréquation, etc. Pour les géographes, en particulier, la question est celle de la localisation, parce que l’accès aux ressources en dépend. C’est la mise à distance qui, dans les territoires, révèle les injustices.
[1] Professeur dans les universités de Princeton, Oxford, Cornell et Harvard, John Rawls (1921-2002) est un philosophe américain. Son œuvre est construite autour de la réactualisation du concept de justice sociale, notamment dans son ouvrage de référence A Theory of Justice, publié en 1971.
[2] Iris Marion Young (1949-2006) est une philosophe américaine, féministe, et professeur de sciences politiques à l’Université de Chicago.
Les questions de territoires ont été beaucoup médiatisées ces dernières années, notamment avec le concept de fracture territoriale puis avec les mobilisations des « Gilets jaunes ». Qu’ont-elles révélé ?
Beaucoup d’incompréhension et une confusion qu’il est important de dissiper. Le débat public a quelque peu caricaturé la position des géographes sur la fracture territoriale notamment parce que des géographes médiatiques, dont Christophe Guilluy (depuis "La France périphérique", Flammarion, 2014), ont développé des théories très contestables sur la France périphérique qui ont eu pour effet d’essentialiser ces territoires. Cela veut dire quoi ? Que pour eux, c’est le territoire en lui-même, sa nature géographique, sa localisation, etc., qui produit les difficultés des gens qui y vivent, parce qu’il s’agit d’un territoire défavorable, éloigné, sans ressources, etc. Or je pense, comme d’autres chercheurs qui travaillent en géographie sociale, que c’est une vision erronée. Insistons sur ce point : le territoire ne génère pas les inégalités, il n’est que le révélateur de difficultés socialement construites.
Est-ce que vous n’allez pas trop loin dans l’évacuation des facteurs géographiques, physiques et objectifs ? Intuitivement, c’est compliqué de ne pas imaginer qu’une vallée enclavée des Alpes ne subisse pas cet enclavement comme une difficulté objective liée à la géographie de son territoire.
Voilà justement un bon exemple pour illustrer ce que je veux dire. Ce n’est pas parce qu’on est au fond d’une vallée alpine qu’on est nécessairement à distance de tout. Pourquoi ? Parce que la distance aux ressources (emploi, services) est relative, et que ce sont les politiques publiques qui permettent – ou non – d’y pallier. La Vallée de la Tarentaise a ainsi fait l’objet du plan neige dans les années 1970, avec une politique offensive de construction et des infrastructures importantes comme des paravalanches, des deux fois deux voies gratuites. Elle a bénéficié d’une couverture assez exceptionnelle en 3G et 4G pour favoriser le tourisme. Elle est desservie par 8 TER par jour et un TGV direct depuis Paris en période hivernale. Conclusion : cette vallée, qui est à des kilomètres de tout, est plus accessible qu’une petite commune de la grande couronne parisienne. On le voit, ce que le territoire révèle, ce sont les choix des politiques publiques d’aménagement, choix plus ou moins coûteux c’est vrai, mais qui dépendent des besoins d’une époque et qui illustrent à quel point ce n’est pas le territoire qui détermine l’enclavement mais la manière dont s’organise la société.
Prenons un autre exemple, celui de l’emploi. On parle aujourd’hui de l’éloignement géographique aux bassins d’emplois de certains territoires ; pourtant, là encore, ce n’est pas le territoire qui produit cet éloignement à l’emploi, mais la façon dont une société organise ses moyens de production. Ainsi, l’enclavement est apprécié à l’aune d’une sorte d’évidence de l’hyper-mobilité qui fait que l’emploi est désormais concentré dans les zones urbaines et rend banale la distance entre l’emploi et l’habitat – sauf pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens du voyage. Mais si l’on reprend l’exemple des vallées alpines, lorsqu’on était dans une économie de subsistance où le travail était à proximité de son habitat, cette contrainte n’existait pas. Je le redis, l’idée d’enclavement est une contrainte liée à l’organisation des sociétés et non aux territoires eux-mêmes. Aujourd’hui, on est facilement mobile, donc on a regroupé les emplois pour faciliter le développement et faire des économies d’échelles, mais, de ce fait, on a créé une nouvelle contrainte spatiale.
En termes d’action publique, quel est la conséquence de cette déconstruction du déterminisme territorial ?
Dire que le territoire enregistre un ensemble de contraintes socialement produites, c’est bien différent que dire que le territoire produit des contraintes. On sort du fatalisme. On ne peut plus s’abriter derrière des facteurs géographiques prétendument indépassables et on peut replacer le débat dans le champ de l’action publique. Cela invite à reconsidérer des choses qui nous paraissent insurmontables en nous interrogeant sur nos modèles de société, pour transformer ce qu’on pense être une contrainte en un levier d’action. Par exemple, favoriser des petites structures agricoles de qualité et relocaliser une partie des emplois dans les petites villes permettrait de développer de l’emploi et de relancer bien des territoires ruraux, eux qui disposent de foncier et d’atouts paysagers pour cela. On cesserait ainsi de les considérer comme des espaces plombés par « leurs » contraintes.
Cela suppose aussi de trouver des moyens de mieux corriger les inégalités entre les territoires. Or, aujourd’hui, une des inégalités qui constitue une injustice, ce sont les dotations par l’État aux collectivités. Elles sont définies à partir d’un calcul par habitant qui n’est pas satisfaisant parce qu’il a tendance à favoriser les espaces les plus peuplés, qui sont généralement les plus riches. Une commune rurale comptant entre 200 et 2000 habitants récolte ainsi moins de 800 euros par habitant de ressources fiscales et de subventions, contre plus de 1400 pour les villes de plus de 10 000 habitants. Une intercommunalité classique en milieu rural touche 20 euros par habitant, mais la métropole de Lyon 60 euros. Conclusion, le système à tendance à renforcer les inégalités plus qu’il ne les corrige. Certes, le législateur considère que ces profils de territoires n’ont pas les mêmes charges. En fait, ils n’ont pas le même "type" de charges, et les territoires les plus ruraux ont surtout des charges trop importantes relativement à leurs faibles moyens. Pour moi, il faut commencer par renforcer les mécanismes budgétaires de péréquation horizontale entre les communes, entre territoires riches et pauvres, sur la base des revenus moyens par habitant.
Vous avez précisé qu’il n’était pas toujours simple de dire où passe la ligne entre inégalités injustes et inégalités justes, laquelle ligne ne passe sans doute pas au même endroit pour tout le monde. Dans vos travaux, quels écarts avez-vous constatés entre les inégalités injustes et les sentiments d’injustice ?
En 2018, les mobilisations des Gilets jaunes m’ont beaucoup interrogé, comme d’ailleurs beaucoup de chercheurs. Elles témoignaient d’un sentiment d’injustice alors que le mouvement mobilisait surtout les franges périurbaines des grandes agglomérations, c’est-à-dire des territoires décrits par les statistiques publiques comme parmi les plus riches de France. C’est en effet là que l’on trouve les personnes les plus prospères en termes de revenu moyen par habitant, avec le plus faible taux de chômage, le plus fort taux de propriété privé, etc. Donc les indicateurs n’étaient pas du tout favorables à l’identification a priori d’un sentiment d’injustice. C’est pourquoi le mouvement a d’abord été assimilé à un mouvement poujadiste de petits propriétaires, pas si mal lotis que ça, venant se plaindre du prix de l’essence… Ce qu’on pouvait alors se demander, c’est si l’expression du sentiment d’injustice n’était pas un mode de construction de l’action collective que ces personnes mobilisaient pour exiger plus d’avantages qu’elles n’en avaient déjà, alors même qu’elles ne subissaient pas une situation objective d’injustice sociale.
Mais le coût pour les personnes d’une telle mobilisation (en temps, en argent perdu, etc.) a tout de même rapidement laissé penser que leur sentiment d’injustice n’était pas feint et correspondait bien à une réelle détresse sociale. Et c’est bien ce qui est apparu quand on a creusé les données statistiques – ce qui, par parenthèses, illustre la difficulté d’objectiver les injustices sociales. Les effets de moyennes ont été désastreux dans la première mesure du phénomène et n’ont pas permis d’apprécier la situation réelle des personnes vivant dans ces territoires parce qu’ils masquent la situation des plus fragiles. La réalité des faits, c’est qu’il y a des inégalités profondes dans cet espace périurbain où cohabitent des gens très aisés et d’autres qui le sont moins, parce qu’il faut deux véhicules, que les frais d’entretien des maisons et de chauffages sont importants et augmentent, etc. Ce que l’on constate, c’est que la précarité, c’est-à-dire celle que l’on mesure à partir des revenus, y est certes faible en valeur absolue, mais que la pauvreté relative, c’est-à-dire celle qui est mesurée en tenant compte des dépenses contraintes, y est plus importante. Or c’est bien ce second indicateur qui compte pour les personnes qui, elles, regardent surtout ce qui leur reste pour vivre une fois tous les frais incompressibles réglés. On s’est alors aperçu que dans ces territoires des gens vivaient des situations d’inégalité, voire de relégation sociale, qu’ils ont traduites en injustice dès lors qu’on leur demandait de payer plus et alors qu’ils ne recevaient aucune aide, preuve que l’État ne voyait pas leur situation de détresse.
Ce qui est intéressant dans l’exemple des Gilets jaunes, c’est que le sentiment d’injustice a d’abord été pensé comme non légitime par les observateurs avant de trouver une légitimité dès lors qu’on changeait les critères d’objectivation. Ici le sentiment d’injustice rendait effectivement compte d’une injustice sociale vécue. Mais est-ce toujours le cas ? N’y a-t-il pas des sentiments d’injustice qui pourraient sembler illégitimes ou infondés ? Comment les reconnaître ? Comment les déconstruire ? On pourrait par exemple penser à des personnes aisées qui trouvent injuste de payer autant d’impôt…
C’est une question difficile. Si l’on suit John Rawls, la limite de la légitimité du sentiment d’injustice, c’est lorsque celui-ci remet en question le postulat d’égalité de base entre citoyens. En simplifiant, c’est quand on réclame plus d’avantages pour soi que ceux qui permettraient simplement de corriger une inégalité observée – avantages qui, de ce fait, vous placent dans une situation supérieure à une situation d’égalité moyenne. C’est une posture un peu théorique, mais elle permet de guider nos choix de recherche.
De manière beaucoup plus concrète, Iris Marion Youg considère qu’il y a des situations d’injustices prioritaires à traiter. Ce sont toutes celles qui sont renforcées par la discrimination et les stéréotypes, deux a priori qui ne sont jamais justifiables moralement. Par exemple, les populations pauvres ou d’origine étrangère qui vivent dans les banlieues populaires sont placées d’office dans des situations d’injustice d’accès à l’emploi lorsque les recruteurs les jugent par des stéréotypes de lieu ou de faciès. La politique de la ville a constitué une tentative – inachevée – de réponse à ces discriminations. Il existe d’autres exemples, moins bien pris en compte, comme celui du monde rural, dont les habitants sont encore parfois méjugés comme « arriérés » et qui, dans le contexte actuel de crise environnementale, sont mis en cause du fait de leur usage intensif de la voiture, ou de l’intensité de la production agricole, de l’usage des pesticides, etc., alors même que la plupart partagent ces inquiétudes, voire s’engagent contre ces pratiques. Donc, pour Iris Marion Youg, un point dur de l’analyse des inégalités est d’identifier des processus préalables de stéréotypisation et de discrimination afin de mieux les combattre.
Comment peut-on les identifier ?
Un des outils que j’ai essayé de développer est la catégorie de « marge ». Au départ, il s’agissait d’un concept géographique peu stabilisé qui m’a paru intéressant parce qu’il permettait de décrire des territoires à l’écart, touchés par des phénomènes de relégation, et donc témoignant a priori de situations d’injustice territoriale. Pour comprendre ce qu’est une marge, il faut insister sur le fait que ce n’est pas seulement une situation géographique périphérique. C’est davantage un état de transformation, une dynamique d’évolution par rapport à d’autres territoires, que l’on peut objectiver en mobilisant une série de huit critères que j’avais proposés (pauvreté, équipements, etc.). Une marge est multiscalaire, c’est-à-dire qu’elle touche plusieurs échelles de temps et d’espaces. Dans la Métropole de Lyon, par exemple, on va repérer des marges par rapport aux territoires qui forment le cœur économique de la Métropole. Ce sont bien souvent des espaces ruraux éloignés, ce sont certaines banlieues et quartiers sensibles, mais aussi des zones en plein cœur de ville ou des friches urbaines. Pour moi, la marge est une catégorie d’analyse du territoire qui permet de mettre le projecteur sur des interstices dont on parle peu et d’y repérer des dynamiques, parfois inquiétantes de décrochage, parfois intéressantes d’adaptation et d’innovation. Le point commun, c’est que ce sont des territoires instables, en mutation rapide vers le bas ou le haut, souvent marqués par un caractère transitoire et précaire, notamment quand il y a des violences urbaines, des squats, des expulsions, des mobilisations sociales d’habitants, par exemple contre la gentrification ou les opération ANRU, et qu’on y sent poindre insatisfaction sociale et demande de changement. Ce sont des territoires qui ont un besoin d’intervention publique, même si celle-ci ne doit pas y prendre la même forme. Quant à identifier ces marges avant que s’expriment ces injustices ressenties, ce n’est pas toujours aisé comme en témoigne le mouvement des Gilets jaunes, puisque la marge périurbaine, on ne l’a pas vu venir, pas plus à Lyon qu’ailleurs.
Cette approche par les marges est intéressante pour une collectivité sensible aux inégalités territoriales. Quelles sont les types d’intervention publiques que vous y avez constaté ?
Je peux donner trois exemples de marges qui ont été inégalement pris en charge par les politiques publiques. Le premier est celui des territoires en politique de la ville (Quartier prioritaire, QPV, CUCS, ANRU, etc.). Ils ont été institutionnellement définis par des indicateurs de pauvreté. Ils ont connu des violences urbaines qui témoignaient d’une injustice ressentie et publicisée, et ils sont fortement touchés par cet effet de stéréotypisation et discrimination que j’évoquais tout à l’heure. Ces territoires ont bénéficié de politiques publiques sur mesure même si les résultats sont contrastés. Le deuxième exemple est celui des quartiers en cours de gentrification comme les pentes de la Croix-Rousse, le Vieux Lyon ou la Guillotière pour lesquels, là aussi, la puissance publique a agi. Il s’agit de quartiers qui étaient historiquement en décrochage, qui se paupérisaient, et dans lesquels les politiques publiques ont mis en place des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), des politiques de patrimonialisation (périmètre de l'AVAP, UNESCO, etc.) et une montée en gamme de l’offre commerciale, soit des outils qui permettent de stopper un processus de dégradation par une requalification architecturale et sociale. Là encore, on note des effets contrastés de ces interventions puisque les politiques publiques n’ont pas empêché des effets de flambée des prix. Troisième exemple, les friches industrielles et les politiques d’urbanisme transitoire. Les friches ont posé de vrais problèmes parce qu’elles constituaient des nuisances importantes liées à l’inoccupation des lieux ou à leur détournement sauvage, comme les squats, peu appréciés des riverains. L’urbanisme transitoire a permis de transformer le handicap en atout en proposant des baux d’occupation provisoire de ces périmètres, le temps de prévoir de nouvelles affectations et fonctions à ces lieux. On peut observer de réelles réussites sur certaines friches par la promotion d’événements éphémères et d’expérimentations artistiques (street art, expositions temporaires, concerts et cycles de conférence, insertion dans la Biennale d’art contemporain), notamment dans les sites industriels en cours de requalification dans les 7e et 8e arrondissements de Lyon. L’image entière du quartier en sort transformée.
Dans ces trois exemples, ce qui caractérise ces marges, c’est le changement et la mutation de ces territoires, qui sont par nature instables, et que les politiques publiques cherchent à stabiliser et à faire entrer dans une certaine norme.
Faites-vous une distinction entre injustices territoriales et injustices environnementales ?
Oui. Les injustices environnementales sont un sous-ensemble des injustices territoriales. Elles recouvrent plusieurs aspects, comme la justice alimentaire ou la justice écologique, au sens de l’accès aux espaces naturels de qualité. C’est sur ce dernier point que j’ai travaillé : les inégalités d’accès à la nature. On constate simplement que des populations n’ont pas les moyens d’une mobilité vers des espaces naturels, notamment les parcs périurbains ou la campagne, qui permettent certains loisirs. Sans surprise, ces inégalités d’accès sont corrélées aux revenus des populations plus qu’à la distance qui les séparent de ces espaces naturels. On constate donc un cumul d’inégalités : les populations ont peu les moyens de se déplacer, ont peu de budget disponible et ont développé d’autres habitudes de consommation que ce type de loisirs, ce qui fait que, quand bien même elles sont à proximité de ces territoires elles ne les fréquentent pas forcément.
Vous faites de cette inégalité d’accès à la nature une injustice comme si l’accès à la nature était une catégorie de la justice. Est-ce que les personnes qui n’ont pas les moyens de fréquenter ces espaces naturels ont formalisés un sentiment d’injustice ?
C’est en effet d’abord une injustice pour ceux qui ont envie d’y aller et ne peuvent pas. Peut-on généraliser et considérer cela comme une nouvelle norme morale ? Les considérations climatiques vont vraisemblablement en ce sens, avec le souhait croissant des habitants d’avoir plus d’espaces végétalisés à Lyon pour combattre, à l’avenir, la formation des îlots de chaleur. Or le Grand Est lyonnais est très bétonné alors que l’Ouest est très végétalisé. Donc on retrouve le souhait de combattre une inégalité qui serait vue comme une injustice par les populations touchées. Il me semble qu’on voit ici comment se construit une injustice ou un sentiment d’injustice, lorsqu’une population conscientise, d’abord pour elle-même, une inégalité en injustice puis la formalise et la publicise plus largement (manifestation, pétition, etc.) en demandant que l’inégalité soit corrigée. Mais on pourrait aussi objectiver ce sentiment d’injustice en calculant, quartier par quartier, les surfaces existant par habitant ainsi que l’effort d’investissement consenti par la collectivité en matière de végétalisation pour corriger les différences. Pour résumer cette question d’injustice d’accès à la nature et à ses aménités, il faudrait 1- délibérer sur la nécessité de l’accès des personnes à cette ressource 2- savoir si un sentiment d’injustice est formulé et 3- tenter d’objectiver ce sentiment à partir d’indicateurs.
Cela signifie qu’une inégalité ne pourra pas être qualifiée d’injuste si elle n’est pas perçue comme telle par la personne qui la subit ?
C’est un point fondamental. Est-ce que l’on peut forcer l’émergence d’un sentiment d’injustice en l’exprimant au nom des populations qui ne formaliseraient pas d’elles-mêmes une inégalité en injustice ? Ce dont on doit se méfier, c’est de parler à la place des personnes et, pire encore, d’agir à leur place. En matière d’aménagement du territoire, cela a produit beaucoup de dérives et on a pu créer plus de détresse sociale qu’on n’en solutionne. Pour autant, de nombreux processus d’injustice sont intériorisés par les populations qui en sont victimes. De ce fait, ils ne sont pas vus comme des injustices – pire, ils sont banalisés ou considérés comme des fatalités contre lesquelles on ne peut agir. Iris Marion Young, encore elle, montre bien que parmi tous les facteurs d’oppression, la stéréotypisation que subissent les groupes sociaux marginalisés fait qu’ils finissent par considérer tel ou tel trait comme leur étant naturellement attaché et qu’ils ne formalisent pas leur situation en termes d’injustice. De tels cas sont couramment décrits par les mouvements féministes, par les associations de lutte contre le racisme et la xénophobie, et plus généralement par tout le secteur de l’action sociale agissant en faveur de plus de justice sociale. Mais il faut aussi être capable de se dire que l’injustice qu’on cherche à caractériser peut, au moins en partie, être un construit de chercheur plaqué de manière quelque peu forcée sur telle ou telle population qui n’y verrait qu’une différence.
On voit bien que ces questions se construisent dans le temps et parfois à l’initiative des chercheurs. Un exemple intéressant est celui des mobilisations féministes qui ont progressivement tourné la question des inégalités femmes-hommes en injustices de genre, ce qui a conduit à mobiliser largement les femmes et les hommes contre ces injustices. Comment une collectivité publique peut-elle anticiper ces transformations et identifier les champs d’émergence des injustices ?
Il me semble que décentralisation et participation sont deux outils intéressants pour lutter contre les sentiments d’injustice et aider à la formation de politiques publiques justes. D’abord, on voit depuis un demi-siècle, et plus encore depuis les années 1990, un épuisement des formes représentatives des démocraties. Parallèlement à la décentralisation, qu’elle a accompagnée, s’est développée une forme participative de la démocratie. Pour autant, aujourd’hui, décentralisation et participation rencontrent des difficultés. D’abord, je constate un mouvement de recentralisation, notamment du fait de la baisse des financements des collectivités publiques et du regroupement des échelons territoriaux (intercommunalités, métropoles, etc.). Pour éviter un effet de déconnexion, il faut absolument conserver le lien aux territoires et maintenir, par exemple, des conférences territoriales et des élus attachés à un périmètre local bien identifié. Le premier interlocuteur des politiques publiques reste l’élu local, en particulier le maire. Pour la Métropole de Lyon, on ne sait pas encore très bien quels vont être les effets des transformations du lien au territoire mais il y a un risque de déterritorialiser un échelon municipal qui était bien identifié.
Ensuite, on doit bien constater que la participation ne se décrète pas : tout le monde ne peut pas le faire – parce cela suppose du temps, de s’en sentir les capacités, etc. – et l’autorité publique a souvent du mal à jouer pleinement le jeu : elle veut bien consulter, mais pas déléguer la décision. En somme, il est difficile de mobiliser, et les participations ne produisent pas toujours les résultats escomptés puisqu’elles s’appuient sur une fraction réduite de la population. Il me semble que, pour éviter cela et prendre en compte le sentiment d’injustice, il faut donner une chance à la participation d’aller au bout des processus pour lesquels elle est mobilisée en en reconfigurant le principe. Pour Sherry Arnstein (1930-1997) qui a travaillé sur cette question dans les années 1960, la seule participation qui vaille est celle qui est capable de transmettre effectivement le droit aux participants de bloquer la décision publique. Tant que la part de la population impliquée dans la réflexion ne dispose pas de ce droit de veto, il n’y a pas participation réelle mais une coopération ou une consultation. Certes, c’est assez contraire au logiciel politique contemporain et pourtant, si on prend le risque d’être placé en position de rejet, cela signifie qu’on fait confiance au processus de participation et qu’on responsabilise les participants. Dans cette dévolution de la décision, l’autorité publique n’est pas absente pour autant : elle encadre le processus de participation pour informer, voire former les participants à la prise de décision, y compris sur les questions techniques, mais aussi pour conseiller et accompagner les personnes. Mais au cœur du processus on trouve la confiance alors qu’aujourd’hui la participation est souvent un motif de défiance réciproque. C’est le même principe qu’on trouve dans les budgets participatifs de Belo Horizonte, au Brésil, développé dans les années 1990, qui sont des leviers de justice sociale [1].
[1] Voir « Le budget participatif : un outil de justice sociale ? », entretien de Héloïse Nez par Sylvie Mauris-Demourioux, Millénaire 3, 2014. En ligne : www.millenaire3.com/Interview/2014/le-budget-participatif-un-outil-de-justice-sociale
Comment organiser ces processus pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient effectivement présents dans les participations, c’est-à-dire les associations, les retraités, etc. ?
Je sors un peu de mon champ de recherche, mais je pense que le tirage au sort est une bonne voie à condition de donner effectivement aux personnes tirées au sort la possibilité de le faire (compensation intégrale de revenus, information / formation, etc.) et qu’elles soient responsabilisées par le fait que leur action aura une efficacité réelle sur la décision finale, tout en permettant des décisions non-binaires (scrutins au jugement majoritaire, par approbation, par notation, etc.). C’est sans doute lourd pour la fabrique de toutes les politiques publiques locales mais il y a certainement des enjeux transversaux qui méritent ce type de démarche, comme les grands projets d’équipement du territoire métropolitain, les questions climatiques (transport urbain, végétalisation) ou encore la répartition des subventions à la vie culturelle et sportive locale – bref ce qui reflète au plus près le quotidien des habitants du territoire.

Article
La smart city, concept apparu dans le sillage des nouvelles technologies numériques et de l’information, est-elle inclusive ?

Article
Dans Le Coup d’État citoyen, Elisa Lewis et Romain Slitine font un tour du monde des innovations démocratiques et proposent des pistes de réflexion et des solutions concrètes pour changer le logiciel de notre démocratie.

Article
Analyse « Le crépuscule de la France d'en haut » de Christophe Guilluy et sa critique d'une grandissante séparation entre politiques et citoyens.
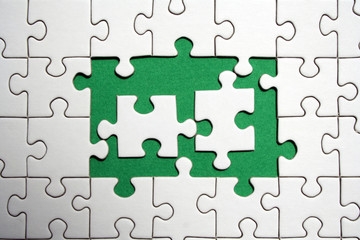
Article
Déroulé historique des différents termes expliquant la question sociale et urbaine.

Étude
Ce cahier interroge la notion de mixité à travers 3 politiques conduites dans et par le Grand Lyon : la politique de la ville, la politique du logement, et la mobilité.

Interview de Samuel Depraz
Géographe et maître de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
« La participation est un outil de lutte contre le sentiment d’injustice dans l’action publique, pour peu que l’acteur public accepte d’aller jusqu’à la dévolution de la décision aux participants »

Étude
Quelles sont les opportunités que la ville intelligente peut représenter pour les quartiers prioritaires ?

Étude
L’abstention a atteint un taux record aux législatives de 2017, avec 51,29 % : symboliquement, elle est devenue majoritaire....décryptage et tendances de la non participation électorale.

Étude
Quels sont les différents modèles de villes intelligentes ? Comment ceux-ci s’articulent-ils aux différentes finalités de la ville ?

Article
En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?
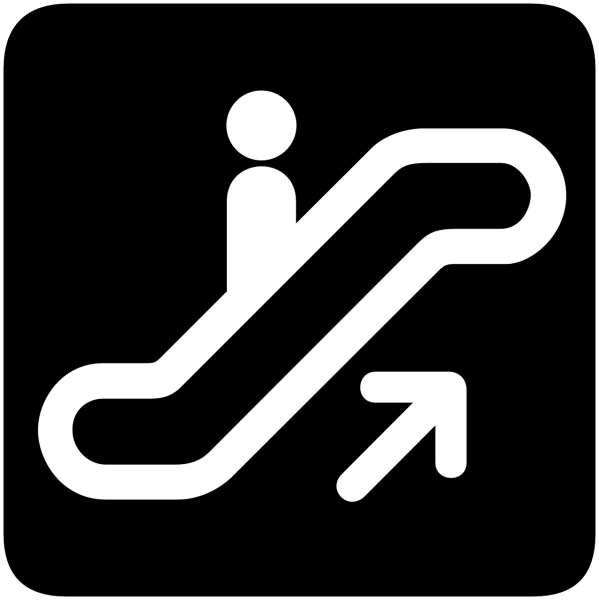
Texte d'Emmanuelle SANTELLI
Dans le cadre d’une étude effectuée par le Groupe de Recherche sur la Socialisation, (UMR 5040 CNRS, Lyon II), Emmanuelle Santelli étudie les parcours des populations d’origine maghrébine dans une perspective intergénérationnelle : comment se construisent les trajectoires professionnelles en référence aux parcours des parents.
Ce texte s’appuie sur une enquête effectuée sur les descendants d’immigrés algériens qui ont eu des parcours réussis.

Article
Investigations théoriques et pratiques sur l'exclusion dans la ville, par le laboratoire de recherche et création LALCA.

Étude
Enseignements et interpellations prospectives issues de la série d'études [sur]vivre dehors.

Interview de Abdelkader Larbi
L’équipe du CCAS de la Ville de Lyon présente notamment deux dispositifs dédiés aux personnes sans abri.

Interview de Zaïra Brahmi, Assistante sociale
« La ville connait une dynamique, elle est attractive pour de nouveaux habitants et pour les vénissians »

Étude
Cette étude fait le point sur les besoins fondamentaux des personnes sans-abri. Elle met en évidence le renouvellement des solutions pour « sur » vivre dans la rue au quotidien.

Interview de Edouard Gardella
Chargé de recherche au CNRS
« Un des enjeux actuels de l’intervention sociale est, selon moi, de tenir compte de ces attachements à la rue, que les personnes risquent de perdre quand elles sont amenées à aller dans un hébergement social »

Dossier
Ce dossier permet de mieux comprendre les modes de vies et les usages des personnes sans-abri.