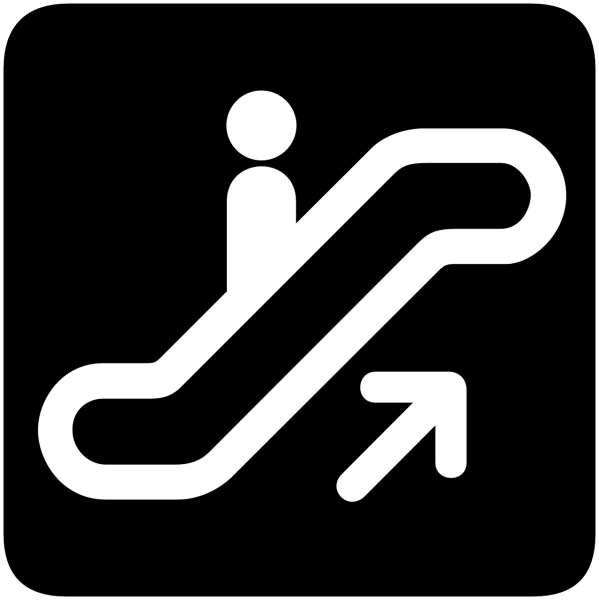Mon parcours dans la recherche sur le sans-abrisme commence en 2004, par une enquête sur les formes prises par la répression de la mendicité qui ont succédé à la dépénalisation des délits de mendicité et de vagabondage en France (juillet 1992). Puis j’ai enquêté sur les formes prises par l’assistance ; répression et assistance ne devant pas être séparées comme l’a bien montré l’historien Bronislaw Geremek, du moins si on s’interroge sur les règles morales suivies par les sociétés pour traiter leurs membres considérés comme marginaux. J’ai ainsi analysé la politique d’urgence sociale. Une partie de ce travail a donné lieu à la publication d’un livre, écrit avec Daniel Cefaï, intitulé L’urgence sociale en action. Ethnographie du Samusocial de Paris (2011). J’ai ensuite soutenu une thèse de doctorat en sociologie sur cette question, intitulée « L’urgence sociale comme chronopolitique. Temporalités et justice sociale de l’assistance aux personnes sans abri en France depuis les années 1980 » (2014).
Le problème empirique par lequel j’ai abordé l’urgence sociale dans mon travail de thèse était le suivant : les personnes sont à secourir parce qu’elles sont « sans domicile fixe », et pourtant, l’aide qui leur est proposée les amène à devoir changer, fréquemment parfois, de lieu où dormir. Comment comprendre que l’aide d’urgence sociale semble prolonger l’instabilité vécue par les sans-abri en leur imposant des habitats temporaires ? Cette contradiction paraissait encore plus forte à une époque où on voyait perdurer ce turnover dans les hébergements sociaux, alors qu’avait été reconnue dans le droit la possibilité pour les personnes de rester dans un hébergement aussi longtemps qu’elles en avaient besoin (article 4 de la loi DALO, mars 2007). Cette consolidation du droit des personnes sans abri provenait notamment de mobilisations associatives, dans les espaces publics (en particulier le canal Saint-Martin à Paris, occupé par les Enfants de don Quichotte) puis dans les arènes judiciaires (en particulier le tribunal administratif de Lyon devant qui des professionnel.le.s de l’urgence sociale ont porté des dossiers pour renforcer le droit par la jurisprudence, faisant ainsi de Lyon une place historique de cet engagement dans la défense des droits des sans-abri).
Les réponses disponibles à l’époque à cette question de la mobilité imposée aux personnes sans domicile, étaient soit insatisfaisantes, soit incomplètes. Certaines interprétaient ce fait comme une orientation punitive de la société, qui serait cachée « derrière » l’affichage d’assistance. Or, au vu des pratiques réellement répressives qui existent (destruction d’installations et d’objets, amendes pouvant conduire à l’emprisonnement), qualifier de répressifs les services d’urgence sociale n’éclaire pas, mais obscurcit la réalité. D’autres analyses ne faisaient que pointer un paradoxe, en menant une réflexion en termes d’irrationalité d’un système qu’il faudrait « rationaliser ». Cette façon de considérer les acteurs comme insuffisamment rationnels signale systématiquement, en sociologie, un manque d’enquête empirique. Les réponses les plus convaincantes, mais encore incomplètes, insistaient sur les problèmes posés par l’humanitaire et l’urgence, comme gestion à court terme. Ces dernières manquaient cependant de précisions dans l’enquête menée auprès des acteurs qui accomplissaient cette politique au quotidien. D’autres enfin réduisaient l’explication de ce phénomène au manque de places d’hébergements offertes par rapport aux demandes ; ce qui était trop partiel. D’une part, l’imposition de durées de séjour limitées dans les hébergements sociaux se retrouvait dans des territoires (comme la Bourgogne) où le problème du manque de places ne se posait pas comme dans les territoires où les professionnel.le.s pointent une véritable pénurie. D’autre part, et surtout, historiquement, les premiers hébergements d’urgence apparus dans la seconde moitié du 19ème siècle sous la forme d’« asiles de nuit » (comme l’a montré l’historienne Lucia Katz), suivaient déjà la règle de durée de séjour limitée (3 nuits d’affilée), sans que la question du manque de places ne soit posée. Autrement dit, historiquement, la règle de la durée limitée en hébergement d’urgence n’est pas apparue en réponse à un problème de manque de places. Une conclusion s’imposait : si le manque de places peut accentuer la mobilité dans l’assistance, il ne l’explique pas.
Il fallait donc mener une enquête sociologique, qui commence toujours par décrire ce que font les acteur.e.s et à comprendre le sens de ce qu’ils et elles font (avant de les critiquer) ; il fallait, comme on dit, aller sur le terrain. Mon travail, réalisé entre 2005 et 2015, essentiellement en région parisienne, a consisté à interroger des professionnel.le.s et observer ce qu’ils et elles faisaient au quotidien, dans différents services d’urgence sociale : le 115, des équipes mobiles (appelées parfois « maraudes »), des accueils de jour, des hébergements sociaux.