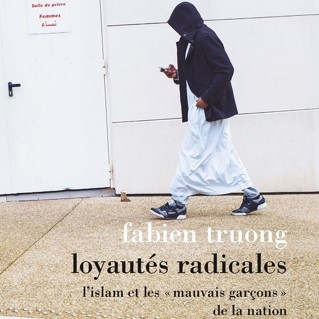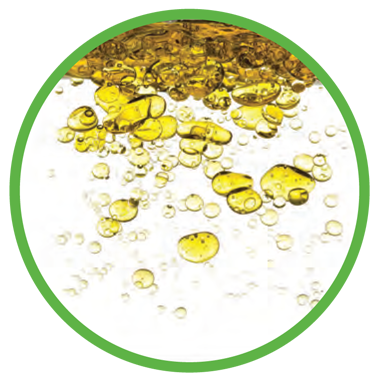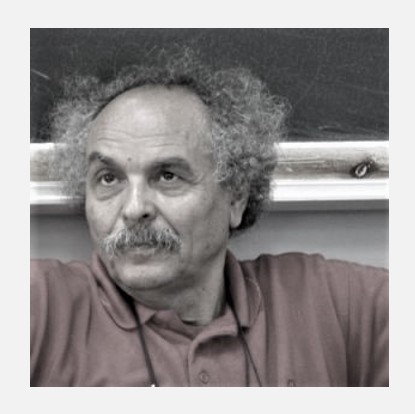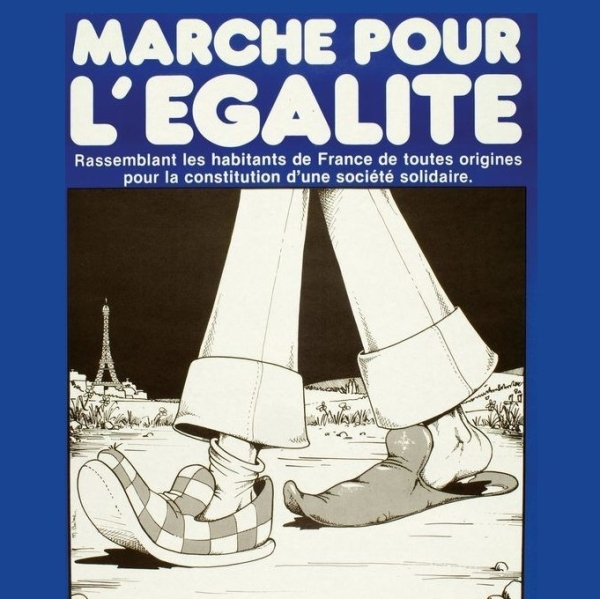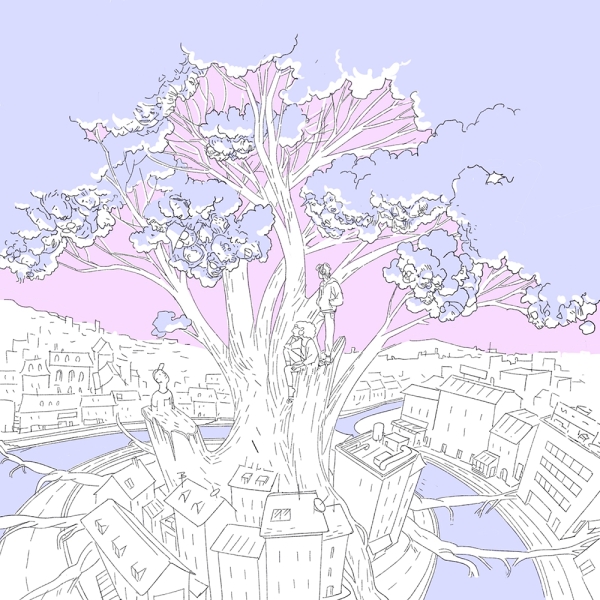D’abord parce qu’il y a une déconnexion complète entre le mot et les réalités. Le mot fonctionne sur le mode de l'imaginaire nationaliste, il nous parle des peurs fantasmatiques, parfois projetées sur des transformations sociales effectives. Pourquoi chimère ? Ce n'est pas pour moi une métaphore, mais une expression littérale. On est dans le domaine de l'imaginaire, j'ai donc cherché quelle est la figure imaginaire qui pouvait correspondre à ce que fait, ce que dit, ce que dénonce ce mot. La chimère, dans la mythologie grecque, est un animal imaginaire effrayant, un hybride : elle a une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent. Bien qu’elle n'existe pas physiquement, cette « menace » potentielle justifie pour ceux qui y croient de mettre en œuvre des systèmes de défense. On peut retrouver dans le discours du communautarisme trois figures majeures, qui structurent ce monstre hybride, et que l’on peut – métaphoriquement, cette fois – faire coïncider avec le lion, la chèvre et le serpent. Le corps serait la question de l'islam, qui constitue depuis le début l’objet central du discours ; la tête de lion pourrait figurer l'Empire américain, supposée tête pensante du libéralisme et du multiculturalisme qui menacerait la « spécificité française » ; la queue de serpent figurerait le rôle prêté à la gauche et au pouvoir socialiste depuis 1981, qui par ses contorsions et des aménagements électoralistes, voire la traîtrise héritée de son parti-pris pour le camp soviétique, ferait le jeu de celui qui a remplacé la menace communiste : l'islamisme. Cet argument grotesque a cours dans l’espace politique et médiatique, à travers l'accusation d'« islamo-gauchisme » – parfois relayée par des chercheurs !
On pourrait bien sûr discuter de la stratégie américaine (ou autre) de diffusion culturelle qui colonise le monde vécu ; des pratiques clientélistes et électoralistes qui irriguent de tous temps la vie politique ; de l’existence d’un fanatisme religieux qui aimerait imposer ses normes aux autres, etc. Ce sont d’anciennes questions. Ces divers processus sont réels, mais ils sont bien plus banals que ne le laisse croire ce discours complotiste. Et puis, quel lien entre eux ? En quoi seraient-ils liés à de quelconques communautés substantielles ? C’est là, dans ce montage délirant, que prend corps l’idée de « communautarisme ». Il ne parle pas de la réalité en elle-même, mais fait prospérer sur elle une vision fantasmatique qui reproduit au fond le discours de la race, de la menace sur « la race » - sauf qu’au terme de « races », on a substitué ceux de communautés et de nation.