Années 2000 : quand la Politique de la Ville révèle une politique d’intégration à la française

Étude
Cette étude revient sur ce qui marque les années 2000 de la politique de la ville.
Interview de Camille Peugny

Cet entretien avec Camille Peugny est réalisé dans le cadre de la thèse Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte de Benjamin Lippens.
Il se décompose en deux temps. Premièrement, il est l’occasion de revenir sur les questions des mobilités sociales et plus particulièrement sur les notions de « déclassement » et de « reproduction sociale ».
Les propos de Camille Peugny nous aident à mieux saisir les évolutions de la structure sociale lors des quarante dernières années.
Dans un second temps, le sociologue nous livre son regard sur la crise sanitaire du Covid-19, à la lumière de ses recherches autour des inégalités sociales.
Vous-vous êtes intéressé à la reproduction sociale dans vos travaux. Comment y-êtes-vous arrivé et comment a-t-elle évoluée ?
Mon entrée dans la sociologie s’est faite par le thème de la mobilité sociale, notamment dans le cadre de ma thèse [1]. J’ai voulu introduire une mesure par générations de naissance de la mobilité sociale pour deux raisons. Une raison de fond, avant d’être inscrit en thèse, je suivais un cours de Louis Chauvel à Sciences Po sur les inégalités entre générations, quelques années après son livre sur le destin des générations [2] et je me suis dit que si les inégalités entre générations étaient d’une telle ampleur, alors il devait nécessairement y avoir un phénomène de mobilité sociale descendante entre les générations. Or, la sociologie de la mobilité sociale s’est surtout intéressée aux promotions sociales. Mon souci à l’époque était de vérifier dans les statistiques si pour les générations de jeunes des années 2000 il y avait une augmentation de la mobilité sociale descendante. Je me suis aperçu que la plupart des travaux qui publiaient des données sur la mobilité sociale présentaient des tables calculées pour les 30-59 ans. Je ne trouvais pas ce très large regroupement satisfaisant, puisque qu’il revenait à ajouter des générations qui avaient connu des dynamiques économiques très différentes. Un individu âgé de 30 ans en 2000 était né dans les années 1970 et avait dû s’insérer sur le marché du travail dans les années 1990, dans un contexte de crise déjà bien avancé, alors qu’un individu âgé de 59 ans en 2000 avait connu les Trente Glorieuses. Il fallait proposer une mesure par génération des perspectives de mobilité sociale, c’est-à-dire une mesure qui soit plus fine. Ce faisant, j’ai montré que lorsque l’on compare les générations nées dans les années 1940 à celles de leurs enfants, nées dans les années 1960 et au début des années 1970, on s’aperçoit que l’on a une dégradation généralisée des perspectives de mobilité sociale : des mobilités sociales ascendantes moins fréquentes depuis le bas de la structure sociale, et une augmentation des risques de déclassement pour les enfants issus de milieux plutôt favorisés.
J’ai soutenu ma thèse en 2007, et plus les années passaient, plus je me disais qu’il était important d’actualiser les résultats. En actualisant les données, je me suis aperçu qu’à mesure que les générations du baby-boom s’éloignent dans le temps, on a surtout beaucoup de reproduction sociale. Les jeunes qui avaient 30 ans dans la décennie 2010 sont les enfants de la génération qui a eu 30 ans au début des années 1980, qui est déjà une génération qui a connu la crise.
Pour répondre plus précisément à votre question sur la reproduction sociale, je l’observe en regardant un indicateur assez simple qui est la proportion de jeunes adultes qui, 5 à 8 ans après la fin de leurs études, exercent une profession qui les classe dans la même catégorie socioprofessionnelle (CSP) que celle de leurs parents au même âge. On s’aperçoit qu’au début de la décennie 2010, on a environ 70% des enfants d’ouvriers qui exercent un emploi d’ouvrier ou d’employés (donc qui restent dans les emplois caractéristiques du salariat subalterne). À l’autre-bout de l’échelle sociale on a environ 70% des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures qui eux, quelques années après la fin de leurs études, exercent un emploi de cadre ou une profession intermédiaire. C’est ce qui m’amène à conclure dans mon ouvrage le "Destin au berceau" que la mobilité sociale en France a très peu progressé entre le début des années 1980 et les années 2010 et que la reproduction s’est maintenue à un niveau élevé. Cette conclusion invite à changer la focale avec laquelle on considère la question des inégalités entre les générations. En effet, tous les travaux qui dans les années 1990 ont souligné l’ampleur des inégalités entre générations ont souligné cette dimension à juste titre, car à cette période, les données statistiques permettent de comparer le sort des trentenaires des années 1990 avec le sort des trentenaires des années 1970, c’est-à-dire les baby-boomers qui pour certains d’entre eux ont connu une trajectoire exceptionnelle au sens statistique du terme, propulsés en quelque sorte par le contexte de forte croissance et de transformation rapide de la structure sociale qui accompagne les Trente glorieuses. Mais dès lors que cette génération s’éloigne dans le temps et que l’on cesse de comparer systématiquement le destin de toutes les générations de jeunes à ces premiers nés du baby-boom, qui aujourd’hui sont septuagénaires, on s’aperçoit qu’on a plutôt une succession de générations entre lesquelles se transmettent avec force les avantages et les désavantages sociaux. C’est l’actualisation des résultats qui m’amène à passer d’une analyse plutôt en termes de déclassement à une analyse qui insiste plutôt sur la reproduction des inégalités.
J’ai mené ce travail aussi en réaction à une certaine dérive dans l’espace du débat public, où il y a eu une utilisation des travaux de Louis Chauvel, Christian Baudelot, Roger Establet et de tous les économistes et statisticiens de l’INSEE qui, dans les années 1990, insistent à juste titre sur la question des inégalités entre générations. Dans le débat public cette question est instrumentalisée : on parle par exemple de réformes à mener ou de la nécessité de mener éternellement des politiques d’austérité pour réduire la dette que ne doivent pas avoir à rembourser les générations futures. On a même vu fleurir des pamphlets écrits par les journalistes qui mettent en accusation les baby-boomers, les soixante-huitards, taxés d’égoïstes, qui auraient vécu au-dessus de leurs moyens et feraient aujourd’hui payer la note aux jeunes générations. Cette analyse qui homogénéise artificiellement les générations ne me paraît pas satisfaisante car elle conduit à totalement invisibiliser toutes les inégalités sociales qui fracturent les générations. C’est aussi en réaction à cette instrumentalisation des travaux académiques des années 1990, dans le débat public des années 2000, que j’ai souhaité mettre l’accent sur la reproduction des inégalités.
[1] Peugny C., 2007, "La mobilité sociale descendante : l’épreuve du déclassement", thèse de doctorat, ENSAE ParisTech.
[2] Chauvel L., 1998, "Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle", Paris, Presses universitaires de France, 301 p.
Si je comprends bien, l’analyse en termes d’inégalités entre les générations serait moins pertinente aujourd'hui et laisserait plutôt place au prisme de la reproduction sociale ?
Pour être précis, il faut articuler les deux. On est dans une situation où des générations de jeunes sont moins nombreuses que les générations précédentes, dans un contexte de vieillissement de la population et où le marché du travail se précarise par les jeunes. Il faut bien sûr continuer à mesurer les inégalités entre générations. Mais cette prise en compte des inégalités intergénérationnelles doit être articulée avec l’analyse des clivages profonds qui continuent à fracturer les générations. Pour le dire autrement, il faut articuler générations et classes sociales. Cette approche n’est pas nouvelle et par exemple Jean-Claude Chamboredon, dès les années 1970, met en garde contre cette tentation qu’il y aurait à considérer que la jeunesse étudiante qui domine les représentations serait la seule jeunesse. Simplement on a peu de travaux empiriques qui essayent d’articuler les deux dimensions. Lorsque l’on s’intéresse aux politiques publiques, on peut considérer qu’elles doivent avoir un double objectif : veiller à ce qu’il n’y ait pas une fracture entre générations qui grandissent dans des sociétés vieillissantes, et par ailleurs, réduire les inégalités sociales au sein des générations.
Sur la question du déclassement, pourrait-on considérer qu’un ouvrier lui-même enfant d’ouvrier serait en situation de déclassement, au vu du déclin du groupe ouvrier, de la culture ouvrière et de sa légitimité professionnelle ?
C’est une question très importante qui souligne l’une des difficultés auxquelles doit faire face la nécessaire mesure quantitative de la mobilité sociale, notamment au cours du temps. Si l’on adopte un point de vue statique et en apparence naturel, saisi par les lunettes un peu larges du sociologue quantitativiste, on peut considérer que si un enfant d’ouvrier devient ouvrier, alors il s’agit de reproduction sociale. Mais effectivement, si l’on s’intéresse à l’évolution du poids numérique et symbolique du groupe ouvrier au sein de l’espace social et si l’on prend connaissance des travaux qui soulignent la dégradation des conditions de travail des ouvriers et l’intensification de ces conditions de travail, alors on aura envie de raisonner en termes de déclassement. Si l'on compare un enfant d’ouvrier, dont le père a travaillé dans les derniers feux des Trente glorieuses, à un moment où les délocalisations étaient moins nombreuses et lorsque la population ouvrière représentait 35% de la population active, avec des syndicats et des partis politiques qui portaient la voix des ouvriers de manière plus ferme et avec une plus grande audience, et qu'on le compare aujourd’hui avec un jeune ouvrier dans l’industrie, en intérim, au smic, et dans la menace permanente de voir son contrat non reconduit, on a très envie de raisonner en termes de déclassement. La mesure quantitative des flux de mobilité sociale est essentielle, mais elle doit être complétée par une approche ethnographique de la mobilité sociale qui saisit les conditions de travail, d’emploi et d’existence des individus et des groupes sociaux.
Votre définition du déclassement n’est pas uniquement objective mais revêt aussi un versant subjectif. Quels sont les effets du déclassement ?
La définition du déclassement sur laquelle j’ai travaillé est la définition intergénérationnelle de la mobilité sociale descendante. Ce que j’ai cherché à montrer dans ma thèse c’est que défini ainsi, le déclassement n’était pas uniquement une lubie de sociologue mais que cela avait un sens dans la vie de ces personnes. Le fait d’avoir, pour le dire brutalement, moins bien réussi dans la vie professionnelle que ses parents, d’avoir moins d’argent, c’est quelque chose qui avait du sens pour les individus, qui avait une influence sur la manière dont ils se représentaient le fonctionnement de la société. Cela ne veut pas dire qu’il y a une expérience univoque du déclassement, il y a différentes manières de vivre sa trajectoire descendante. Dans ma thèse j’en présentais deux : une première façon de le vivre sur le mode générationnel – de l’appartenance à une génération déclassée par rapport aux parents – et une autre sur le mode individuel – de l’échec personnel. Ce qui est intéressant, lorsque l’on regarde les caractéristiques des individus qui ont ces deux types de discours, c’est que l’on s’aperçoit rapidement que ce ne sont pas les mêmes trajectoires. D’un côté ceux qui vivent cela sur le mode générationnel sont certes issus de familles cadres, lorsque l’on observe avec les lunettes des CSP. Pour autant, lorsqu’on les interroge et que l’on cherche à écrire l’histoire de leur lignée, on se rend compte que leurs pères étaient bien souvent des « cadres de promotion » comme les appelait Boltanski, c’est-à-dire des individus issus des classes populaires et qui, profitant des Trente glorieuses, à force de cours du soir et de formations professionnelles, ont pu accéder à des emplois d’encadrement. Souvent ces déclassés qui vivent leur trajectoire sur le mode du destin générationnel sont des enfants qui ont fait plus d’études que leur père (devenus cadres en fin de parcours avec aucun diplôme ou un CAP/BEP) mais qui accèdent à des emplois moins stables et moins rémunérés. Ils ont donc l’impression d’une injustice de génération : « c’était plus facile pour mes parents de réussir sans diplôme ». À l’inverse, ceux qui vont vivre le déclassement comme un échec personnel sont plutôt des enfants d’ « héritiers », c’est-à-dire qu’ils sont enfants de cadres eux même enfants de cadres. Ils sont issus de familles beaucoup plus bourgeoises et ont eu des trajectoires scolaires qui leur paraissent comme étant plutôt modestes voire plutôt ratées : autant pour un enfant de « cadre de promotion », avoir un BTS est une vraie réussite scolaire, autant pour un enfant de médecin lui-même fils de notaire, avoir un BTS est presque un échec scolaire et le déclassement va sembler logique, et sera plus fréquemment vécu sur le mode de l’échec personnel.
Il est également intéressant de travailler sur la mobilité au cours du cycle de vie car c’est elle qui est encore plus signifiante. Je pense que ce qui oriente beaucoup les comportements, les façons de penser, le vote, les rapports au politique c’est aussi le sens de sa propre trajectoire. Par exemple être déclassé en cours de carrière, perdre un emploi, ne pas en retrouver à hauteur du premier emploi, connaître un accident de parcours, c’est quelque chose qui a beaucoup de sens pour les individus. Par exemple un des grands changements par rapport à il y a quarante ans, et un des effets de la polarisation de l’emploi, est que tous ces emplois de qualification intermédiaire qui disparaissent sont autant de supports de mobilités en cours de carrière qui disparaissent. Quand il y avait des emplois de qualification intermédiaire, on pouvait commencer en bas de l’échelle, puis se former et y accéder en fin de carrière, ce qui donnait le sentiment d’une ascension possible. Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus dans une économie avec en quelque sorte deux marchés du travail : celui pour les qualifiés (ou considérés comme tels) et celui pour les non-qualifiés (ou considérés comme tels). Il y a une déconnexion qui est de plus en plus forte entre l’emploi qualifié et l’emploi non-qualifié ce qui rend les trajectoires de petites mobilités plus difficiles qu’hier. Cela a beaucoup d’importance sur la manière dont les individus et les groupes peuvent se projeter dans l’avenir. Il y a en revanche beaucoup plus de mobilité horizontale et je pense par exemple aux femmes de ménages que j’interroge, qui ont été Atsem, puis ont travaillé dans les cantines, se sont occupé d’enfants en tant qu’aide à domicile, ont fait quelques mois de caissière, ont été dans la vente, etc.
Quelles sont les conséquences de la massification scolaire sur la structure sociale d’aujourd’hui ?
La massification scolaire a contribué à ce qu’Olivier Schwartz appelle « l’extraversion » des classes populaires ou l’ « acculturation » des classes populaires [1]. En 2015, parmi l’ensemble des ouvriers en France, 1/5 sont bacheliers. On a eu de manière extrêmement rapide, une élévation du niveau de diplôme de toute la population, y compris les ouvriers. En 1962, quand l’INED fait la première enquête statistique rigoureuse sur l’entrée en sixième, on s’aperçoit que 60% des enfants d’ouvriers ne rentrent pas en sixième. Cinquante ans après, le cinquième des ouvriers est bachelier.
On a eu une massification scolaire, qui est en réalité une révolution qui a contribué à transformer les attentes et aspirations des jeunes et notamment des jeunes des classes populaires qui sont souvent les premiers à fréquenter d’abord le collège, puis le lycée et, pour un certain nombre d’entre eux, l’enseignement supérieur. Cela transforme considérablement les attentes de ces jeunes – comme le travail de Stéphane Beaud l’a montré dans "80% au bac" – et provoque pour certains de la frustration et de la colère. Et en même temps, Tristan Poullaouec montre que pour les classes populaires, le diplôme est l’arme la plus efficace pour s’insérer sur le marché du travail et espérer connaitre une promotion sociale.
Ces débats sur les effets de la massification scolaire sont piégeux politiquement parce que l’on peut dire qu’il y a un problème de débouchés puisque la structure des emplois s’élève moins vite que la structure des diplômes et produit des diplômés déclassés et de la frustration, tandis que le diplôme reste « l’arme des faibles » [2]. Donc les progrès très ténus en termes de mobilité sociale pour les classes populaires depuis trente ans ont été rendus possibles par la diffusion des diplômes et par la massification scolaire. C’est tout le débat sur la valeur des diplômes : certains vont insister sur le fait qu’aujourd’hui avec le bac on ne fait plus rien, alors qu’avec le bac hier on était le roi du pétrole. Ils vont montrer que le diplôme s’est dévalorisé en valeur absolue. D’autres, vont préférer insister sur le fait que d’un point de vue relatif, la protection qu’offre le diplôme n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui. En effet, chaque niveau de diplôme protège davantage du chômage que le niveau de diplôme inférieur. Aujourd’hui l’écart entre le taux de chômage entre les diplômés de l’enseignement supérieur et les non-diplômés est de près de 40 points.
Ces débats sur les effets de l’élévation du niveau de diplôme sur les classes populaires ne sont pas nouveaux et déjà dans les années 1970, chez des auteurs aussi différents que Raymond Aron [3], Raymond Boudon [4] ou Pierre Bourdieu [5], on met en garde contre les probables désillusions futures de ces jeunes générations de diplômés qui peut-être ne trouveront pas d’occupation à la hauteur de leur qualification
[1] Schwartz O., 2011, « Peut-on parler des classes populaires ? », "La Vie des idées", p. 1‑49.
[2] Poullaouec T., 2010, "Le diplôme, arme des faibles : les familles ouvrières et l’école", Paris, Dispute (L’enjeu scolaire), 147 p.
[3] Aron R., 1969, "Les désillusions du progrès : essai sur la dialectique de la modernité", Paris, Calmann-Lévy.
[4] Boudon R., 1973, "L’inégalité des chances: la mobilité sociale dans les sociétés industrielles", Paris, Armand Colin.
[5] Bourdieu P., 1978, « Classement, déclassement, reclassement », "Actes de la recherche en sciences sociales", 24, 1, p. 2‑22.
Pour compléter la question précédente, la massification scolaire qui a concerné l’ensemble des classes sociales a-t-elle fluidifié la structure sociale ? Ou a-t-elle contribué à renforcer les inégalités entre classes sociales et/ou au sein d’une même classe sociale ?
Les éventuels progrès, très ténus, de la mobilité sociale au cours des trente dernières années ne sont absolument pas à la hauteur de la massification scolaire. La diffusion massive de l’éducation au sein de la société ne s’est pas traduite par des progrès de la mobilité sociale de la même ampleur. Il faut alors poser la distinction entre la massification d’un côté et la démocratisation de l’autre. La massification est l’élévation des taux de scolarisation au fil des âges et le fait qu’en moyenne tout le monde fait plus d’études qu’il y a trente ans. La démocratisation est le fait que les écarts en termes de scolarisation et de diplôme entre les enfants des classes populaires et les enfants des classes moyennes et supérieures se réduisent. Aujourd’hui on a un faisceau de travaux qui souligne que la massification ne s’est pas traduite par une réelle démocratisation. Pierre Merle parle de « démocratisation ségrégative » [1] par exemple. À mesure que le système éducatif s’est ouvert, il s’est filiarisé et les inégalités « quantitatives », d’accès aux différents niveaux du système éducatif, ont été remplacées par des inégalités « qualitatives », par la filiarisation du système : on a créé le baccalauréat technologique dans les années 1970, le baccalauréat professionnel en 1985, donc cela fait augmenter fortement la proportion de bacheliers au sein d’une génération. Mais on sait bien qu’en termes d’insertion professionnelle, de stabilité de l’emploi et de perspectives de mobilités futures, ce n’est pas tout à fait la même chose d’avoir un bac professionnel ou général. Les travaux qui ont été réalisés par Mathieu Ichou [2] montrent que si l’on raisonne en termes de probabilité d’avoir le bac, alors oui les inégalités ont diminué au cours des dernières décennies. En revanche si l’on tient compte de la filière du bac, on s’aperçoit que les inégalités n’ont en réalité pas disparues. On passerait d’un système d’inégalités verticales à un système d’inégalités horizontales ou d’inégalités quantitatives à des inégalités qualitatives. Simplement, en termes de mobilité sociale et d’insertion sur le marché du travail on retrouve le même type d’inégalités que lorsqu’il y avait des inégalités d’accès au système éducatif. Cette massification ne s’est pas traduite par une réelle démocratisation scolaire, ce qui explique qu’au cours des trois dernières décennies, la reproduction sociale s’est maintenue en France.
[1] Merle P., 2012, "La ségrégation scolaire", Paris, Découverte, coll. « Repères Sociologie », no 596.
[2] Ichou Mathieu, 2018, "Les enfants d’immigrés à l’école : inégalités scolaires, du primaire à l’enseignement supérieur", Paris, PUF.
Comment analyser l’évolution des inégalités sociales depuis ces trois dernières décennies ?
Il y a plusieurs clés de lectures possibles mais je ne peux y répondre qu’au travers de mes travaux. Il y a quelque chose à creuser du côté du concept de polarisation de la structure sociale. Si l’on regarde sur le moyen terme, le type d’emplois créés sont soit considérés comme très qualifiés, soit considérés comme très peu qualifiés au détriment d’emplois de qualification intermédiaire. Il me semble que le concept de polarisation est fécond [1]. Les politistes depuis le début des années 2000 parlent de « gagnants » ou de « perdants » de la mondialisation, d’« insiders » et d’ « outsiders » : lorsque l’on analyse les succès des partis populistes d’extrême droite en Europe, ceux-ci iraient chercher leurs suffrages dans le rang des vaincus de la mondialisation. Il y a beaucoup de travaux aujourd’hui qui questionnent ces formes de nouvelle polarisation de la structure sociale, dans le cadre d’une économie dans laquelle les services prendraient une importance croissante et où le monde industriel finirait de disparaître.
Il y a aussi depuis plusieurs années les analyses en termes d’intersectionnalité qui montrent à quel point il faut croiser les inégalités de genre, de race et de classe pour saisir la manière dont se structurent, s’articulent et se reproduisent les inégalités. On pourrait également ajouter la dimension territoriale. Par exemple, cela fait trois ans que je mène une enquête sur les femmes de ménage dans une grande entreprise de service à la personne ; j’ai fait une première partie de l’enquête dans une région de l’Ouest de la France et ces femmes de ménages étaient plutôt des femmes blanches, quinquagénaires, « autochtones », et une deuxième partie de l’enquête en région parisienne, auprès de femmes plus jeunes, étrangères ou immigrées. Il y a une dimension spatiale à cette stratification sociale. S’ajoutent également une dimension migratoire puisque d’un côté, ces femmes blanches, quinquagénaire, de l’ouest deviennent souvent femmes de ménage à la suite d’un accident de la vie. Leur situation professionnelle est le signe d’une déstabilisation assez forte. A l’inverse en Île de France, certaines femmes de ménage de la même entreprise, qui sont par exemple roumaines ou moldaves, vivent le fait d’arriver en France et de décrocher un contrat de travail comme une forme de stabilisation. Quelques-unes sont auparavant passées par l’Italie, ou ont été employées « au noir » dans des conditions proches de l’esclavage. Finalement arriver en France, être logé dans un hôtel meublé avec ses enfants et obtenir un contrat de travail à durée indéterminée dans cette entreprise de ménage est une stabilisation et une pause indéniable dans leur trajectoire. Le même emploi, dans la même entreprise résonne différemment selon les parcours, de chute ou de déstabilisation d’un côté et au contraire de promotion et de stabilisation de l’autre.
Il y a enfin des débats qui permettent de penser les classes sociales et d’en renouveler l’approche. Les débats autour du « care » ressurgissent en cette période de Covid où l’on s’est rendu compte que les métiers indispensables sont bien souvent des métiers du « care », avec notamment les soignants. Et si l’on regarde le budget des cadres et classes supérieures on observe une part croissante consacrée à l’embauche d’autres particuliers pour s’occuper des enfants, du ménage, etc. Cela participe de cette vision en termes de « care », le fait que des particuliers achètent le temps de travail d’autres particuliers précaires. Si l’on ajoute cela à la nécessité comme je le disais précédemment, d’articuler inégalités intra et intergénérationnelles, on a quelques pistes pour continuer à penser la question des inégalités.
[1] Peugny C., 2018, « L’évolution de la structure sociale dans 15 pays européens (1993-2013) : quelle polarisation de l’emploi ? », Sociologie, vol.9, n°4, p. 319-416.
Quel regard portez-vous sur les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 ?
Pour répondre simplement, je trouve que nous vivions dans une société devenue totalement indifférente aux inégalités et la crise du Covid a obligé certains à voir les inégalités. On peut citer plusieurs exemples :
La question des inégalités de conditions de travail et des risques professionnels était visible avant la crise pour quiconque souhaitait regarder les statistiques du ministère du travail. En décembre-janvier, quand il s’agissait de débattre de la réforme des retraites, parler de la pénibilité du travail était presque un « gros mot ». Quatre mois après, lorsque nous sommes tous confinés, on s’aperçoit que pendant que les cadres sont en télétravail, les caissières, les infirmières, les éboueurs, les livreurs, et d’autres sont dehors, exposés concrètement au virus. Je caricature un peu, mais l’on voit bien le hiatus entre la hiérarchie des revenus et du prestige d’un côté et la hiérarchie de l’utilité sociale de l’autre. Si l’on enlève les soignants et médecins, c’est la France du Smic qui est dehors, et d’une certaine manière c’est en partie la France des ronds-points des gilets jaunes.
On observe aussi des inégalités scolaires avec cette « vrai-fausse » reprise sur la base du volontariat où on s’aperçoit ville par ville que c’est essentiellement les familles favorisées qui ont remis leurs enfants à l’école et que ceux qui décrochent sont les plus éloignés de l’école. Dans le champ scolaire, les inégalités sont massives entre les enfants et entre les familles.
La crise sanitaire a rendu visible des inégalités que l’on préfère ne pas voir le reste du temps, et pendant un cours moment on a été une société qui a dû sortir de ses accommodements avec les inégalités. Je trouve qu’on est quand même dans une société qui s’accommode assez facilement des inégalités : les réduire n’est même plus un projet politique aujourd’hui.
On peut également ajouter la question des inégalités territoriales, mise en évidence par les inégalités de traitements policiers dans les quartiers populaires, et des inégalités face au logement.
Oui tout à fait !
Pour vous laisser conclure de manière ouverte, quels enseignements peut-on tirer de cette situation sur les plans politiques et économiques ?
C’est une question très compliquée ! Pour ne pas sortir de mes thèmes de recherche, la leçon à retenir est ce hiatus grandissant et devenu inacceptable entre la hiérarchie du prestige et des revenus et de l’autre la hiérarchie de l’utilité sociale. On voit bien dans cette situation à quels points tous les discours que l’on nous tient depuis quatre décennies sur les premiers de cordées, sur « ceux qui ont réussi » et « ceux qui ne sont rien », reposent sur du vide et sur du sable idéologique. Quand une société est réduite à ses fonctions minimales, de protéger, soigner et nourrir on s’aperçoit qu’elle repose sur tous ces métiers de l’ombre, que l’on préfère en temps normal garder dans l’ombre, et que ce sont eux « les premiers de cordées » qui font fonctionner la société. Je ne sais pas du tout ce que va devenir ce moment. J’ai bien peur qu’il ne devienne pas grand-chose. Qu’est-ce qui va suivre ce moment où éclate la discordance absurde entre la hiérarchie des revenus et la hiérarchie de l’utilité sociale ? Attention, il ne faut pas trop caricaturer, ni être trop manichéen et penser que tous les métiers bien payés sont inutiles. Ce n’est absolument pas ce que je veux dire, mais ce qui est apparu c’est une discordance qui éclatait dans toute son absurdité. Si l’on n’essaye pas de la résorber, je veux dire autrement que par des médailles en chocolat et de grands discours lyriques, cette fracture va continuer à produire des dommages irréversibles en termes de cohésion sociale.
En restant sur ce volet politique, quelles peuvent être les solutions pour reconnaître et endiguer les inégalités sociales ?
Si l’on veut réduire ce décalage entre les revenus et l’utilité sociale, dans le secteur public cela passe par des choix de politiques de dépense publique. Par exemple si l’on veut mieux rémunérer les aides-soignantes cela nécessite simplement d’augmenter les budgets des hôpitaux. On peut considérer que l’État a la main sur ce point.
En revanche si l’on veut améliorer les conditions de travail dans le privé, par exemple des caissières d’une grande entreprise ou pour améliorer les conditions de travail des aides à domicile, employées par telle ou telle entreprise de service à la personne, cela nécessite de poser des questions douloureuses comme la répartition des richesses et l’équilibre entre capital et travail. Ce sont aussi des questions d’organisation et de construction d’un secteur d’activité. On peut tout à fait se battre concrètement pour que dans le secteur des services à la personne on reconnaisse un certain nombre de qualifications, qu’il y ait des conventions collectives qui ne soient pas au ras du code du travail, qu’il y ait des possibilités de formation et de progression en cours de carrière. Ainsi, ce sont des choses qui s’organisent à la fois au niveau des secteurs d’activité, et qui nécessitent également un changement de modèle économique. Si on rémunère 300 euros par mois de plus une caissière, ce sont 300 euros qui ne vont pas dans la rémunération du capital. Ces problématiques nous mènent à la nécessité de penser un nouveau modèle économique.
Camille Peugny est sociologue à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du laboratoire Printemps et corédacteur en chef de la revue Travail et Emploi. Ses recherches s’articulent autour des thématiques de la stratification et des inégalités sociales, du travail, des classes sociales, et abordent également les questions des jeunesses et des générations. Après la publication d’un premier ouvrage sur le "Déclassement" (2009, Paris, Grasset), issu de sa thèse de doctorat, il s’est intéressé à la reproduction sociale dans "Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale" (2013, Paris, Seuil).

Étude
Cette étude revient sur ce qui marque les années 2000 de la politique de la ville.

Interview de Corinne Lachkar
Costumière
Corinne Lachkar présente dans cet entretien son travail auprès de nombreux publics amateurs en insistant sur l'importance de l'utilisation des matériaux de récupération.
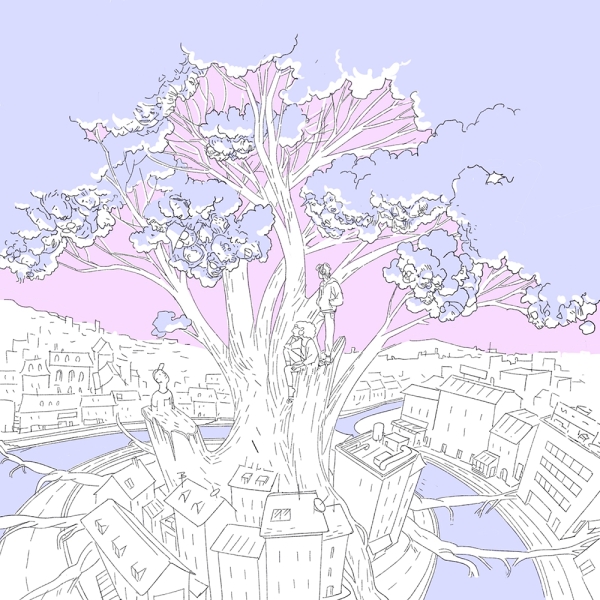
Article
Négocier et construire ses appartenances c’est faire une série de choix qui influent sur notre point de vue sur le monde et la position où l’on nous situe dans la société. Ces processus complexes sont au cœur des apports des sciences humaines et sociales.

Dossier
À travers les différentes ressources que nous vous proposons, nous explorons ces processus sociaux en tension, afin de nourrir un débat public particulièrement sensible lorsqu’il est question d’identité(s).

Article
Le croisement des cultures émergentes à Lyon devient-il un symbole du territoire ?

Article
De quelle façon les mèmes se sont-ils inscrits dans une forme d’identification à un territoire ?

Interview de Jean-Christophe Vincent
Président du club de football de La Duchère
Dans cet entretien, Jean-Christophe Vincent nous propose sa lecture du projet d’un club qui a choisi de jouer collectif sur le terrain de la citoyenneté.

Article
La smart city, concept apparu dans le sillage des nouvelles technologies numériques et de l’information, est-elle inclusive ?

Article
Nous sommes passés de l’intégration à l’insertion avec l’exclusion en arrière-fonds, mais la vulnérabilité, la cohésion et l’inclusion sont venus renouveler les termes du débat.