Veille M3 / [Infographie] Du moustique au papillon, vainqueurs et perdants de l’Anthropocène
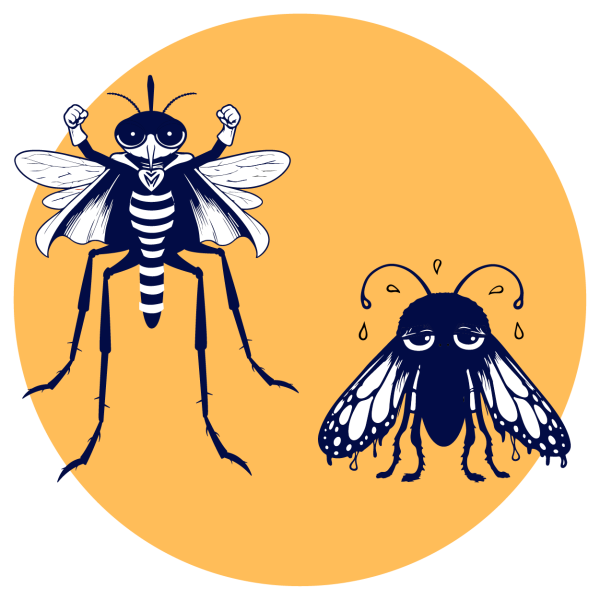
Article
Comment l’Anthropocène favorise certains êtres vivants, tout en précipitant la disparition d’autres ?
Interview de José Halloy

Nourrir la planète sans épuiser ses ressources : l’équation semble de plus en plus complexe à résoudre.
Face au réchauffement climatique, à la mondialisation des échanges et à la fragilité croissante d’économies spécialisées, les systèmes agricoles actuels montrent leurs limites.
Pénuries, crises sanitaires, dépendances accrues… Les signaux d’alerte se multiplient.
Spécialiste reconnu des enjeux de soutenabilité agroalimentaire, José Halloy est physicien, chercheur au sein du Laboratoire interdisciplinaire des Énergies de demain (CNRS) et professeur de l’Université Paris Cité, est.
Dans cet entretien, il nous interpelle sur les transformations à conduire en matière de production alimentaire, à l’échelle d’un monde de plus en plus instable, encore prisonnier de certains modèles pourtant déjà dépassés.
Dans votre article de 2022 intitulé « Power law scaling and country-level centralization of global agricultural production and trade » (écrit avec Marie-Cécile Dupas et Petros Chatzimpiros, dans Environmental Research Letters), vous montrez que la production agricole mondiale se centralise autour d’un petit nombre de pays. Cette concentration constitue-t-elle selon vous une vulnérabilité structurelle face aux aléas climatiques et géopolitiques ?
Dans notre article de 2022, nous montrons que la production et le commerce agricoles mondiaux sont fortement concentrés dans un petit nombre de pays (occidentaux). Un noyau réduit de grands exportateurs nets et quelques hubs de réexportation soutiennent un nombre croissant de pays importateurs, en particulier pour des produits stratégiques, comme les céréales et les oléagineux.
Dans ce contexte, je considère que cette concentration constitue bien une vulnérabilité structurelle aux chocs climatiques comme aux chocs géopolitiques et de marché. En ce qui concerne le climat, certains pays, qui contribuent de manière significative à la production et aux exportations mondiales, sont considérés comme des « nœuds » clés. Lorsque ces pays sont touchés par des événements extrêmes, tels que des sécheresses régionales, des vagues de chaleur ou des invasions de ravageurs, ces événements ont un impact immédiat sur les prix et la disponibilité physique dans le monde entier.
Sur le plan géopolitique, des interdictions d’exportation, des conflits, des sanctions, des blocages portuaires ou des épisodes de spéculation financière partant d’un petit nombre de grandes puissances agricoles ou de hubs commerciaux peuvent se répercuter en chaîne sur de nombreux pays dépendants des importations, surtout en l’absence de réserves publiques ou de protection sociale robustes.
Vu comme un système technique, cela illustre le régime alimentaire de l’Anthropocène : des flux massifs de biomasse et de nutriments, sur de longues distances, découplant la consommation des écosystèmes locaux et dépendant fortement des combustibles fossiles. Ces flux reposent sur des infrastructures concentrées (ports, usines d’engrais, plateformes financières) elles-mêmes localisées dans quelques territoires politiquement et stratégiquement centraux et occidentaux. Ils contribuent au dépassement de plusieurs « frontières planétaires » (climat, biodiversité, azote et phosphore, usage des terres), ce qui renforce en retour les risques climatiques qui menacent la production. Dans mes travaux, je qualifie de configurations de « technologies zombies » ces architectures très centralisées, fortement géopolitiques, parce que planétaires, dépendantes des combustibles fossiles et fragiles.
Elles assurent des débits élevés à court et moyen termes, mais au prix de la dépendance à des stocks énergétiques et minéraux et de lourds dommages externalisés. À l’inverse, des configurations technologiques vivantes, plus diversifiées, ancrées dans les milieux régionaux, qui fonctionnent avec les flux renouvelables, les cycles écologiques et une certaine redondance, sont peut-être moins spectaculaires en volume, mais plus robustes sur le long terme. Pour les politiques publiques et la gouvernance internationale, il ne s’agit donc plus seulement de gérer des chocs isolés, mais bien l’architecture géopolitique et matérielle du système technique agroalimentaire mondial, si l’on veut le dézombifier et le rapprocher de technologies véritablement vivantes et soutenables.
Votre travail souligne les effets de la spécialisation extrême des régions du monde et les interdépendances complexes qui en découlent. Peut-on dire que cette spécialisation maximise la performance à court terme, mais rend les systèmes agricoles écologiquement et politiquement ingouvernables à long terme ?
Partant du constat de forte concentration exposé dans la question précédente, je peux regarder la spécialisation non plus seulement comme une photographie du système, mais comme une dynamique : un choix collectif de performance à court terme qui reconfigure en profondeur ce qui reste gouvernable à long terme.
À court terme, la spécialisation joue clairement en faveur de la performance. En concentrant certaines productions dans des régions où les rendements apparents sont élevés, les coûts fonciers relativement bas et les infrastructures logistiques déjà amorties, elle permet de baisser les coûts moyens, de sécuriser des volumes importants et de lisser les aléas locaux par le recours au marché mondial. Du point de vue d’un importateur, il semble rationnel de s’appuyer sur quelques grands bassins pour réduire ses propres risques climatiques ou politiques et d’externaliser ainsi les incertitudes vers des « fermes du monde » et des acteurs privés capables d’absorber les chocs, au moins, tant que l’énergie fossile et le capital restent abondants.
Mais cette performance repose sur un empilement de fragilités. Écologiquement, la spécialisation homogénéise les paysages, simplifie les systèmes de culture et accroît la dépendance aux intrants fossiles et minéraux. Elle concentre les pressions sur l’eau, les sols, les cycles de nutriments et la biodiversité dans des territoires déjà au cœur du régime alimentaire de l’Anthropocène. Systématiquement, elle réduit la diversité des réponses possibles : les mêmes variétés, les mêmes intrants, les mêmes calendriers culturaux sont reproduits sur de très grandes surfaces.
Les amortisseurs locaux (stocks publics, polyculture-élevage, circuits de proximité) sont démantelés ou marginalisés, tandis que les signaux de crise (épisodes de sécheresse, problèmes d’engrais, tensions énergétiques) se propagent plus vite et plus loin. Politiquement enfin, la spécialisation concentre la capacité de produire et de transformer dans un ensemble limité de filières et de territoires, ce qui diminue l’espace de manœuvre des autres États, captifs d’architectures techniques et contractuelles qu’ils ne contrôlent pas.
Dans mon langage, cette trajectoire correspond à une zombéité croissante : un système maintenu en mouvement par de puissants flux d’énergie et de capital, mais de plus en plus dépendant de stocks non renouvelables et d’infrastructures lourdes, difficiles à réorienter et dont les dégâts écologiques et sociaux restent externalisés. À l’inverse, des configurations agricoles plus diversifiées, régionales, fondées sur les flux renouvelables et une certaine redondance relèvent de technologies vivantes : elles offrent moins de gains spectaculaires de productivité à court terme, mais laissent aux sociétés une capacité de pilotage, d’apprentissage et de réversibilité.
Peut-on dire que le système devient ingouvernable ? Je pense que la spécialisation, telle qu’elle se déploie aujourd’hui, tend à réduire la gouvernabilité, en enfermant les décisions publiques dans la gestion de crises à répétition plutôt que dans une véritable capacité de choix. Il est toutefois possible d’infléchir cette trajectoire : en réintroduisant de la diversité et de la redondance dans les systèmes de production et d’échange, en soutenant des agricultures vivantes ancrées dans les milieux, en redéfinissant les règles commerciales pour limiter les dépendances extrêmes et rendre visibles les vulnérabilités qu’elles génèrent. La question n’est donc pas seulement de mesurer le gain de performance, mais de décider jusqu’où nous acceptons que cette performance se paie en perte de gouvernabilité écologique et politique.
Vos travaux mobilisent la physique des réseaux pour analyser le commerce agricole mondial. Que nous apprennent ces modèles sur la propagation des crises ? Un choc climatique local, ou un choc énergétique, peut-il encore rester « local » dans un système aussi interconnecté ?
Comme je l’ai indiqué plus haut, la centralisation de la production et du commerce donne déjà un premier diagnostic de vulnérabilité structurelle. La physique des réseaux permet d’aller un cran plus loin, elle montre comment cette architecture favorise des chocs en cascade. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de savoir « qui produit quoi », mais de comprendre comment les perturbations circulent le long des routes commerciales et financières qui relient ces producteurs au reste du monde.
Vu comme un réseau, le commerce agricole mondial ressemble à une carte avec quelques grands carrefours très fréquentés et une multitude de routes secondaires. Dans nos travaux, nous montrons que la majorité des flux partent d’un petit nombre de nœuds centraux et transite aussi par des hubs de réexportation. Lorsqu’un choc climatique ou énergétique frappe l’un de ces carrefours (une sécheresse dans un grand bassin exportateur, une crise énergétique qui renchérit brutalement les engrais dans un pays clé), ce n’est pas seulement le pays affecté qui souffre : toutes les routes qui en partent sont simultanément perturbées. Si, en plus, ce pays est un fournisseur pour d’autres hubs de transformation ou de réexport, le choc se propage par étapes, affectant des régions qui ne commercent pas directement avec la zone initialement touchée.
Il faut distinguer ici deux dynamiques de propagation. La première concerne les volumes physiques : des récoltes plus faibles, des capacités logistiques réduites, des exportations suspendues. La seconde, tout aussi déterminante, concerne les prix, les anticipations et les contraintes financières. Dans un réseau très centralisé, une mauvaise récolte ou une tension énergétique localisée peut faire grimper rapidement les prix mondiaux via les marchés à terme, déclencher des comportements de stockage défensif, des interdictions d’exportation préventives, et amplifier ainsi l’impact initial. Ce sont des dynamiques non linéaires : en deçà d’un certain seuil, le système encaisse, au-delà, les réactions en chaîne (décisions politiques, paniques de marché, effets de levier financiers) font que le choc ne reste plus « local », même s’il l’est encore du point de vue purement climatique.
Pour autant, tout choc n’est pas condamné à devenir global. La physique des réseaux montre aussi qu’un système plus maillé, avec plusieurs routes de contournement et une certaine redondance des fournisseurs, amortit mieux les perturbations. Des stocks publics, des accords régionaux de solidarité, des circuits plus courts ancrés dans les milieux locaux peuvent limiter la contagion : ils offrent des alternatives temporaires, ralentissent la transmission du choc et laissent du temps aux politiques publiques pour réagir.
À l’inverse, quand la sécurité alimentaire d’un grand nombre de pays dépend d’un petit nombre de hubs et que ces pays n’ont ni réserves, ni filet social robuste, ni diversification géographique, un choc climatique ou énergétique a toutes les chances de se transformer en crise systémique.
Du point de vue de la gouvernance, cela signifie que la sécurité alimentaire doit être pensée comme la gestion active d’un réseau interconnecté, et pas seulement comme une question de volumes produits ou de prix moyens. Réduire la zombéité du système, c’est aussi travailler sur son architecture comme limiter certaines dépendances extrêmes, favoriser la diversification des sources d’approvisionnement, reconstruire des buffers régionaux, encadrer les interdictions d’exportation et, plus largement, soutenir des configurations agricoles vivantes, ancrées dans les territoires et capables d’absorber des chocs sans les répercuter immédiatement à l’échelle planétaire.
Dans un monde de plus en plus exposé à la simultanéité des chocs climatiques, énergétiques et financiers, la question n’est plus de savoir si un choc peut rester parfaitement local, mais de savoir jusqu’où nous voulons laisser les cascades aller, et quelles mailles de sécurité nous décidons, collectivement, de tisser.
Pourquoi considérez-vous que le secteur agricole est le poste avancé d’une bataille à venir ? Est-ce une bataille pour la souveraineté alimentaire, pour la résilience biophysique, ou pour la capacité politique à gouverner des systèmes instables ? Et qu’est-ce que cela dit, plus largement, de notre rapport aux aléas ?
Je parle de « bataille à venir » parce que l’agriculture est, depuis le Néolithique, le premier domaine où l’humanité a inventé un système de technologie vivante : organiser, par la technique de la domestication, la reproduction et la régénération des êtres vivants pour nourrir des sociétés humaines. C’est sur cette matrice que se sont greffées, au fil des siècles, des couches de technologies zombies, mécanisation fossile, engrais azotés, pesticides, chaînes logistiques centralisées. Aujourd’hui, le système agroalimentaire mondialisé dépend surtout de ces couches zombies, et c’est là que se joue la bataille.
J’appelle technologies zombies des dispositifs qui, selon cinq critères biophysiques, maximisent la performance à court terme, mais dégradent la capacité à durer dans un milieu instable. 1) Ils reposent sur une forte dépendance à des stocks d’énergie, principalement fossiles, mais aussi sous forme d’agrocarburants intensifs, pour produire, transformer, stocker et transporter. 2) Ils mobilisent aussi des stocks de matériaux, engrais minéraux, métaux critiques pour les machines, le froid, les infrastructures logistiques. 3) Ils exigent des densités de puissance très supérieures à la « bande vivante » de la photosynthèse, donc des infrastructures lourdes et peu adaptables. 4) Ils perturbent profondément les cycles du carbone, de l’azote, du phosphore, de l’eau et la biodiversité, sapant les bases de la production future. 5) Et ils produisent des objets et infrastructures peu réparables, faiblement recyclables, qui s’accumulent en déchets : zombéité de sénescence et de recyclage.
Ces cinq dimensions, 1) énergie, 2) matériaux, 3) densité de puissance, 4) cycles, 5) recyclage, définissent les technologies zombies, par contraste avec des technologies vivantes alignées sur les flux, et montrent comment les premières dégradent la fitness (NDLR : valeur selective) à long terme, malgré une stabilité apparente.
Le système agroalimentaire global actuel score très haut sur ces cinq critères. Il est performant : rendements élevés, volumes massifs, prix bas apparents. Il présente même une robustesse à des perturbations : un choc local est absorbé par la circulation mondiale des produits. Mais cette performance et cette robustesse sont obtenues au prix d’une fitness très faible : dans un Anthropocène marqué par des chocs climatiques, énergétiques et géopolitiques plus fréquents, le profil de zombéité révèle une vulnérabilité structurelle.
À l’inverse, les technologies vivantes agricoles (agroécologie, diversification des cultures, polyculture-élevage, sobriété en intrants fossiles, relocalisation partielle des filières) visent à réduire la zombéité sur chacun de ces critères : moins de dépendance à des stocks non renouvelables, densités de puissance plus compatibles avec les flux solaires et biologiques, moindre perturbation des cycles, matériaux et systèmes plus réparables et recyclables. Elles ne maximisent pas toujours la performance immédiate, mais elles améliorent la fitness du système : sa capacité à exister durablement dans un milieu instable, en conservant une robustesse suffisante.
L’agriculture est un poste avancé parce qu’elle se situe à l’interface directe entre biosphère et Technosphère : sols, eau, climat, énergie, logistique, finance, géopolitique se rencontrent dans chaque récolte. La centralisation des flux de commerce agricole fait que la souveraineté alimentaire de nombreux pays dépend de quelques grands exportateurs et hubs de réexportation. La bataille est donc une bataille de souveraineté : qui contrôle, à terme, l’accès aux calories de base, quelques États et grandes firmes au cœur du réseau, ou des configurations plus distribuées, plus redondantes, mieux ancrées dans les milieux locaux ?
C’est aussi une bataille sur notre capacité politique à gouverner des systèmes complexes techniques. Qui définit les règles du commerce, des normes sanitaires, des infrastructures portuaires et logistiques, des mécanismes d’assurance et de stockage ? Aujourd’hui, beaucoup de ces dispositifs verrouillent une architecture zombie : centralisée, « puissancevore », matériellement lourde. La question pour les États et les organisations internationales est de savoir s’ils veulent continuer à gérer des crises en chaîne, ou accepter de reconfigurer ces règles à partir des contraintes biophysiques que résume le cadre des critères de zombéité.
Enfin, cette bataille révèle notre rapport aux aléas. Nous avons construit un système qui les masque au consommateur (prix bas, étals pleins, flux tendus), tout en concentrant les risques dans quelques nœuds zombifiés invisibles. La vraie alternative n’est pas entre sécurité totale et chaos, mais entre deux manières de vivre avec l’incertitude : prolonger des technologies zombies qui déplacent les aléas vers les plus vulnérables et vers le long terme, ou accepter une plus grande visibilité des variations, une diversité des milieux et des techniques, et une sobriété en puissance qui augmente la fitness globale.
Ce que nous déciderons de transformer dans l’agriculture, en assumant qu’elle doit redevenir une technologie vivante, et non rester surcodée par des couches zombies, conditionnera la manière dont nous aborderons ensuite l’énergie, les transports, les métaux et le numérique. C’est pour cela que j’y vois le premier terrain de bataille contre les technologies zombies et le premier terrain d’apprentissage des technologies vivantes.
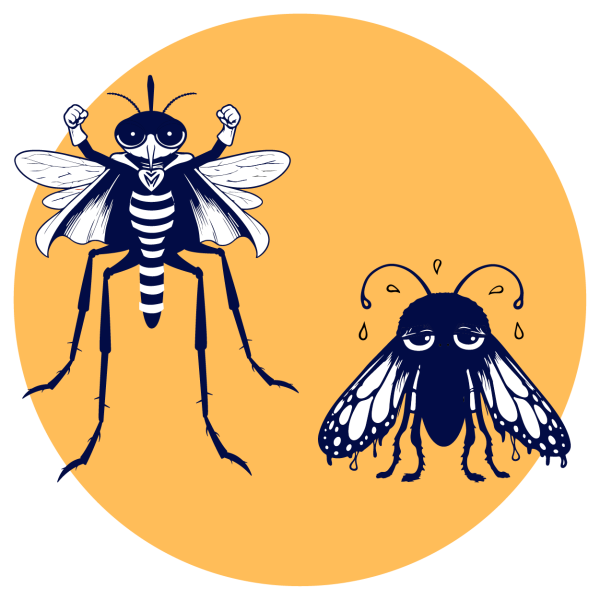
Article
Comment l’Anthropocène favorise certains êtres vivants, tout en précipitant la disparition d’autres ?

Étude
La forêt, une réalité contrastée entre les attentes d’une société une source d’énergie et de matériaux biosourcés, mais également un levier pour lutter contre le changement climatique.

Interview de Jonathan Lenoir
Chercheur au CNRS, écologue au sein du laboratoire Écologie et dynamique des systèmes anthropisés (EDYSAN), Université de Picardie
Dépérissement des arbres, incendies dévastateurs, perte de biodiversité… Ces véritables poumons verts de notre territoire subissent de plein fouet le réchauffement climatique.

Étude
Qu’en est-il des impacts environnementaux sur la biodiversité et les ressources naturelles ?

Dossier
La voiture électrique est-elle vraiment plus vertueuse pour le climat ? Est-elle réservée aux plus riches ? Que faire des batteries en fin de vie ?

Article
À l'ère des polycrises, l'urgence est de repenser le développement économique des métropoles
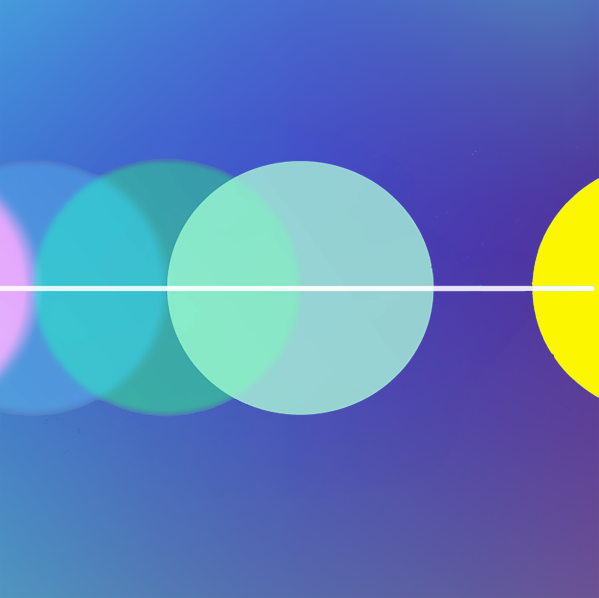
Dossier
Ce dossier donne de premières clefs pour interroger de manière lucide les leviers de transformation de nos entreprises et de leurs modèles.

Article
La pollution de l'eau pourrait coûter très cher à la société.

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?