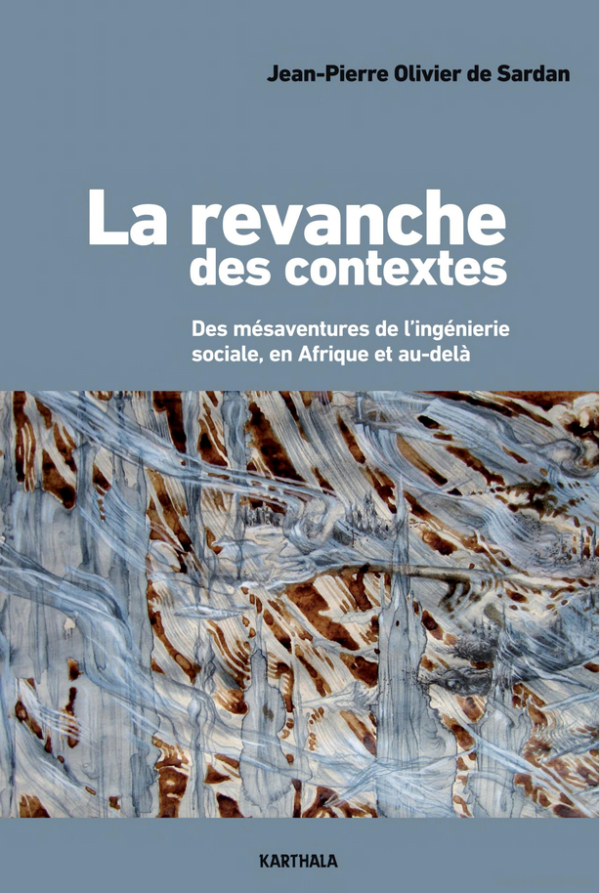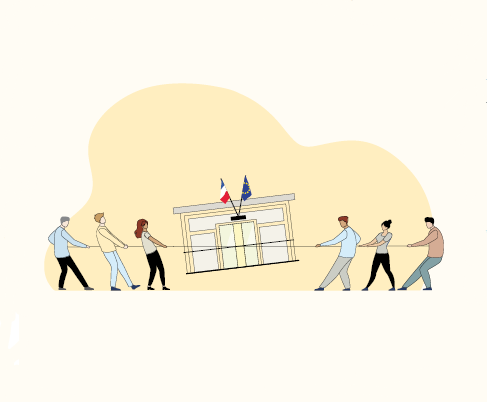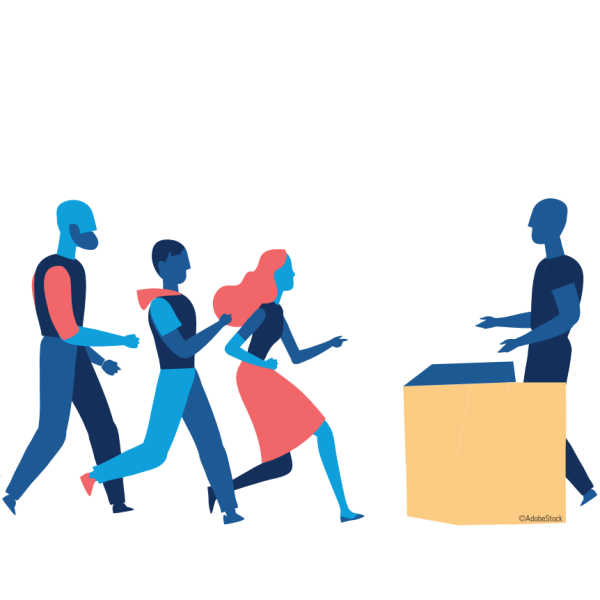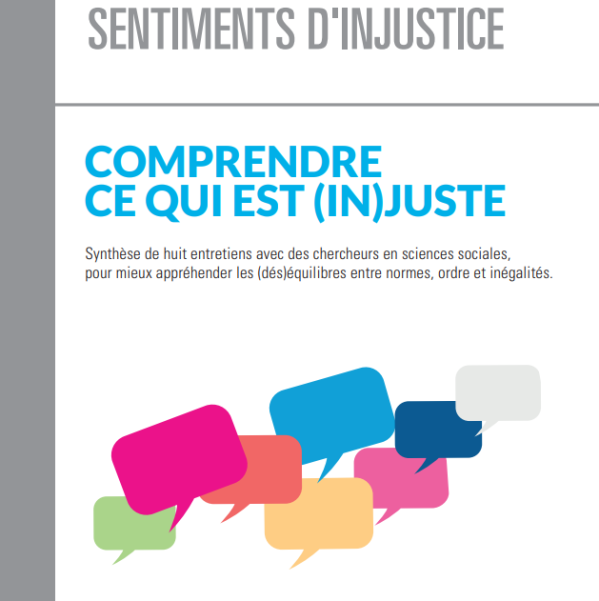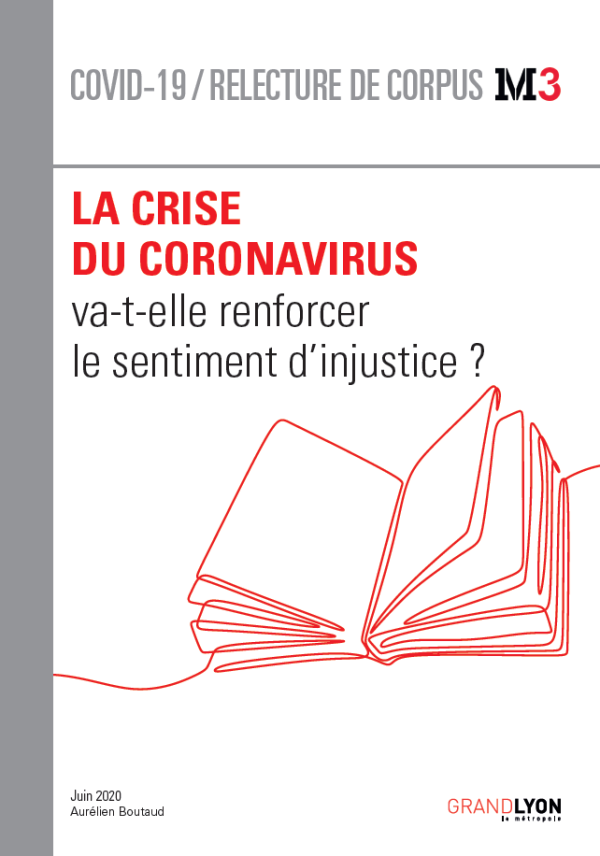Au lendemain des révolutions démocratiques affirmant que « les Hommes naissent libres et égaux », s’est posée la question du scandale des inégalités sociales. Deux grandes conceptions de la justice sociale ont émergé. La première, dominante dans les sociétés européennes industrielles et se percevant comme nationalement homogènes, est celle de l’égalité des places. Comme les travailleurs sont exploités, la société doit leur rendre ce qui leur été « volé ». La justice consiste à réduire les inégalités entre les positions sociales, entre les riches et les pauvres, grâce à l’impôt progressif, aux droits sociaux, à la redistribution sociale, à l’État providence, aux services publics… Entre les années 1900 et les années 1980, cette conception de la justice défendue par les syndicats et les gauches a sensiblement réduit les inégalités sociales.
La seconde conception de la justice s’est plutôt développée aux États-Unis. C’est l’égalité des chances qui affirme que tous les individus ont le droit de faire valoir leur mérite et d’accéder à toutes les positions sociales aussi inégales soient-elles. L’égalité des chances méritocratique vise à construire des inégalités justes, reposant sur le mérite plus que sur les héritages sociaux. Ce modèle, qui n’est pas moins exigeant que le précédent, lutte contre les discriminations qui affectent l’égalité des chances plutôt que contre l’exploitation.
Bien sûr, les deux conceptions de la justice ont cohabité, mais on voit bien que, depuis une trentaine d’années, en Europe et en France, l’égalité des chances se substitue à l’égalité des places. La justice sociale vise moins à réduire les écarts qu’elle ne veut promouvoir une compétition équitable pour accéder aux diverses positions sociales. Le langage des discriminations s’est élargi et bien des inégalités de positions sont perçues comme des discriminations. Ce processus tient à la multiplication et à l’individualisation des inégalités, à la multiplication des identités culturelles et des minorités.
Il faut bien comprendre que ces deux conceptions de la justice sont parfaitement légitimes, mais qu’elles ne conduisent pas vers les mêmes politiques. Le risque de l’égalité des chances est de multiplier les cibles des politiques et d’accroître ainsi la concurrence des victimes. Il est aussi d’être particulièrement cruel à l’égard des vaincus de la compétition méritocratique car si l’égalité des chances peut fonder l’orgueil des vainqueurs, elle peut aussi légitimer l’humiliation des vaincus, de ceux qui n’auraient pas su saisir leurs chances.